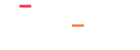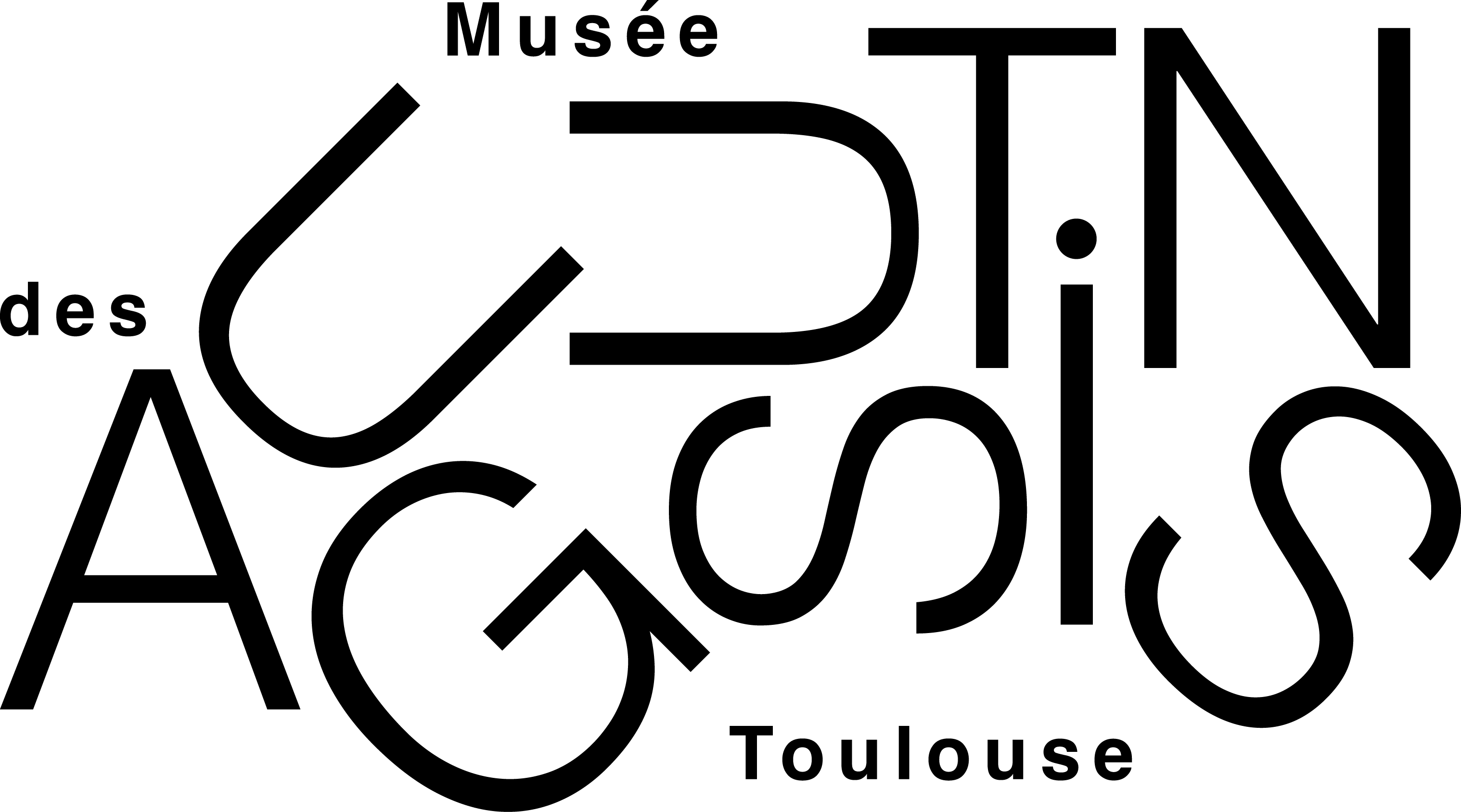Podcast « Objectif BAC ! »
Ce podcast offre aux futurs bacheliers un outil de révision et aux curieux une immersion dans les œuvres du musée des Augustins
« Histoire des arts, Objectif Bac ! » est une série en six épisodes proposée par le musée des Augustins portant sur le programme de la spécialité « Histoire des arts » du baccalauréat (session 2024).
Cette production audio met en lumière les œuvres remarquables des collections du musée des Augustins et s’adresse autant aux lycéens qu’aux curieux, invités à prêter une oreille attentive. Toutes les œuvres citées pourront être retrouvées dans la base de données du musée.
Objets et enjeux de l’histoire des arts : Femmes, féminité, féminisme.
Thème récurrent dans l’art, son image est partout. La figure féminine endosse une multitude de statuts au service des œuvres : muse, allégorie, elle est souvent une représentation fantasmée, érotisée, idéalisée.
Modèles aux multiples fonctions sociales, elles sont tour à tour l’incarnation de la sensualité ou de la maternité, du vice ou de la vertu. Une image qui n’a pas de demi-mesure
De la vierge Marie aux saintes, en passant par les très jeunes filles façon « oies blanches » du 19e siècle, aux déesses grecques virginales : comment l’art occidental a été le relai de cet idéal, à la fois comme support moral et reflet de fantasmes masculins ?
Quelles sont les différentes images de la femme ?
Partie 1/2
FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME : ÉPISODE 1/2
[Musique]
[Voix masculine ]
Les podcasts du musée des Augustins
[Musique]
[Marthe Pierot]
Histoire des arts, objectif BAC !
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Bonjour à tous et à toutes.
[Marthe Pierot]
Bonjour.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Nous sommes Isabelle et Marthe, les conférencières du Musée des Augustins.
[Marthe Pierot]
Oui et dans ce deuxième podcast de la série nous allons vous présenter le sujet “Femme, féminité et féminisme, objet et enjeux de l’histoire des arts”.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà nous allons nous demander quels sont les liens qui existent entre l’art et les femmes ? Quel rôle les femmes ont joué au fil des siècles ?
[Marthe Pierot]
Oui, alors on sait qu’elles sont très très représentées dans les œuvres et elles sont souvent cantonnées au rôle de muse et de modèle. Elles répondent donc en ce sens-là à des attentes très masculines parce que ce sont évidemment les hommes qui peignent et qui regardent les œuvres. Elles sont donc figées, passives, désirables, et on se rend compte que la place des femmes dans l’art est tout à fait en lien avec leur place dans la société.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Cependant, elles ont aussi été actives, créatrices et protectrices des arts. Même si ces femmes sont trop souvent restées dans l’ombre, il est important de les remettre en lumière.
[Marthe Pierot]
C’est vrai, et c’est ce qu’on va faire d’ailleurs dans ce podcast. Nous allons dans un premier temps observer la manière dont elles sont représentées dans les œuvres, les œuvres évidemment du musée des Augustins, et on va voir ensemble quelle image l’histoire de l’art occidentale a véhiculé avec ses représentations.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et dans un second temps nous évoquerons celles qui sont sorties du cadre, c’est-à-dire pas simplement du tableau, mais celles qui ont osé créer.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait, allons-y !
[Isabelle Bâlon-Barberis]
On y va !
[Musique]
[Marthe Pierot]
Dans un premier temps nous allons parler de l’image de la femme, la manière dont elle est représentée dans les œuvres et en fait on s’aperçoit que c’est un thème très récurrent dans l’art, son image est partout. La figure féminine endosse une multitude de statuts. Elle peut être muse, allégorie, et elle est très souvent une représentation fantasmée, érotisée, et carrément idéalisée. On s’aperçoit qu’en fait ce modèle est très multiple, et il répond aux fonctions sociales qu’on attend de la femme, c’est-à-dire qu’elle sera soit l’incarnation de la sensualité ou de la maternité, du vice ou de la vertu. En fait c’est une image qui n’a pas de demi-mesure.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et c’est vrai que de la Vierge Marie aux saintes, en passant par les très jeunes filles façon “oies blanches” du 19e siècle, nous allons nous demander comment l’art occidental a été le relais de cet idéal, à la fois comme support moral et comme reflet des fantasmes masculins.
[Marthe Pierot]
Oui et nous allons voir quelles sont ces différentes images de la femme dans les œuvres du musée. Alors on a fait plusieurs catégories. On va commencer par la femme sacralisée, quand elle est symbole de vertu, quand elle est le modèle qu’il faut suivre. Là, en fait, on parle de Marie. Evidemment, Marie c’est le modèle par excellence. C’est l’exemple même de la perfection. Déjà, même enfant, elle est représentée dans les tableaux comme une petite fille modèle, consciente déjà de sa responsabilité, sage et sérieuse.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et à cet égard on pense, dans les collections du musée des Augustins, à “La Présentation au Temple” de Charles de La Fosse, un peintre du 17e siècle. Dans ce tableau, Marie est représentée marchant vers le grand prêtre. Ele est consciente bien avant l’heure du lourd destin qui l’attend. Elle est un exemple de responsabilité alors qu’elle n’a que 5-6 ans. On la voit quitter ses parents et elle gravit lentement les marches de l’escalier monumental, très droite, très digne. Son comportement est très éloigné de l’enfance. Elle est déjà adulte, elle ne parle pas, elle ne se révolte pas contre un destin qui est tout tracé.
[Marthe Pierot]
Oui, puis c’est en mère idéale qu’elle sera représentée, et on s’aperçoit que la manière dont elle est mère c’est très codifié en histoire de l’art, et il y a beaucoup de “Vierge à l’enfant” qui se trouvent au musée et qui représentent une femme douce, dévouée à son enfant, et toujours prête au sacrifice. Elle fait face à son devoir mais on s’aperçoit qu’elle est quand même très rarement épanouie. Et on le voit d’ailleurs dans le chef-d’œuvre du musée, dans la sculpture qui s’intitule “Nostre Dame de Grâce”.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Dans cette sculpture, la tristesse, la résignation l’emportent. C’est un groupe sculpté de la fin du 15e siècle qui représente Marie assise sur un banc de pierre avec son enfant Jésus dans les bras. Elle tourne son visage rêveur et mélancolique vers la gauche et elle ne regarde pas du tout son fils qui tourne, lui, son visage vers la droite. Il y a donc un déséquilibre des attitudes, un mouvement complètement opposé qui fait la rareté. Ce qui rend unique véritablement cette œuvre, c’est ce positionnement. Et puis elle est coiffée d’une couronne trop grande pour sa tête. Ces vêtements semblent trop lourds pour son corps si frêle. Mais cela nous dit peut-être, déjà, son accablement. Elle sait déjà peut-être que son fils va mourir.
[Marthe Pierot]
C’est vrai, et on s’aperçoit aussi que les martyres qui sont représentés en histoire de l’art sont également des modèles de vertu, il n’y a pas que Marie, les martyrs sont symboles de courage. Et en fait ils imposent une image très stricte du bon comportement, entre guillemets bien sûr, parce qu’ici le sacrifice est mis à l’honneur. Avec toujours cette idée qu’une femme respectable est toujours vierge. Les martyrs le sont toujours, et on se sent obligé de le préciser. Si elles ne sont pas mères, elles sont vierges. On a un exemple avec Ursule de Cologne. C’est la première vierge – donc on le dit – martyre de l’histoire chrétienne. Elle veut se rendre en pèlerinage à Rome avant de se marier en compagnie de dix de ses amies. Et sur le chemin du retour elles se font massacrer par les Huns, ce peuple de Mongolie. Elle est criblée de flèche parce qu’elle a refusé d’épouser leur chef. Au musée nous avons une petite peinture du 15e siècle qui la représente, qui représente cette jeune femme, auréolée car c’est une sainte. Elle tient une flèche à la main, c’est l’instrument de son martyre. Et elle a un très grand manteau qu’elle ouvre en signe de protection, comme une vierge de miséricorde sous lequel elle pourrait abriter toutes les autres vierges qui ont accompagné son pèlerinage et son martyre.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Beaucoup de martyres féminines sont aussi des modèles de force. Force de caractère parce qu’elles osent proclamer leur liberté personnelle au nom de Jésus-Christ. Mais elles le payent de leur vie, elles le payent cher, et le message donc n’est pas très encourageant.
[Marthe Pierot]
C’est vrai. Alors on remarque aussi, on s’est aperçu avec Isabelle, que la représentation même physique des femmes évolue au fil du temps, la manière dont on va vraiment les imager en quelque sorte. A la Préhistoire elle est toute en rondeur pour représenter la fécondité, et au Moyen Âge la femme n’est qu’une vierge, on l’a vu, mais ce n’est surtout qu’un visage, on ne montre pas du tout son corps. Et à la Renaissance, et après dans les siècles qui suivent, elle sera de plus en plus un corps idéalisé qui répond à des canons différents selon les époques.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Si elle n’est pas ange, c’est-à-dire représentation de la perfection, en fait elle est démon, il n’y a pas de demi-mesure, il n’y a pas de nuance. Elle est diabolisée, elle est cette pêcheresse, et la vision est très moralisatrice pour ramener les fidèles dans le droit chemin. De tout temps et depuis Eve et la pomme, les femmes sont associées à la tentation, à la luxure, au péché, et l’histoire de l’art et l’imagerie chrétienne en général sont remplies de ces représentations féminines négatives, au comportement tout à fait immoral.
[Marthe Pierot]
Dans un des chapiteaux romans du 12e siècle que nous avons au musée – alors un chapiteau c’est cette sculpture de pierre qui se trouve au sommet des colonnes et qui décore les cloîtres – et bien il y a une histoire de Marie l’égyptienne qui est racontée, qui est sculptée tout autour de ce chapiteau de pierre. Marie l’égyptienne c’est une prostituée dont on voit les vêtements très luxueux. Sur le chapiteau il y a des pierreries qui sont sculptées très finement, et donc elle vivait du commerce de son corps, ce qui était jugé comme très mauvais. Et un jour elle a une vision de la Vierge Marie, et suite à cette vision, elle décide de tout changer dans sa vie : elle refuse les pièces d’or, se coupe les cheveux qu’elle portait très longs et lâchés, ça c’est un argument de sensualité les cheveux, et elle se retire dans le désert pour vivre dans un dénuement absolu. Et cette fois-ci de manière très rustique on la représente avec une peau de bête à ce moment-là.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est vrai. On retrouve cette idée d’une femme de mauvaise vie qui, suite à une rencontre, fait le choix d’abandonner sa vie d’avant et se repend, et on la retrouve donc cette image avec Marie- Madeleine. Il y a au musée des Augustin un tableau de Nicolas Tournier, un peintre du 17e siècle, qui nous parle d’elle et on retrouve donc l’argument des longs cheveux dénoués, comme précédemment, comme Marthe vient de vous le dire, argument de séduction en Orient. Et ici on sait aussi que les cheveux sont couverts de baumes de parfum, parce qu’une femme quand elle se déplace, dans son sillage parfumé elle attire les hommes. Et de plus dans le tableau elle est vêtue de jaune qui est une couleur très voyante, et qui est une couleur négative aussi.
[Marthe Pierot]
On a un autre chapiteau roman aussi où il est question d’une autre femme, mais plus particulière, là c’est un personnage mythologique. Il s’agit d’une sirène, une sirène qui est sculptée. Elle est au centre d’un cercle végétal et elle est en train de se coiffer et de se regarder dans un miroir. Elle a la poitrine nue et une queue de poisson, c’est donc une créature hybride, mais c’est important de vous dire que dans la mythologie grecque la sirène était une femme oiseau qui séduisait les hommes. Mais en chantant, elle volait au-dessus des navires et elle charmait les marins avec sa voix. Et avec le christianisme on assiste à un glissement de son apparence et elle devient une femme poisson. Et au fur et à mesure elle piège les hommes non plus par sa voix mais surtout par son apparence. En fait on s’aperçoit que dans ce chapiteau il est question de l’apparence puisqu’elle se coiffe et donc elle est représentée coquette, et la coquetterie était un vice. Donc l’imaginaire médiéval nous montre la femme comme séductrice, une tentatrice charnelle et donc un agent de transmission du péché par excellence.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
D’accord, quelle histoire ! Bon alors quittons le Moyen Âge et propulsons-nous au 19e siècle où l’on voit que le corps féminin provoque toujours des pensées très coupables. Alors je pense au “Cauchemar”, cette sculpture en marbre gris de Thivier, un sculpteur de la fin du 19e siècle, qui va donc s’inspirer d’un célèbre tableau de la fin du 18e siècle peint par un peintre suisse qui s’appelait Füssli. J’espère que vous suivez là parce que le chemin est celui-là ! Donc on peut voir une femme nue allongée sur un lit. Elle ferme les yeux, son corps entier se tort parce qu’une créature terrifiante s’est posée sur elle. Elle est en proie donc à un cauchemar et le monstre matérialise ce cauchemar. Alors il est représenté sous la forme d’une créature hideuse et hirsute, poilue. Pour dire son animalité, alors que le corps de la jeune femme est montré lisse, doux, sensuel, on est vraiment sur le principe d’opposition. Et il y a une ambiguïté parce que bien que cette femme tente de se défendre en repoussant d’une main le monstre, son autre main agrippe le drap comme si elle saisissait le drap dans un geste de plaisir, d’extase.
[Marthe Pierot]
C’est troublant.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui mais il faut noter aussi qu’au 19e siècle aucune femme de bonne moralité ne dort nue. Or là, elle est représentée toute nue. Donc vous voyez en fait combien tout l’accuse. Le plaisir sexuel féminin est diabolisé, son corps est diabolisé car il est associé au désir. Alors cette sculpture représente à la fois les joies et les souffrances, c’est une étonnante attirance et en même temps une répulsion face à ce démon.
[Marthe Pierot]
Alors ce démon, il faut le préciser, on va vous le décrire un petit peu. Isabelle tu l’as dit, il est poilu mais il n’y a pas que ça. Il a une corne unique, une queue très velue, des ailes de chauve-souris, des griffes. C’est une créature hybride qui est très médiévale dans sa représentation, un peu comme une gargouille, mais qui a une poitrine ! Ça, c’est important, c’est un démon féminin. Et là tout est troublé, et en fait on a envie de se demander : Est-ce que ce démon ne serait pas une part d’elle-même ? de la femme qui dort un peu comme son côté obscur, son “dark side” qu’elle tente de repousser comme si elle se battait contre elle-même. Ça soulève plein de questions !
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors on va à présent proposer une autre image encore de la femme. On a vu la “femme perfection”, on a vu la “femme diablesse”, voyons à présent la femme qui est juste érotisée, juste fantasmée, où là il n’est plus question de moralité mais de nu. Nous sommes au 19e siècle, les femmes sont objet de désir en peinture, en sculpture, on l’a vu. Et donc c’est vrai qu’on pense aux nus que Ingres, que Manet ont représentés . Que tant d’hommes au 19e siècle ont représentés – parce qu’elles nourrissent leurs fantasmes.
[Marthe Pierot]
Oui et en fait c’est vrai que surtout au 19e siècle – on va beaucoup vous parler d’œuvres de cette époque – les femmes sont encore plus nues qu’elles ne le sont habituellement en histoire de l’art, parce que là, elles vont être vraiment représentées sous le prisme du désir masculin. Elles sont très sexualisées. Elles peuplent tous les salons d’exposition et on s’aperçoit qu’elles sont aussi très stéréotypées. Elles répondent à des canons de beauté très stricts qui marquent encore notre société aujourd’hui. On va tenter un peu de vous les décrire. On commence avec un tableau qui s’appelle “La Mort de Cléopâtre”, un tableau peint en 1874 par Rixens. Alors Cléopâtre, vous la connaissez au moins de nom. C’est cette reine d’Égypte, la dernière reine d’Égypte et on est en 30 avant Jésus-Christ. En fait, on raconte beaucoup l’histoire de sa mort parce que Cléopâtre se suicide afin d’éviter l’humiliation de sa défaite face au premier empereur de Rome. Et en histoire de l’art on raconte très souvent cet épisode mais c’est souvent aussi un prétexte pour représenter une mort érotique. On s’aperçoit souvent qu’il y a un corps très sensuel et dénudé pour nous parler de cette reine.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Dans un décor très cinématographique, on a l’impression de voir les films en technicolor du 20e siècle où les couleurs sont très saturées. Tous les clichés de l’Égypte sont là. On voit des hiéroglyphes, on voit des statues d’Isis. On a ce parfum d’Orient avec des peaux de bête. La reine est allongée complètement nue sur son lit et elle s’abandonne avec extase à une mort désirable. L’érotisme est tout à fait morbide ici. Et pour évoquer sa mort on peut se demander : mais quel besoin avait-on de la dénuder ? On la réduit à un fantasme, à un corps, alors qu’elle était un génie politique? Qu’elle parlait sept langues, qu’elle tenait tête à Jules César, voilà, c’est très réducteur !
[Marthe Pierot]
C’est important de le dire, mais c’est vrai que pour le peintre, pour Rixens, à cette époque l’idée première ce n’est pas de parler de Cléopâtre ou de cette femme puissante, ni même de parler de l’histoire, il fait un tableau d’histoire mais c’est juste en fait pour faire passer son nu féminin en toute impunité. Sa volonté c’est de parler d’Égypte parce que c’est la mode, mais de parler du corps de la femme.
Et on va retrouver les mêmes codes de représentation dans d’autres tableaux, c’est-à-dire une femme à la blancheur immaculée, un corp de porcelaine, allongée, inconsciente, c’est important le fait qu’elle soit inconsciente. Elle est donc à la merci des hommes dans un tableau qui s’intitule “Les Naufragés”, tableau réalisé par François Latil en 1841.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui alors ça c’est un tableau… Attention ! On est en pleine nuit au milieu d’une mer agitée, lourde des débris d’un bateau qui a fait naufrage. Il y a deux personnages qui se sont échoués, accrochés à un rocher, ce sont donc les rescapés. L’homme du moins parce qu’on ne sait pas trop si la femme vit encore. Mais évidemment le corps de la femme est absolument dépourvu de toute blessure qui nuirait à la contemplation qu’on peut en avoir, alors qu’il est évident qu’il devrait être couvert de bleus et d’éraflures. Elle est aux pieds de l’homme. Elle est à ses pieds en quelque sorte, dans une position ondulante, telle une Vénus ou une sirène, elle est allongée et lui il est dressé. Elle est presque entièrement nue, seul un tissu couvre le bas de son ventre. Son corps est abandonné et rien n’est réaliste, rien n’est naturel, tout est ridicule parce que personne ne meurt comme ça, on peut le dire comme ça. L’idée c’est simplement de susciter du désir sur fond de catastrophe naturelle.
[Marthe Pierot]
Exactement et en fait on s’aperçoit vraiment que toutes ces représentations de femmes complètement inconscientes et au sol véhiculent des stéréotypes, déjà sur les corps féminins et masculins, mais surtout transmettent deux idées importantes. Il y a le corps masculin qui est toujours tonique, droit, debout, qui s’oppose à un corps féminin amolli, allongé. Et en fait ces deux images renvoient vraiment à des rapports de société actif/passif, vraiment.
Alors on a un autre tableau dans un même contexte funeste où on mélange mort et érotisme avec une œuvre très très grande qui s’intitule “La mort de Ravana”. On est aussi au 19e siècle mais là cette fois-ci c’est un contexte de mythologie hindou. Ravana c’est un démon arrogant qui est devenu roi du Sri Lanka, mais de manière illégitime. Et donc finalement il va être destitué et tué, enfin destitué de son trône et tué, et ce tableau nous raconte le moment où il meurt.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà, donc, Marthe vient de vous le dire, le très grand format c’est 4 par 3. C’est comme une affiche publicitaire. Et dans ce tableau donc, il y a une multitude de femmes autour d’un homme couché, donc Ravana. Il agonise dans un décor apocalyptique puisque le paysage est accidenté, rocheux. Il y a du feu, des incendies au loin et il y a cette débauche de corps alanguis. On peut noter donc un caractère parfaitement morbide. Le roi est vaincu dans une grande théâtralité. Il y a du sang, des blessures et on a comme une véritable veillée funèbre et érotique à la fois. Toutes les femmes qui sont à ses côtés sont en fait ses femmes à lui. Elles sont dévastées de douleur, elles sont couchées, elles sont debout, elles accourent et on voit leurs couleurs aussi qui sont très différentes. Elles sont blanches, elles sont noires, elles sont blondes, elles sont rousses, elles sont brunes. Ca symbolise en fait la puissance de cet homme qui peut avoir toutes les femmes du monde. Et dans ce sens-là ça nous dit beaucoup du fantasme de l’homme occidental par rapport justement à ce fantasme de la polygamie. Donc toutes sont presque nues, poitrine visible, habillées à l’orientale pour ajouter de l’exotisme à l’érotisme.
[Marthe Pierot]
Et en fait à chaque fois ces représentations, évidemment, stigmatisent et emprisonnent la féminité dans un rôle qui ne répond qu’au désir masculin. Mais quand même, il n’y a pas que ça et heureusement. Certaines figures offrent des modèles de féminité plus affirmés, parfois même combattantes. La collection du musée des Augustins est quand même riche en femmes puissantes qui s’affirment dans une attitude frontale et assumée. Des femmes qui sont debout et fortes. Et ça c’est notre dernière partie sur l’image des femmes : les femmes émancipées, libérées et puissantes. On peut prendre en exemple “Théodora”, c’est une sculpture réalisée par Jean Rivière. Et Théodora c’est une femme importante. C’était une impératrice du 6e siècle après Jésus-Christ, et nous sommes à Byzance, c’est Istanbul aujourd’hui. C’est donc un personnage historique.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui et elle a régné avec son mari Justinien, et c’est très rare à l’époque. Elle est issue d’un milieu modeste. Elle va recevoir une solide formation culturelle et religieuse cependant, et ça va susciter bien sûr l’attention de l’empereur Justinien, qui va choisir de l’épouser et qui lui donne une place dans son gouvernement. Il l’associe vraiment au pouvoir et Théodora a une influence importante, notamment sur les réformes législatives, et notamment pour tout ce qui concerne le droit des femmes.
[Marthe Pierot]
Oui. Donc en fait c’est une personnalité aux multiples facettes et elle laisse vraiment l’image d’une femme au tempérament affirmé qui était à la fois habile et impitoyable. C’est l’une des souveraines les plus influentes de son temps. En fait son parcours est un exemple remarquable d’ascension sociale aussi, parce que tu l’as dit Isabelle, elle vient d’un milieu modeste. Et elle arrive à avoir cette place-là et ce pouvoir-là. Et on l’oublie un peu aujourd’hui. On la connaît moins alors qu’elle était quand même très très importante. Mais il y a eu beaucoup de représentations d’elle à un moment qui témoigne la fascination des auteurs à son égard. Mais c’est vraiment une œuvre que nous avons au musée des Augustins qui nous fait comprendre à quel point elle était importante parce que c’est un buste. En fait on voit le visage de Théodora, c’est un plâtre tout doré qui est fait pour être accroché à un mur. Mais elle prend donc beaucoup de place, et tout en bas en tout petit, vous avez Justinien, mais il est ridiculement petit à côté d’elle !
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Ce qui veut tout dire ! Donc c’est une œuvre très orientale étant donné les bijoux, les dorures, les pierreries, les immenses boucles d’oreilles que porte Théodora. Au musée des Augustins il y a aussi une autre femme, cette fois qui est issue de la Bible, qui est une femme très puissante, c’est la “Judith” qui brandit la tête d’Holopherne réalisée par Victor Ségoffin en 1896. Là il y a toute la puissance d’une femme dont l’acte est politique. Une femme qui, cette fois six siècles avant Jésus-Christ, va libérer son peuple en tuant le tyran, le général Holopherne. Donc nous sommes en Béthulie, c’est une province de la Palestine aujourd’hui. Et il s’agit d’une femme qui sort de sa condition de femme, de veuve, de mère et qui se fait guerrière et justicière, à une époque et dans une géographie où dans ce rôle on n’attend pas du tout une femme. C’est un bronze de petite taille, il fait à peine plus d’un mètre de hauteur mais la taille de l’œuvre contredit complètement la force de l’expression.
[Marthe Pierot]
Oui c’est vrai. Le personnage de Judith est tout en tension. Elle est debout, les bras tendus vers le ciel qui forment un V. Le V de la victoire. Et au bout de chaque main elle tient l’épée et la tête coupée. Il y a une forme de violence dans ce geste de triomphe, mais elle vient de tuer le général. Ele brandit cette tête qui est toute petite, réduite à une dépouille dérisoire et il y a véritablement un geste théâtral, quelque chose de très dynamique dans cette position. Alors tu l’as dit tout à l’heure, on a parlé de l’orientalisme un peu avec Théodora, c’est un peu le cas aussi avec cette sculpture, c’est la même époque. Il y a cette mode de l’Oriental, on a vraiment une robe très très longue mais avec un plastron de pierres, des boucles d’oreilles très lourdes. On a vraiment les pieds nus, les bijoux aux pieds et aux chevilles, tout est là pour évoquer le côté oriental.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et on note aussi ces larges manches qui découvrent des bras puissants, des hanches larges également qui accentuent l’impression de force et de froide détermination. Elle a la tête tournée vers la tête coupée d’Holopherne et on découvre une mâchoire puissante, presque saillante. Donc dans cette œuvre on a une modernité mais aussi une virilité de représentation.
[Marthe Pierot]
Oui, Judith est très souvent représentée, et beaucoup au 19e, aussi parce que c’est une héroïne très séduisante et dangereuse qui sait jouer de ses charmes. Et en fait on peut dire que c’est un petit peu l’archétype de la femme fatale aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors. On termine cet épisode avec une dernière œuvre, une œuvre d’Amélie Beaury-Saurel. Donc à la fin du 19e siècle, les femmes peintes par Amélie Beaury-Saurel illustrent un combat profond et nécessaire, celui de la liberté. L’œuvre s’intitule “Dans le bleu” et elle a été réalisée en 1894. Alors il est question d’une femme de profil qui est tout à son moment. Le moment de fumer sa cigarette. Elle n’est pas du tout apprêtée, elle est encore en peignoir, elle n’est pas maquillée, ses lèvres sont blanches, elle n’a besoin de personne pour être bien à ce moment-là. Donc sa position est décontractée puisqu’elle est assise seule à une table. Elle est pensive, elle boit un café, elle fume une cigarette, elle n’a pas de chapeau et elle est en tenue d’intérieur mal ajustée, donc grossièrement refermée sur elle-même. Mais il faut revenir sur l’idée de nicotine et de caféine. Ce sont les plaisirs réservés aux hommes et c’est un véritable manifeste féministe que cette œuvre. Cette peinture nous montre une femme libérée, une femme qui n’est pas du tout dans la norme. Elle ne regarde même pas le spectateur, elle ne pose pas, elle ne cherche pas à être un objet de désir. Elle échappe au code de la bienséance.
[Marthe Pierot]
Oui et c’est intéressant de savoir dans cette œuvre que ce n’est pas une commande. C’est important parce qu’en fait l’artiste, donc Amélie Beaury-Saurel, a choisi de faire ce portrait parce qu’elle est séduite sûrement par cette femme absorbée par le bleu de sa fumée, le bleu qui évoque aussi le rêve, le blues, le tableau s’appelle “Dans le bleu”. Et donc finalement elle vole un instant, elle capte un moment naturel qui l’a touché et elle nous parle de cette femme libre. Mais cette femme parfaitement anonyme, on ne sait pas de qui il s’agit, on est loin des femmes d’histoire ici. Alors on peut même aller jusqu’à se demander : est-ce que ce ne serait pas elle-même qu’elle peint ? Une forme d’autoportrait un peu dissimulé, comme si elle nous parlait de ce qu’elle était. Et c’est important parce que Amélie Beaury-Saurel était une femme engagée et militante. Mais on va vous parler un peu plus d’elle dans la deuxième partie de ce podcast. Retrouvez-nous pour le deuxième épisode, pour comprendre un petit peu plus de choses sur cette artiste et sur tant d’autres femmes artistes que nous avons au musée.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
A très vite !
[Marthe Pierot]
Merci beaucoup !
[Musique]
[Marthe Pierot]
Et pour compléter ce podcast n’hésitez pas à regarder les œuvres sur le site du musée des Augustins.
[Musique]
[Rémi Roig]
Ce podcast a été réalisé par l’équipe du musée des Augustins : à l’écriture et au micro Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, au montage Rémi Roig et à la coordination Ghislaine Gemin.
[Musique]
[Marthe Pierot]
Si vous avez aimé ce podcast, n’hésitez pas à liker et à vous abonner.
[Musique]
Partie 2/2
FEMMES, FÉMINITÉ, FÉMINISME : ÉPISODE 2/2
[Musique]
[Voix masculine] Les podcasts du Musée des Augustins
[Musique]
[Marthe Pierot] Histoire des arts, objectif bac !
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Bonjour à tous et à toutes
[Marthe Pierot]
Bonjour
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons donc pour le deuxième volet de Femmes, Féminité, Féminisme. Alors on a vu dans un premier temps que la femme était ange ou démon. Elle était soumise au désir de l’homme. Elle était montrée également puissante. Elle était représentée sous différentes images. Mais elle entretient aussi avec l’art un autre lien c’est celui de la femme créatrice.
[Marthe Pierot]
Oui là nous allons plutôt parler et bien des femmes qui vont réaliser des œuvres donc pas la représentation des femmes mais plutôt les femmes qui construisent, qui imaginent, qui créent, qui inventent. Celles qui sont en fait derrière la caméra en quelque sorte. Et on s’aperçoit qu’au musée des Augustins et bien il y a beaucoup d’œuvres quand même de femmes artistes dans les collections. Mais le pourcentage reste très faible par rapport aux hommes, comme dans beaucoup d’autres musées.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui et d’ailleurs pour donner une petite parenthèse chiffrée, aujourd’hui sur les 1200 musées de France sur 35 000 artistes seulement 2304 sont des femmes.
[Marthe Pierot]
On constate donc une invisibilité des femmes comme créatrice alors que le geste artistique féminin est attesté depuis l’Antiquité. C’est important de le dire quand même.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Mais alors pourquoi et quels sont les différents facteurs qui ont contribué à exclure ces femmes au fil des siècles ?
[Marthe Pierot]
Oui. Il y a beaucoup de raisons. Déjà ces créatrices sont trop souvent restées dans l’ombre d’artistes masculins. Les noms des femmes ont traversé les siècles mais ils ont souvent été accolés à celui d’un maître, d’un époux, d’un condisciple masculin. Alors il faut préciser aussi que jusqu’à la Renaissance beaucoup de productions étaient anonymes. Mais ça c’était pour les hommes comme pour les femmes. Ca n’a pas aidé quand même. Mais il y avait des créatrices et il y avait parfois des artistes qui étaient reconnus de leur temps. C’est important de le dire aussi, elles avaient une reconnaissance institutionnelle et puis pouf !! Elles sont tombées dans l’oubli. Il y a eu comme une amnésie de l’histoire. L’Histoire avec un grand “H” évidemment écrite par des hommes.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Evidemment. Alors pourquoi sont-elles moins nombreuses à créer ? Parce que leur parcours d’artiste a été semé d’embûches.
[Marthe Pierot]
Oui. Ca c’est vrai c’est important de le dire. Quand même ce n’était pas facile d’être artiste. Déjà il n’y a pas d’accès aux formations officielles. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que l’école des Beaux Arts soit ouverte aux femmes.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et il fallait avoir les moyens pour financer un cursus artistique dans ses établissements privés. Parce que le coût pour les femmes était multiplié par deux par rapport aux hommes.
[Marthe Pierot]
C’est vraiment pas facile. Et en plus si elles arrivent à peindre ou à sculpter elles ne peuvent quand même pas gagner leur vie en étant artiste. Elles ne sont pas indépendantes financièrement. Elles sont toujours sous le contrôle financier d’un mari ou d’un père.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui et de manière générale, il fallait éviter qu’elle soit trop distraite par un travail extérieur au foyer. Elle ne devait pas se laisser accaparer par quelque chose qui était, qui aurait été plus important que leurs tâches domestiques.
[Marthe Pierot]
Et quand elles peuvent produire, elles sont en plus cantonnées à un genre en peinture qui est considéré comme mineur. C’est-à-dire qu’on va leur demander de faire des natures mortes ou des scènes de genre mais surtout pas de peinture d’histoire et en plus les techniques qu’on va leur être attribuées seront très souvent dites féminines comme le pastel. La peinture à huile c’est pour les hommes.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc on comprend que quand les femmes sont associées à l’art, elles sont souvent muse, modèle mais rarement artiste. Mais précisément donc parlons des artistes à présent. Nous avions terminé le premier épisode avec Amélie Beaury-Saurel. Cette peintre présente au Musée des Augustins. Que nous disent ses tableaux ?
[Marthe Pierot]
Oui, alors c’est vrai qu’Amélie Beaury-Saurel c’est important de parler d’elle avant même de reparler de ses œuvres. On ne l’a pas vraiment présenté avant. On a parlé plutôt d’un de ses tableaux. Mais on voulait vous dire qu’elle appartient vraiment à la première génération d’artistes femmes qui se forment dans une académie, une académie privée. L’école des Beaux-Arts n’est pas encore ouverte. Mais il y a l’Académie Julian qui est ouverte aux femmes. Evidemment c’est plus cher on l’a dit pour elle d’intégrer ses ateliers et elle va se spécialiser dans le portrait. Et puis ensuite elle reprend la direction de cette académie. Ca c’est très important. Et pendant qu’elle est directrice, elle continue sa carrière de portraitiste et elle soutient inconditionnellement l’éducation des femmes artistes. Elle encourage les femmes à peindre. Ca c’est très important. Et elle va même recevoir une Légion d’Honneur de son vivant pour sa participation à la transformation de l’image sociale des femmes. Et ça veut dire qu’on reconnaissait son militantisme à l’époque. Quel dommage qu’on l’ait oublié aujourd’hui.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui. Alors on avait parlé d’elle avec un pastel à la fin du premier épisode et là nous pouvons citer un autre portrait qu’elle a réalisé au fusain cette fois. Et c’est un même thème. C’est une femme qui à nouveau fume et qui boit du café. Le tableau s’intitule “Après déjeuner”. Donc une femme affranchie à nouveau, une femme donc fière. Elle est également de profil, le menton redressé, se tenant coude sur la table, mains sur les hanches. Un brin mutine, elle est pleine d’assurance. Cette femme nous ignore royalement. On est donc très loin des Muses et des Vénus idéalisées. Elle ne croise pas notre regard. Elle ne pose pas. Mais la place des femmes dans la société commence à changer à cette époque. Il faut redéfinir ce moment-là. Les femmes travaillent, certaines en tout cas. Elles gagnent leur vie sans dépendre d’un homme et ce portrait témoigne vraiment et bien de cette évolution. On comprend aussi les engagements et les prises de position d’Amélie Amélie Beaury-Saurel.
[Marthe Pierot]
Tout à fait. Alors on va remonter un peu le temps dans les collections du musée et on va évoquer une artiste du 17e siècle. Là l’époque est lointaine. C’est beaucoup plus rare de parler des femmes artistes à cette époque mais il y en avait. Louise Moillon donc c’est vrai qu’elle est artiste parce qu’elle a la chance de baigner dans un milieu artistique très riche depuis son enfance. Son père, son beau-père, sa sœur étaient peintres. Mais les choix des sujets qu’elle peut réaliser sont très restreints. Elle a interdiction de peindre des nus. C’est le tabou absolu. Elle a interdiction de peindre des œuvres religieuses aussi parce qu’elle est protestante donc elle ne peut pas représenter des saints. Donc qu’est-ce qui lui reste ? La nature morte. Mais elle réalise des natures mortes spectaculaires. Des petits formats qui sont des petits panneaux de bois où règnent simplicité et rusticité.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et on note qu’il y a un décalage entre un réalisme exacerbé du détail. Par exemple les gouttes de rosée sur la peau des fruits et le côté artificiel de la composition parce que les abricots dans cette nature morte se superposent les uns au-dessus des autres comme des bulles de savon. Mais on note vraiment combien c’est suave combien c’est sensuel. La rondeur des fruits, la douceur duveteuse de leur chair. Alors c’est intéressant de dire qu’elle ne va peindre que pendant 10 années. Quand elle est auprès de son père. Mais quand elle se marie, elle n’a d’autre choix que d’abandonner la peinture pour élever ses enfants. Et au 17e siècle il y a même pas de sujet, il y a même pas de débat sur ce point.
[Marthe Pierot]
Elle peint que 10 ans et elle peint peu d’œuvres aussi. Et le musé des Augustins en possède quand même trois de cet artiste. Trois natures mortes aux fruits.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors nous pouvons à présent évoquer un tout autre parcours, une autre artiste. Elle s’appelle Elisabeth Louise Vigée Le Brun. Et elle a eu le loisir de peindre jusqu’à 87 ans. pendant des décennies elle peut s’exprimer. C’est une artiste portraitiste qui commence à peindre à la fin du 18e siècle.
[Marthe Pierot]
Oui et dans ses portraits, elle apporte vraiment quelque chose de nouveau. Elle donne du naturel et de la souplesse à ses modèles. Les portraits jusque-là étaient peints par des hommes et proposer des figures très raides, guindées, sérieuses, très satisfaites d’elles-mêmes. Enfin très satisfaits d’eux-mêmes finalement. Mais elle, elle propose autre chose. Et elle nous propose un portrait d’une baronne. En fait elle est assise sur un fauteuil de style Louis XVI certes mais il y a quelque chose de décontracté parce qu’elle se retourne pour nous regarder. Et elle semble surprise, un peu comme si on la prenait en photo. On a l’impression qu’elle vient juste de se retourner pour nous regarder. Il y a beaucoup de spontanéité. Et on remarque aussi qu’elle est coiffée et habillée selon la mode de l’époque qui était en fait la mode de la reine Marie- Antoinette. Tout le monde voulait faire comme Marie-Antoinette à ce moment-là. C’était clairement une influenceuse. Et bien la baronne elle fait tout comme elle. C’est-à-dire qu’elle a ce foulard de soie noué autour du coup à la bergère. On a vraiment tous les codes des vêtements de cette époque.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et je pense qu’il est important d’insister sur le fait que Elisabeth Louise Vigée Le Brun à la fin du 18e siècle c’est la première femme en France à vivre de sa peinture. Il faut je pense saluer la chose. Alors c’est une femme qui s’affirme à la cour. Marthe vient de vous dire donc son intimité avec la reine Marie-Antoinette. La manière dont elle est protégée par la reine. Et insister aussi sur le fait que c’est une mondaine qui sait rebondir parce qu’elle fuit la France juste après la Révolution Française. Et elle continue à travailler jusqu’à la fin de sa vie puisqu’elle est acclamée et elle est demandée par toutes les cours d’Europe. Alors on va parler à présent d’un autre portrait réalisé par une autre femme peintre mais cette fois de la fin du 19e siècle. J’ai nommé Berthe Morisot. Et on pense au portrait que notre musée des Augustins conserve à savoir “la jeune fille au parc”. Une œuvre réalisée en 1888. Alors Berthe Morisot, cette femme impressionniste qui a été tout à fait soutenue par son père. Donc elle va côtoyer d’autres peintres. Elle va rencontrer par exemple Manet. Elle est même la muse de Manet. Mais Manet va se permettre de retoucher ces tableaux. C’est un petit peu encombrant et dérangeant finalement. On va souvent la qualifier de belle-sœur de Manet, ce qui est quand même un peu réducteur. En fait elle était véritablement admirée et reconnue par ses pairs. Il a une trentaine de peintres impressionnistes qui exposent, elle en fait partie. Elle est la seule femme. Et même un petit peu plus tard à l’époque des avant-gardes que ce soit donc Seurat, Pissarro, elle est encore parmi eux et elle compte. Et elle a vraiment tout son poids.
[Marthe Pierot]
Oui mais c’est fou de se dire que quand on parle d’impressionnisme on retient beaucoup plus Manet, Monet tant d’autres. Et en fait on oublie Berthe Morisot.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà même si on la réhabilite un peu aujourd’hui quand même.
[Marthe Pierot]
Oui mais elle est quand même moins connue. Alors qu’elle faisait partie vraiment de cette figure clé de l’impressionnisme. Elle était au début de ce mouvement et d’ailleurs même quand elle meurt, c’est difficile de dire qu’elle est peintre parce que son statut était inscrit comme sans profession. Comme si ce n’était pas possible de gagner sa vie en tant que femme peintre.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui, alors qu’on est quand même bien à la fin du 19e.
[Marthe Pierot]
Pourtant oui tout à fait. Mais le combat est encore là. Alors dans le tableau que nous avons au musée d’elle, c’est une jeune fille qui est dans un parc. Une jeune fille qui est assise sur un banc. Elle est face à nous. Ce qui est très impressionniste dans ce tableau, c’est le travail de la touche qui est très libre et les ombres colorées du tableau. Il n’y a pas de couleur qui est sombre. Tout est très très lumineux. On est vraiment en extérieur. C’est la peinture de plein air où tout semble vibrer sous l’effet de la lumière. En fait ce tableau on dit souvent que c’est plus le portrait d’une saison, que le portrait d’une femme. Parce qu’on a vraiment cette sensation de fraîcheur, de climat, de printemps, d’harmonie. Vous avez une végétation extraordinaire derrière qui semble un peu folle. Qui prend beaucoup de place et qui est un peu sauvage et qui fait écho en fait à la chevelure lâchée de cette jeune fille. Avoir les cheveux lâchés c’est être libre aussi. Donc il y a cette liberté-là de la végétation et la liberté de la chevelure. C’est une jeune fille qui est à l’aube de sa vie et qui sourit tout simplement en nous regardant. Mais elle ne joue pas à la coquette. Il y a quelque chose de figé et d’un peu énigmatique dans son sourire et ça ça nous plaît. C’est une présentation assez moderne et on sent que c’est une femme qui représente une femme.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Effectivement. Alors on peut finir avec une dernière artiste sculptrice cette fois. Très célèbre aujourd’hui bien que redécouverte par un livre seulement en 1982. Puis célébrée grâce à un film qui a connu un grand succès en 1988. C’est Camille Claudel.
[Marthe Pierot]
Oui. Alors c’est une artiste majeure et encore une fois on l’associe beaucoup à un homme comme on a parlé de Berthe Morisot et de Manet. Ici vous avez Camille Claudel et Rodin. C’est un peu ce duo indissociable. Alors Rodin ce grand sculpteur incontesté de la fin du 19e siècle et bien il était le maître de Camille Claudel. Quand elle rencontre Rodin, ça bouleverse évidemment sa vie et son travail. C’est une chance pour elle. Mais c’est à la fois le drame de sa vie. Voilà et en fait Camille Claudel en plus de cette relation un peu compliquée avec Rodin, dans sa famille ce n’était pas simple. Parce que son père l’encourage à créer mais il meurt trop tôt et sa mère ne l’encourageait pas du tout. Au contraire elle voulait qu’elle soit une femme juste à marier. Donc en fait son génie est complètement gâché et gâché par 30 ans d’internement à l’hôpital psychiatrique. Donc ça c’est terrible évidemment. Donc la vie de Camille Claudet est parsemée de génie et de tragédie. Mais elle fait des chefs-d’œuvre extraordinaires. Et c’est important de dire aussi que les grands chefs-d’œuvre qu’elle réalise, c’est au moment où elle s’est affranchie de Rodin. C’est quand elle n’est plus avec lui. Et on s’aperçoit vraiment que son travail, ses bronzes, ses sculptures proposent vraiment une interrogation inquiète sur la destinée humaine. Parce qu’elle a vraiment un goût pour le répertoire mythologique mais aussi la psychologie et l’intime. Elle aime sculpter les âges de la vie. Des enfants qui sont très jeunes et purs ou des vieillards qui sont cabossés par le temps ou même des adolescents frondeurs. Comme c’est le cas avec le buste du musée.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui. Ce buste en fait représente Paul Claudel à 16 ans, c’est-à-dire son frère. On est en 1884 quand elle représente ce buste. Et elle va prêter à ce futur écrivain une affirmation qu’elle lui envie. En fait comme Rodin, elle va parvenir avec cette sculpture à libérer la vie de la matière, à donner au bronze une vraie palpitation. Et ce jeune homme nous montre sa fierté, presque son arrogance. Il n’a que 16 ans. Mais sculpté par les mains de sa sœur, on arrive à voir toute cette affirmation. On dit de ce buste, que c’est un buste à l’italienne. Parce que finalement il y a les épaules et c’est pour ça qu’on parle de buste à l’italienne. Alors il est représenté en jeune romain parce que Camille Claudel lui propose enfin lui pose sur les épaules un drapé. Et il y a une pointe de cheveux qui est ramené sur le front comme si c’était un jeune empereur. Et c’est vrai que c’est une manière aussi de le magnifier. Et Camille n’essaie pas de créer des effets affectés ou sentimentaux, elle montre avant tout le mental très fort de son frère. Et donc il y a un réalisme dans ce portrait. Mais il y a aussi le choix d’aller à l’essentiel, sans s’encombrer de la tradition académique. Elle est très moderne. Elle est sans concession.
[Marthe Pierot]
Tout à fait, tout à fait. Et vraiment dans ce portrait, je me dis on voit vraiment l’admiration qu’elle portait à son frère qui était un écrivain important vraiment. C’était lui l’artiste de la famille selon la mère de Camille Claudel. Mais voilà on voit le lien qu’elle avait avec lui très fort. Alors on peut en parlant de lien, faire un autre lien quand on parle d’art et des femmes. Et c’est aussi important de montrer comment les femmes peuvent aussi avoir un rôle à jouer dans l’art autre qu’en étant muse ou artiste. C’est le statut de mécène ou de collectionneuse. Elles peuvent vraiment contribuer à la richesse artistique aussi. Et c’est notre dernière partie sur les femmes mécènes.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui, parlons à présent des femmes mécènes et définissons peut-être ce qu’est un mécène ou une mécène. C’est une personne qui va aider financièrement un artiste. Parce que c’est une personne qui a le goût des arts et la personne va devenir bienfaitrice ou protectrice comme par exemple Madame de Pompadour à la fin du 18e siècle. La favorite du roi Louis XV qui avait ce goût prononcé pour l’architecture, pour les arts décoratifs. Mais on peut évoquer que dès le 16e siècle, les femmes tiennent des salons littéraires. Et que par leur soutien financier, par leur goût des arts, elles vont aider, elles vont propulser des artistes à donner le meilleur d’eux mêmes finalement.
[Marthe Pierot]
Oui, elles encouragent. Elles ont un rôle important en tout cas dans la création. Oui tout à fait. Alors on va parler d’une femme qui est toulousaine, d’une mécène qui était aussi muse parce qu’elle inspirait beaucoup d’artistes. Mais elle a vraiment encouragé aussi les artistes à créer. Une femme toulousaine on revient au Musée des Augustins et on va vous parler de Clémence Isaure. Là nous sommes au 15e siècle à l’époque du Moyen- Âge et Clémence Isaure est un personnage très particulier parce qu’on dit qu’elle est semi-légendaire. C’est un mystère. On ne sait pas en fait à quel point elle est réelle ou à quel point elle est inventée. Mais c’est un personnage important parce qu’on lui attribue la sauvegarde, la restauration du grand concours de poésie. Il y a un concours de poésie qu’on appelle le concours des Jeux floraux qui existe à Toulouse depuis le début du 14e siècle qui est une véritable institution. C’est même la première institution littéraire en Europe. Voilà et à un moment Clémence Isaure donne son argent. A ce qu’on raconte, elle donnerait tout son héritage à la ville de Toulouse pour sauver ce concours de poésie qui menaçait d’être complètement supprimé. On ne sait pas vraiment ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais sur les registres de comptes de la ville figurait le nom Isaure pour signaler que cette femme aurait versé tout son argent pour aider les poètes à rimer. Elle encourage la production donc de poèmes et elle lègue tous ces biens à condition que le concours ait lieu chaque année. Et il existe toujours aujourd’hui. Au musée cette mécène est représentée qu’en même 7 fois. Ce n’est pas rien.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Mais on va vous parler en fait d’une œuvre qui a été réalisée par une sculptrice. Une sculptrice va donc faire le buste de Clémence Isaure en marbre blanc. C’est une œuvre qui fait à peu près un peu plus de 70 cm de hauteur. On est en 1822. Il y a ce buste qui est installé sur un support et sur le support il y a gravé, ciselé, la lyre du poète et les fleurs qui étaient décernées au meilleur poète de l’année. Cette Clémence est représentée avec sa coiffure médiévale. Ces macarons tressés et enroulés au niveau des oreilles, couverts d’un voile. D’un voile qui est extraordinaire parce que les plis sont réalisés en marbre, mais ils sont d’une telle finesse qu’on les dirait justement en tissu. Et c’est donc toute la prouesse de ce buste. Alors il faut dire qu’au 19e siècle, les valeurs et l’esthétique du Moyen-Âge sont la référence. On peut dire que cette œuvre s’inscrit dans ce qu’on a appelé au 19e siècle, le courant gothique troubadour. Alors il faut vraiment revenir sur Julie charpentier, la sculptrice du 19e siècle, auteur de ce buste de Clémence dont le père était graveur et qui logeait au Louvre. Elle a passé sa petite enfance dans ce lieu de prestige. Elle a été très précoce. Elle a pu avoir certains professeurs, mais elle s’est surtout formée par elle-même. Et ce qu’il faut dire aussi c’est que c’est en fait de l’État qu’elle recevait ses commandes. Ce qui n’est pas rien.
[Marthe Pierot]
Oui, on reconnaissait quand même son travail et son talent. Oui donc c’est vrai que là on vient de vous parler d’une femme artiste mais qui représente une mécène donc là on est vraiment dans un milieu très très féminin en tout cas pour terminer cet épisode. Et on voulait juste ouvrir aussi avec des mécènes un peu plus actuels qui sont des mécènes qui constituent des collections incroyables dans le monde entier. Là on s’ouvre par rapport au musée aussi mais par exemple on va vous donner des noms qui vont peut-être faire écho comme Helene Kröller-Müller ou Peggy Guggenheim. Voilà ces noms quand même parlent, beaucoup plus connus. Voilà c’est important aussi de montrer ce que les femmes font encore aujourd’hui. Donc c’est intéressant de parler de ces femmes qui ont vraiment enrichi les collections des musées, qui contribuent à la sauvegarde artistique, qui ouvrent des galeries, qui font des legs dans les musées par rapport à leurs œuvres.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà et là on est au 20e siècle.
[Marthe Pierot]
Tout à fait et on vous propose d’ailleurs de terminer cet épisode et de conclure un peu sur toute cette thématique très féminine.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc on a pu voir que l’image de la femme est très souvent éloignée de la réalité. Que son image correspond à des codes très stricts au Moyen-Âge on l’a vu et qu’au 19e siècle elle est un fantasme, elle est un objet de désir. On pourrait même se demander comment au 21e siècle on peut la représenter.
[Marthe Pierot]
Oui, c’est vrai en tout cas c’est intéressant de considérer toutes ces représentations avec un regard actuel, notre regard d’aujourd’hui. Parce qu’il nous permet vraiment de comprendre le passé mais aussi de se poser des questions sur le présent, d’avoir une une forme de réécriture, de relecture de tout ça. Et c’est important de questionner ces images et ces représentations féminines mais évidemment pas de questionner leur exposition. Le musée doit parler de tout ça pour comprendre le passé.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Trop de femmes créatrices demeurent cependant encore dans l’ombre. Mais une mise en lumière est enclenchée. Il y a eu au 20e siècle des mouvements féministes, des combats, des luttes qui ont porté cela. Mais il y a aussi l’importance de la responsabilité des musées. Leur politique d’acquisition a un rôle à jouer.
[Marthe Pierot]
Oui, c’est un des grands enjeux des musées aujourd’hui. C’est intégrer vraiment les artistes femmes aux collection publiques.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Cependant, l’expression même de femme artiste témoigne qu’elle demeure un problème. On n’a jamais besoin de préciser homme artiste. Ca c’est un peu fort.
[Marthe Pierot]
C’est vrai. Alors de toute cette manière-là dans tout ce qu’on a pu voir ensemble, c’était important de relier comment la femme avait une place à jouer dans l’art, dans le milieu artistique. On a vu son image, on a vu quand elle était artiste, mais on a vu aussi qu’elle était mécène. Mais elle ne fait pas que ça. Elle a d’autres rôles aussi, elle contribue à la connaissance, à la diffusion, à la préservation, à la conservation aussi des œuvres d’art. Parce qu’une femme elle peut être aussi historienne, scientifique, conservatrice, guide aussi dans les musées. On le voit aujourd’hui, les musées sont vraiment peuplés de femmes qui ont un rôle à jouer dans tout ça.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et on en est fières. Voilà donc merci de nous avoir écoutées et à très bientôt. Au revoir.
[Musique]
[Marthe Pierot]
Et pour compléter ce podcast n’hésitez pas à regarder les œuvres sur le site du Musée des Augustins.
[Musique]
[Rémi Roig]
Ce podcast a été réalisé par l’équipe du Musée des Augustins. A l’écriture et au micro Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot. Au montage Rémi Roig et à la coordination Ghislaine Gemin.
[Musique]
[Marthe Pierot]
Si vous avez aimé ce podcast n’hésitez pas à liker et à vous abonner.
Un artiste en son temps : Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)
L’incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019 rallume les braises mal éteintes d’un débat difficile à trancher : faut-il ou non conserver les interventions de Viollet-le-Duc dans les édifices patrimoniaux ? La cote d’amour de cet architecte parmi les plus célèbres de notre histoire a fluctué selon les époques, et ce depuis le 19e siècle. Ouvert à l’environnement, il est intervenu partout en France et a joué un rôle décisif dans la reconnaissance et la préservation de nombreux sites. Mais n’a-t-il pas été trop interventionniste parfois ?.. Aujourd’hui, la restauration obéit à des règles et suit des procédures très encadrées, pour une harmonisation des programmes de protection des sites et monuments.
À l’époque d’Eugène Viollet-Le Duc, ce cadre n’existait pas, laissant plus de place à la subjectivité et aux interprétations. Ce dont ne s’est pas privé cet amoureux passionné du Moyen Âge ! Retour sur un personnage controversé mais essentiel, sans lequel nombre d’édifices majeurs ne seraient plus là…
Partie 1/2
EUGÈNE VIOLLET-LE-DUC : ÉPISODE 1/2
[Musique]
[Voix masculine]
Les podcasts du musée des Augustins
[Musique]
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Histoire des arts, objectif BAC !
[Marthe Pierot]
Bonjour.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Bonjour à tous et toutes.
[Marthe Pierot]
Et bienvenue pour ce nouveau podcast du Musée des Augustins
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Nous sommes ravis de vous retrouver.
[Marthe Pierot]
Oui. nous sommes Isabelle et Marthe les deux conférencières du musée de Toulouse et pour cet épisode nous allons parler de Eugène Viollet-le-Duc, un artiste en son temps.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors dans la soirée du 15 avril 2019 vers 18h un grave incendie se déclare à Paris. Le sinistre qui ravage les combles, détruit la toiture de la cathédrale Notre-Dame ainsi que sa charpente du 13e siècle, sa flèche et tant de voûtes. L’incendie déclenche une émotion considérable en France, on s’en souvient, mais aussi dans le monde entier. Et on va garder à jamais dans les yeux, les images de la flèche qui brûle et qui se brise. La flèche d’Eugène Viollet-le-Duc édifiée en 1859. Alors rebâtir immédiatement, c’est une évidence qui s’impose. Rebâtir immédiatement mais comment ?
[Marthe Pierot]
Et à partir de là, le nom de Viollet-le-Duc est dans tous les esprits. Alors cet homme, c’est un architecte amoureux du Moyen-Âge mais surtout connu pour toutes les restaurations et les réparations des édifices qu’il a réalisése et ses constructions médiévales. Mais Viollet-le-Duc, il n’est pas que ça. Il est aussi historien, théoricien, pédagogue, professeur, dessinateur, écrivain, archéologue et même alpiniste. Voilà c’est vraiment un homme ouvert à l’environnement et c’est un artiste aux multiples facettes on va le voir. Mais surtout ce qu’il cherche à faire, c’est transmettre la connaissance en protégeant et en prolongeant la vie des constructions. Et il intervient partout en France.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Tout à fait. Alors il est considéré comme le précurseur de l’architecture moderne par les uns et par les autres il est considéré comme trop interventionniste. Viollet-le-Duc ne laisse donc pas indifférent près de 150 ans après sa mort. Le but de ce podcast est donc d’étudier son œuvre pour comprendre l’importance du patrimoine et les enjeux de ses restaurations.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait, et dans une première partie, nous allons surtout présenter cet homme qui était Viollet-le-Duc, cet artiste protéiforme.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et dans une deuxième partie, nous nous demanderons pourquoi il a tant fait débat ? Pourquoi son travail est si controversé ?
[Marthe Pierot]
Et bien c’est parti !
[Musique]
[Marthe Pierot]
Alors Viollet-le-Duc, cet artiste aux multiples facettes, nous allons pour mieux le comprendre, commencer par mieux le connaître. Et dans un premier temps parlons un petit peu de sa biographie. Donc cet homme est né en 1814 à Paris et meurt à Lausanne en Suisse en 1879. Ce qui est important c’est la famille dont il provient. Il est issu d’un milieu aisé. Son père était un homme de lettres et surtout il s’occupait de toutes les résidences royales. Donc il avait du réseau en quelque sorte et sa mère tenait un salon littéraire très important. Donc toutes ses relations avec sa famille et les puissants, vont beaucoup aider Viollet-le-Duc. Mais surtout ce qui déclenche tout, ce qui le marque, c’est quand il est tout enfant, quand il découvre Notre Dame de Paris. Il est ébloui par cette architecture et d’autres éblouissements suivront par la suite.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est vrai et un petit peu plus tard quand il est adolescent, il a vraiment l’esprit rebelle. Il a déjà le goût de la construction et du risque puisqu’on sait qu’à 16 ans il va construire des barricades pendant la Révolution de 1830. Et à 18 ans, quand il envisage des études supérieures, il refuse de rentrer dans le rang. Il dit et écoutez bien cette phrase – “si j’ai du talent que je sorte ou non de l’école, je percerai. Si je n’en ai pas ce n’est pas l’école qui m’en donnera”. Ca c’est dit. Donc c’est vrai, c’est vraiment un caractère bien trompé et il ne suivra pas les cours de l’école des Beaux-Arts de Paris. Cela lui vaudra également le mépris de nombreux architectes.
[Marthe Pierot]
Et en fait à la place, sa formation, c’est une formation de terrain. Il parcourt la France. Il étudie les anciens bâtiments en les dessinant. Il va vendre ses œuvres pour financer aussi ses voyages d’études à venir. Donc c’est vraiment comme ça qu’il se forme. Et ce statut d’architecte un petit peu marginal aura un immense succès quelques années plus tard auprès des jeunes étudiants réformistes eux aussi qui vont refuser la mentalité conventionnelle de l’architecture académique. Donc ça inspire.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Effectivement. Et il est important de dire qu’il obtient les faveurs et les commandes du régime en place sous Louis-Philippe et sous Napoléon III durant le Second Empire. Donc il jouit de la protection de ces deux monarques. Alors il se veut un homme de science mais il est un homme de cour. Il adore être en représentation et il a aussi une grande conscience de son talent.
[Marthe Pierot]
Alors quels sont ces grands chantiers ? Et bien évidemment on peut citer la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale d’Amiens mais quelques châteaux aussi comme celui de Pierrefonds dans l’Oise et surtout la Cité de Carcassonne qui est son plus grand chantier.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui. Alors à Toulouse, Viollet-le-Duc intervient sur trois chantiers. A la basilique Saint-Sernin, pour le donjon du Capitol et pour le collège Saint-Raymond. Et on sait qu’il réalise aussi bien sûr des plans et des dessins pour le couvent des Augustins et celui des Jacobins. Mais nous allons y revenir.
[Marthe Pierot]
Et oui bien sûr. D’abord présentons un petit peu toutes les facettes de Viollet-le-Duc. Il est architecte c’est sûr, mais il est aussi dessinateur. Parce que pour être un bon architecte, il faut être un bon dessinateur. Donc le dessin d’architecte, qu’est-ce que c’est ? C’est une technique fondamentale pour pratiquer l’architecture. Parce que le croquis, le dessin en amont permet de poser un concept, de mettre en forme une idée. C’est déterminant pour guider le regard.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc un dessin c’est difficile parce que il y a trois dimensions et il faut penser au plan, à l’élévation, à la coupe. Je pense que Viollet-le-Duc aurait adoré les logiciels d’aujourd’hui pour concevoir en 3D justement ses idées. Mais c’est vrai qu’il est un virtuose de la perspective et du dessin. Il sait donner l’illusion des volumes avec les moyens qu’il a, c’est-à-dire les moyens du 19e siècle. Ces dessins vont complètement modifier le concept du dessin d’architecture classique. Et il va également utiliser l’aquarelle pour certaines de ses vues avec des couleurs vives, des couleurs harmonieuses qui vont magnifier ces dessins. Ces dessins et ses idées, il faut le savoir, seront repris, copiés par de nombreux architectes par la suite. Notamment des gens comme Gaudi ou Le Corbusier.
[Marthe Pierot]
Oui qui sont des architectes du 20e siècle. Alors il utilise le dessin comme base pour son architecture mais il va aussi s’en servir pour communiquer et convaincre. Et pour toute restauration ou pour tout chantier très souvent il y a un concours qui nécessite donc une partie écrite, théorique et graphique afin de visualiser la proposition. Et en fait ce fut le cas pour Notre Dame et les dessins de Viollet-le-Duc sont véritablement au service de ses projets de restauration. Par exemple pour Carcassonne, dont les fortifications étaient en ruine – mais les ruines plutôt intactes – il va proposer des dessins pour améliorer tout ça. Et les dessins vont être soumis à Prosper Mérimée, une personnalité importante dont on va vous parler un peu plus tard qui lui-même va tenter de convaincre Napoléon III. Parce qu’en fait il faut convaincre la faisabilité du projet, justifier les coûts. C’est presque une démarche publicitaire ces dessins-là. C’est important et il utilise la même stratégie pour le château de Pierrefonds. C’est vraiment les dessins qui garantissent que le projet pourra se poursuivre même après sa mort.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui c’est vrai. Alors il y a des dessins aussi pour le couvent des Jacobins à Toulouse qui permettent d’étudier et de témoigner du gothique méridional propre à Toulouse. Ce fameux gothique de briques. Et il y a aussi bien sûr des dessins pour le futur Musée des Augustins. Ce sont des dessins qui vont servir de base à son travail. Car c’est un autre architecte qui va poursuivre le travail de Viollet-le-Duc une fois mort. Alors Viollet-le-Duc a dû imaginer pour le couvant des Augustins un tout nouveau bâtiment qu’il va intégrer dans un ancien couvent médiéval. Ca n’est pas une mince affaire. C’est tout un défi. Alors la municipalité de Toulouse se tourne vers Viollet-le-Duc pour le projet parce qu’il est déjà intervenu à Toulouse notamment pour la basilique Saint-Sernin. Donc il est connu.
[Marthe Pierot]
Oui exactement et il va proposer de nombreux dessins mais comme l’a dit Isabelle il meurt avant la réalisation du bâtiment. C’est donc son élève Denis Darcy qui va reprendre ses planches et qui va rendre concret son travail. Les deux architectes ont des interventions qui se succèdent. Mais tout ça est possible grâce au dessin en amont de Viollet-le-Duc. Il a réalisé une salle en rez-de-chaussée qui est collée au cloître avec un étage. Mais on va y revenir plus tard pour vous le détailler. On va parler beaucoup de cet exemple du couvent des Augustins parce qu’on travaille au Musée des Augustins donc c’est un sujet qu’on connaît.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est vrai. Alors on parle d’autres dessins encore qui sont des relevés qu’il a effectué lors de ses voyages. Il réalise ses dessins lors de son tour de France. Il fait des repérages et il pousse l’exploration toujours plus loin en allant de ville en ville et parfois dans les villages les plus reculés. Ces voyages sont précieux pour inventorier, relever et estimer l’état des bâtiments remarquables de France.
[Marthe Pierot]
Et puis il va aussi illustrer beaucoup de guides notamment un guide très important qui va faire l’inventaire de tous les bâtiments abîmés en France celui du baron Taylor qui s’intitule “Les voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France”. Donc il illustre tout ça et il va voyager en Italie. Il va d’ailleurs faire son grand tour personnel. Si vous avez écouté le podcast sur le voyage des artistes en Italie sachez que Viollet-le-Duc est parti là-bas aussi. Et ce qui est très important aussi dans son dessin, c’est qu’il va s’en servir pour enseigner aussi. Il utilise ses planches et ses dessins à destination de ses élèves. Et c’est ce qui nous amène à l’autre partie, l’autre facette de Viollet-le-Duc, le professeur qu’il était.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui. Il était un professeur et un auteur. Et il s’appuie beaucoup sur ses dessins pour enseigner. Ses dessins lui servent de matériel pédagogique. Il explique, il transmet, c’est un pédagogue et aussi pourrait-on dire un vulgarisateur. Il réalise plusieurs publications et on sait qu’il a écrit plus de 100 ouvrages. Dont certains ont un succès international au 19e siècle mais sont toujours aujourd’hui publiés.
[Marthe Pierot]
Oui, tout à fait. Alors le plus connu, c’est son “dictionnaire raisonné de l’architecture”. Il a réalisé cet ouvrage à partir de beaucoup de planches dessinées et c’est un ouvrage divisé en 8 volumes. C’est énorme. C’est une véritable encyclopédie de l’architecture médiévale, de l’architecture romane et gothique. Et en fait dans cet ouvrage il compile toutes les découvertes de son temps.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc on a compris qu’il a envie de transmettre un passé qui est surtout le Moyen-âge. Et le choix qu’il fait dans la restauration va témoigner de cela. En restaurant un monument, importe pour lui et par-dessus tout, l’idée d’en faire un outil didactique. Alors il a une fameuse phrase.
[Marthe Pierot]
Oui. Qui permet de comprendre ça voilà.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Cette phrase c’est “restaurer un édifice ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire. C’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné”.
[Marthe Pierot]
Oui, c’est très important parce que finalement la pédagogie est plus importante, quitte à déformer un petit peu la vérité pour nous faire comprendre quelque chose. Il restitue à l’objet une valeur historique mais pas vraiment une historicité, pas la vérité de l’histoire. Le monument est plutôt révélateur d’un moment de l’histoire. Mais finalement il tente de nous faire comprendre le passé. Ce qui a pu exister mais ça n’a pas forcément existé comme ça voilà. C’est ça cette subtilité-là. Donc il va se permettre de rajouter des choses. Mais on n’est pas tout à fait sûr de l’authenticité de ce qu’il fait. Donc pour lui, le monument est véritablement un lieu d’enseignement et d’études. Et il va dire je cite : “chaque chantier deviendrait une école, la meilleure de toutes”.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc un restaurateur qui est doublé d’un historien. Un historien qui lit, qui se renseigne, qui fait beaucoup de recherches. C’est dans ses travaux de restauration qu’il découvre dans le génie des édifices gothiques, un système de construction intemporel qui est basé sur l’observation de la nature. Donc il y puise une inspiration très forte et également dans les carnets de Villard de Honnecourt qui est un maître d’œuvre du 13e siècle qui est vraiment l’incarnation de la dignité de l’architecture médiévale. Ce qui est intéressant c’est que Viollet-le-Duc qui est tellement investi dans cette période médiévale et bien quand il dessine, il dessine en tenue médiévale. Car il estime qu’il faut se mettre dans la peau d’un artisan du Moyen-Âge.
[Marthe Pierot]
Donc, il s’inspire d’un architecte du Moyen-Âge et il va même aller jusqu’à se déguiser en lui. En tout cas on comprend bien que pour lui c’est important de connaître ce que le passé peut apporter à l’architecture de son époque qui est le 19e siècle. Donc il va étudier tous les savoir-faire, toutes les contraintes et les besoins qui ont pu à un moment donné amener les artisans ou les architectes à choisir une forme particulière ou une architecture particulière. Il se met vraiment à la place des bâtisseurs de l’époque et pour lui c’est vraiment un tremplin pour comprendre l’histoire des édifices. Il faut prendre en compte tout ça et même les mœurs d’une civilisation pour pouvoir restaurer et réparer un édifice ancien.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors il est l’un des premiers architectes restaurateurs et nous sommes dans les années 1840. Il va en quelque sorte fonder par sa restauration de la basilique de Vezelay en Bourgogne et par celle de Notre-Dame de Paris, une école française de la restauration. Alors son plus grand chantier a présent c’est Carcassonne. Et c’est un chantier titanesque.
[Marthe Pierot]
Oui, nous allons un peu développer cet exemple pour comprendre qu’est-ce qu’il s’est passé à Carcassonne. Sachez qu’au 19e siècle, la cité médiévale est terriblement délabrée. Les murailles sont démantelées et servent de carrière de pierre pour que les maçons locaux puissent se servir. On puise dedans. Et puis entre les deux enceintes, l’espace qu’on appelle des lices et bien est complètement envahi d’habitations misérables. Ca devient un refuge pour des habitants, pour les habitants les plus pauvres de la ville. Donc c’est complètement squatté.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Effectivement on peut le dire comme ça. Alors à l’intérieur de la cité, il y a une église qui est en fait la basilique Saint-Nazaire et c’est par elle que Viollet-le-Duc commence. Nous sommes en 1840. Il réalise une analyse très minutieuse de l’édifice et s’entoure de nombreux artisans dont des maçons, des maîtres verriers et les travaux vont se poursuivre pendant 25 ans. En 1849 c’est l’ensemble de la cité médiévale qui est classé Monument Historique. Et en 1852, la restauration commence vraiment.
[Marthe Pierot]
Alors qu’est-ce qu’il fait ? Et bien Viollet-le-Duc fait d’abord supprimer les maisons qui encombrent justement les lices, cet espace entre les deux enceintes qui était occupé. Et il va ensuite s’attaquer à la partie intérieure de l’enceinte puis il intervient sur les tours qu’il va faire couvrir. Les fortifications ne sont généralement abîmées qu’à leur sommet. C’est donc les parties hautes qui vont demander le plus d’attention notamment les crénelages, les voûtements et les toitures.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors Viollet-le-Duc va superviser à distance puisqu’il est un petit peu partout. Il est beaucoup à Paris et il ne se rend qu’une fois par an sur place. Et les opérations vont se dérouler notamment en considérant les tours de l’antiquité romaine qu’il faut aussi restaurer en partie supérieure. Et il va s’occuper également de la barbacane Saint-Louis. Cet ouvrage semi-circulaire et défensif.
[Marthe Pierot]
Et pour contribuer à tout ce travail, il va évidemment en tant que dessinateur, déployer tous les moyens graphiques qui sont à sa portée. Il va réaliser des plans à l’aquarelle, des croquis à la plume. Il examine tous les vestiges, toutes les archives, bref il maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Mais nous allons revenir plus en détail sur cette exemple-là dans la deuxième partie de ce podcast.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà. Alors on peut continuer avec d’autres exemples de ces restaurations notamment à Toulouse avec le donjon du Capitole. En fait c’est la tour aujourd’hui de l’office du tourisme. Mais c’était au 16e siècle, la tour des archives pour la municipalité toulousaine. Alors c’était une tour massive, carré, au toit plat. Mais justement la toiture, le couronnement de l’édifice avait disparu depuis longtemps. Il était dans un état de ruine qui laissait à Viollet-le-Duc les mains libres de choisir ce qu’il voulait pour faire justement ce toit. Et la restauration a été finalement très arbitraire. Il a décidé tout seul. Il a la volonté de donner à cette tour, une silhouette d’un véritable donjon médiéval. Alors il lui ajoute un chemin de ronde avec des machicoulis, des meurtrières. Et le résultat visuellement c’est un beffroi nordique avec un toit en très forte pente, une couverture en ardoise sombre surmontée d’une pointe donc d’une flèche très effilée qui est tout à fait dans l’esprit de celle de Notre-Dame de Paris justement.
[Marthe Pierot]
Si vous habitez à Toulouse n’hésitez pas à passer pour voir cette tour qui est toujours présente évidemment. Donc avec tout ce qu’on vient de voir on le comprend Viollet-le-Duc n’est pas simplement un restaurateur. Il ne rétablit pas que le passé, c’est aussi un moderne, un inventeur. Toutes ces créations font de lui un visionnaire. Ses dessins lui permettent de s’interroger, de travailler et d’imaginer différentes restaurations. Et donc il a véritablement une capacité à entrer dans le monde de l’imaginaire voir de l’utopie. Et il est architecte, maître de la perspective mais aussi du paysage. En véritable magicien, il nous montre parfois des visions complètement idéalisées d’un nouveau bâtiment ou d’un nouveau paysage. Il propose des reconstitutions. En fait il nous propose parfois une BD futuriste. Avec un toutes ses aquarelles très colorées, il propose des choses très nouvelles. Viollet-le-Duc a vraiment des visions du passé mais aussi de l’avenir.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et oui parce qu’au Musée des Augustins, quand il crée ce nouvel édifice – nous en avons parlé – et bien il va inventer quelque chose. Il se retrouve à composer avec un urbanisme du temps qui est la création de deux nouvelles rues. Et entre ces nouvelles rues et bien il faut – à la suite de la destruction d’un vieux réfectoire du couvent des Augustins – qu’il invente un nouveau bâtiment.
[Marthe Pierot]
Oui exactement. En fait le couvent des Augustins s’est transformé en musée. Donc il faut proposer un nouveau bâtiment qui puisse abriter les œuvres. Il le faut plus étroit justement pour qu’il puisse s’aligner avec les nouvelles rues en construction mais plus haut pour pas perdre en espace. Donc c’est un véritable challenge pour Viollet-le-Duc parce qu’il va proposer un bâtiment tout nouveau, dans un couvent médiéval qui n’était pas du tout adapté à être un musée, à une présentation d’œuvres. Et donc pour inventer cette architecture à partir d’un bâtiment existant, il faut connaître l’histoire de ce bâtiment, l’histoire de ce couvent, sa fonction, ses matériaux, son environnement.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui. Et en fait il a la responsabilité aussi de la conception de tout. De tous les éléments, les menuiseries, les huisseries, les ferronneries, les sculptures et les peintures décoratives et le mobilier également. C’est une œuvre totale, une œuvre d’art total qui fait intervenir tant de corps de métier.
[Marthe Pierot]
0ui. Alors quel est son projet au Musée des Augustins ? Et bien il va s’inspirer de cet ancien réfectoire qui a été détruit et il maintient la brique. Mais il s’adapte aussi au nouvel urbanisme. C’est ce qu’on disait. Aux rues qui se construisent à côté. Donc il propose des nouveaux volumes mais surtout des volumes avec des lignes plus sobres et simples. Et il est très audacieux parce qu’il ne va pas proposer une architecture gothique. Pourtant il est passionné du Moyen- Âge. On l’attendrait-là, et puis toute l’architecture du couvent des Augustins est gothique. Mais lui il va casser le rythme et il mélange dans cette proposition différents styles.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Par exemple il y a une inspiration très romane pour la grande salle du rez-de-chaussée avec des voûtes. Et il y a une inspiration très renaissante pour l’encadrement très soigné des fenêtres et pour la cage de l’escalier d’honneur qui est tout à fait dans l’esprit d’un château de Loire.
[Marthe Pierot]
Oui exactement. Alors Viollet-le-Duc pour terminer sur cette première partie, c’est important de dire, que certes il se focalise sur l’art du Moyen-Âge mais vous le comprenez, vous allez continuer à le comprendre, il est très moderne. Et on l’a déjà cité, mais il est très admiré par Le Corbusier – cet architecte du 20e siècle – qui dit que pour lui Viollet-le-Duc ce sont les racines de l’architecture moderne. Mais on va bien le comprendre il est adulé. Mais il est aussi parfois détesté. Et c’est très rare d’avoir des architectes qui suscitent autant le débat. Et rares sont ceux aussi qui ont à ce point imprimé leur marque sur les générations et les constructions futures. C’est vraiment un personnage très complexe.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc on rappelle le fait qu’il est un homme très introduit dans les milieux les plus hauts placés. Qu’il est également un romantique sensible à la grandeur de la France, à l’idée de Nation. Qu’il est le défenseur d’une vision totale de l’architecture pour atteindre à une certaine pureté du bâtiment. Et il est également un homme dans les combats de son temps. Engagé politiquement.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait. Donc finalement on s’aperçoit que Viollet-le-Duc dans ses interventions, il va modifier plusieurs monuments. Et c’est ce qui explique que son œuvre soit aussi controversée. Mais c’est aussi important de dire qu’en intervenant comme ça, ça aussi permis de sauver beaucoup d’édifices de la ruine.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est fondamental.
[Marthe Pierot]
Retrouvons-nous dans le 2ème épisode pour parler un petit peu plus de ce qui fait débat dans son travail.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
A bientôt, merci.
[Musique]
[Marthe Pierot]
Et pour compléter ce podcast, n’hésitez pas à regarder les œuvres sur le site du Musée des Augustins.
[Musique]
[Rémi Roig]
Ce podcast a été réalisé par l’équipe du Musée des Augustins. A l’écriture et au micro Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot. Au montage Rémi Roig et à la coordination Ghislaine Gemin.
[Musique]
Partie 2/2
EUGÈNE VIOLLET-LE-DUC : ÉPISODE 2/2
[Musique]
[Voix masculine]
Les podcasts du musée des Augustins
[Musique]
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Histoire des arts, objectif BAC !
[Marthe Pierot]
Bonjour à tous et à toutes.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Bonjour.
[Marthe Pierot]
Et bienvenue pour cette deuxième partie du podcast sur Eugène Viollet-le-Duc.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc dans une première partie nous avions vu que Viollet-le-Duc est un artiste aux multiples facettes : architecte, dessinateur, professeur, auteur historien et restaurateur bien sûr.
[Marthe Pierot]
Oui et dans cette deuxième partie, nous allons voir un petit peu plus pourquoi son travail a autant suscité et bien des foudres. Pourquoi il fait débat. Parce qu’en deux siècles on lui adresse louange et polémique, admiration ou colère. Il a eu l’ambition de restaurer, de sauvegarder un patrimoine en ruine, mais il a du même coup défiguré à jamais beaucoup d’édifices.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc on va se questionner autour de la restauration. Jusqu’où on doit s’arrêter pour ne pas dénaturer un édifice ? A l’époque de Viollet-le-Duc, le fait est qu’il n’y a pas vraiment de règle ou de cadre. Donc il y a beaucoup de liberté. Donc comment, pourquoi restaurer ?
[Marthe Pierot]
Oui pour comprendre son travail, c’est important de comprendre vraiment ce qu’est la restauration. Ne pas confondre avec le restaurant où l’on mange. C’est important de le dire, la restauration c’est vraiment tout ce qui concerne la sauvegarde, la réparation pour dire un autre mot d’édifice ou d’objets. Et en fait il y a toute une histoire autour de ça, parce qu’on n’a pas toujours eu cette volonté de réparer, de restaurer. Les premières restaurations commencent on va dire à la Renaissance au 16e siècle. Et c’est très lié à ce que la Renaissance veut. Parce qu’au moment de la Renaissance, on revient à l’époque de l’Antiquité. En tout cas on a envie de reparler de l’Antiquité. Donc il y a un intérêt pour les œuvres antiques, qui est de nouveau présent. Et donc ces œuvres qui sont très abîmées, parfois certains artistes vont avoir l’audace de vouloir compléter ces œuvres, ces fragments pour plus de grâce. Ce n’est pas toujours fait, c’est surtout imaginé, dessiné. Mais on imagine ce qui a été un peu détruit pour les œuvres antiques. Mais surtout c’est à partir du 19e siècle que se pose véritablement la question de la restauration parce qu’il y a eu la période révolutionnaire et beaucoup de vandalisme suite à la Révolution. Donc on est partagé entre cette période de vandalisme et cette volonté de sauvegarde. Et en plus il y a toute une génération de romantiques qui sont très sensibles à la ruine. Ils se prennent d’amour pour tous ces édifices détruits. Ils sont touchés et ils ont envie de préserver tout ce qui a pu être détruit.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc le vandalisme de la Révolution entraîne des réactions et surtout une prise de conscience de ce qu’est le patrimoine. Il faut protéger les biens, les édifices parce que ça a un intérêt pour le public. Donc la restauration prend forme en 1832 avec la création des Monuments Historiques. Et le plan de sauvegarde passe d’abord par un travail d’inventeur. Ensuite il y a la création d’un poste d’inspecteur et d’une commission. Cette commission est en charge de former les architectes qui interviennent sur les monuments à commencer par Eugène Viollet-le-Duc.
[Marthe Pierot]
Oui, même si on dit qu’il a fait un peu n’importe quoi, il était quand même formé pour intervenir sur des monuments qui étaient répertoriés et classés. Alors on a parlé de ces Monuments Historiques, de cette création, de ce label. C’est très important parce que Prosper Mérimée – on en a parlé dans le premier épisode on va le détailler un petit peu plus là – c’était l’inspecteur général des Monuments Historiques en 1834. Et en fait c’est une personnalité très importante, parce qu’il contribue à la restauration de nombreux monuments anciens. Et pour ça il se déplace partout en France pour faire un état des lieux, pour évaluer l’état des monuments et signaler les dangers qui les menacent. Et ensuite une fois qu’il a fait cet inventaire, il va travailler avec des architectes comme Eugène Viollet-le-Duc ou Émile Boeswillwald qui vont justement contribuer à la restauration. Mais selon lui, selon Prosper Mérimée, une restauration totale est toujours une forme de destruction. Il en a conscience. On intervient sur les édifices, on les modifie. Mais son rôle c’est de restaurer des monuments pour justement éviter de les condamner. Et il lutte contre le vandalisme. Le vandalisme qui s’est produit au moment de la Révolution et il a envie de sensibiliser les locaux et les usagers au patrimoine. Donc il a vraiment cette ambition de protéger, réparer et sensibiliser.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors Eugène Viollet-le-Duc a la volonté de réparer les dommages causés par la Révolution on l’a dit. Et sa méthode de restauration a fait débat parce qu’une grande part de ce qui est restaurée est pure hypothèse. Mais l’idée nouvelle c’est qu’il a été reconnu véritable restaurateur parce qu’il a gagné le concours de la restauration de Notre-Dame de Paris. Et pour lui c’est une belle revanche parce que justement n’ayant pas fait l’école des Beaux-Arts et bien là tout le monde va respecter son travail parce qu’il a gagné le concours.
[Marthe Pierot]
Tout à fait. Effectivement, c’est vrai. Alors on va essayer de comprendre un petit peu les débats qui ont eu lieu au niveau de la restauration parce que Viollet-le-Duc n’est pas le seul à restaurer ou à travailler dessus. Il y a en fait autant de styles ou de manières de restaurer qu’il y a eu de restaurateurs. Vraiment et comme on l’a dit, il n’y avait pas vraiment de règle au 19e siècle, donc chacun faisait un petit peu ce qu’il voulait. Et il y avait plusieurs théories sur la restauration qui se sont parfois même opposées parce qu’il y avait des concepts et des personnalités très différents. Et donc on s’aperçoit qu’au fil des années, il y a plusieurs théories sur la restauration qui ont vu le jour et qui se sont souvent opposées.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui par exemple on note deux points de vue qui s’opposent entre par exemple Quatremère de Quincy qui est un académicien idéaliste, autoritaire et très conservateur qui s’oppose à Viollet-le-Duc l’autodidacte pragmatique et moderne. Chacun a écrit son dictionnaire de l’architecture et chacun se retrouve dans la recherche de l’unité d’un bâtiment. Mais l’un défend un idéal grec donc classique et l’autre défend un idéal gothique donc médiéval.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait. Donc les concepts s’opposent. Mais ils ont quand même cette volonté d’appartenir à une restauration qu’on appelle stylistique vraiment et c’est ce que prône Viollet-le-Duc. Mais comme il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs concepts et il y a un moment d’autres personnalités qui vont prôner autre chose : une restauration qu’on appelle la restauration conservation. Et là justement il n’y a pas de question de style. On veut respecter l’original et limiter l’intervention au maximum. Et cet homme John Ruskin qui est un critique d’art et un théoricien anglais, il défend ça. Pour lui, il faut prendre soin des monuments, les protéger, les conserver pour ne pas avoir à les restaurer. Donc il faut privilégier la conservation pour ne pas avoir à intervenir parce que c’est toujours une agression sur les édifices ou les objets. Et puis la réflexion évolue. Il y a notamment Camillo Boito qui était un théoricien italien cette fois-ci. Il compare les théories de ces deux personnages Viollet-le-Duc et John Ruskin pour en tirer sa propre théorie un peu plus modérée. Pour lui, il se dit : très bien il faut limiter la restauration. Il faut donc valoriser la conservation, mais quand on restaure, c’est possible, il faut utiliser des matériaux et un style dissociable de l’original. Il faut pouvoir identifier ce qui a été rajouté pour ne pas mélanger les époques et comprendre qu’il y a eu une intervention. Et ensuite, vous avez une autre personnalité Émile Boeswillwald – on en a déjà un petit peu parlé tout à l’heure. Et bien lui, il va succéder à Prosper Mérimée au poste d’inspecteur général des Monuments Historiques et il collabore beaucoup avec Eugène Viollet-le-Duc. Et notamment il va poursuivre le travail de Viollet-le-Duc à Carcassonne après sa mort. Donc il succède véritablement.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc après avoir donc évoqué ces personnalités importantes dans le monde de la restauration au 19e siècle, il faut se dire que ça n’est qu’au 20e siècle que la restauration est théorisée. Elle est théorisée par un certain César Brandi, un Italien, un historien et critique d’art considéré comme le père de la restauration moderne. Il crée l’Institut centrale de la restauration qui ouvre ses portes en 1939 et il est l’auteur de la théorie de la restauration et cela en 1963. Et c’est pour longtemps le texte de référence de la conservation restauration. C’est ce texte qui parle véritablement du fait qu’il faut respecter l’intégrité d’un objet.
[Marthe Pierot]
Oui c’est très important. C’est vraiment le 20e qui va commencer à poser des cadres. Alors ce qu’on vous propose c’est d’illustrer un petit peu les restaurations de Viollet-le-Duc avec des exemples concrets pour voir un petit peu qu’est-ce qui a pu faire débat. Et en fait quel est le style de Viollet-le-Duc finalement ? Quel est le style de sa restauration ? Quelle est sa méthode de travail ? On vous l’a dit dans la première partie, il travaille beaucoup à partir de dessins. Il fournit des dessins, des vues aquarellées à mémoire explicatif. Bref il dresse un inventaire très rigoureux et s’appuie sur une enquête scientifique. Donc il travaille quand même sur l’époque et le bâtiment avant même de proposer quelque chose. Mais il va recréer des éléments d’architecture, ce qui manque en déduisant leur forme d’après des études stylistiques. Donc ce n’est pas toujours juste mais pour lui la restauration est une démarche moderne quoi qu’il en soit. Et il réétablit un état ou un édifice qui n’a peut-être jamais existé en se basant sur ses recherches qui pourraient exister mais qui n’est pas forcément réaliste. Mais il prend des décisions et il fait des choix.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui et donc ça c’est du courage.
[Marthe Pierot]
C’est audacieux.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors dans un premier temps, il reconstitue le monument par fragment. Puis il cherche à restituer le style local, le style régional par exemple. Et enfin au troisièmement et bien il va utiliser la photographie pour être parfaitement objectif au sens de l’objectivité photographique. C’était un nouveau médium pour justement être sûr de l’état d’un chantier à un moment donné. Donc il utilise des moyens très modernes. Alors avec lui on peut dire avec Viollet-le-Duc que les chantiers on se rationalise parce qu’il y a cette investigation scientifique. Mais il y a aussi des innovations techniques parce qu’il va mettre au point des échafaudages d’un type un peu nouveau pour justement des chantiers encore plus performants. En 1894 c’est le premier concours d’architectes des bâtiments historiques. Ca c’est vraiment une date.
[Marthe Pierot]
Alors ce qu’on vous propose c’est de prendre l’exemple d’une de ses plus célèbres restaurations qui est la cité de Carcassonne. On en a déjà parlé dans l’épisode 1 mais ici on va vraiment voir comment il a pu sauver cette grande cité qui était laissée à l’abandon. Mais à quel point ça a pu être compliqué pour lui de faire ce qu’il a fait. A quel point cette intervention a soulevé quelques foudres. Parce qu’il y avait quand même des réalités concrètes à prendre en compte, les autorités locales, les notables, les commissions des Monuments Historiques pouvaient parfois un peu faire barrage à ces propositions. Donc pour lui, il fallait composer mais convaincre surtout et proposer des solutions architecturales qui étaient acceptées par tout le monde parce que ces réalisations sont quand même loin de faire l’unanimité. Donc il prend quelques libertés avec la réalité historique et il fait des choix surprenants qu’il faut parfois justifier. Mais ce qui comptait pour Viollet-le-Duc c’était véritablement de restituer la cité telle qu’elle pouvait apparaître à la fin du 13e siècle. Et donc par exemple Viollet-le-Duc pour restituer la cité, il va tenter vraiment de la proposer comme elle pouvait exister au 13e siècle d’après ses recherches mais rien n’est sûr. Il fait ajouter un pont levis à la porte narbonnaise qui était l’entrée principale de la cité. En fait on ne sait pas du tout s’il y avait un pont levis à cet endroit.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui on sait que dans les châteaux forts il y a des ponts levis, mais il y en avait peut-être pas là. Donc l’élément néanmoins le plus controversé concerne les tours de l’enceinte. Sur une grande partie des tours d’enceinte de la cité, il s’attaque à la partie supérieure et il fait poser des loses d’ardoise gris sombre sur des toits très pentus. Alors qu’en fait une bonne partie des tours va conserver et bien un toit plat en tuile rouge. Donc en fait résultat, il y aura deux styles qui vont s’équilibrer. Mais ça va beaucoup surprendre ces toits pointus. On se croit au centre de la France avec cela. 0n peut dire aussi que si jusque dans les années 1960 ses transformations ont été critiquées, elles font aujourd’hui pleinement partie du visage de la cité qui est inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de l’UNESCO.
[Marthe Pierot]
Oui c’est important effectivement de le dire. Et comme on l’a expliqué tout à l’heure, les règles de la restauration se sont durcies au 20e siècle. Il y a eu de nombreuses chartes notamment celles d’Athènes, de Venise. Des règles, des théories et donc finalement la légitimité de son travail commence à être remise en question parce que ce qu’il a réalisé c’était trop interventionniste pas assez réaliste ou pas assez authentique. Donc on va même se demander si on ne devrait pas toucher à son travail. Alors à Carcassonne on ne touche pas à ce qu’il a réalisé.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui, oui et d’ailleurs on est aujourd’hui en 2024 et on est en train de terminer une restauration de la cité qui est extrêmement fidèle à ce qu’avait voulu Viollet-le-Duc.
[Marthe Pierot]
Oui c’est vrai. Mais à Toulouse on procède différemment. Et dans les années 80, on va faire le choix d’enlever certains de ces ajouts qui ont été jugés comme incongrus ou anachroniques.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui c’est vrai. Alors c’est une étude de cas véritablement, de cas local qui est celui de la basilique Saint-Sernin de Toulouse qu’on a nommé la basilique de la discorde à la fin du 20e siècle pour une restauration qui devient une dérestauration. En fait, on reproche à Viollet-le-Duc certaines erreurs. C’est vrai que ça donne lieu à une émotion patrimoniale qui est montée très très haut à la fin du 20e siècle. Donc on sait qu’en 1838 la basilique Saint-Sernin de Toulouse est classée Monument Historique. En 1846, il y a un projet de rénovation de la tête de l’Église. Et en 1860 les travaux débutent. Il y a urgence parce que les toits de l’église prennent l’eau. Ils ne sont plus imperméables. Il faut intervenir. Donc Viollet-le-Duc a l’idée de créer des décrochements successifs de la toiture. Il va étager ou étaler les toits. Il va ensuite remplacer les tuiles rouges en terre cuite par des dalles de pierre claire mais lourde puisque c’est de la pierre. Et ensuite il va avoir l’idée de supprimer toutes les petites fenêtres toulousaines qui sont en dessous du niveau du toit et qu’on appelle des Mirandes. Des petites fenêtres à la base carrée avec un plein cintre. Donc il va rétablir un édifice dans un état qui n’a peut-être jamais existé justement. Il fait œuvre de création parce qu’il voulait faire de Saint-Sernin l’édifice type de la basilique romane selon une tradition. Mais ce parti pris de Viollet-le-Duc entraîne des restaurations qu’on va juger excessives.
[Marthe Pierot]
0ui exactement. Et donc qu’est-ce qui se passe au 20e siècle ? Et bien en 1979, l’année du centenaire de la mort de Viollet-le-Duc, la Commission des Monuments Historiques décide une “déviolletisation”. On peut le mettre entre guillemets. C’est vraiment l’idée de vouloir retrouver l’état originel de la basilique avant les ajouts du restaurateur. Et donc qu’est-ce qu’on va enlever ? Et bien on revient en fait au toit unique. On revient aux tuiles rouges et on rétablit les Mirandes. Voilà et il y a des débats houleux et passionnés dans les années 80 entre 79 et 80 parce que ça fait débat. Il y avait même des manifestations, des camping-cars et des caravanes qui faisaient un sitting autour de Saint-Sernin pour justement un peu débattre autour de tout ça. C’était très vif mais la décision est tranchée en 1990 par le ministre Jack Lang. C’est Paris qui tranche. Il y aura une “déviolletisation”. On enlève ce qu’il a réalisé.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors à Toulouse, il y a un autre exemple de dérestauration. C’est celle du collège Saint-Raymond. Un bâtiment du 16e siècle devenu musée. Au 19e siècle Viollet-le-Duc restaure les parties hautes de ce vieux collège en créant un crénelage de brique. Il adore s’occuper des parties hautes des édifices. En 1982 c’est la dérestauration. C’est le retour à l’état d’avant Viollet-le-Duc parce que le couronnement de l’édifice par Viollet-le-Duc a été considéré comme une erreur d’interprétation. Parce que Viollet-le-Duc avait supprimé les Mirandes. Ces petites fenêtres qui avaient vraiment une fonction précise qui était celle d’aérer les combles. Donc lui, il a cru bon de rétablir un crénelage qui en fait n’avait jamais existé. Donc Viollet-le-Duc est vraiment entre le désir de rétablir un état ancien d’un bâtiment et le souci de le sauvegarder. Et ça ça a pu le faire arriver à une solution hybride qui ne se justifiait pas et qui faisait regretter l’état ancien. Donc les critiques sont virulentes encore jusqu’à la fin du 20e siècle.
[Marthe Pierot]
Oui c’est vrai. Mais c’est important de dire que si nous sommes sensibles à la notion du patrimoine aujourd’hui c’est grâce à Viollet-le-Duc. Parce qu’il a sauvé beaucoup de bâtiments. Et sa virtuosité ont permis de sauvegarder des édifices qui n’existeraient peut-être plus aujourd’hui et qui nous ont permis de comprendre leur importance. Même si ce n’est pas toujours authentique, il a assuré la pérennité et la sauvegarde de beaucoup de bâtiments. Et c’est important vraiment de vous dire que les deux exemples que l’on vous a donnés sur Toulouse, on a envie d’enlever ce qu’il a ajouté. Ca pose question quand même aujourd’hui parce que ça va à l’encontre des règles de la restauration où on ne touche plus les édifices parce que ce qu’il a fait, ça fait partie de l’histoire. Et justement c’est ce qui s’est passé, c’est ce qui a fait débat pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui absolument. C’est le débat donc autour de la flèche de Notre-Dame. Cette pointe qui surmonte l’ensemble de l’édifice. Donc après la première flèche du 13e siècle qui avait été fragilisée par les intempéries et démontée à la fin du 18 siècle.
[Marthe Pierot]
Il y a une deuxième flèche qui a été construite par Eugène Viollet-le-Duc en 1859 et qui a été détruite vous le savez en 2019 par le feu.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc la question de la construction éventuelle d’une troisième flèche a fait immédiatement débat après l’incendie.
[Marthe Pierot]
Exactement. Et c’est finalement une reconstruction à l’identique qui a été préférée en juillet 2020, parce qu’en fait ça fait partie de l’histoire. Alors pour conclure, qu’est-ce qu’on peut dire ? Et bien il faut rappeler qu’aujourd’hui la restauration obéit à des règles très très strictes à la différence du 19e siècle. Et donc il convient véritablement de respecter une forme d’intégrité et d’histoire par rapport à ce qu’on va restaurer. Il y a trois règles très importantes : la stabilité c’est-à-dire qu’il faut utiliser des matériaux qui ne menacent pas en fait l’objet ou l’édifice qui sont bien compatibles ; la réversibilité, ça veut dire qu’on doit toujours pouvoir enlever ce qui a été fait si jamais ça a été mal fait comme ça a été le cas pour Viollet-le-Duc par exemple et la lisibilité. Il faut pouvoir voir ce qui a été restauré au 21e siècle pour le différencier de l’authenticité de l’objet. Donc on va limiter au maximum l’intervention sur l’objet. Quand même la restauration vient en dernier, il faut d’abord conserver, protéger l’objet ou l’édifice avant tout.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors que la restauration qui vise à améliorer la visibilité d’une œuvre, la compréhension d’une œuvre, elle est facultative. Elle est importante pour une transmission aux générations futures, mais elle peut n’être qu’esthétique. Elle n’est pas indispensable. La déontologie c’est à dire l’ensemble des règles de la restauration, va en ce sens à l’opposé de ce que Viollet-le-Duc faisait.
[Marthe Pierot]
Exactement. Donc on ne peut pas s’empêcher de se demander si Viollet-le-Duc existait aujourd’hui, est-ce qu’il aurait pu faire tout ce qu’il a fait ? Il est évident que non. Il n’aurait pas pu faire tout ça. Mais faut-il éliminer son travail pour autant ? Faut-il le “déviolletiser” ?
[Isabelle Bâlon-Barberis]
En tout cas le climat passionnel c’est à peine apaisé parce qu’on voit bien avec l’exemple de Notre-Dame de Paris que la question reste très sensible. Elle est d’autant plus que c’est une des spécialités du BAC que le sujet sur Viollet-le-Duc. Donc on comprend combien la question se pose encore.
[Marthe Pierot]
Et oui c’est un sujet très actuel et c’est un homme qui est très important de comprendre pour mieux appréhender un petit peu toutes ces questions. Voilà nous avons terminé merci beaucoup d’avoir suivi ces épisodes et ces podcasts du musée des Augustin.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui merci encore de votre attention et à bientôt.
[Marthe Pierot]
Au revoir.
[Musique]
[Rémi Roig]
Ce podcast a été réalisé par l’équipe du Musée des Augustins. A l’écriture et au micro Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot. Au montage Rémi Roig et à la coordination Ghislaine Gemin.
[Musique]
[Marthe Pierot]
Si vous avez aimé ce podcast, n’hésitez pas à liker et à vous abonner.
[Musique]
Arts, ville, politique et société : le voyage des artistes en Italie, 17-18e siècles.
Étape essentielle dans la formation des artistes européens (dès le XVIe siècle), le voyage des artistes en Italie est une rencontre avec une civilisation et son histoire.
Les motivations, les attentes et la durée du voyage en Italie diffèrent selon les artistes et évoluent au cours de ces trois siècles.
Partie 1/2
LE VOYAGE DES ARTISTES EN ITALIE : ÉPISODE 1/2
[Musique]
[Voix masculine]
Les podcasts du musée des Augustins
[Musique]
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Histoire des arts, objectif BAC !
[Marthe Pierot]
Bonjour à tous et à toutes.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Bonjour.
[Musique]
[Marthe Pierot]
Et bienvenue pour ce podcast du Musée des Augustins. Nous sommes Marthe et Isabelle, les conférencières du musée et on vous propose aujourd’hui un podcast en 2 épisodes sur le thème…
[Isabelle Bâlon-Barberis]
…du voyage des artistes en Italie du 17 au 19e siècle.
[Marthe Pierot]
Exactement. Et on va vous raconter cette histoire à la lumière des œuvres qui se trouvent au musée de Toulouse évidemment et nous ne nous appuyons que sur les artistes qui sont présents au musée.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est parti, Allons-y !
[Musique]
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors ce voyage constitue une étape essentielle pour la formation des artistes européens et cela dès le 16e siècle. Les jeunes artistes rêvent de voir le patrimoine italien et c’est une rencontre avec une civilisation, avec son histoire et leur motivation, leurs attentes et la durée du voyage en Italie diffèrent selon les artistes et va évoluer au cours des trois siècles.
[Marthe Pierot]
Et oui tout à fait. Et on a envie de se demander pourquoi l’Italie finalement ? Donc quand on remonte un petit peu le temps, on s’aperçoit que c’est une destination de prédilection dès le Moyen-Âge. Parce qu’il y avait beaucoup d’échanges universitaires entre la France et l’Italie mais évidemment pour des familles nobles.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui à l’époque de la Renaissance, c’est une émulation artistique réelle que l’Italie. Il y a une circulation des hommes, des idées. Mais il y a également une circulation des gravures. Les gravures qui sont issues des chef-d’œuvres. Et elles vont circuler et faire découvrir aux artistes, l’art antique et l’art de la Renaissance italienne.
[Marthe Pierot]
Oui ça c’est important. Et puis ça continue au 17e siècle. En réaction contre la religion protestante, l’église passe beaucoup de commandes parce que justement l’église se sert de l’art comme une propagande. Donc l’église devient un mécène très important et le marché de l’art est en pleine expansion à ce moment-là.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et à la fin du 18e siècle, il y a la fameuse découverte de Pompéi qui va booster le voyage. Au nom de la connaissance, le voyage en Italie s’impose et ça devient l’aventure de leur vie pour tant d’artistes voyageurs pourrait-on dire.
[Marthe Pierot]
Oui et après – et on va le voir un petit peu plus tard – on s’aperçoit que le voyage va vraiment s’institutionnaliser grâce à la création du prix de Rome qui va permettre aux artistes de séjourner en Italie.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et enfin il y a une pratique touristique qui va se développer pour toute la jeunesse issue d’un milieu favorisé c’est ce qu’on appelle le grand tour. Avant de fonder une famille, de démarrer une carrière et bien les jeunes gens d’une élite – ce ne sont pas que des artistes – vont faire ce grand tour, ce voyage de formation à travers toute l’Europe et c’est un passage obligé.
[Marthe Pierot]
Oui c’est vrai. Alors il y a plusieurs enjeux pour un artiste quand il fait ce voyage. Déjà il y a un enjeu pédagogique, un enjeu de formation selon deux objectifs précis d’abord enrichir son inspiration d’après l’art antique qui est incontournable mais en même temps se confronter au maître de la Renaissance italienne.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et il y a aussi un enjeu de carrière. Donc il y a ce dynamisme du mécènat. Ces nombreux commanditaires qui existent en Italie. Rome est le siège de la chrétienté. Il y a le Vatican. Les artistes rêvent de travailler pour les plus puissants et pourquoi pas pour les papes.
[Marthe Pierot]
Ca c’est pas rien, ça c’est vrai. Et puis il y a le dernier enjeu qui est celui quand même de la découverte personnelle. On va voir aussi que le voyage en Italie est une véritable introspection et même parfois un lieu de refuge.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors on va commencer en se demandant comment les artistes se rendent en Italie ? Dans quel cadre ils font ce voyage ? Quelles sont les raisons qui évoluent au fil des siècles et des modes ?
[Marthe Pierot]
Oui et dans une deuxième partie, on essaiera vraiment de comprendre comment les artistes ont été marqués par ce voyage. A quoi ça se voit dans leur travail, dans leurs œuvres ? Qu’est-ce qu’ils ont trouvé comme influence en Italie ?
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà et bien c’est parti.
[Musique]
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors comment les artistes voyagent en Italie ? De nombreux récits du 17 et du 18e siècle relatent les voyages des artistes. Certains artistes se rendent en Italie seul par leurs propres moyens. Ils se débrouillent en sorte et d’autres font le voyage grâce à des structures très officielles. Et c’est ce que permet justement le prix de Rome. Il institutionnalise le séjour en Italie.
[Marthe Pierot]
Oui. Alors le prix de Rome c’est vraiment un concours sans précédent. Il est créé en 1663, organisé par l’Académie royale de sculpture et de peinture. Et en fait c’est un concours très prestigieux qui vise à récompenser les artistes français. Et il existe pendant très longtemps parce qu’il est créé sous Louis XIV et il va durer jusqu’à Malraux, parce qu’il est supprimé en 1968. Donc ça c’est quand même très important. Et quelques années après la création de ce prix, il va y avoir la création d’une académie de France à Rome. Et cette académie accueille les artistes et elle facilite vraiment le séjour des artistes français en Italie.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et sous l’Ancien Régime, c’est-à-dire avant la Révolution Française, la pension et le séjour à Rome sont déterminés par la faveur royale. Le roi seul accorde ce privilège.
[Marthe Pierot]
Oui donc c’est un peu pipé. C’est pas parce qu’on gagne le concours qu’on y va. Alors c’est un séjour qui s’organise entre 2 et 4 ans, mais il y a des conditions. Les artistes sont logés et nourris gratuitement. Ils perçoivent une allocation qui couvre leurs frais mais ils doivent en échange envoyer des œuvres, leurs grandes productions. Et c’est comme ça qu’ils vont enrichir les collections françaises, les collections de l’État parce qu’ils vont envoyer régulièrement leur travail.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et après la Révolution, Napoléon place l’Académie de France à la Villa Médicis et les lauréats y séjournent automatiquement systématiquement. Le roi n’existe plus, il n’a plus son mot à dire. Il ne peut plus s’opposer.
[Marthe Pierot]
Tout à fait.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et il faut signaler que rares étaient les élus. Quelques lauréats seulement chaque année pour trois disciplines : peinture, sculpture et architecture. Et ensuite arrivera la musique au 19e siècle.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait. Alors on va vous présenter quelques artistes qui sont présents au musée et qui ont remporté ce prix de Rome. 0n commence notamment avec un peintre de la région : Ingres. Un peintre du 19e siècle qui naît à Montauban et il remporte le prix de Rome en 1801. Alors il va passer 18 ans comme pensionnaire à la Villa Médicis. Il a une véritable reconnaissance officielle quand il rentre en France. Mais il repart après en Italie pour 7 ans de plus et devient carrément le directeur de la Villa Médicis. Donc au total, il passe 25 ans de sa vie en Italie.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui tout à fait. Alors ce qu’on connaît de Ingres c’est par exemple la grande odalisque, les bains turcs. Donc c’est ce visage tout à fait orientaliste du peintre. Mais il s’est rendu à Rome et à Florence. Il s’est enrichi. Il a été fasciné par Raphaël, par la Renaissance, par l’archéologie, par l’Antiquité et c’est ce qui va développer son côté néoclassique.
[Marthe Pierot]
Tout à fait et au musée, nous avons un tableau qui est un véritable sujet d’histoire romaine. Un tableau qui s’intitule “Tu Marcellus Eris”. Et en fait c’est l’histoire qui raconte le moment où un poète romain, qui s’appelait Virgile, lit un morceau de son texte devant des personnages dont l’empereur Auguste qui est le premier empereur de Rome. Donc on a des personnages historiques très importants ici. Et en fait c’est l’histoire de la mort de celui qui aurait dû remplacer Auguste à la tête de l’Empire. Mais ce qui nous intéresse dans ce tableau, c’est la composition qui est ultra classique. Tout est dans l’ordre et dans la mesure. Les personnages sont en frise c’est-à-dire qu’ils s’alignent vraiment les uns à côté des autres. Au premier plan, les silhouettes sont parfaitement idéalisées et elles répondent à des canons très classiques. Des personnages élancés, des têtes réduites, des profils grecs c’est-à-dire quand le nez est dans la continuité du front et même le mobilier, les vêtements sont romains. Il y a des drapés, des toges, des décorations géométriques. Voilà tout est là pour rappeler l’Antiquité et c’est ça qui est très néoclassique et c’est ça qui l’a inspiré en tout cas.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Tout à fait. Alors un autre peintre à avoir gagné ce prix de Rome c’est le peintre Louis Joseph le Lorrain. Et lui et bien on se souvient de lui pour le courant baroque, pour la théâtralité, l’emphase et l’exubérance de sa peinture. On est au 18e siècle et lui il a été pris de Rome en 1739. Donc au musée, nous avons l’étude c’est-à-dire ce qu’on appelle le modelo d’une peinture qui était destinée à être placée au plafond d’un palais. Donc c’est une version préparatoire mais dans laquelle s’exprime déjà tous les trompes-l’oeil que l’on peut imaginer. Il s’agit de L’apothéose d’Hercule. Donc il faut savoir qu’à Rome il y a beaucoup de plafonds en trompe-l’oeil notamment dans les églises.
[Marthe Pierot]
Oui et c’est le cas du tableau qu’on a au musée où il s’agit de L’apothéose d’Hercule. Et ce qui est impressionnant, c’est d’avoir cette impression de ciel infini au centre alors que le tableau et le plafond sont plats Mais on a vraiment cette sensation d’être aspiré vers un ciel qui s’ouvre jusqu’à l’infini. Et c’est un véritable jeu illusionniste. Et tout paraît faux. En fait tout paraît vrai et tout est faux dans ce tableau parce que l’architecture elle est vraiment fantaisiste. Et d’ailleurs il fait beaucoup de ça dans ses tableaux. Il réalise beaucoup, il invente beaucoup d’architectures. Et on ne sait pas vraiment où commence la peinture et où s’arrête l’architecture ? Il y a des fausses voûtes, un faux cadre, une fausse bordure, du faux marbre… Bref c’est un trompe-l’œil étourdissant et ça c’est caractéristique du baroque c’est-à-dire la théâtralité et la démesure comme tu l’as dit.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui c’est vrai. Mais il y a quand même un sujet dans ce tableau. Il a une histoire. Hercule après ses 12 travaux est enfin accepté sur le mont Olympe. Il a fait ses preuves et il mérite d’accéder au statut de Dieu. Alors il est représenté ici selon une toute petite échelle. Il est sur une mer de nuages debout sur un char qui est tiré par des lions qui le hissent vers son ultime destinée. Le sujet est tout à fait mythologique et il est prétexte à ce jeu sur la profondeur. Louis Joseph le Lorrain en se déplaçant à Rome – parce qu’il est prix de Rome – découvre une manière de peindre vraiment comme je le disais dans l’exubérance. C’est une tendance très italienne qui n’était pas du tout le goût français à l’époque puisque le goût français c’était le goût classique.
[Marthe Pierot]
Alors le prix de Rome continue même au 19e siècle et nous avons un artiste qui s’appelle Antonin Mercié qui le remporte en 1868. Et en fait lui, il voyage et séjourne en Italie. Et c’est un rêve pour lui parce qu’il va découvrir les œuvres d’artistes qu’il admirait tant Donatello et Michel-Ange. C’étaient vraiment ses idoles. Et donc là il va pouvoir grâce à ce prix de Rome, voyager en Italie et voir un petit peu tout ce travail et s’en inspirer. Et de retour en France, il va même aller jusqu’à intégrer un groupe qui s’intitule le groupe des Toulousains mais qui se retrouve à Paris. Donc il a quand même une volonté de revendiquer ses origines méridionales. Mais il s’appelle aussi le groupe des florentins parce qu’il revendique aussi un goût prononcé pour la Renaissance. Et donc il y a vraiment cette volonté de revenir à l’art de l’Antiquité alors qu’on a parlé du baroque tout à l’heure qui était dans la démesure. Là finalement, on a un peu envie de revenir à quelque chose de très contrôlé, très ordonné. Alors dans cet esprit justement il y a une sculpture au musée en bronze qui représente David et Goliath. Alors c’est une histoire de l’Ancien Testament. David c’est un jeune berger – nous sommes en Israël – et il deviendra plus tard carrément le roi d’Israël grâce à un exploit parce qu’il va réussir à tuer le géant Goliath qui est un membre des Philistins. C’est ce peuple guerrier et ennemi juré d’Israël. Et il arrive à tuer ce géant, alors qu’il est très jeune, un adolescent, parce qu’il va utiliser une fronde. Et donc finalement on utilise beaucoup cette histoire comme une forme de métaphore où on se dit que c’est le plus fort qui n’est pas toujours celui qu’on croit. Parce que finalement David a réussi à prouver sa valeur autrement que par la force mais grâce à son intelligence et à son courage.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Tout à fait oui, c’est vrai. Mais en fait David alors comment il se présente ? Et bien on le voit dans un geste ample, qui replace l’épée dans son fourreau, un pied posé sur la tête du géant qu’il vient de tuer. Et la référence à l’Antique quelle est-elle ? Et bien c’est cette étude de l’anatomie de son corps adolescent avec des proportions parfaitement harmonieuse, tel un éphèbe grec. Et il y a également ce contrapposto, le fait qu’en étant debout, il a une jambe raide et l’autre légèrement fléchie. Donc ce qui crée ce déhanché qui est très antique. Alors c’est vrai que cette œuvre a eu un succès extraordinaire. Et on lui connaît de nombreuses versions et c’est une œuvre qui se trouve également au musée d’Orsay à Paris.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait. Bon alors ça c’est pour ceux qui pouvaient gagner le prix de Rome et aller en Italie en obtenant cette bourse et tous ses privilèges. Mais tout le monde n’a pas la même opportunité de séjourner en Italie grâce à ça. Il y a d’autres manières et notamment le grand tour.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà alors le grand tour, c’est vraiment une institution. C’est quelque chose qui va avoir lieu à travers toute l’Europe. Donc au 17e siècle, le voyage en Italie devient un aboutissement magistral. Le grand tour s’organise sur des itinéraires qui favorisent les rencontres entre intellectuels, aristocrates, financiers, diplomates et artistes. Mais voilà, l’idée c’est qu’il n’y a pas que des artistes qui fassent ce grand tour. Donc c’est une jeunesse dorée, une jeunesse cultivée qui va pratiquer ce voyage qui va parfaire son éducation. Et on a donc Rome, Florence, Venise pour les pôles qui sont les plus importants. Et à partir disons de la seconde moitié du 18e siècle, c’est le sud de l’Italie avec bien sûr Naples et Pompéi qui vont avoir beaucoup de succès. Donc un voyage de formation.
[Marthe Pierot]
Oui, un petit peu comme un genre d’Erasmus finalement. On voyage quand on est jeune pour se former même si c’est évidemment réservé à une jeunesse de l’aristocratie quand même. Alors beaucoup d’artistes font ce grand tour et pas que des français. Nous avons un artiste au musée qui est hollandais, un peintre du 17e siècle qui s’appelle Van Wittel. Et donc lui, il va faire ce grand tour, voyage à travers l’Europe, termine en Italie. Il voyage vraiment partout et il va même s’installer à Rome définitivement. Donc il décide de vivre là-bas et il va aller jusqu’à italianiser son nom carrément. Il va se faire appeler Vanvitelli. Voilà et il appartient à un courant qu’on appelle le védutisme. En fait veduta, ça veut dire vue en italien. Et donc le védutisme c’est vraiment un genre à part entière en histoire de l’art qui se développe beaucoup en Italie. C’est l’idée de présenter des paysages avec une vérité, des paysages urbains, avec une vérité topographique très exacte. En fait topos, ça veut dire le lieu en grec. Donc l’idée pour le peintre, c’est de rendre véritablement la réalité d’un lieu, une vue de ville comme elle est. Et c’est une pratique très influencée par les peintres du Nord. Parce que les peintres du Nord ont ce goût pour le paysage, la précision, l’exactitude, le détail. Donc en fait ils vont apporter leur style et leur savoir-faire pour le mettre au service des paysages italiens.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors ce qu’on voit dans le tableau, c’est la place Saint-Pierre à Rome. Et on constate donc cette observation, cette transcription très très fidèle du réel. Au premier plan vous avez le petit peuple qui s’active devant l’immense place Saint-Pierre à la perspective majestueuse. Et en arrière-plan, il y a cette façade de la basilique très noble. Très à l’Antique aussi avec un jeu de colonnades. Donc il y a la volonté de la part du peintre de raconter les gens, leur vie sur des lieux fidèlement observés. Il y a ce souci de vérité, de rationalité. On voit les charrettes, les gens qui débarquent leurs marchandises, qui s’attendent, qui discutent, qui fument. Et cette vérité-là est d’autant plus permise que le peintre peut utiliser un instrument très précieux qu’on appelle à l’époque la camera obscura. C’est une boîte qui est percée d’un trou pour que la lumière y pénètre et c’est un petit peu l’ancêtre de l’appareil photographique.
[Marthe Pierot]
Oui. C’est vraiment grâce à ça qu’ils peuvent faire toute leur vue de ville. Et en fait on s’aperçoit que les védutistes travaillent beaucoup pour des riches étrangers surtout des anglais qui vont faire ce grand tour. Et quand ces touristes ou ces premiers touristes voyagent et bien ils découvrent une ville comme Venise. Une ville sur l’eau c’est extraordinaire. Et ils veulent évidemment ramener un souvenir de ces vues. Et donc ils vont chercher des peintres qui vont pouvoir produire des petits formats avec une représentation de cette ville très juste. C’est un peu finalement l’ancêtre de la carte postale. Quand on n’a pas la photographie et bien on commande aux artistes des petits formats à emporter voilà. Et Vanvitelli fréquente beaucoup d’ateliers de gravure et il participe à l’illustration des premiers guides de voyage. Donc c’est vraiment son créneau.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est vrai. Alors il y a un autre peintre du Nord : Rubens. Ce peintre des Flandres, cet immense artiste qui est présent au Musée des Augustins aussi qui est adepte du grand tour. Il a traversé de nombreuses villes parce qu’il a passé au total 8 ans en Italie. Donc il a beaucoup copié les artistes qu’il aimait et il a été très inspiré par Titien à Venise. Par la force du rouge de Titien. Et lui aussi, il a un petit peu modifié son nom, puisqu’il signait sur ses tableaux Pietro Paolo Rubens.
[Marthe Pierot]
Et voilà toujours plus. Alors notre dernier artiste qui a fait le grand tour que l’on va vous présenter c’est Rodin. Alors c’est ce grand sculpteur du 19e siècle. C’est vraiment le père de la sculpture moderne. Et bien lui à l’âge de 35 ans, il va aussi faire son grand tour pour voir les œuvres de Donatello et de Michel-Ange. Un peu comme Antonin Mercié. Ce sont aussi ses idoles et il a envie de découvrir leur travail. Et ça c’est à partir de là en fait que sa carrière va vraiment décoller. Et justement on retrouve beaucoup l’inspiration de Michel-Ange dans son travail avec son goût pour les corps en tension, cette esthétique de l’inachèvement ce qu’on appelle le non finito, tout ce qui donne l’illusion de la vie. Et c’est cette vibration, cette palpitation que l’on retrouve dans un bronze que nous avons au Musée des Augustins qui représente le buste d’un peintre qui était son ami. Et en fait dans ce buste tout semble s’extraire de la matière parce que à la base du buste on voit les traces de doigts du sculpteur. L’aspect n’est pas du tout lissé. On a vraiment l’impression que cette sculpture vraiment émerge du bronze un petit peu comme on le voit avec les esclaves mourants de Michel-Ange qui semblent complètement s’extraire de la pierre.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors on peut se poser une question. Rodin sans ce voyage en Italie serait-il devenu l’artiste extraordinaire que l’on connaît ?
[Marthe Pierot]
Oui …. Quand on voit toutes ces influences. Oui tout à fait, il a vraiment cette idée de vouloir libérer la vie de la matière. Et en plus comme c’est un bronze que nous avons au musée, il y a aussi ce jeu de reflets de lumière qui donne beaucoup de vie à ce buste.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et avec ce buste qui représente donc Jean-Paul Laurens, l’ami de Rodin, et bien on a la restitution véritablement du réalisme de la vieillesse : une peau fine, des clavicules apparentes. Il est terriblement vivant par des paupières qui palpitent, des tempes saillantes, des narines dilatées, une bouche ouverte, une moustache retroussée, une épaule en avant.
[Marthe Pierot]
Oui il y a vraiment du mouvement et de la vie. Alors pour terminer cette première partie, on voulait aussi vous dire qu’il y avait une autre raison pour certains artistes de faire ce voyage. Parfois ils n’ont pas le choix. Ils doivent fuir et donc là l’Italie devient en fait une terre d’exil ou un lieu de refuge.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors c’est le cas en fait de cet artiste Elisabeth Louise Vigée Le brun. Au moment de la Révolution Française en 1789, il y a donc une émigration des artistes. Puisqu’ils doivent quitter la France et les troubles politiques qui règnent. Et cette femme peintre est la première à vivre de son pinceau. Elle a peint surtout des aristocrates. Elle a fait des portraits donc avant la Révolution française. Elle était très proche de la reine Marie-Antoinette de la monarchie. Et elle a de bonne raison de fuir la France puisqu’elle n’a plus de commande, ses commanditaires sont décapités ou ont fui à l’étranger. Alors elle va parcourir une fois à l’étranger, les capitales et les cours européennes. Et elle va pendant 2 années séjourner en Italie. Elle sera à Naples mais également à Turin, à Bologne, à Florence. Elle est obligée de gagner sa vie. Donc elle peint de nombreux portraits. Elle est très sollicitée par la noblesse anglaise qui fait le grand Tour. Et il y a également les princes locaux, les princes régnants et notamment la reine de Naples qui est la sœur de Marie-Antoinette qui va donc solliciter Elisabeth Louise Vigée Le Brun.
[Marthe Pierot]
En fait elle travaille toujours pour la cour mais pas en France finalement. [oui c’est ça] Et donc on a une deuxième artiste aussi un peu moins connue que Elisabeth Louise Vigée Le Brun, il s’agit de Félicie de Fauveau qui est une sculptrice qui est présente au musée. Et qui va devoir quitter la France pour aller en Italie parce que sa famille est d’origine noble. Donc avant que n’éclate la Révolution, il faut justement se réfugier en Italie. Et en fait ce qui est très intéressant, c’est de se dire que là nous avons deux personnages féminins. Et que finalement c’est dur pour une femme d’aller en Italie parce qu’elles n’ont pas accès au prix de Rome. Le prix de Rome n’est ouvert aux femmes qu’en 1903 et le Grand Tour c’est un privilège qui est accordé aux hommes. Donc finalement quand une femme va en Italie – avec ces deux exemples – on s’aperçoit que soit elle doit se débrouiller toute seule, soit c’est parce qu’elle n’a pas le choix. C’est une question de survie. Et donc Félicie de Fauveau pendant son exil en Italie, on s’aperçoit que c’est là qu’elle réalise énormément d’œuvres. Notamment des bustes en marbre de Carrare. Ce matériau suprême, très utilisé par les artistes même utilisé par Michel-Ange. C’est vraiment ce marbre blanc que l’on cherche et elle a notamment réalisé avec ce marbre, un buste funéraire d’un petit garçon qui est parfaitement d’inspiration Renaissance florentine parce qu’on retrouve la douceur des traits, mais surtout le buste s’inscrit sur fond de coquille rainurée. Et ça fait référence à l’Antiquité.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc, nous avons donné les raisons du voyage en Italie. Nous avons exposé comment les artistes s’y sont rendus. On a dit pourquoi, on a dit comment.
[Marthe Pierot]
Et dans une deuxième partie, qui est donc le prochain épisode, nous allons regarder plus en détail les œuvres pour essayer de comprendre justement comment ce voyage a transformé le style de nos peintres.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
A très bientôt.
[Marthe Pierot]
Oui. Retrouvez-nous très vite. Merci de nous avoir écouté et au revoir.
[Musique]
Partie 2/2
LE VOYAGE DES ARTISTES EN ITALIE : ÉPISODE 2/2
[Musique]
[Voix masculine]
Les podcasts du musée des Augustins
[Musique]
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Histoire des arts, objectif BAC !
[Marthe Pierot]
Bonjour à tous et à toutes
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Bonjour
[Marthe Pierot]
Et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast “le voyage des artistes en Italie”.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà nous nous retrouvons pour cette deuxème partie. Nous sommes toujours les conférencières du musée des Augustins Marthe et Isabelle.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait. Et en première partie, dans l’épisode précédent, on avait vu un petit peu ensemble justement comment les artistes se rendaient en Italie, dans quel cadre ils avaient voyagé entre le grand tour, le prix de Rome ou même parfois l’exil qui les contraignait à aller en Italie. Mais dans la deuxième partie et ce nouvel épisode, on va parler d’autres choses.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui, on va se demander comment ce voyage influence leur travail ? A quoi ça se voit dans leur production qu’ils ont bien fait le voyage là-bas en Italie ? Qu’est-ce qu’ils y ont trouvé ? Comment ils y ont vécu ? Alors en fait durant 3 siècles, ce voyage est une véritable nourriture artistique, une formation sans égal. Et c’est vrai que ce voyage influence leur manière de peindre, leur style, modifie leur goût. Ce voyage les inspire. Ils vont réinterpréter les modèles antiques et c’est vrai que c’est important d’évoquer les échanges qui auront lieu entre les artistes qui se retrouvent dans des grands foyers, dans des grandes villes d’Italie. Ils se concentrent aux mêmes endroits et là et bien ils vont partager leurs découvertes, leur travail mais aussi les moyens de gagner leur vie parce qu’en fait, ils vont chercher à vivre de leur peinture mais parfois même à survivre. Ce n’est pas évident de trouver des commanditaires.
[Marthe Pierot]
Oui donc c’est vrai qu’ils travaillent tous ensemble. Il y a une forme de concurrence aussi parce qu’il faut trouver ses commanditaires. Mais quand même à Rome ou en Italie il y en a beaucoup. Les mécènes sont de plus en plus importants. Ils sont réputés très généreux envers les meilleurs meilleurs artistes et les plus ambitieux. Donc certains vont pouvoir vivre de leur peinture grâce à ces mécènes romains et à ces collectionneurs qui grandissent de plus en plus et qui vont aussi amener à un nouveau style de peinture. Parce que justement ils vont vouloir des tableaux peut-être un petit peu plus petit ou de taille moyenne qui vont pouvoir bien s’intégrer dans leur cabinet d’amateur. Et donc c’est là que va vraiment se développer ce style de figure, de demi-figure. On va voir des personnages, des portraits et ça c’est quelque chose que Caravage va beaucoup travailler aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et voilà. Et dans son sillage, on va avoir des peintres caravagesques à Rome. Des artistes qui viennent de toute l’Europe pour essayer de comprendre la révolution Caravage. Caravage est mort en 1610 et c’est vrai que dans on va dire la première moitié du 17e siècle, il y a cette volonté de comprendre ce qui s’est passé, cette volonté d’approfondir la leçon de Caravage pour justement essayer de donner une modernité à la peinture.
[Marthe Pierot]
Et justement c’est le cas par exemple de notre premier artiste dont on va vous parler Nicolas Tournier qui est donc caractérisé comme un peintre caravagesque puisqu’il suit cet esprit-là. Il s’intéresse à cette révolution et en fait il va aller en Italie en 1619. Il y reste 7 ans et là-bas il est très influencé par le clair-obscur élaboré par Caravage. On peut dire qu’il y a deux grandes périodes chez Nicolas Tournier : une période à Rome où il fait une grande partie de sa carrière et puis ensuite il revient à Toulouse où il travaille beaucoup et il fait beaucoup de production. Et c’est pour ça qu’au musée on possède énormément d’œuvres de Nicolas Tournier. Je crois même je dirais 9 tableaux de ce peintre. Donc ce qui n’est pas rien et on s’aperçoit dans toutes ces productions qu’il y a des thématiques communes. C’est vraiment le peintre du silence, de la retenue, de l’émotion et même du ténébrisme. Il y a une forme d’austérité dans sa peinture qui est d’ailleurs très liée à sa religion parce qu’il était protestant et le protestantisme cherche la retenue. Donc on retrouve ça dans ses peintures. Et souvent ce sont des figures à mi-corps donc isolées sur un fond sombre avec des effets de lumière qui vont donner une véritable tension dramatique. Et tout ça ce sont vraiment les codes du portrait typiquement caravagesque. Et donc on voit aussi qu’il fouille toujours ses visages pour leur donner beaucoup d’humanité. Que ce soient des portraits anonymes ou pas, Nicolas Tournier traque la réalité comme le faisait Caravage. A chaque fois, il nous propose des visages avec des rides profondes qui sont soigneusement dessinées autour du front ou autour des yeux. Et pour un exemple concret vous avez un apôtre qui l’a réalisé qui est Pierre. Et bien le regard de cet apôtre nous trouble. Quand on le voit, il y a un réalisme dans sa vieillesse, une faiblesse de son corps décharné qui nous touche profondément. Il y a beaucoup d’humanité dans son travail.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui et cependant il y a peu de couleurs. On constate que la palette est restreinte avec des touches de blanc pour renvoyer la lumière et accrocher notre regard. On peut voir un morceau de papier blanc, une plume sur un chapeau qui justement est source de lumière. On peut penser également à un autre tableau que nous avons au musée, le portrait d’un soldat avec cette plume justement et ce costume de fantaisie mis à la mode par Caravage. On se souvient de ce morceau d’armure avec des jeux de lumière sur le métal. Donc les personnages de Tournier nous proposent si souvent ces attitudes spontanées, ces hommes barbus qui donnent l’impression de sortir d’une auberge romaine, qui sont vraiment très très proches des figures masculines traitées par Caravage. Alors on va parler à présent d’un autre peintre caravagesque. Il s’appelle Valentin de Boulogne. Alors si les innovations de Caravage sont très réemployées, revisitées, chaque artiste en fait un usage selon sa propre sensibilité. Et vous avez chez Valentin de Boulogne un lyrisme qui appartient à la peinture italienne mais également une mélancolie qui l’attache un peu plus à l’art français. Valentin de Boulogne est le plus grand des caravagesques français et il est à noter qu’il a été le professeur de Tournier, le peintre dont nous venons de vous parler. Il arrive à Rome en 1609. Caravage n’est pas encore mort. Il a encore une année à vivre. Et donc Valentin de Boulogne y fera tout sa carrière.
[Marthe Pierot]
Et alors on peut se demander, c’est même une question qui brûle mes lèvres. Est-ce que Valentin de Boulogne a rencontré Caravage ?
[Isabelle Bâlon-Barberis]
On a envie de le croire. On peut l’espérer. On ne sait pas.
[Marthe Pierot]
En tout cas dans son travail, on voit l’influence de Caravage et même dans les sujets qu’il utilise. Parce que le tableau que nous avons au Musée des Augustins de Valentin de Boulogne, c’est un tableau qui représente Judith. Cette femme qui au 6e siècle avant Jésus-Christ délivre son peuple. Son peuple juif qui était opprimé par le général Holoferne. Et elle tranche la tête de ce général et elle libère ainsi son peuple. Nous sommes en Béthulie, c’est une province de Palestine au moment de l’histoire. Et Caravage représente très souvent Judith. Il y a un tableau très connu où Judit est en train de décapiter Holopherne à l’aide de sa servante. Elle tranche la tête avec beaucoup de sang. Et en fait ce tableau on le connaît et Valentin de Boulogne nous propose une autre version de cette histoire où cette fois-ci la violence a déjà eu lieu. En fait il n’y a pas de violence directe, il n’y a pas d’effet sanguinolant. Parce que c’est un portrait. On voit Judith qui prend toute la place. D’ailleurs le cadrage est très serré. On a l’impression que c’est un zoom, c’est une figure isolée. Elle est comme une matronne romaine. Elle règne sur le tableau et tout au fond enfin en bas sur le tableau on a la tête d’Holoferne dans l’ombre mais on ne la voit pas beaucoup. C’est surtout Judith qu’on voit. Et il y a un véritable contraste entre la beauté de cette femme et l’horreur de ce qu’elle vient de commettre. Et ce qui est intéressant, c’est de voir son visage qui nous trouble aussi. Il y a une gravité, une mélancolie même dans son visage et ça c’est très propre à Valentin de Boulogne comme Isabelle tu le disais tout à l’heure. Donc on a cette simplicité de mise en page, cette figure isolée, mais on a aussi un aspect très monumental. Il n’y a pas beaucoup de place autour de Judith. Tout est resserré et surtout sa robe prend beaucoup de place. Elle est très volumineuse. Il y a des plis qui sont complexes, des manches bouffantes, des tissus qui accrochent la lumière. Donc il y a véritablement un bouillonnement des étoffes et ça c’est très baroque comme manière de peindre. Mais c’est intéressant de souligner la richesse de ces accessoires, de ces bijoux parce que l’artiste a envie de nous montrer que c’est une femme qui a tué cet homme et donc là sa féminité est très assumée. Elle n’est pas en armure, elle est en robe.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors quelles sont les conditions de vie des artistes à Rome au 17e siècle ? Ces artistes ont sûrement un mode de vie proche de celui de Caravage, le côté bad boy. Et on sait qu’ils se retrouvent dans leurs ateliers pour travailler. Mais il se retrouvent aussi dans les cabarets, dans les tavernes. C’est la bohème avant l’heure. Et c’est vrai que ça n’a rien à voir avec le mode de vie des peintres qui font le grand tour ou qui gagnent le prix de Rome. Ici il y a pas d’hébergement. Ils n’ont pas de bourse et ils n’ont pas du tout les mêmes moyens. C’est pour ça que en fait les jeunes artistes représentent souvent des Bacchus qui signifie, qui symbolise le Dieu de l’ivresse et qui fait écho à leur mode de vie un petit peu dissipé. Mais qui en même temps est un personnage qui les fait puiser aux sources de la mythologie.
Et d’ailleurs nous avons un Bacchus au Musée des Augustins mais qui est réalisé par un artiste du Nord. Il n’y a pas que les peintres français qui partent à la recherche du style de Caravage. Il y a une école caravagesque dans le Nord notamment à Utrecht. Et un des plus grands représentants de cette école c’est Dirck Van Baburen. Le peintre que nous avons au musée et qui nous propose en fait son Bacchus. Et son Bacchus, il le met en scène et bien comme Caravage le faisait c’est-à-dire un portrait seul. Mais il a une attitude tout à fait défiante et c’est ça qui nous trouble parce que ce Bacchus nous regarde et vient nous provoquer même un petit peu. Et ça nous fait penser en fait au tableau de Caravage dans sa jeunesse notamment le Bacchus malade, où il a réalisé voilà.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et on retrouve la même demi-figure, le cadrage serré et un corps enveloppé d’une lumière chaude alors que le fond est très noir. Et c’est ici le corps d’un antihéros. On n’est absolument pas dans l’idéalisation alors qu’il s’agit d’un dieu. On a vraiment des personnages de la rue qui rentrent dans le tableau. Il est très humanisé. On a les bas-fonds de la rue qui sont là devant nous alors qu’il est question d’un dieu.
[Marthe Pierot]
Oui c’est ça. Et en fait ça fait écho à leur vie et on l’a déjà dit un peu tout à l’heure mais c’est intéressant de s’imaginer que les artistes s’inspirent du style pictural de Caravage mais de sa vie aussi. Donc il faut vraiment imaginer la vie de ces artistes dans un contexte très underground. Où ils fréquentent des tavernes et en fait ils sont vraiment impliqués tout le temps dans des bagarres. Ils ont une manière de vivre très particulière. Ils sont dans les échanges d’injures, des affaires de mœurs. Il y a beaucoup d’annales policières qui sont remplis de leurs querelles, de leurs farces, de leurs débauches. Donc on a des sources un petit peu sur ce mode de vie très particulier et c’est pour ça qu’il y a beaucoup de scènes de tavernes, de joueurs de luth, de diseuse de bonne aventure, de mendiant, de vagabonds, de bohémiennes et de soldats dans leur peinture, parce que c’est vraiment leur univers. C’est l’univers des peintres caravagesque.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors tous les artistes ne voyagent pas en Italie pour suivre et bien l’esprit ou la manière de peindre de Caravage. Il y a au contraire même je dirais, d’autres artistes qui sont vraiment dans la tradition, dans un certain conformisme, dans un académisme non dénué souvent de raffinement d’ailleurs. Alors ils ont eux choisi une autre voix et ils espèrent en fait obtenir un meilleur statut en effectuant ce voyage. Ils ont une stratégie, un plan de carrière pourrait-on dire également. Ils se mettent, ils cherchent à se mettre sous la protection d’un mécène grâce à ce voyage, afin d’obtenir des commandes pour atteindre un certain degré de reconnaissance sociale. Ils ont envie de ne plus être cet artisan anonyme pour devenir un peintre à part entière. Et avec Stella, cet artiste lyonnais que nous avons au Musée des Augustins, on a donc cette mouvance-là. C’est un homme qui part à Florence puis à Rome où il restera 10 ans. Il peint pour les Médicis. Il répond à beaucoup de commandes et notamment à celle du pape Urbain III qui n’est pas rien et son style se situe vraiment entre le classicisme de Rome et le raffinement de Florence. Il reprend vraiment le style précieux et renaissant de Raphaël. Et justement le tableau du Musée des Augustins qui s’intitule Le Mariage de la Vierge donc est clairement inspiré d’un tableau du même nom de Raphaël où on retrouve une mise en scène très élaborée qui se déploie dans une perspective très étudiée avec des bâtiments à l’antique.
[Marthe Pierot]
Oui, oui tout à fait. Dans notre tableau on a vraiment tous ces codes qui sont repris. Au premier plan d’ailleurs vous avez des personnages et vous avez cette histoire où c’est Joseph qui passe la bague au doigt de Marie. Quand même c’est un moment important qui est vraiment très délicat. Entre ces deux personnages vous avez le grand prêtre qui supervise un peu ce moment et il y a des attitudes très maniérées qui sont représentées. Mais en tout cas ce qui est très classique c’est évidemment cette composition en frise. Les personnages sont tous au premier plan les uns à côté des autres et ils s’inscrivent vraiment dans un jeu de perspective quasiment parfait. En fait dans cette scène on est à l’intérieur d’un palais avec tout un jeu de colonades, d’arcades qui nous emmène très très loin au fond. Et en fait il travaille énormément la perspective linéaire de cette manière avec un point de fuite unique. Toutes les lignes nous emmènent au même endroit vers le fond du tableau. Et on s’aperçoit que les personnages sont tous très grands. Ils sont complètement idéalisés un peu comme chez Ingres vous l’avez vu dans le premier épisode. On retrouve les mêmes codes de représentation avec aussi une délicatesse de la gamme chromatique qui est très propice au classicisme de Stella.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est vrai. Alors on a vu des artistes qui trouvent donc dans le caravagisme quelque chose de fort et de nouveau. Certains autres qui dans le classicisme prolongent la tradition mais il y a aussi une autre quête il y a d’autres choses à trouver là-bas. Ils sont en fait en Italie parce qu’ils sont en quête de ce contact avec la nature. L’Italie comme une terre idéale pour le paysage. Un attrait pour la lumière de ce pays du sud de l’Europe et le voyage devient une manière d’appréhender ce qui est sensible et ça devient en fait quelque chose de très personnel presque introspectif, presque méditatif. Et on peut songer donc à l’Allemagne de l’époque romantique en peinture. On est toujours à la fin du 18e siècle et on pense justement à ce voyage intérieur dont parle Gœthe dans son voyage en Italie parce qu’il fait l’expérience d’un autre monde, d’un autre mode de sentir, de voir et également d’une autre façon de vivre. Donc c’est fort ce qui se passe là-bas comme expérience physique du pays.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait. Et donc ça va vraiment se traduire par des réalisations de paysage beaucoup. On enlève un petit peu le côté portrait peut-être qu’on avait avec Caravage, le côté histoire très classique avec Stella mais là on va plutôt parler de nature. Et les ruines d’ailleurs se retrouvent très souvent dans ce type de paysage parce que les ruines sont propices à l’introspection. Il y a une poésie qui est associée aux ruines qui permet de parler de l’oubli et des sentiments. En fait on est vraiment sur une réflexion existentielle voire philosophique. Allons-y partons dans la philosophie avec Pierre-Henri de Valenciennes qui est un peintre donc qui est né à Toulouse et il voyage à plusieurs reprises en Italie. D’abord en 1769 et c’est une révélation pour lui ce premier voyage. Et ensuite il y retourne plusieurs fois après. Mais tous ses voyages en Italie ont véritablement nourri sa réflexion sur l’art. Il aime travailler dehors, être confronté à ses paysages justement. Il travaille en plein air et il insiste ses élèves à en faire de même. Il va même aller jusqu’à rédiger un ouvrage pour eux, pour expliquer la perspective mais surtout de la perspective atmosphérique c’est comme ça qu’il nous parle de l’extérieur. On a vu la perspective linéaire avec Stella tout à l’heure et l’architecture et le point de fuite unique. La perspective atmosphérique, elle est dans les paysages. C’est pour nous montrer en fait un horizon qui semble s’éloigner. Donc il y a un jeu de couleur, le premier plan propose des couleurs très foncées et à mesure que l’on s’éloigne les couleurs sont de plus en plus claires et de plus en plus diluées. Donc en fait Pierre-Henri de Valenciennes témoigne grâce à ça d’une nouvelle sensibilité devant la nature et il a un vrai talent de coloriste.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Mais pour justifier un paysage à une époque où ce genre est encore mal considéré, il intègre une histoire avec des personnages afin de nous enseigner quelque chose il y a une vraie visée pédagogique. Et la conséquence c’est qu’il va créer un prix de Rome du paysage historique en 1816. Pour revaloriser le genre du paysage., il crée une nouvelle catégorie. Alors on s’aperçoit vraiment de cela avec la toile qui se trouve au Musée des Augustins et qui s’intitule Ciceron découvrant le tombeau d’Archimède. C’est un tableau qu’il réalise quand il est à Rome et il donne en fait une place très importante à la nature qui occupe à peu près les 3/4 du tableau. Et il donne une place essentielle à son sujet historique qui est la redécouverte du tombeau d’Archimède. Donc c’est un paysage qui est très construit selon plusieurs plans : premier plan Cicéron accompagné de ces esclaves entrain de tenter d’enlever les branches qui recouvraient le tombeau car la nature a repris ses droits. C’est aussi la possibilité d’illustrer la fameuse poussée d’Archimède à sa manière. Et on voit on découvre ce tombeau en ruine, cette ruine qui occupe une place importante mais qui est surtout très symbolique puisque elle nous parle de l’oubli, de l’ignorance dans laquelle est tombé ce tombeau d’un homme pourtant si important. Au fond du tableau on a une nature très idéalisée avec quelques constructions à l’antique et au fond majestueux on a l’Etna enneigé. Nous sommes bien en Sicile avec ce tableau.
[Marthe Pierot]
Oui et justement par rapport à cette composition très organisée et ce paysage très idéalisé, cette œuvre a longtemps été considérée comme l’exemple type d’un paysage néoclassique qui récupère tous les codes du classicisme. Mais la réelle révolution de Pierre-Henri de Valenciennes c’est justement d’avoir cherché à rapprocher un paysage et un sujet historique. Et ce mélange des deux donc histoire + paysage et bien Pierre-Henri de Valenciennes l’applique dans toutes ses peintures quasiment. Et d’ailleurs il ne propose pas que des paysages néoclassiques, il propose aussi des paysages beaucoup plus romantiques. Le romantisme, ce mouvement en histoire de l’art qui se développe à la fin du 18e siècle on en a déjà parlé un petit peu tout à l’heure. Mais on a un tableau qui s’intitule l’éruption du Vésuve et qui met vraiment en lumière toute cette âme-là romantique. Mais avant de vous le décrire, c’est important de vous dire que Valenciennes visite Pompéi. Et donc c’est là où il y a le Vésuve justement. Et Pompéi est une ville qui a été rendue célèbre quand on fait les fouilles au 18e siècle on redécouvre cette ville antique. Et donc Pierre-Henri de Valenciennes était là et il a même assisté à une éruption du volcan. Donc il est absolument fasciné par la puissance de la nature. Il veut en faire une peinture de très grand format. L’œuvre du musée fait quasiment 2 m sur 1,50m. Mais il faut savoir que c’était très à la mode à l’époque. Au 18e siècle il y a eu de nombreuses éruptions et donc la représentation de ce phénomène était un sujet très apprécié par les peintres. Il ne faut pas oublier que les peintres à cette époque étaient de véritables photo-reporters.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et oui c’est vrai. Avant la photographie on avait besoin de leur témoignage pour comprendre ce qui se passait dans le monde. [exactement exactement]. Alors si on revient au tableau c’est vraiment un volcan qui est tout à fait en colère qui envahit la toile. Le ciel est rouge et la ville de Pompéi s’effondre comme un château de carte avec une mer qui s’affolle. Dans cette toile Pierre-Henri de Valenciennes insiste vraiment sur l’impuissance de l’homme face au déchaînement de la nature et ça c’est vraiment l’idée romantique. Le volcan crache des pierres à une hauteur vertigineuse et il déverse des fleuves de lave bouillonnante face auxquelles les personnages paraissent absolument minuscules. Mais en plus de nous raconter cet épisode donc naturel, de l’éruption d’un volcan, l’artiste représente en fait la mort d’un homme qui s’appelait Pline l’ancien. Et on voit ce personnage au bas du tableau, un grand scientifique qui parce qu’il a voulu s’approcher trop près du volcan pour comprendre comment ça fonctionnait il est puni de sa témérité et il meurt asphyxié par la fumée. Donc vraiment avec ce tableau on a un paysage romantique mais on a aussi un moment d’histoire. [Et ça c’est son créneau] Voilà et dans cette veine, on voit que Pierre-Henri de Valenciennes fait des émules parce qu’il y a une femme peintre qui s’appelle Louise Joséphine Sarazin de Belmont qui réalise au milieu du 19e siècle une vue de Naples. Un très beau tableau qui qui se trouve au Musée des Augustins. Une femme élève de Pierre-Henri de Valenciennes.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait. Csa veut dire que Pierre-Henri de Valencienne ouvrait son atelier aux femmes quand même [exactement] et ça c’est pas fréquent. Et en fait elle travaille beaucoup avec lui et on le voit dans ces tableaux, la perspective et le rendu de la lumière. Mais c’est important de vous dire que cette artiste femme était connue de son temps. On la connaît plus très bien aujourd’hui, mais elle était très protégée par des grands noms comme l’impératrice Joséphine ou la duchesse de Berry. Elle avait un atelier à Paris, remporte plusieurs médailles mais surtout ce qu’on retient d’elle c’est que c’était une grande voyageuse. Et elle va comme beaucoup de peintres c’est notre sujet, étudier en Italie, découvrir les paysages italiens. Mais il faut savoir que voyager à l’étranger quand on est une femme ce n’est pas facile. On l’a déjà dit dans le premier épisode. On ne gagne pas de prix de Rome avant 1903. Le Grand Tour c’est un privilège qui est accordé uniquement aux hommes. Donc il faut être une aventurière, avoir une âme d’aventure pour partir un peu avec son baluchon à la quête des paysages italiens. Et c’est ce qu’elle fait vraiment et elle traque toutes les variations de la lumière du Sud. Elle réalise beaucoup d’esquisses et des dessins sur place. Elle a un souci de la vérité topographique vraiment, elle rend la réalité des lieux. Et c’est ce qui est le cas pour notre tableau qui présente la baie de Naples.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
La baie de Naples dans toute sa rondeur comme une épaule bleue baignée par la lumière de la chaleur, lovée dans la Méditerranée. Donc elle essaie de dissoudre tous les contours dans une lumière qui absorbe tout. Et là aussi on peut parler donc de perspective atmosphérique. Elle arrive à noyer tous ses contours dans une lumière chaude vraiment la lumière de l’Italie.
[Marthe Pierot]
Mais attention, il ne s’agit pas que d’un paysage. Comme son maître, elle intègre une petite histoire à l’intérieur de son paysage. Et au premier plan de ce tableau on aperçoit une femme qui est en rouge donc elle ressort beaucoup. Cette femme c’était l’amie de la peintre, l’amie de Sarazin de Belmont. Et elle veut ici nous montrer un petit peu et bien la générosité de son amie qui malheureusement est morte et elle fait ce tableau pour lui rendre hommage. Et elle en fait presque une allégorie de la charité parce que, que fait cette femme dans le tableau ? Elle vide sa bourse pour des mendiants au moment de sa promenade. Donc l’idée c’est de nous parler d’elle. Elle est toute petite dans le paysage. C’est aussi cette volonté de nous parler d’un tableau très romantique parce qu’il y a cette question d’échelle : une femme qui se noie dans un paysage immense. [Effectivement]. Voilà donc nous avons terminé cette deuxième partie et on peut même conclure.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui absolument on peut conclure. Donc ces deux épisodes concernant le voyage des artistes en Italie et on s’est rendu compte qu’au fil des siècles et des œuvres que nous avons évoquées, on a vu vraiment l’évidence de ce pôle d’inspiration artistique qui a été l’Italie. Cette nécessité de se former pour être un artiste légitime en son pays après le voyage. Et un voyage cependant qui peut pour certains durer toute une vie. [oui c’est vrai]. Et c’est vrai qu’on peut insister sur le fait qu’ils sont très nombreux à faire le voyage pour décrocher une commande ou un mécène. Il y avait une vraie concurrence. Mais maintenant on peut se demander : l’Italie aujourd’hui qu’est-ce qu’elle représente ?
[Marthe Pierot]
Oui c’est vrai qu’avec la mondialisation on peut quand même dire que la géographie a un peu explosé et que les pôles artistiques sont à présent partout sur la surface du globe. Il y a eu Paris au début du 20e siècle qui était le centre du monde de l’art quasiment après Berlin, New York, Londres. Aujourd’hui on peut parler d’Amérique du Sud, Mexico, São Paulo et puis en Asie, Tokyo, Singapour. Ce sont des villes qui font écho quand même et on s’aperçoit que ce sont des centres artistiques qui sont très attractifs aussi aujourd’hui. Et sans oublier la création des capitales européennes depuis les années 80 qui justement visent à démultiplier un petit peu tous ces lieux de rencontres et à changer un peu.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Donc l’Italie n’est plus la référence unique en matière d’art. Elle a perdu un petit peu de terrain sur le plan d’un rayonnement culturel. Mais elle fascine toujours pour son passé, son histoire et aujourd’hui il y a donc par exemple la Mostra de Venice pour le cinéma, il y a bien sûr la Biennale de Milan qui est la plus grande des manifestations d’art contemporain. C’est vrai que on peut également je pense au design contemporain qui compte en Italie.
[Marthe Pierot]
Oui oui c’est vrai, il y a vraiment cette démultiplication des lieux certes mais aussi des disciplines. Et en fait finalement les artistes aujourd’hui on a l’impression qu’ils ne doivent plus viser un seul pays, une seule culture mais plutôt être des voyageurs du monde.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est vrai voilà, nous avons terminé. Nous vous remercions de nous avoir écoutées.
[Marthe Pierot]
Oui c’est ça c’est la fin de ces deux épisodes sur la thématique du voyage des artistes en Italie.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà tout à fait et nous tenions à vous dire que vous retrouver toutes ces œuvres sur le site du Musée des Augustins.
[Marthe Pierot]
N’hésitez pas à aller les voir pour rendre les choses un peu plus concrètes.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Absolument. Au revoir
[Marthe Pierot]
A très bientôt au revoir
[Musique]
[Rémi Roig]
Ce podcast a été réalisé par l’équipe du Musée des Augustins. A l’écriture et au micro Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot. Au montage Rémi Roig et à la coordination Ghislaine Gemin.
[Musique]
[Marthe Pierot]
Si vous avez aimé ce podcast n’hésitez pas à liker et à vous abonner.
[Musique]
Ce podcast est réalisé par l’équipe du musée des Augustins.
* À l’écriture et aux micros : Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot
* Montage : Rémi Roig
* Coordination : Ghislaine Gemin