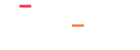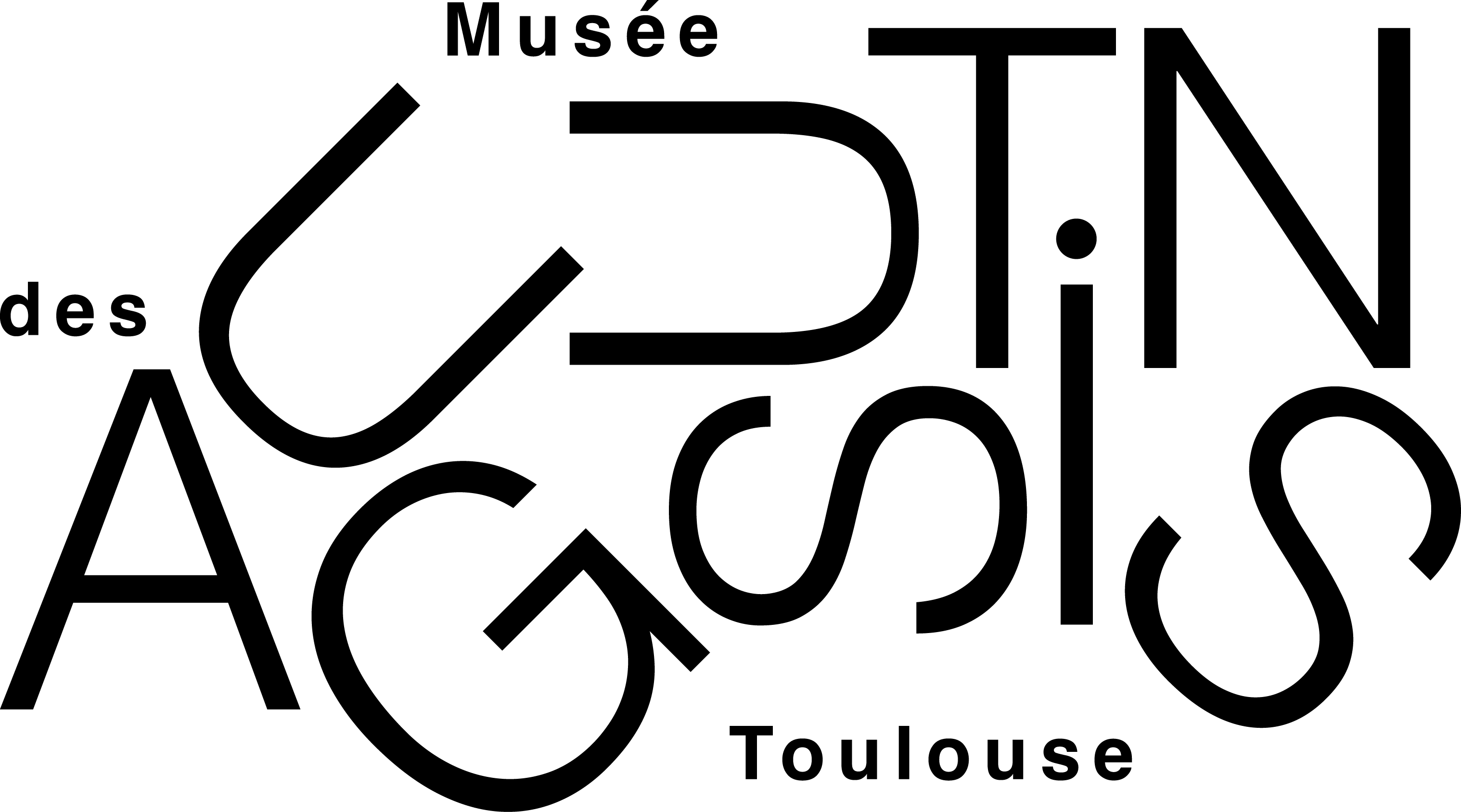Conférences en ligne
Toutes nos conférences en histoire de l’art sont à voir sur notre chaîne YouTube
Elles sont présentées Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières du musée des Augustins.
Le portrait, les femmes artistes, l’art roman, etc. Des thèmes à découvrir à travers les œuvres du musée.
Premières neiges
Premières neiges
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Premières neiges”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2024]
[Marthe Pierot]
Messieurs, dames, bonjour
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Bonjour à tous
[Marthe Pierot]
Et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne du musée des Augustins.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Absolument. Aujourd’hui on avait envie de vous parler d’un joli thème qui est celui de la neige en peinture.
[Marthe Pierot]
Oui et puis c’est de saison. Donc c’était intéressant pour nous de parler de ce sujet, même si en histoire de l’art, il a longtemps été traité de manière un petit peu à l’écart, finalement, c’est un genre mineur. La peinture d’hiver ou la neige, on ne la représente pas beaucoup. Ca se représente beaucoup plus à partir du 19e siècle. On le verra dans nos peintures, cette évolution et cette variété de peinture de neige. Mais c’était intéressant d’en parler et d’introduire sur ça, parce que techniquement, peindre du blanc, c’est compliqué.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est compliqué. C’est même un paradoxe parce que comment la peindre ? Comment peindre le blanc quand on veut peindre du blanc sur une toile blanche ? C’est vrai que c’est une non-couleur, le blanc, mais c’est également une non-couleur qui va refléter toutes les Lumières. Donc comment le peintre s’y prend-il ?
[Marthe Pierot]
Et oui, c’est ça qui est difficile, ce jeu de reflets, ce jeu de lumière. Et la neige, c’est tout à fait ça, parce que la neige n’est pas monochrome. Quand on regarde la neige de près, on s’aperçoit en fait que ce sont des milliers de petites facettes de cristaux glacés qui par leur transparence renvoient la lumière. Et donc en fait, si la neige est au soleil, elle sera jaune. Si la neige est à l’ombre, elle sera mauve. Mais les peintres, ils ont compris ça. Et justement, ils vont irriser leur palette de plein de couleurs pour sublimer la neige et pour éviter de peindre juste du blanc. Ils jouent sur ça.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
On peut même penser que dans le Grand Nord, chez les Inuits, il existe plus d’une vingtaine de mots pour qualifier le blanc. Tellement le blanc peut être teinté de gris, d’ocre, de rose, de bleu. Et là ça donne une couleur qui est tout autre. Donc c’est vrai que c’est tout à fait difficile à traduire et que c’est un défi.
[Marthe Pierot]
Oui et puis c’est un défi qui se rajoute aussi au paysage où s’inscrit la neige finalement. Parce qu’une neige dans la montagne, dans les bois ou en ville sera différente. Et selon son état, si elle vient de tomber, si elle est poudreuse, si elle est fine. Est-ce qu’elle est en train de fondre, d’être verglacée ? Est-ce qu’elle est épaisse ? Tout ça aussi sera traduit de manière différente, avec des jeux de couleurs différents.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et puis il y a toute une ambiguïté quand on voit la neige. Quelle est l’émotion qui vient donc nous prendre ? C’est vrai qu’il y a une idée de pureté, mais il y a également une idée de danger qui peut exister. C’est vrai qu’elle peut être cette neige d’une affolante clarté, dans ce cas-là elle est immaculée, il y a cette idée de virginité. Mais on peut également penser en la voyant à quelque chose de complètement négatif qui évoque l’angoisse, le deuil, la désolation. Oui donc, au fil des 30 minutes et des 10 visuels que nous allons vous présenter, on va parler donc d’une saison, qui est l’hiver. Ça s’impose. Mais pas simplement puisque si on pense à la neige éternelle, on peut tout à fait être en été. Si on pense aux premières neiges, on peut être en automne, d’accord, en novembre par exemple. Mais on peut parler également, des neiges de printemps et dans ce cas-là on peut être en avril. Donc ce n’est pas que l’hiver.
[Marthe Pierot]
Ce n’est pas si simple. Et je vous propose de mettre vos chaussures d’hiver pour marcher dans la neige avec nous.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Allons faire craquer les capitons de neige.
[Illustration : peinture de Louise Joséphine Sarazin de Belmont, “Vue du convent de Saint-Savin et de la vallée d’Argelès” – vers 1831].
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Alors nous nous trouvons ici devant l’église abbatiale de Saint-Savin. Alors où ça se trouve ? Nous sommes dans la vallée d’Argelès et vous avez cette construction du 12e siècle. Donc sur la droite, Vous voyez cette église un petit peu défensive puisqu’au 14e siècle on lui a fait ce drôle de clocher en éteignoir. C’est une tour lanterne. Maintenant, qui est l’auteur de ce tableau ? C’est Joséphine Sarazin de Belmont.
[Marthe Pierot]
Oui alors c’est vrai qu’on vous en a déjà parlé pour ceux qui suivent nos conférences régulièrement, parce qu’en fait elle a réalisé plusieurs tableaux et au musée on en conserve beaucoup d’elle.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Cette Louise Joséphine, eh bien elle est une peintre paysagiste. Elle est également une grande voyageuse en Europe et dans les Pyrénées. Et c’est vrai qu’elle ne se limite pas à la vallée d’Argelès. C’est celle que vous découvrez ici. Elle peint également Gavarnie, Cauterets, la région de Luchon également. Ces sites sont des sites qui, au début du 19e siècle, sont connus mais rares sont les gens qui s’y aventurent et rares sont les peintres qui les représentent. Et que dire des femmes peintres ? Elle est l’unique à le faire. Et elle veut tellement être au plus près de la nature qu’on dit, et c’est une vérité, qu’elle s’est installée seule dans une cabane de berger afin de peindre au mieux ces Pyrénées, avant de se lancer dans son atelier pour des grandes compositions. Donc ici c’est un tableau qui fait 65 cm sur 104. Ca vous donne un petit peu le format. Notre peintre ici traque vraiment la pureté de la lumière, la fraîcheur des couleurs et les détails très délicats. Alors cette composition est particulièrement harmonieuse. Et je dirais que la perspective est également très efficace puisque sur la gauche, vous avez la vallée en contrebas avec une ligne oblique qui creuse la perspective. Donc on est dans les années 1830 et vous avez en fait une composition qui joue sur le parallèle entre à droite et bien les hauts murs et le clocher de l’Église, et à gauche, les abruptes montagnes qui sont enneigées. Et au premier plan, vous avez cette construction qui est un lieu où des hommes d’église conversent encore. Ils se retirent du monde. Et vous avez derrière eux, ce paysage vierge, cet univers immaculé. Sur la gauche, une église avec des flèches pointues qui rivalisent un petit peu avec les montagnes et leurs sommets aiguisés. Alors vous avez derrière cette construction, un autre et ultime poste, une petite chapelle isolée sur un petit python. Qui est le dernier poste justement habité avant le mystère et l’altitude et le silence de la montagne. C’est intéressant de voir comment donc Louise Joséphine nous propose sur la droite du tableau, ses couleurs chaudes, la patine ocrée orangée des pierres dorées et puis à l’arrière, le blanc minéral glacial transparent. Une autre position, c’est la neige loin derrière tandis que devant, c’est une végétation qui est déjà presque printanière. Et c’est ça qui est intéressant ici de voir que finalement, ces neiges, on peut considérer qu’elles seront des neiges éternelles qui dureront tout l’été. Une époque bien révolue. Parce que si l’on fait un petit point météo climat, les neiges éternelles, aujourd’hui, c’est une appellation qui va disparaître. On ne peut que le réaliser.
[Marthe Pierot]
Mais vous voyez, on commence en douceur, parce que le premier paysage ne nous propose qu’un tout petit peu de neige au sommet des montagnes. Ce n’est pas ce qui occupe tout le paysage, contrairement à notre prochain tableau qui est réalisé par Francesco Foschi.
[Illustration : peinture de Francesco Foschi, “L’Hiver” – 1779]
C’est un peintre italien du 18e siècle qui réalise beaucoup de paysages de neige. En fait, on l’appelle même le roi des neiges, carrément, voilà, c’est son créneau. Alors il s’installe à Rome, comme tout artiste à cette époque qui veut développer son réseau et travailler. Mais pourtant, il ne s’intéresse pas du tout à l’architecture romaine et antique. Lui, ce qu’il aime, c’est les paysages et la nature. Et donc il revient régulièrement dans la campagne de son enfance, pour peindre tous ces paysages et ces paysages d’hiver. Alors pourtant, quand on pense Italie, on a tendance, et à défaut parfois, de penser le Sud, le soleil, la plage. Mais il y a aussi d’autres choses. Il y a bien sûr les montagnes. Même si ici, on a un petit peu du mal à savoir où on se trouve exactement. La géographie est assez floue. Vous avez une vallée bordée de montagnes, traversée par une rivière. Alors on pourrait être un petit peu partout en Europe, en Italie, en Hollande, parce qu’il n’y a pas vraiment d’architecture qui pourrait nous aider. D’ailleurs, la neige gomme toutes les particularités géographiques. Mais on peut quand même imaginer qu’on est dans les Alpes italiennes. Alors ce qui est intéressant, c’est que c’est un peintre italien, mais qui emprunte vraiment aux peintres nordiques. Parce que les peintres nordiques et hollandais maîtrisent parfaitement la peinture de neige, les lacs gelés. On est vraiment dans cette image là , la minutie de la peinture. Vous pouvez penser au grand peintre néerlandais du 17e Avercamp par exemple. On peut penser à Bruegel, enfin, à d’autres peintres en tout cas, qui s’emparent de ces sujets où on a vraiment toujours ces petits personnages qui représentent une activité humaine et rurale, qui se noient dans un décor très très grand. Et c’est ce qu’on trouve ici, parce que d’ailleurs quand on zoome, on s’aperçoit que sur ce sentier gelé, et bien il y a un homme emmitouflé qui transporte sur son dos du bois et qui avance avec précaution. Et puis à côté de lui, il y a des personnages avec et bien peut être un cheval et il y a comme un trafic de peaux animales un petit peu. On se demande ce qu’ils font. S’il y a une sorte de marché, un peu. Et de l’autre côté de la rivière, sur le zoom qui est en-dessous, vous avez une grotte qui sert d’étable, un petit peu pour abriter vache et chien qui sont un peu en retrait de tout ça. Voilà donc c’est intéressant aussi de prendre en compte le format. Le format qui est parfaitement allongé de ce tableau. C’est tout à fait étonnant pour nous proposer un paysage panoramique. Et de regarder aussi toute cette minutie qui vient directement des peintres hollandais. La minutie, des arbres avec ses branches très fines, qui sont ciselées dans le ciel. Cette ligne d’oiseaux. On a les rochers, on a ce petit village en arrière-plan. Tout est très très fin ici. Et puis évidemment, on a un tableau avec une palette chromatique très harmonieuse. Des nuances de blanc et de gris avec quelques rehauts d’ocre pour parler des maisons, des arbres et de la roche. Mais la lumière reste pauvre et basse pour nous parler d’un paysage endormi et sourd, dans lequel on imagine que les sons sont parfaitement étouffés par le manteau de neige. Aucun bruit, si ce n’est le crissement de la neige sous les pas des marcheurs ou peutêtre le clapotis de l’eau. Mais on est dans une grande sobriété. Et c’était intéressant de terminer en vous disant qu’ici, c’est un paysage qui évoque peut-être par cette ambiance un peu rurale et la pauvreté des vêtements, quelque chose de difficile. On est loin des paysages idylliques. Aujourd’hui, quand on pense à la neige, on pense aux vacances, aux balades familiales, aux jeux dans la neige. Mais avant tout, surtout à cette époque, l’hiver était vraiment redouté et c’était synonyme de difficulté.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Tout à fait. Alors on va sortir de cette ambiance où le ciel est bas, pour parler de la seule sculpture que nous vous présenterons. Et qui s’intitule “L’Hiver”.
[Illustration : Jules-Jacques Labatut, “L’Hiver” – 1889]
Alors ici effectivement, on ne voit pas la neige, mais comme il s’agit d’une œuvre en marbre blanc, et bien on peut imaginer qu’on reste quand même dans le thème. Alors il s’agit avec cette sculpture, d’une commande d’un grand avocat toulousain qui voulait donc décorer son salon. Et il a demandé aux quatre plus grands sculpteurs toulousains de l’époque, et bien, de représenter les quatre saisons de l’année. Ici on a une œuvre réalisée par Jules-Jacques Labatut. Mais les autres saisons, ce n’est pas lui qui s’en occupera. Il y a notamment pour l’automne une œuvre de Falguière qui est un autre très grand sculpteur dont on vous a déjà parlé. Alors revenons à Labatut. C’est vrai que l’œuvre qu’il a réalisée, donc pour vous donner une petite idée, elle fait 97 cm de haut, donc presque 1m. Ca vous donne une petite idée. Et c’est vrai que c’est une œuvre qui insiste sur la pauvreté. Vous voyez les haillons qui servent de vêtements à cette jeune fille. Le bois mort à ses pieds. Ses pieds nus également. Elle n’a même pas les moyens pour avoir des vêtements chauds. Toute son attitude, tout son corps dit le froid, étant donné qu’elle a la tête baissée. Elle a la tête enfouie sous un foulard. Ses mains sont jointes comme pour se réchauffer et son corps est recroquevillé pour offrir le moins de surface possible, je dirais, au froid. C’est ça l’idée. Et elle personnifie véritablement la nature en sommeil et les rigueurs de l’hiver. C’est vrai qu’avec Marthe on s’était dit qu’on était près, donc tout près de cette fable de la Fontaine qui s’appelle “La cigale et la fourmi”. Puisque finalement elle porte en bandoulière mais remisée dans son dos, sa mandoline puisqu’elle ne peut plus s’en servir étant donné que la saison n’est pas propice, Elle ne peut plus chanter. Et c’est vrai qu’elle peut juste errer telle une âme en peine. Et c’est vrai qu’on se dit que la cigale ayant chanté tout l’été se trouve bien dépourvue puisque la bise est venue. On a envie de lui dire “mais que faisiez-vous aux temps chauds ?”. Et elle répondrait “mais je chantais, ne vous déplaise”. Voilà, on est dans le contexte. Alors c’est une saison de tristesse, une saison négative, une saison de contrainte. L’hiver, très souvent, les artistes le représentent sous les traits d’un vieillard fatigué. Et là, notre sculpteur Labatut, nous propose une jeune fille. Alors évidemment, c’est la sensualité de son âge qui est ici présentée. Le modelé délicat de son corps. Et vous avez bien sûr cette couleur blanche comme la neige.
[Marthe Pierot]
Et l’épaule qui est nue aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà, le vêtement est volontairement un peu déchiré sur l’épaule. Donc Labatut fait partie du groupe des Toulousains qui était très très influent à la fin du 19e siècle. Et cette sculpture, comme les trois autres, ornaient le salon 19e siècle du musée des Augustins.
[Marthe Pierot]
Oui. Alors on va revenir à la peinture parce qu’effectivement, parler de la neige en peinture, c’est peut-être plus simple qu’en sculpture. Là c’était vraiment surtout le contexte de l’hiver. Mais on reste dans l’hiver quand même ici avec ce tableau réalisé par Alexandre Antigna.
[Illustration : peinture d’Alexandre Antigna, “La Halte forcée” – 1855]
C’est vrai qu’Alexandre Antigna, c’est un peintre qui est très préoccupé par la question sociale. Il s’intéresse à la Révolution ou à l’esprit de la révolution de 1848 et à tout le contexte de cette période. C’est à dire et bien la période de l’exode rural. Ce moment où les paysans quittent les campagnes pour aller espérer trouver du travail en ville. Mais il s’intéresse à la précarité de la condition de ces réfugiés. La difficulté du monde paysan, l’industrialisation, toute la misère qu’elle entraîne, la condition ouvrière. Bref, c’est le peintre des humbles. Ils cherchent à leurs donner une dignité en les représentant. C’est un peintre réaliste qu’on peut rapprocher de Courbet et c’est quelqu’un d’engagé. Mais dans ce tableau ici, il nous montre un moment très anxiogène, déjà parce que la nuit tombe. Et on imagine qu’avec la nuit, le froid ne va cesser d’augmenter et de s’intensifier. Le cheval est couché, la carriole est renversée. Rien ne va plus. Cette famille qui était en chemin pour aller quelque part, peut-être en ville dans cette période d’exode rural, est obligée de s’arrêter suite à un incident. Est-ce que le cheval a glissé sur cette neige verglacée ? Est-ce que le cheval a été attaqué par un loup dont on peut deviner la silhouette un petit peu au fond vers la droite, vers la gauche, pardon. On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas le mystère est là et on sait que c’est compliqué pour cette famille. Et en plus de ça, la neige a dû brouiller tous les repères. Peut-être qu’ils ont perdu la trace de leur chemin. Tout est compliqué. Et on peut se dire que comme il fait nuit, il va refaire froid et peut-être qu’il va recommencer à neiger et peut-être que le feu ne va pas tenir. Voilà, on peut imaginer un peu toute la catastrophe qui peut arriver. En tout cas, on sent que la neige est tombée parce que, regardez, elle est évidemment au sol avec ses teintes bleutées. Et on a aussi cette neige qui est saupoudrée, qui saupoudre les vêtements, le haut de la carriole. Donc voilà, on a ces petites tâches blanches qui nous disent vraiment le froid et la difficulté de cette saison. Et puis regardez la couleur du ciel, pour évoquer le temps qui est parfaitement lourd avec cette palette très grise, avec un petit peu de vert et de mauve. Mais tout est là pour nous dire un petit peu à quel point il fait froid et à quel point finalement, on est dans quelque chose d’angoissant. Voilà. Mais ce qui nous rassure un peu, c’est de voir la détermination de cette femme, qui semble prendre les choses en main. Elle est au milieu, droite tel un pilier ou tout pivote autour d’elle. On sent que c’est elle qui prend les décisions face aux deux hommes complètement désemparés. Donc continuons, on parle aussi un petit peu d’une allégorie de la force. Finalement, elle représente, comme une Marianne, ce peuple infatigable dont il a à cœur de nous parler.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui, donc vraiment un tableau social en même temps qu’un tableau de neige. Alors on va continuer avec un paysage en extérieur réalisé par Victor Charreton.
[Illustration : peinture de Victor Charreton, “Neige à Royat”, hiver – vers 1918]
Nous sommes à Royat. Royat, c’est une station thermale du Puy de Dôme qui était très active au 19e siècle. On a ici un temps agité, instable, puisque vous avez une visibilité qui est troublée. Quand on regarde ce tableau, on a l’impression de regarder à travers une vitre givrée couverte par des plaques translucides. C’est la saison que Charreton préfère. C’est vrai qu’il a une prédilection pour les paysages d’hiver en Auvergne. Et d’ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, c’est là qu’il va résider. Et il va se concentrer donc sur les neiges qu’il va peindre maintes fois. Alors il est un paysagiste qui se trouve à la suite des peintres impressionnistes. On est juste un petit peu après le courant impressionniste et vous avez en fait quelqu’un qui va utiliser véritablement un couteau plutôt qu’un pinceau, pour parler d’une matérialité. On a souvent l’impression que la neige a une apparence un peu croutée. On va y revenir. Mais pour vous parler donc de lui, c’est intéressant juste de dire qu’il avait engagé des études de droit et il est même devenu avoué à Lyon. Et vers l’âge de 40 ans, il se consacre à la peinture, il va même écrire des articles sur la théorie des couleurs. Il est quelqu’un qui va essayer vraiment de réfléchir à sa pratique. Et justement sa pratique est particulière parce que pour donc obtenir cet effet que vous distinguez sur le tableau, il va avoir recours à une peinture sur finette. Mais qu’est ce que ça veut dire la finette ? C’est une étoffe pelucheuse qui lui permet de renforcer le caractère vaporeux de ces peintures. Une toile très cotonneuse. Et lorsque l’on peint du blanc dessus, ça donne un aspect un peu de cristaux. C’est le seul à peindre sur ce support-là. Donc il est assez inclassable avec cette technique-là. Son œuvre est souvent très intimiste. Parce que dans ce paysage il ne se, comment dire, concentre pas sur de vastes espaces. Il va resserrer son cadrage et il va nous parler de cette petite dame là qui est sortie, qui examine en fait son potager, qui est complètement couvert par la neige. Et voilà, il s’arrête sur l’attitude de cette femme. Et on est là dans une histoire qui est extrêmement intimiste comme je le disais. Alors ce qui est intéressant c’est qu’en fait il y a une manière de juxtaposer ces touches qui sont tantôt un peu rosées, un peu roses, mais souvent mauves et violettes. Mais et finalement, il y a des couleurs, telles celles d’un vitrail ici, pour nous parler de cette journée ensoleillée d’hiver. Et c’est intéressant aussi de dire qu’il est à la confluence de plusieurs mouvements, parce que vous voyez, on est un peu après l’impressionnisme, mais ses couleurs violettes le rapprochent du courant qu’on appelle le fauvisme. Et c’est vrai qu’il y a quelque chose d’un petit peu cubiste aussi, et je dirais de géométrique dans la manière de travailler les arêtes des toits. Voyez avec la verticalité, même dans la façade de cette maison. On rentre vraiment dans une modernité avec, et bien, cette manière de mettre ensemble tous ces courants.
[Marthe Pierot]
Après, bon, tu parles de soleil d’hiver. Moi je trouve que dans ce tableau on n’a pas vraiment l’impression qu’il y a beaucoup de soleil. Le bleu ou le mauve est très lumineux, c’est brillant, c’est beau, mais on sent quand même – si on peut distinguer un peu le ciel – quelque chose de lourd quand même aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Oui c’est juste parce que finalement il ne nous montre pas le ciel. Mais on a juste devant la maison, quelque chose de très blanc, de très très lumineux. [Marthe Pierot : Une façade qui accrocherait ou renverrait la lumière] exactement comme un miroir.
[Marthe Pierot]
Alors on reste dans les mêmes couleurs avec le tableau suivant, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de légèreté parce que la technique est tout à fait différente.
[Illustration : peinture de Carl Larsson, “Paysage d’hiver” – 1886]
C’est du pastel. Toujours intéressant de pouvoir évoquer la technique des peintres comme on vient de le faire avec du coup Charreton. Et là ici Carl Larsson est un peintre suédois qui nous propose un tableau très vertical dans une composition plutôt classique, parce que c’était un tableau qui se compose en trois plans. Vous avez au premier plan une meule recouverte de neige, et puis à l’arrière-plan, vous avez une clôture avec une silhouette qui se dessine et qui semble marcher dans la rue. Et tout au fond derrière, vous avez un alignement de façade de maisons. Mais ce qui est assez audacieux dans ce tableau, c’est de nous proposer au premier plan justement, cette meule-là qui prend toute la place. Un peu comme si c’était le personnage principal. Alors le peintre de ce tableau, de ce pastel, et bien il est suédois. Mais c’est surtout un illustrateur. Il réalise beaucoup d’affiches dans son pays natal. C’est une grande figure, il est connu pour ça. Il fait beaucoup d’aquarelles et de pastels, et il réalise des illustrations, souvent de vie intime et familiale où il représente des intérieurs de maison avec des enfants, des jardins. Alors là on est à l’extérieur, mais finalement moi j’ai un peu l’impression qu’on regarde par la fenêtre l’extérieur. Comme si on était dans une maison avec peut-être une tasse de thé chaud et qu’on observerait le jardin avec les personnes qui passent et peu de personnes qui passent derrière la clôture. Donc on peut retrouver un petit peu ce créneau là finalement. Mais c’est quand même intéressant de vous dire qu’il a passé dix ans de sa vie en France et qu’en fait il connaît les impressionnistes. Il fréquente ceux qui sont allés à l’école de Barbizon, donc il s’inspire un peu de la légèreté de la touche des impressionnistes. Même s’il y apporte une note personnelle avec la finesse de ce trait, avec les teintes vaporeuses et transparentes qui sont très propices au pastel et qui annoncent même aussi la technique de l’aquarelle, ce qui va réaliser après par la suite. Mais ça donne vraiment quelque chose de très atmosphérique. D’ailleurs, notre thème, la conférence sur la neige, c’est un sujet parfaitement atmosphérique. On est vraiment dans ces subtilités, dans ces ambiances et là on a un effet très intéressant qui propose l’idée d’un brouillard. L’idée de quelque chose d’un peu flou et d’un ciel très très bas. Cette brume hivernale où le personnage au fond est à peine visible. Voilà donc on a cette belle transparence. Mais on a quand même aussi la massivité de cette meule de foin en premier plan. Avec ce qui est intéressant et mignon, c’est de voir le petit chat tout en bas qui est de dos vers la droite, qui se frotte le dos contre peut-être les branches. Ou peut-être qu’il guette les oiseaux, parce qu’il y a beaucoup de petits oiseaux noirs qui viennent piquer le tableau, un peu comme des notes de musique sur une partition. Donc ces jeux de couleurs intéressantes entre le bleu, le doré du ciel et les touches noires du chat et de l’oiseau, et un ciel un petit peu, un peu verdi quand même. Voilà, donc c’est intéressant en tout cas de définir un peu l’atmosphère de ce tableau qui est tout à fait léger, parce que la technique nous le propose aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Effectivement. Alors on va garder ce bleuté, toujours quelque chose d’un petit peu plus appuyé quand même avec Henri Martin et donc la vallée du Lot.
[Illustration : Henri Martin, “L’Hiver sous la neige à la Bastide-de-Vert » – 1904]
Henri Martin, c’est quelqu’un qui passe sa vie entre le Lot et Toulouse et c’est vrai qu’il nous parle beaucoup de ces paysages puisqu’il est question ici de l’hiver sous la neige à la Bastide-du-Vert. Alors c’est intéressant de vous dire, messieurs dames, que ce tableau ne se trouve pas au musée des Augustins. Ce paysage, d’une vie rêveuse, il est au Capitole. [Marthe Pierot : on fait un petit écart là]. Absolument, on fait un écart parce que Henri Martin, nous avons beaucoup, beaucoup de tableaux de lui au musée des Augustins, mais nous n’avons pas de tableau de lui sous la neige. C’est pour ça qu’à quelques encablures, on est allé chercher celui du Capitole pour vous parler de la neige.
[Marthe Pierot]
Oui et puis si vous êtes toulousain, c’est très facile d’y aller pour pouvoir le voir. Donc vous n’hésitez pas.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Justement, dans la salle “Henri Martin” qui lui est consacrée au Capitole, vous avez des œuvres de lui de très très grand format puisqu’il est l’auteur là-bas d’un cycle qui concerne et bien les saisons. À gauche de l’hiver, vous distinguez l’automne avec cette petite femme toute seule. Et on glisse vers l’hiver. C’est important de faire comprendre cette progression-là. Alors c’est vrai que Henri Martin va s’éloigner un petit peu de la peinture impressionniste pure pour verser dans quelque chose qui est un petit peu plus mystérieux, qui est un petit peu plus symboliste. Et vous avez toujours quelque chose, qui est une atmosphère secrète, qu’il diffuse dans ces paysages. Ici, vous avez un tableau qui est barré par les lignes verticales des arbres. Et vous avez ce clocher au loin de ce petit village de la Bastide-du-Vert, et on descend lentement, voyez, il n’y a personne. Mais cependant, regardez à travers les fenêtres, il y a de la lumière, on a l’impression qu’il y a des feux de cheminée. Et donc chez Henri Martin, il n’y a pas de désespoir. La neige pourrait souvent dans certains tableaux, nous parler justement d’angoisse, mais ici, il y a quelque chose de très serein. Et ce qui est très important également de comprendre, c’est la technique de Henri Martin, puisque vous voyez, il y a beaucoup de blancs dans ce tableau. Mais si vous y regardez de plus près, vous apercevrez que le blanc n’est pas tellement blanc. Alors ici, avec ce détail, on a l’impression de quelque chose de très crémeux, de très beurré, de très onctueux, avec beaucoup de souplesse dans le pinceau. Il y a des touches qui sont courtes, qui sont séparées qui nous parlent de toutes les tonalités marron, glacées ou grises qui se logent ici. Et quand on continue, on considère ici des touches qui sont extrêmement mauves, très rosées également. Et si on regarde encore un petit peu de plus près, on s’aperçoit qu’entre les touches de peinture, il y a la toile, la toile qui permet de dire le blanc.
[Marthe Pierot]
Et ça a un nom ça, quand on voit la toile apparaître justement ?
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Absolument, ça s’appelle une mise en réserve de la toile. C’est une technique qu’il applique et que Monet avait déjà inventée en quelque sorte à la fin du 19e siècle.
[Illustration : peinture de Paul Bernadot, “Neige à Plaisance-du-Touch » – 1909]
[Marthe Pierot]
Alors on change un peu d’ambiance avec un tableau qui flirte toujours avec la modernité, mais qui nous propose des choses beaucoup plus dures, peut-être moins crémeuses, moins onctueuses et beaucoup plus rigides, en tout cas dans les lignes, ici avec Paul Bernadot qui est un peintre qui est né à Plaisance-du-Touch. Donc voilà, plutôt proche. Et à l’origine, il était médecin. Il a fait des études de médecine et il travaillait la peinture plutôt dans son temps libre. C’était plutôt une activité qu’il faisait à part. Mais comme il meurt très jeune, malheureusement à l’âge de 27 ans, de la tuberculose, on a peu d’œuvres de lui. Donc on ne sait pas s’il aurait finalement fini par abandonner la médecine pour poursuivre la peinture. Mais ici, il nous propose une technique très originale parce qu’en fait c’est un tableau qui nous propose des matériaux collés l’un sur l’autre. C’est à dire que c’est en fait du papier ocre collé sur du carton et il fait un mélange d’aquarelle et de gouache. Donc voilà, on est quand même dans une technique assez moderne sur un tableau qui fait 48 cm sur 63. C’est pour donner aussi une idée de taille. Voilà, et on a cette impression d’ébauche un peu. On aperçoit le support, le carton derrière et on a l’impression que ce n’est pas fini, mais c’est ce qui apporte aussi de la modernité. Donc on voit vraiment la différence avec des tableaux plus anciens, comme par exemple le Foschi qu’on vous a montré au tout début, ou même Sarazin de Belmont avec des lignes très fines et très précises. Là, on a l’épaisseur des traits bruns. On a une modernité aussi dans les formes très, très carrées, très cubistes un peu de cette œuvre-là. Alors ici, la neige, elle est comment ? Parce que c’est notre sujet. Et bien, elle se retire. C’est fini le blanc immaculé qui adoucit tout le paysage. Et là, on a plutôt une neige qui est sur la fin, qui se mélange avec la terre. Une neige un peu gadouilleuse, une neige un peu terreuse en tout cas, qui est peut-être même un peu verglacée avec le bleu au milieu. Il n’y a pas d’âmes qui vivent, pas de feu de cheminée. Ici, il n’y a rien du tout, on a l’impression que tout est dans le silence, tout est dans l’attente. Regardez, cette charrette à droite qui se trouve vraiment collée sur les façades de la maison. Elle est posée parce qu’elle ne peut pas servir avec ce climat. Elle est dans l’attente de la bonne saison. Donc tout est à l’arrêt, vraiment ici. Et on a ce contexte agricole de pauvreté. Sur le côté, vous avez une maison dont on devine les briques, le crépi ne recouvre même pas toute la façade de la maison. Parce qu’on imagine vraiment qu’on est dans un contexte difficile et que la neige, pour un contexte agricole, c’est catastrophique. Donc là, on a une sorte de monochromie qui n’est pas du tout idyllique. Un tableau qui n’est pas lumineux, une neige qui n’est pas harmonieuse hein, finalement. Mais c’est pour évoquer autre chose, un contexte tout à fait différent ici.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est sûr. Donc on sent vraiment que le temps arrive. On est vraiment entré dans le 20e siècle. Alors on va continuer justement puisqu’on va évoquer à présent un peintre qui s’appelle Henri Manguin.
[Illustration : peinture d’Henri Manguin, “Fruits et moustiers” – 1907]
On est en 1907 et là on est à l’intérieur. Pour la première fois on va se réchauffer. Mais sachez messieurs, dames, c’est un parti-pris peut-être parce que Marthe et moi nous pensons qu’en fait derrière la vitre c’est la neige, c’est l’hiver. Mais c’est peut-être pas le cas. Mais en tout cas on avait envie de le croire. Oui voilà donc c’est posé. Ce qui est intéressant c’est que, vous avez ici une chaleur douillette d’un intérieur qui est proposée par le mobilier. Les rideaux, la vaisselle, et justement, ce sont les matières qui sont les matières du tissu, de la céramique et même de l’extérieur derrière la vitre qui sont porteuses de cette couleur blanche. Donc on a une nappe avec une fibre assez épaisse qui est teintée de gris ou de mauve et qui nous donne une tonalité particulière de blanc. Et puis il y a le plat onctueux, de cette faïence qu’on appelle le moustier qui est une partie des Alpes de Haute-Provence. C’est une faïence particulière. Et regardez, les bordures du plat sont traitées en arrondi, ce qui nous donne un petit peu l’idée des congères de neige, de quelque chose qui est souple, d’un amas de neige extrêmement confortable. Et par la fenêtre à l’arrière on a vraiment encore une fois un rendu absolument atmosphérique qui nous parlerait peut-être d’une ville engourdie en contrebas. Alors c’est important de dire que Manguin utilise des notes de gris, de mauve, de jaune pour dire tous les accents qu’il apporte au blanc afin de différencier ces matières. Et sur ces tonalités froides que sont le blanc teinté, vous avez cette audace d’un rideau multicolore à gauche et les couleurs des fruits variés. Imaginez des mangues et des citrons. Et ces couleurs chantent d’autant plus que vous avez cette base froide et neutre qui est le blanc grisé. Donc ça, c’est vraiment une peinture moderne, dans la mesure où on se rapproche à nouveau de l’expérience du courant fauviste au début du 20e siècle, avec des couleurs pures et vives et cette volonté de simplifier les formes. Vous avez ici une manière de traduire la lumière grâce à la couleur.
[Marthe Pierot]
Tout à fait. Et on reste dans cette modernité et dans les couleurs qui peuvent être assez fortes et vivantes avec ce dernier tableau réalisé par Achille Laugé qui est également un pastel, un pastel sur papier.
[Illustration : Achille Laugé, “Paysage” – 1923]
Alors à première vue, on pourrait se dire “ouh un verger qui est peut-être encore enneigé finalement avec ces derniers petits flocons qui sont là”. Et bien non, c’est un petit piège qu’on vous tend ici, qu’on s’est permis en tout cas de faire. C’est qu’ici, nous sommes, le vert nous le dit, dans un contexte de printemps. Et ce sont vraiment les petites fleurs blanches, toutes fines et toutes légères sur cet arbre aux branches parfaitement évasées et légères qui pourraient évoquer la neige, mais qui sont là en fait pour évoquer la douceur et la légèreté du printemps. Alors Achille Laugé, c’est un peintre qui vient de l’Aude et qui est un peintre postimpressionniste. Un peu comme Henri Martin, qui suit les impressionnistes dans la légèreté de la touche mais qui propose aussi d’autres techniques. Ce qui pourrait être impressionniste quand même, c’est de voir l’utilisation du bleu pour parler de l’ombre. Regarder cet arbre là qui a des traces bleues sur le côté. On évacue vraiment les peintures et les couleurs foncées. Pour parler de l’ombre, on va utiliser beaucoup plus de lumière. Et on a l’impression que finalement, s’il y avait un petit peu de vent, toutes les fleurs blanches s’envoleraient et proposeraient aussi peut-être une petite tempête de neige, de fragiles flocons qui tomberaient sur l’herbe. Et même au fond, vous avez ces arbres qui sont comme des boules de neige ou comme des boules de coton un peu effilochées qui suggèrent aussi le blanc, et le blanc c’est vraiment la dernière marque de la saison passée. Donc c’est peut-être des touches aussi qui nous rappellent l’hiver qui vient de se terminer. Même si cette fois-ci pour la première fois on vous montre un ciel qui est bleu, qui est dégagé et qui est loin d’être lourd. Voilà, là, on est vraiment dans une autre saison, une saison plus légère proposée par cet artiste avec des coups de crayon qui différencient complètement cette peinture des peintures à l’huile qui disait justement l’épaisseur du manteau neigeux. Ici, la nature s’en est complètement débarrassé, elle respire et elle renaît. Et c’est pour ça qu’on voulait terminer sur ce tableau, sur l’arrivée du printemps.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Voilà une petite note optimiste.
[Marthe Pierot]
Bien sûr, tout à fait. Voilà, on a terminé avec nos dix visuels, Donc on vous propose de conclure à présent. Alors effectivement, après avoir examiné tous ces tableaux et cette sculpture qui nous parlent tous ou presque de neige, et bien on aurait pu s’attendre finalement, peut-être que c’est ce que vous imaginiez, une enfilade, une succession de tableaux monochromes qui sont tous blancs. Et bien on s’aperçoit, comme on vous l’expliquait en introduction, et bien que non, les artistes ne sont pas tombés dans ce piège et qu’ils ont su nous montrer avec beaucoup de finesse une multiplicité de couleurs et de lumière.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
C’est vrai qu’on avait envie d’insister sur le pouvoir qu’est la neige, parce que c’est un pouvoir étonnant. En quelques heures, comme par magie, comme par le coup d’une baguette magique, tout est changé. La neige va adoucir, va transformer le paysage. Elle va même parfois donc accuser, rendre le paysage plus rude. Mais en tout cas à chaque fois, elle réécrit le paysage à sa manière.
[Marthe Pierot]
Oui, tout à fait. Et dans nos collections, c’était intéressant aussi de nous intéresser aux artistes qui représentent la neige. Et on s’aperçoit que dans les peintres anciens, il n’y en a pas tant que ça, ce sont surtout les artistes hollandais qui connaissent bien la neige, qui vont nous parler de ces paysages. Et en France, c’est surtout à partir du 19e siècle et l’impressionnisme, quand on peint à l’extérieur, que là on va justement s’attarder à ces paysages de neige. Mais c’était difficile pour nous de choisir dix visuels parce qu’il faut savoir que beaucoup de paysages que nous avons sont du 20e siècle. Beaucoup de peintres modernes aiment parler de la neige. Mais ces tableaux-là, on ne pouvait pas vous les montrer parce qu’ils sont trop récents. Ils ne sont pas encore tombés dans le domaine public – ça c’est pour le côté anecdotique – et donc ils sont encore réservés de droit. Donc on ne pouvait pas tous vous les montrer. Mais il y en a plein encore dans nos réserves qui sont spectaculaires et très très beaux à voir. Mais il a fallu faire un choix dans ce qui était possible aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
En fait, on peut se dire aussi que quand il neigeait, le photographe faisait son plus gros chiffre de l’année parce que tout le monde prenait des photos. Aujourd’hui, c’est différent puisque tout le monde a son téléphone et peut donc prendre des photos. Mais ce qui reste une chose très importante, c’est qu’on a toujours cette envie de fixer, d’immortaliser le moment où la neige est tombée. Parce qu’il y a là quelque chose qui se passe. On redevient des enfants et c’est vrai qu’on veut fixer le beau. Parce que ce beau-là est éphémère et qu’on a envie de goûter à ce silence tellement particulier.
[Marthe Pierot]
Oui tout à fait. C’est très très beau de conclure sur ça. Peut-être qu’on avait aussi envie de vous parler d’autres paysages qu’on ne vous a pas montré parce qu’on ne les a pas. Mais qui sont importants pour les paysages de neige.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Et oui, parce que par exemple, si vous allez au musée d’Orsay, vous allez voir “La Pie” de Monnet. Là c’est mon préféré. C’est vrai que vous serez émerveillés par la qualité du blanc et la lumière.
[Marthe Pierot]
Oui et puis on peut penser aussi à tous les paysages de ce romantique allemand, Friedrich, aussi vraiment, où il peint beaucoup de paysages de neige. Voilà, n’hésitez pas à regarder d’autres paysages pour vous inspirer un petit peu de toutes ces subtilités.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Pour prolonger.
[Marthe Pierot]
Oui exactement. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivi. Et puis on vous souhaite et bien peut-être une bonne soirée ou une bonne journée, et on vous dit à bientôt !
[Isabelle Bâlon-Barberis]
A très bientôt !
[Marthe Pierot]
Au revoir.
[Isabelle Bâlon-Barberis]
Au revoir.
Folies vestimentaires
Folies vestimentaires
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Folies Vestimentaires”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2024]
Isabelle Bâlon-Barberis : Messieurs, dames, Bonjour
Marthe Pierot : Bonjour à tous et toutes
Isabelle Bâlon-Barberis : Aujourd’hui on se pique de parler couture.
Marthe Pierot : Oui et d’ailleurs ça se voit un petit peu avec nos vêtements, notre accoutrement.
Isabelle Bâlon-Barberis : On assume cette exubérance parce que le thème
Marthe Pierot : Et oui le thème c’est “Folies vestimentaires”, donc soyons folles. Voilà, on voulait vous parler de beauté, de gourmandise, de tissu. Vous allez voir à travers 10 visuels, on va parler étoffe, dentelle, textile et fanfreluche.
Isabelle Bâlon-Barberis : Mais le vêtement n’est pas là juste pour le plaisir des yeux et il nous raconte des choses. Il obéit à des dress codes parfois très particuliers. Sur quoi nous renseigne-t-il vraiment ?
Marthe Pierot : Oui, c’est vrai que le vêtement nous donne beaucoup d’indices. Parfois des indices sur la géographie, on va voyager un petit peu. Parfois il nous donne des indices aussi sur la personne en elle-même. On est looké un peu en fonction de son statut dans la société, d’une hiérarchie. Parfois le vêtement nous renseigne simplement sur une époque, le Moyen Âge, après la révolution. Et parfois le vêtement est juste là pour le plaisir. C’est de la liberté, l’exubérance, le vêtement est une fête.
Isabelle Bâlon-Barberis : Et nous nous attarderons aussi sur la manière dont les peintres traduisent et bien toutes ces étoffes. La manière dont ils nous parlent, des velours, du satin, du côté transparent, des voiles, de tous ces effets de matière qui sont très beaux. Donc on a 30 minutes et c’est un peu la Fashion Week au musée des Augustins
Marthe Pierot : C’est vrai. Et bien allons-y, c’est parti.
[Illustration : Louis Duveau, “L’abdication du doge Foscari” – 1850, peinture]
Marthe Pierot : Alors nous allons débuter avec ce tableau qui s’intitule “L’abdication du Doge Foscari”, un tableau du 19e siècle. On est tout de suite frappé par les couleurs de cette toile, cette harmonie des tons ocre, un peu sable chaud doré avec quelques rouges intenses qui viennent, justement, accentuer la richesse et le raffinement des tissus. Nous sommes à Venise à la fin du 15e siècle. Venise à cette époque, il faut le savoir, c’est la reine du commerce en Méditerranée. Il y a donc un important brassage de population. Mais surtout beaucoup de richesses au niveau de cette ville. Et on le voit ici, il y a une richesse du costume. On note les très beaux habits, les effets de matière, les satins, les soies, les taffetas.
Mais ce qui attire notre regard, c’est le personnage qui se trouve au centre. Il capte toute la lumière. Cet homme, c’est lui, le Doge Foscari. Alors qu’est-ce que c’est, un doge ? C’est vrai que c’est un mot qu’on n’utilise pas forcément tous les jours. Le Doge, c’est le chef. C’est le dirigeant, c’est celui qui va diriger la République de Venise. Il faut savoir qu’on est à une époque où Venise est organisée en plusieurs États avec des gouvernements différents. Ce n’est pas le pays unique que l’on connaît aujourd’hui. La République de Venise était dirigée par des doges.
Le moment qui nous est montré ici, c’est le moment où il est disgracié. Après avoir administré pendant 35 ans la République de Venise, il ne fait plus l’affaire et suite à une conspiration, il est obligé d’abdiquer. Et donc le peintre nous montre avec beaucoup de théâtralité le moment où le doge est obligé d’accepter son sort. Il quitte son palais par le grand escalier de pierre. C’est très dramatique de descendre cet escalier monumental avec peut-être beaucoup de lenteur.
Mais parlons de son vêtement parce que c’est notre thématique. On voit qu’il a un bonnet sur sa tête, mais c’est surtout sa robe qui est incroyable. Cette robe de satin brochée d’or. Alors on voit, quand on zoome, qu’il y a une doublure en hermine à l’intérieur. Mais surtout, quelle est cette technique-là ? Parce que c’est vraiment brodé à cette époque. On peut parler de brocard. Le brocard en fait, c’est un tissu d’une grande richesse qui est connu depuis l’Antiquité. Mais c’est l’idée de broder des motifs en relief sur un tissu, des motifs floraux ou géométriques. Ce sont des vêtements de luxe et de cérémonie. Mais on peut penser à une autre technique, avec Isabelle on n’est pas tout à fait sûr, c’est le damas. Le damas, c’est un petit peu le même principe, ce sont des étoffes de soie qui sont brodées en relief, mais il y a le côté réversible. Une partie des fleurs sont en satin et de l’autre côté c’est du taffeta. Donc on a ce côté un peu recto/verso, et on ne peut pas vraiment le voir ici, mais c’est une technique qui vient de Syrie, d’ou le nom de Damas.
Et c’est possible de la voir ici parce qu’on est à Venise et c’est la reine du commerce. Donc il peut y avoir des techniques qui viennent d’Orient, c’est tout à fait possible. En tout cas, on voit d’autres personnages. A gauche, vous avez sa belle fille qui le soutient, qui porte une robe en soie bleu-vert avec un très beau décolleté et une écharpe blanche à rayures qui tombe au niveau de ses hanches avec ce côté taille basse qui est souligné. Ce qui en fait un vêtement typique du Moyen Âge. Donc on peut replacer les époques aussi grâce à ça.
Et puis plein d’autres personnages. On voit d’ailleurs celui qui est à l’origine de cette abdication, qui a ce regard un peu machiavélique, qui est habillé de rouge. Beaucoup de monde est présent, tout le monde assiste à cette scène très dramatique.
[Illustration : Antoine De Favray, “Dames levantines en coiffure de ville – femmes maltaises”, 1768, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Nous continuons avec une certaine idée de l’Orient avec ces “dames levantines en coiffure de ville”. Un tableau qu’on appelle également “les femmes maltaises”. Une œuvre de la fin du 18e siècle. Dans ce tableau, il y a cette tendance orientaliste, celle qui avait beaucoup de succès, celle qui nous parlait d’un Orient qui était en fait en Méditerranée, du côté de Malte ici en l’occurrence. Et ces œuvres, on les appelait des turqueries. Souvenez-vous que Mozart, au même moment, écrit La marche turque.
Alors quand on considère l’œuvre, on voit un cadrage court, des personnages qui sont à mi-corps. Et nous nous trouvons très près d’elle, dans un monde clos, dans un monde qui dit l’intime et on voit qu’elles se parlent par les yeux avec ces jeux de regards. Voyez la lenteur, voir la longueur de leurs attitudes. Il y a certainement un lien de parenté entre elles, une amitié, en tout cas une bienveillance. Elles se préparent certainement à sortir puisque sur leur turban, il y a ces voiles et regardez les vêtements, notamment la femme sur la gauche.
La femme sur la gauche nous propose ce petit manteau de fourrure grise, ce mantelet. Quant à la femme du milieu, elle porte en fait un manteau dans une couleur qui est un beige rosé, un manteau qui semble moiré, avec une pelisse, c’est à dire une fourrure blanche. Le manteau est doublé de fourrure blanche à l’intérieur, et on le voit bien au niveau de son décolleté. Il y a notamment aussi cette finesse du voile sur ces seins, ce jeu de transparence. Les reflets des soieries, les rivières de diamants autour du cou. Elles sont extrêmement apprêtées, parées même, à partir, à sortir. Et vous voyez, concernant leurs cheveux. Il n’y a que quelques mèches courtes autour du visage, et surtout pas, surtout pas de longs cheveux dans le dos, ce ne serait pas décent.
Alors elles sont là dans une prison, qui est peut être une prison dorée, et elles sortent. Peut être est ce le jour ici du mariage ? En tout cas si c’est la mariée au centre, elle est parfaitement absente. Elle est belle mais elle n’est pas très enthousiaste, c’est le moins qu’on puisse dire. Alors vous voyez, en fait c’est important de dire que la personne du milieu est très claire au niveau de son vêtement, celle qui est sur la gauche est plus foncée. Et il y a cette volonté de faire jouer justement l’une par rapport à l’autre. Regardez celle de gauche, les petits bouquets à fleurs brodés sur son bras. Et regardez également les rayures. La rayure pendant des siècles en Occident et bien ça nous parle des gens qui sont exclus, qui sont hérétiques, qui sont des jongleurs, des bouffons. C’est aussi la tenue de celui qui est en livrée. C’est le domestique qui porte des rayures. Mais dans cet Orient là et bien la rayure n’a pas du tout le même symbole et c’est pour ça qu’on l’utilise. Elle aura ensuite en Occident, de beaux jours devant elle. On va beaucoup l’aimer.
Marthe Pierot : Mais c’est intéressant cette histoire de rayures finalement, de savoir.
[Illustration : Denis Etcheverry, “Les nounous, Ariégeoises et Bretonnes”, 1899, peinture]
Marthe Pierot : On vous propose d’aller en extérieur, parce que jusque-là on était dedans. Sortons un petit peu pour parler de ces nourrices. Un tableau réalisé par Denis Etcheverry, qui est un peintre de Bayonne. Alors il y a 4 nourrices dans ce tableau et 2 bébés. Un qu’on voit très bien, un autre, qu’on peut deviner car celle qui est à l’arrière-plan porte un bébé qui ne ressort pas, parce qu’il est complètement noyé dans un méli-mélo de mousseline et de dentelle. Et puis vous avez une petite fille en bas à gauche, qui est habillée d’un vêtement rose, qui joue dans le sable. Ici, nous sommes à Paris, dans le jardin des Tuileries plus exactement. On peut le reconnaître avec ces caisses d’orangers ou de lauriers qui existent toujours et cet escalier en pierre et les nounous, parce qu’on parle du vêtement.
Et bien parlons du vêtement que portent ces nourrices. Elles sont habillées aux couleurs locales. Elles portent coiffes et habits folkloriques pour nous montrer qu’elles viennent de la France entière, mais qu’elles ne sont pas de Paris. En fait, les familles aisées, les familles qui ont de l’argent, font appel à des nourrices de toute la France entière. Elles cherchent les meilleures selon les régions pour les faire venir à Paris et s’occuper de leurs enfants. Et donc, on reconnaît une ariégeoise au premier plan avec son costume traditionnel. Elle a un vêtement qui nous signifie qu’elle vient de la Haute vallée de Bethmale. C’est très précis avec cette robe écarlate, ce corsage sombre, ce tablier blanc et cette toile incurvée en voûte qu’elle a au niveau de sa tête avec ce bandeau noir. Et qu’est-ce qu’elle fait ? Elle s’apprête à donner le lait du bébé, évidemment en tant que nourrice. Un bébé dont on ne sait pas vraiment s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon. Parce qu’à l’époque les enfants s’habillaient pareil. Mais on a plutôt l’impression que c’est un vêtement de baptême tellement il est bien habillé cet enfant.
Et puis derrière, vous avez cette femme debout, qui est une bretonne. Elle a une robe sombre avec un décolleté brodé, puis on a vraiment cette coiffe caractéristique de la Bretagne. Mais celle-ci semble plutôt résigner par son travail et sa condition. Elle est moins épanouie que la première. Et puis au fond, vous avez 2 nourrices qui discutent sur la droite. Et après avoir étudié toutes ces coiffes, avec Isabelle, on pense qu’elles sont sûrement bretonnes aussi parce qu’il y a plein de costumes en Bretagne. La région est grande, donc c’est tout à fait possible.
Isabelle Bâlon-Barberis : Presque la bigoudène.
Marthe Pierot : Oui, c’est vrai, c’est forcément d’où elle est. En tout cas, ce sont des femmes qui nous parlent d’un métier. Enfin qui évoque ce métier de petites conditions. Et le vêtement ici nous dit leur déracinement. Il nous dit vraiment qu’elles ne viennent pas de Paris. Et on a aussi tous ces tissus, ces voilages, ces dentelles, ces soies, au niveau des enfants qui nous disent la richesse des femmes et des familles qui font garder leurs enfants. Mais on note surtout l’idéalisation du moment, la douceur des couleurs, des lumières dorées, des matières. En fait, ce tableau correspond vraiment à une époque précise, la fin du 19e siècle et surtout la 3e République qui veut parler du sujet des enfants pour nous attendrir. C’est vraiment dans la veine du moment.
[Illustration : Marie-Guilhelmine Benoist, “Portrait du baron Larrey”, 1804, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Passons au monde des hommes avec ce splendide “portrait du baron Larrey” réalisé au début du 19e siècle par sa belle sœur Marie Guilhelmine Benoîst. Cette femme peintre est l’élève de très grand peintre comme Vigée Le Brun, la grande peintre de la fin du 18e siècle. Et c’est vrai que cette femme qui peint son beau frère, était connue en son temps, sa reconnaissance était officielle. L’histoire l’a un petit peu oubliée, mais c’est intéressant aussi de lui rendre hommage.
Alors le portrait de son beau-frère, c’est celui d’un homme, à mi-jambe, un homme assis dans un fauteuil d’acajou et regarder le velours vert olive et les clous dorés, qui nous parlent d’une époque, à savoir le style empire, l’époque de Napoléon. Regardez la bague épaisse, le crayon et le rouleau qu’il a à la main. En fait, c’est le compte rendu chirurgical qu’il a rédigé. Il fait partie de l’armée d’Égypte. Et là on est très précisément dans une période et une géographie. Alors il y a, au tout début du 19e siècle, la création de l’Empire. Et c’est vrai que notre baron Larrey, va être un chirurgien précurseur en matière de chirurgie, puisqu’il va agir dans l’urgence, il va secourir les blessés, trouver des solutions. C’est un homme qui est célèbre justement pour ces actions-là.
Il est natif des Hautes-Pyrénées, c’est pour ça que c’est important d’en parler. Il va fonder à Toulouse le premier hôpital militaire. Mais comment se présente-t-il ici ? Regardez cet homme de 38 ans. A cette époque, il est dans la force de l’âge, voir dans la maturité. Ses joues sont rouges, elles disent son énergie, ses mèches sont souples comme agitées par le vent et ça ça nous dit l’action. Regardez sa veste, c’est une redingote sombre avec des basques longues. Et elle a également ce haut col brodé d’or qui est typique. Le col droit est typique de l’aire napoléonienne. Il n’y a pas d’épaulette qui nous dirait un petit peu son grade, parce qu’ici c’est un vêtement pour la parade, pour les soirs de gala, pour le Prestige. Mais Regardez son pantalon qui est aussi un pantalon de prestige, parfaitement blanc, qui est souligné par le liseré doré.
Je voudrais revenir sur le fait qu’à cette époque on parle pas de pantalon mais de culotte. Concernant les bottes, ce sont des bottes de prestige . Regardez le pompon qui vient les décorer . Elles ne sont pas du tout celles qu’on porte sur un champ de bataille. Le vêtement est très soigné et qu’il exalte la magnificence impériale.
Marthe Pierot : Oui, et il dit aussi la fierté de porter la médaille de la Légion d’honneur, cette distinction très importante. Cette médaille qui est avec un ruban rouge sur son vêtement.
Isabelle Bâlon-Barberis : Bien sûr
[Illustration : Antoine Durand, “Portrait de Bernard de Tissendier, capitoul”, 1648, peinture]
Marthe Pierot : On continue dans cette dynamique, dans cette idée de montrer le vêtement qui fait l’homme, qui fait la fonction. Avec cet autre portrait, un homme un peu moins jeune peut être un peu moins séduisant , un peu moins glamour, mais on l’aime bien quand même, il nous fait rire avec Isabelle. Il s’agit du portrait de Bernard de Tissendier, un homme qui était capitoul à Toulouse au 17e siècle. Les capitouls sont des hommes qui sont comme des conseillers municipaux. Il faut savoir que du 12e siècle jusqu’à la Révolution, les hommes se sont succédés à Toulouse pour diriger et organiser la ville de Toulouse. Ils siégeaient à la maison commune, qui est aujourd’hui la mairie, place du Capitole. Alors parfois ils étaient 8, parfois ils étaient 15. Le nombre varie, mais en revanche ils changent tous les ans. À chaque mois de novembre, il y a une nouvelle élection. Ce sont évidemment des hommes qui sont issus de la bourgeoisie citadine qui ont cette fonction. En étant capitouls, ils ont beaucoup de privilèges, des privilèges juridiques, fiscaux, financiers mais surtout honorifiques. Ils deviennent nobles en étant capitoul. Cette fonction permet un anoblissement et on le voit ici parce qu’il y a sur la droite un blason. Donc on voit que Bernard de Tissandier avait son blason. Il est donc noble. Mais surtout, parmi tous les droits qu’ils avaient outre les privilèges, ils avaient le droit à l’image. Alors ça, c’est particulier. Ils avaient le droit d’être officiellement représentés dans les documents de la ville, les registres, les annales, tout ce qui était officiel, ils y avaient leurs portraits. Alors comme ils changeaient à chaque fois, et bien c’était une manière de garder une trace de leur passage à Toulouse. Ils avaient un portrait individuel et un portrait collectif. Un peu comme une photo de classe à chaque nouvelle élection.
Donc si on en revient à son expression, qui nous amuse, il a une expression tout à fait suffisante, dédaigneuse, voir hautaine. Puis regardez ce geste de la main qui nous met à distance.
Pour en revenir aux vêtements, parce que c’est notre thème, et bien ici, il a un vêtement volumineux qui révèle quand même malgré tout son embonpoint. C’est un habit officiel, c’est l’habit du Capitoul avec ses couleurs rouge et noir, qui sont les vêtements de Toulouse aussi. On a ce manteau rouge qui est par-dessus une robe de velours noir. On a un peu d’hermine au niveau des épaules, mais c’est intéressant de se dire que ce sont les couleurs de Toulouse depuis longtemps. Et il faut savoir que c’est encore très actuel puisque les joueurs de rugby du Stade Toulousain portent également ces couleurs.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Ça c’est une vraie petite mise à jour.
16:06
[Illustration : Philippe de Champaigne, “Réception d’Henri d’Orléans Duc de Longueville, dans l’ordre du Saint-Esprit, par le roi Louis XIII, le 15 mai 1633”, 1634, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors on va continuer avec l’apparat, le prestige et le 17e siècle avec ce grand tableau. Et c’est important de vous dire qu’avant la Révolution Française, les couturiers, les brodeurs avaient des secrets de fabrication. Et les commandes qu’ils recevaient ne concernaient pas du tout les vêtements féminins mais ceux portés par les chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit, qui est la garde rapprochée du roi de France. Donc ce sont des vêtements qui sont les plus précieux qui soient. Cet ordre de chevalerie, c’est un petit peu une Légion d’Honneur avant l’heure, est içi décernée à celui qui est à genoux. Vous avez cette cérémonie fastueuse, solennelle. On a ici un homme qui va jurer fidélité. Il sera à la hauteur du rang qui va le distinguer, et il porte des vêtements extraordinaires. Ils ont tous des vêtements qui sont de très grande qualité. Des fils d’or et d’argent viennent justement décorer ces manteaux.
Alors le roi de l’époque et Louis XIII et ici, il est entouré de sa garde rapprochée. Il y a énormément de solennité dans la scène. Regardez les riches étoffes et cela du sol au plafond. Le sol et les murs sont tendus de soie bleu estampillée par la fleur de lys. Et vous avez les fraises, ces collerettes au cou, qui sont de tuiles et de dentelle et qui magnifient le visage. Regardez les manteaux. Ces manteaux de l’ordre qui ont un revers jaune-orangé, qui apportent des tonalités tout à fait flamboyantes. Par contre les manteaux noirs sont bordés justement de ces flammes. Il y a des collants blancs qui sont régulièrement repoudrés parce qu’ils se salissent, donc il faut trouver des solutions. Et il y a ces culottes amples et bouffantes comme un short très gonflé et qui dévoilent les cuisses. Et puis il y a ce qu’on adore avec Marthe, c’est la double chaussure. En fait, il ne faudrait pas que les souliers portés en extérieur viennent égratigner la soie du sol, donc on passe une pantoufle supplémentaire.
Marthe Periot : Et même cette petite chaussure avec la belle fleur en dentelle est très sophistiquée.
Isabelle Bâlon-Barberis : Exactement. Donc en fait, tout est guindé. Henri d’Orléans, ici est reçu, mais tout est calculé pour le recevoir jusque dans les moindres détails. Et on voit aussi qu’il y a 2 pouvoirs qui s’affrontent, c’est la monarchie et l’Église. La monarchie, c’est le roi assis au centre, coiffé par son chapeau. Et l’Église, c’est sur la droite, cet hôtel avec les cierges posés dessus. Un peu comme dans une secte. Tout est codifié, il y a un protocole, une solennité, le paraître, et d’ailleurs tous sont habillés de la même façon, comme s’ils portaient un uniforme.
Marthe Periot : Oui, c’est vrai.
[Illustration : photo d’un manteau de l’ordre du Saint Esprit, conservé au musée du Louvre]
Isabelle Bâlon-Barberis : Et on a vraiment envie de vous dire que nous sommes allés au Louvre où ces manteaux sont encore conservés.
Marthe Periot : Oui, c’est impressionnant de les voir en vrai.
Isabelle Bâlon-Barberis : Les manteaux du tableau existent encore.
[Illustration : Francesco Curradi, “Le Triomphe de Judith”, vers 1630, peinture]
Marthe Periot : Alors on reste au 17e siècle mais avec un contexte assez différent. Et cette fois-ci, on va surtout vous parler d’une femme. Il s’agit de Judith. Judith qui est un personnage biblique, c’est une héroïne pour le peuple juif. Elle est connue pour avoir décapité au 6e siècle avant Jésus Christ, le général Holopherne. Ce général qui voulait envahir, opprimer ses terres et son peuple. C’est une vengeresse et une justicière.
Ce tableau, réalisé par Francesco Curradi, nous montre le retour victorieux de Judith. Elle a déjà accompli cet acte guerrier et elle revient sur son camp. Elle est au pied des murailles de la ville de Bettuli, qui est une ville en Palestine. Elle est accueillie par le prêtre, et on voit derrière elle ses servantes qui tiennent la tête dans une corbeille. Ou encore, une autre jeune fille qui s’est emparée du sabre et qui le brandit . Mais Curradi, ce peintre Florentin est un très bon metteur en scène parce que dans cette belle composition, il nous montre beaucoup de calme, des gestes très lents, très affectés, avec un équilibre très aéré et des couleurs très douces. Tout cela est maniériste, et c’est un peintre maniériste. Regardez les inclinaisons des têtes, la grâce de toutes ces attitudes et ces couleurs très mauves, très pâles et douces que portent les prêtres sur la gauche.
Il y a des couleurs douces, c’est vrai, mais il y a des couleurs aussi qui réveillent l’ensemble, notamment l’orange acidulé et le rouge vif qui se retrouvent à différentes endroits, à différentes extrémités du tableau. Et Judith rassemble ces 2 couleurs, sa robe est orange et rouge. Elle se voit, c’est une manière d’attirer notre attention sur elle, ce personnage principal. Et c’est aussi pour nous rappeler que c’est avec cette tenue qu’elle a séduit le général Holofernes. C’est comme ça qu’elle est arrivée à ses fins. Donc il faut la montrer féminine, c’est donc pour cela qu’elle a une plume, des bijoux et beaucoup de vêtements.
Mais parlons de ces vêtements justement. On a ces très beaux tissus imprimés, ces effets d’impression. On peut vraiment parler d’un tissu imprimé, un peu comme les prêtres sur le côté, parce que c’est une époque où l’impression arrive en Occident. On est au 17e siècle, les voies maritimes simplifient les échanges et des techniques venues d’Orient peuvent apparaître jusqu’à l’Occident. Les impressions existent depuis des millénaires. Il y avait les impressions sur soie en Chine, les impressions au pochoir au Japon et puis les impressions à la planche qu’on utilisait en Inde, ce qu’on appelle des indiennes. Ca fait comme des tampons qu’on utilise sur le vêtement. C’est donc tout à fait possible, que ces personnages portent ces vêtements-là. On est dans un contexte un peu oriental, parce que le personnage tout à gauche porte un turban. D’ailleurs un turban rayé, si on revient à la rayure, ce qui est tout à fait oriental. Mais ce tableau c’est surtout le prétexte à un très beau défilé de mode, avec ces personnages alanguis, qui avancent comme un cortège.
On perdrait presque un peu l’histoire. Mais Il y a tout de même un détail très intéressant qui nous rappelle l’histoire, c’est le geste que Judith fait. Elle a une robe encombrante, certes, mais elle lève sa robe pour nous montrer cette botte de guerrière, cette botte en métal qui nous rappelle un peu l’armure, comme si elle avait une armure sous son vêtement, pour nous rappeler justement l’acte viril et puissant qu’elle a accompli. Cette botte là nous montre la force et le courage de Judith.
[Illustration : François-André Vincent, “Guillaume Tell renversant la barque sur laquelle le gouverneur Gessier traversait le lac de Lucerne”, 1791, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors nous allons continuer avec un héros, suite à Judith, l’héroïne de Palestine, on va parler ici d’une autre géographie encore avec Guillaume Tell. Puisque Guillaume Tell est le héros de la Suisse. Dans ce tableau de l’extrême fin du 18e siècle, il est question d’un homme du peuple qui a jadis libéré son pays de l’oppresseur. Ce tableau surfe vraiment sur ce qui vient de se passer en France avec la Révolution Française qui aime parler des héros qui se révoltent. Alors, c’est un acte de bravoure qu’il a accompli. Il en a accompli plusieurs et il a notamment tenu tête à celui qui est sur la gauche du tableau et qui se renverse dans une barque. C’est le gouverneur Gessler. Guillaume Tell qui se trouve à droite, en rouge, l’a beaucoup nargué jusqu’à ce que finalement le gouverneur Gessler, ne supportant plus l’aplomb de Guillaume Tell le fait arrêter. C’est pour cela qu’on associe souvent Guillaume Tell à son carreau d’arbalète, ce qu’il porte à la main, comme un Robin des Bois, mais Suisse cette fois. Donc il est condamné, notre Guillaume, à finir ses jours dans une prison. La barque devait l’emmener vers cette prison, on est au niveau du lac des 4 cantons en Suisse. Finalement il va parvenir à sauter de la barque et c’est donc le gouverneur qui va finir dans une cascade, de manière certainement très funeste.
Mais parlons du vêtement, revenons à notre sujet. Nous sommes au 14e siècle, quand il est question de Guillaume Tell, et il est question de ces hommes qui portent collants et culottes courtes. Vous avez des jambes qui sont libres et sans entraves. Et ça c’est très important parce qu’au même moment, le vêtement féminin empêche la femme de se déplacer aisément. La femme doit se contenter d’une sphère domestique, alors que c’est l’homme qui vivra des aventures et qui va explorer le monde. C’est facile avec un vêtement pareil. Le vêtement masculin est une tunique ceinturée, elle est courte. Elle est portée par les militaires, par les travailleurs au champ, alors qu’elle est beaucoup plus longue s’il s’agit des prêtres ou des grands personnages. Mais ici vous voyez que le gouverneur porte cette tenue courte, tout comme Guillaume. Mais les matières et les tissus ne sont pas les mêmes. Le gouverneur à gauche porte des soies, des satins, des fourrures, alors que pour Guillaume sur la droite, on a de très jolies couleurs, de très jolies teintures, mais point de richesse.
C’est important de dire qu’au 14e siècle, ce sont les jeunes nobles qui ont l’idée d’utiliser les vêtements qui se trouvaient sous l’armure pour en faire des vêtements de dessus finalement. Parce que sous les armures et les cuirasses, il y avait des collants et des petites tuniques. Et c’est ce qu’on voit là. Ils vont déambuler dans les rues, vêtus de ce costume court ajusté à la taille. L’église va s’offusquer, va crier au scandale. Mais une mode était née et les jeunes gens étaient très fiers justement, de montrer les muscles avantageux de leurs jambes, les courbes de leur corps, c’est très moulant et très osé. C’est une mode qui est née de cette manière-là.
[Illustration : Hortense Haudebourt-Lescot, “Deux merveilleuses”, 1810-1840, peinture]
Marthe Pierot : Alors on vous propose de parler à nouveau des femmes et de rentrer à l’intérieur, de se mettre au chaud. Peut être pour parler de ce tableau réalisé par Hortense Haudebourt-Lescot. C’est ce qu’on appelle une scène de genre. C’est un petit format qui nous montre une scène de la vie quotidienne mettant en scène des personnes anonymes. C’est un genre qui est souvent réservé aux femmes, d’ailleurs. Même si Hortense Haudebourt-Lescot était une femme très en vue à son époque, elle était reconnue de son temps. Elle a vécu à Rome et a même logé à la Villa Médicis, ce qui n’était pas possible pour les femmes normalement, donc c’est assez exceptionnel. En tout cas, ici, elle nous montre 2 jeunes femmes qui semblent faire une halte pour le goûter, une petite pause gourmande en plein voyage.
Pourquoi ? Parce qu’en fait, elles ne sont pas assises, elles ne sont pas installées, pas de chaises, pas de tables, elles sont debout, elles n’ont même pas enlevé leur manteau et elles se trouvent dans un lieu un peu vétuste. Regardez le vieux plancher qui n’est pas tout à fait travaillé. On sent que c’est un lieu de passage, comme l’arrière boutique d’une auberge peut être. Mais la gourmandise n’attend pas Isabelle. Donc il faut absolument grignoter des choses. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c’est de sentir certes les odeurs de beurre, de fleur d’oranger, de sucre vanillé, mais il y a autre chose quand même. Il a plus à nous dire ce tableau. Regardez le vêtement de ces femmes. Eles ont des longs châles qui n’ont pas vraiment de forme. Elles portent des foulards noués un peu n’importe comment et accumulent soie et voile transparents autour d’elles. On a l’impression qu’elles sont déguisées, comme si elles avaient ouvert la malle de déguisement pour s’amuser un petit peu. Elles sont habillées en marge de tout dress code, et pourtant non, c’est caractéristique d’une époque, une époque qu’on appelle le Directoire. Alors vous avez eu la Révolution Française et après il y a une période qu’on appelle la terreur, une période terrible de privation totale, sans aucune liberté. Quand la terreur s’arrête, l’excentricité est au pouvoir. On est de nouveau libre et on va s’habiller n’importe comment. Les tenues vestimentaires sont extravagantes et folles et on donne des noms aux personnes qui s’habillent comme ça. Les hommes s’appellent les Incroyables, les femmes les merveilleuses.
C’est le titre du tableau. Cette mode-là, cette mode du Directoire, est merveilleuse. Comment elles s’habillent ? Elles mettent des vêtements très fins, des robes légères, on enlève tous les accessoires trop fastueux, on se coupe les cheveux, abat les perruques, et on revient à la mode de l’Antiquité, la mode de l’Antiquité gréco-romaine avec toutes ses tuniques. La liberté du mouvement revient, une fluidité du vêtement et des étoffes qui sont de plus en plus légères, voir un peu trop. C’est une mode qui ne dure pas longtemps parce qu’elle manque de pudeur avec ces vêtements un peu indécents, qui sont beaucoup trop légers et ces robes trop fines. On va vite revenir aux robes encombrantes et aux corsets qui nous compriment, malheureusement. Mais là, on apprécie de voir cette légèreté.
Isabelle Bâlon-Barberis : On respire.
[Illustration : Alexis Grimou, “Etude de jeune fille, dite l’Espagnolette”, 1701-1750, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors on va terminer avec un vêtement qui a tout aussi du déguisement. On recule un petit peu dans le temps, puisqu’on est ici au début du 18e siècle et on a affaire à ce qu’on appelle une figure de fantaisie.C’est à dire que le modèle de ce portrait n’a pas de nom et l’œuvre emprunte beaucoup à une mode vestimentaire d’un autre temps. Cet autre temps, c’est le costume espagnol.
Regardez la, avec sa toque en velours à plumes et le col montant plissé, tuyauté, qui dégage sa nuque si joliment. La robe est émeraude et or,et vous avez des manches à crevés. Ce sont ces fentes qui sont pratiquées dans l’étoffe d’un vêtement pour laisser apparaître la chemise ou la doublure d’une autre couleur. Et puis vous avez également donc au niveau des épaules ces bourrelets, qui nous parlent également d’une période qui est le 16e siècle. Alors il y a vraiment avec cette peinture, la volonté de nous parler quelque chose qui serait peut être de l’ordre du bal costumé, ou une jeune fille serait en costume de scène, on va parler “d’Espagnolette”.
Grimou, qui est le peintre de ce tableau, qui a rendu ce type de figure de fantaisie à la mode. Il nous parle d’un idéal esthétique qui emprunte beaucoup au costume de théâtre mais aussi à la tradition chevaleresque espagnol. Et là on pense justement à Cervantès, ce grand écrivain espagnol du 17e siècle. Grimou va avoir le goût de ce pittoresque et des espagnolettes, comme celle-ci, il va en faire plusieurs. On a plusieurs répliques qui se trouvent dans les musées d’Avignon, de Prague, de Saint-Pétersbourg et qui seront à la fois très semblables et légèrement différentes.
Mais Regardez ici la lumière, la lumière qu’il utilise. Cette lumière dorée et qui donne un charme unique à cette jeune femme. Vous voyez ? Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c’est qu’elle nous adresse un regard au-dessus de son épaule. Il y a cette manière de vriller légèrement son corps qui donne à la ligne quelque chose d’assez serpentin. Pour en revenir juste un petit peu à la lumière, je pourrais évoquer Rembrandt, les peintres ténébreux de Rome de la même époque, c’est à dire du 17e siècle. Parce que justement, ce côté très sombre l’a fait d’autant plus ressortir et nous fait ressentir la simplicité mais également le côté très sophistiqué de cette jeune personne, qui est un petit peu notre jeune fille à la toque pour évoquer Vermeer et sa jeune fille à la perle. Parce qu’il y a ici cette candeur, il y a ce mystère, ce magnétisme, avec cette belle obscurité à l’arrière plan.
Marthe Periot : Oui, c’est une jolie comparaison. Et d’ailleurs on va terminer sur ça et conclure
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, alors on a vu qu’au fil du temps un vêtement se définit socialement, politiquement. Un vêtement obéit à des codes vestimentaires selon les époques. Mais le vêtement dit beaucoup aussi de la personne. Ce que choisit la personne, ce qu’elle choisit de montrer d’elle, ça c’est très important. Et il y a aussi le fait que derrière le vêtement, qui peut être parfois tout à fait somptueux, il y a une obligation, une contrainte de répondre à la mode, d’être à la mode, de suivre la mode. On est victime de la mode et si on ne suit pas la mode on est hors-jeu, on est à l’écart et ça c’est difficile à vivre.
Marthe Periot : Tout à fait. Alors c’est vrai qu’aujourd’hui on porte un tee-shirt, un jeans et un manteau. C’est très simple, on s’habille facilement. Et si on a voulu faire cette conférence aussi, c’est un peu par nostalgie. La nostalgie de la beauté de tous ces tissus, de toutes ces broderies qu’on ne voit plus aujourd’hui, à part peut-être à l’opéra ou dans des vêtements de cérémonie très luxueux. Mais quand même, même s’il n’y a plus ces vêtements, heureusement, parce qu’on ne peut pas s’empêcher d’imaginer l’inconfort de porter tous ses vêtements et ses robes très lourdes. Ces corsets, ces robes à paniers, ces crinolines, bon quand même, ce n’était quand même pas très simple.
Isabelle Bâlon-Barberis : On a trop envie d’y revenir.
Marthe Periot : Non. On va rester avec nos jeans et nos tee-shirts, hein, mais on a apprécié cette conférence. En tout cas, on espère que vous aussi et merci beaucoup,
Isabelle Bâlon-Barberis : Merci à vous.
Marthe Periot : A bientôt.
Mythologie
Mythologie
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Mythologie – divines aventures”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2023]
Isabelle Bâlon-Barberis : Messieurs, dames, Bonjour.
Marthe Pierot : Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne du Musée des Augustins avec Marthe et Isabelle. Et pendant 30 minutes, on va vous parler et bien de la mythologie grecque.
Isabelle Bâlon-Barberis : Absolument. Qu’est-ce que c’est la mythologie grecque ? Commençons par les bases. C’est un ensemble d’histoires très anciennes qui ont été transmises de manière orale. Au fil des siècles, elles ont été enrichies, elles ont été soumises à toutes sortes de variations, et on doit à un homme, Homère, qu’elles existent. C’est vraiment à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ qu’on commence à en entendre parler. Et lui, on le connaît bien, parce que l’Iliade, parce que l’Odyssée, parce que la guerre de Troie.
Marthe Pierot : Oui, ces histoires qu’on connaît très bien. Alors ces ensembles d’histoires fantastiques vont vraiment donner naissance à une religion pratiquée par la civilisation grecque, une religion qui se constitue à partir de croyances et de pratiques rituelles qui s’adressent à des divinités. C’est donc une religion polythéiste où on croit en plusieurs dieux. Mais ce qui est particulier, c’est que cette religion, elle n’a pas de structure formelle, de code religieux très précis ou un livre sacré, comme on pourrait trouver dans le christianisme par exemple. C’est beaucoup plus libre.
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors tu parles d’un livre sacré, cependant il y a quelqu’un au premier siècle à qui on doit une fière chandelle, c’est Homère. On est donc au premier siècle et lui, il a compilé ces histoires et c’est pour ça qu’on les connaît encore aujourd’hui.
Marthe Pierot : Et oui, tout à fait. C’est vrai que c’est l’écrit qui permet de traverser un petit peu toutes les époques. Mais alors, qui sont les héros de toutes ces histoires justement ? Tout simplement, ce sont des dieux. Ils sont généralement au nombre de 12 ou de 14 pour les principaux, et ils vivent tous sur le Mont Olympe. C’est une grande famille, on va d’ailleurs vous montrer un petit arbre généalogique tout à l’heure. Mais ils ont une forme humaine, et c’est ça qui est troublant et passionnant à la fois, c’est parce que ces dieux nous ressemblent sans vraiment nous ressembler. Ils ont des pouvoirs que nous n’aurons jamais, ça c’est certain, mais ils ont des vices et des travers ou des faiblesses que nous avons tous, et c’est ça qui nous rend proche d’eux finalement.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Aujourd’hui, la mythologie, on pourrait la comparer à une super série, avec des épisodes, avec des saisons où il y a beaucoup, beaucoup d’aventures. Ou les personnages sont à la fois des personnages qui auraient existé, qui sont donc des héros de l’histoire grecque romaine. Il y a également des personnages qui sont des dieux, des demi-dieux, qui sont véritablement des personnages inventés. Et c’est vrai qu’il peut y avoir une confusion entre le réel et la fiction. C’est un petit peu troublant mais très intéressant aussi pour cette raison.
[Illustration : arbre généalogique, “Les Dieux de l’Olympe”]
Marthe Pierot : On se mélange beaucoup quand même souvent. Vous allez voir que les histoires sont très complexes, c’est assez compliqué. D’ailleurs, pour vous donner une idée de la grande famille de la mythologie, voici cet arbre généalogique qui nous présente les principaux dieux de l’Olympe. On voit tout en haut Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre, qui en s’accouplant et bien donnent naissance à tous ces enfants que l’on peut voir ici avec quelques dieux que l’on connaît bien : Hadès, Zeus, Artémis, Apollon, Athéna, voilà les principaux.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, parce qu’il y en a beaucoup plus que ça, mais c’est vrai que ce sont eux qui reviennent et qui vont revenir beaucoup dans les œuvres dont on va vous parler.
Marthe Pierot : Et d’ailleurs, on va commencer et on va vous présenter 10 œuvres qui se trouvent dans les collections du Musée des Augustins.
Isabelle Bâlon-Barberis : Allons-y
[Illustration : Jean Léon Gérôme, “Anacréon, Bacchus et l’amour”, 1848, tableau]
Marthe Pierot : Alors on commence avec ce premier tableau réalisé par Jean Léon Gérôme “Anacréon, Bacchus et l’amour”. On est au 19e siècle et Gérôme nous parle d’un poète grec qui s’appelait Anacréon, et qui a véritablement existé, mais qui est entouré de divinités. On est dans cette confusion dont on vous parlait en introduction justement, entre personnages réels et personnages mythologiques.
On a un fond de fête avec ce poète qui a une lyre à 7 cordes et qui est entouré d’un cortège très animé avec des couleurs acides où des personnages à demi vêtus, mais qui participent au caractère très léger et insouciant de la fête et du monde grec, avec tous ces corps en liberté. Ce qui est très beau, c’est de voir la lumière aussi de ce tableau, cette lumière en contre-jour qui nous dit finalement que le soleil va se coucher, qu’ils vont peut-être faire la fête toute la nuit. Mais il y a des couleurs très franches et très tranchées qui sont tout à fait appréciables.
Alors qu’est-ce qu’on voit ? On a ce poète au milieu qui est très grand, et puis on a ces deux divinités autour de lui, mais qui sont représentées dans leur enfance, ce qui n’est pas toujours fréquent. Par exemple sur la gauche, vous pouvez voir ce petit personnage qui a une peau de bête, c’est Bacchus. Bacchus, il a grandi en Asie et c’est le dieu du vin. C’est pour ça qu’il tient de sa main le canthare, cette espèce de vase en fait pour remplir de boisson et il a cette peau de bête pour rappeler son enfance en Asie. On a Bacchus et puis de l’autre côté, on a l’Amour, qu’on appelle Cupidon ou Eros, ça dépend de la mythologie. Il a ses ailes blanches, une courroie avec son carquois fleuri, et il symbolise vraiment la pureté et la tendresse, au lieu de jeter des flèches il sème des petites fleurs, et ça, c’est tout à fait attendrissant.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tel un petit Poucet mythologique.
Marthe Pierot : Oui c’est vrai. On note aussi la minutie de la peinture, regardez en bas à gauche cette corbeille de fleurs avec beaucoup de finesse, ou le vase qu’on appelle un lécythe, avec des scènes mythologiques dessinées dessus. On a des petits oiseaux dans les arbres, enfin on a quelque chose de très doux. On a également cette jeune femme sur la gauche, nue, qui joue une double flûte qu’on appelle un aulos, qui participe à tout ce cortège, qu’on pourrait qualifier de cortège festif, un cortège dionysien, comme ce qu’on appelle des bacchanales aussi, qui accompagnent le dieu Bacchus.
Alors Gérôme est un peintre qui est parfaitement dans la tradition néoclassique. On le voit ici, on retrouve des personnages modelés, académiques, très lisses, et il célèbre l’amour et la mythologie. Mais avec une tradition extrêmement classique. C’est un des principaux représentants de la peinture académique. Mais c’est surtout un peintre qui est très connu à la fin du 20e siècle. Il a une véritable postérité parce que ces grands tableaux vont inspirer énormément le cinéma et notamment les grands péplums.
[Illustration : Laurent-Honoré Marqueste, “Cupidon”, 1882, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors maintenant on va continuer avec un personnage qui était déjà dans le tableau dont Marthe vient de vous parler, puisqu’elle vous a parlé du petit Cupidon et le revoilà. Il est question ici d’un plâtre réalisé par le sculpteur Marqueste en 1882. Dans la mythologie romaine, Cupidon c’est le dieu de l’amour, mais on l’appelle Éros dans la mythologie grecque. A ce propos, la correspondance entre les noms grecs et les noms latins n’est pas toujours évidente.
Cupidon est souvent confondu avec un ange, mais l’ange apparaîtra avec le christianisme, n’en parlons pas pour le moment. Ses attributs c’est l’arc, ce sont les ailes, c’est son étui de flèches, mais ici on voit juste les ailes. Regardez bien, la corde de l’arc est parfaitement imaginaire et l’arc aussi. Avec son arc il envoie des flèches qui vont aller percer les cœurs des dieux et les cœurs des hommes. Quiconque est touché, par la flèche de Cupidon tombe amoureux de la première personne qu’il voit à ce moment-là. C’est intéressant de dire qu’il a un sacré ADN notre Cupidon. Pourquoi ? Parce que son père, c’est le dieu de la guerre, Mars, et sa mère, c’est Vénus, la déesse de l’amour. Ce qui nous explique pourquoi l’amour fait du bien et fait du mal, vous avez compris, ici vous avez une réponse à vos questions. Je pense qu’il est tout à fait intéressant de revenir sur cette représentation, cette figure enfantine. En général Cupidon a 4 ans, entre 4 et 8 ans, il est représenté nu, comme vous l’avez vu tout à l’heure avec Marthe. Et c’est vrai qu’il a l’air très souvent coquin, malin, c’est un très bel enfant. Ici, vous voyez qu’il se régale à l’avance. Il regarde d’en haut, du haut du Mont Olympe, son aire de jeux qu’est la terre, et tous les pauvres mortels qui vont être visés par cette terrible flèche. Ce qui est intéressant ici, c’est de voir qu’il a ce beau front, ses cheveux au vent, et qu’il est ce beau garçonnet à genoux qui bande son arc. Vous avez cette très belle oblique de son corps, cette vision dynamique, puisqu’il y a cette possibilité de voir combien son visage est dans l’axe de ses bras. Intéressant aussi de dire que Marqueste, ce sculpteur toulousain est considéré comme une des figures majeures de la sculpture française à la fin du 19e siècle. Il est très influencé par les modèles classiques et il fait partie à Paris du groupe des florentins, c’est à dire de tous ces artistes qui prenaient la Renaissance italienne comme référence.
[Illustration : Sylvestre Clerc, “Hercule enfant”, 1928, sculpture]
Marthe Pierot : Alors on reste avec les divinités enfantines, ou en tout cas les personnages de la mythologie version enfant, pour vous parler d’Hercule ou Héraclès. Voilà encore une fois les deux noms qui sont importants. Un des plus connus des héros grecs si ce n’est le plus célèbre, il est très célèbre pour son courage et sa force. La mythologie grecque lui prête beaucoup d’aventures, il voyage à travers toute la Méditerranée. Mais les plus célèbres de ses exploits sont évidemment les 12 travaux que l’on connaît assez bien, en tout cas de nom, qui sont souvent racontés. Mais là, c’est autre chose dont il est question, parce qu’on a un Hercule enfant, il n’a pas encore accompli ces 12 travaux. C’est une scène importante parce que là, on nous parle de ce moment où Hercule, enfant, étouffe des serpents qui ont été placés dans son berceau. C’est là qu’on découvre la force et le courage de ce demi-dieu alors qu’il n’est qu’enfant. Hercule, c’est donc le fils de Zeus ou de Jupiter et d’une mortelle, Alcmène. Jupiter est un époux infidèle, et Junon, évidemment, en est folle de rage. De cette infidélité naît donc ce petit Hercule. Quand Junon s’en aperçoit, qu’est-ce qu’elle va faire ? Elle va verser, plutôt jeter, des serpents dans le berceau de l’enfant pour s’en débarrasser. Mais lui, il les étrangle sans aucune difficulté, au lieu d’en avoir peur, il s’en amuse comme si c’étaient des jouets, et les extraits de son lit. C’est ce qu’on voit ici. On voit les serpents qui sont déjà morts, qui forment un vrai bloc derrière l’enfant. Ils sont massifs, on sent le poids des reptiles, on imagine la masse de leur corps écaillés et enroulés. Et puis on voit surtout la posture de l’enfant, extrêmement ancrée au sol. Regardez les jambes écartées, les orteils cramponnés, les muscles très apparents. On voit toute la force et la puissance de ce petit bébé qui est un demi-dieu et qui nous annonce la force de l’homme qu’il va devenir. On a un corps trapu, un peu comme un bébé sumo. C’est intéressant de voir un autre point de vue de ce visuel où on voit bien la force et la détermination de son regard. On a un rendu très virtuose au niveau de ses boucles, de ses cheveux, tout comme les écailles de serpents qui sont extrêmement bien réalisées. C’est une œuvre qui date du 20e siècle, c’est la seule qu’on vous montre de cette époque-là, c’est important de le dire. Sylvestre Clerc est un sculpteur toulousain, qui naît d’une famille d’ouvriers et qui, grâce à une bourse, va pouvoir étudier à l’école des beaux-arts de Paris. Il va ensuite recevoir beaucoup d’honneurs et de nombreux prix.
Ce plâtre que l’on a au musée est un plâtre original, mais il y avait aussi une version en pierre qui s’est très longtemps trouvée sur les allées Frédéric Mistral à Toulouse. Mais à cause du vandalisme et du temps, elle a été déposée au musée des Augustins et remplacée par un moulage que l’on peut toujours voir à Toulouse.
[Illustration : Jean Alexandre Falguière, “La Femme au paon”, vers 1880, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Alors maintenant, on va continuer avec l’histoire de Marthe, puisqu’il était question de Héra, qui a causé tant de problèmes à notre petit Hercule. La voilà. C’est une œuvre ici qui date de la fin du 19e siècle, qu’on appelle “La Femme au paon”. Elle est la déesse du mariage, elle est l’épouse officielle de Zeus ou Jupiter, et son animal, son attribut en quelque sorte, c’est ce paon. Alors pourquoi c’est le paon ? Jupiter, son mari, a une maîtresse et Junon le sait.
Marthe Pierot : Il y en a plus d’une d’ailleurs !
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, absolument. Pour cacher sa maîtresse, Jupiter va transformer cette jeune femme en vache. Junon le comprend et va faire surveiller cette vache par son serviteur Argos, qui possède une centaine d’yeux pour tout voir justement. Mais Jupiter comprend également le stratagème et fait tuer ce monstre aux cent yeux. Junon, pour honorer la mémoire de son serviteur Argos, fera couvrir le plumage de son oiseau fétiche avec les yeux du monstre. Donc maintenant vous savez pourquoi le paon à tous ces cercles sur son plumage. La mythologie est un réservoir de réponses à vos questions, c’est dit ! Alors pour en revenir un petit peu, un tout petit peu à Héra, c’est vrai qu’Homère parle d’elle comme d’une femme jalouse qui, sans cesse, tente de contrecarrer les dessins de son époux et qui provoque des querelles extraordinaires.
Marthe Pierot : On peut la comprendre, quand même, vu le comportement de Zeus.
Isabelle Bâlon-Barberis : Mais Falguière ici, le grand sculpteur toulousain, se donne l’occasion de réaliser un beau nu féminin. Vous voyez qu’ici, Héra a un port de tête de reine. Elle est très sereine, ma foi, elle est quand même l’épouse du dieu des dieux et vous voyez donc cette attitude fière, élégante. Il y a une certaine noblesse de sa pause, et c’est vrai qu’elle est loin de ce côté vengeresse et anxieuse dont on vous a parlé tout à l’heure. Alors l’œuvre s’appelle “La Femme au paon” et on ne nomme pas pour autant, on ne dit pas d’elle qu’elle est Héra. C’est vrai que, au 19e siècle la culture de la mythologie est encore très importante, et c’est vrai que c’est un petit peu une évidence, de dire en sous-titre qu’elle est Héra, même si, ce n’est pas le nom de cette œuvre.
[Illustration : Louis Jacquesson de la Chevreuse, “Orphée aux enfers”, 1865, tableau]
Marthe Pierot : Alors on revient à la peinture et cette fois-ci on va vous parler un peu de l’obscurité de ce tableau pour décrire l’obscurité de l’enfer. On change un petit peu de personnage cette fois-ci. Il est question non plus de Zeus ou de sa femme Héra, mais d’Hadès, Hadès ou Pluton, toujours les deux noms, qui en fait règne sur les enfers. On le reconnaît dans le tableau parce qu’il est au fond dans l’obscurité, il est sur un trône et il a une couronne avec des pointes, il rayonne vraiment sur le monde des enfers. Qui est-il ? Il faut savoir qu’après un très grand combat contre les Titans, les vainqueurs qui étaient trois frères décident de se diviser le monde. Le ciel sera pour Jupiter ou Zeus, la mer pour Neptune ou Poséidon et les enfers, le monde des morts pour Pluton ou Hadès. On a cette division-là du monde. Il est ici aux côtés d’une femme qui est Perséphone ou Proserpine, qui est reine des enfers à mi-temps et le reste du temps, elle est reine du printemps. Elle, elle adapte son emploi du temps…
Isabelle Bâlon-Barberis : 6 mois sur 12 !
Marthe Pierot : Exactement ! Alors quelle est l’histoire qui est racontée ? C’est l’histoire d’Orphée qui descend aux enfers. Orphée, c’est ce personnage au centre qui prend toute la lumière. Il est poète et musicien, fils d’une muse et d’un roi, donc c’est un mortel, mais qui va rencontrer les divinités. Il a quand même un super pouvoir, ce n’est pas n’importe quel mortel parce qu’il arrive à charmer les animaux et les hommes par son chant et sa musique. Qu’est-ce qui se passe dans cet épisode ? Il descend au royaume des morts parce que le jour même de ses noces, Eurydice, sa toute nouvelle femme, est mordue par un serpent caché dans les hautes herbes et meurt immédiatement. Elle descend au royaume des enfers. Orphée est inconsolable et il veut descendre à sa recherche pour la ramener. Il va réussir à charmer, grâce à sa musique, toutes les divinités infernales et Hadès en plus. C’est cette scène qu’on voit où il est en train de jouer de la musique. Ce qui est intéressant dans ce tableau très obscur, c’est de voir finalement le peu de couleurs qui sont assez développées. On a vraiment des personnages qui se mêlent avec le rouge environnant, qui ont des couleurs blanches, grises, un petit peu comme si c’était des âmes qui erraient sans vie, tout autour. Mais on a quand même ce personnage qui est positionné au centre, Orphée, comme sur une scène ou comme sur une arène, avec tous ces personnages sur des gradins qui l’écoutent. Et ça, c’est intéressant de voir comme toute l’assemblée l’écoute avec attention.
[Illustration : Guido Reni, “Apollon écorchant Marsyas”, 1620-1625, tableau]
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Alors on va, avec l’œuvre suivante, rester dans la noirceur. Marthe vient de vous parler d’un tableau qui avait un fond très sombre. C’est également le cas de ce tableau-là, ce qui fait ressortir d’autant plus la carnation des deux personnages. L’auteur de ce tableau, c’est Guido Reni, c’est un grand peintre italien du 17e siècle. Il met en scène certains personnages, ici, vous avez sur la gauche Apollon, le dieu des arts qui est en train d’écorcher Marsyas, un satyre. C’est une créature à corps d’homme, à cornes et à pieds de bouc, mais ici Marsyas a forme humaine. Marsyas jouait de la flûte avec tellement de grâce que tout le monde était captivé et pensait qu’il avait plus de talents qu’Apollon lui-même. Marsyas était très fier de cela. Un jour un concours de musique est organisé pour les départager, à l’issue de ce concours, les muses déclarent Apollon vainqueur. Apollon, regardez-le ici avec cette carnation blanche, va punir Marsyas. Il le punit parce que Marcyas a eu l’outrecuidance de défier un dieu et on ne fait pas ça.
Marthe Pierot : Comment a-t-il osé ? Quelle prétention !
Isabelle Bâlon-Barberis : Il ne pouvait que perdre, car on ne peut défier un dieu. C’est la force du destin, l’ordre ne peut être renversé. Il n’y a pas de révolution chez les grecs. Malgré l’horreur de cette scène, Guido Reni reste tout à fait fidèle à cet idéal de beauté et de perfection pour le corps d’Apollon. Vous avez une construction de l’œuvre qui est donc basée sur une opposition entre les 2 personnages. Vous voyez ? La carnation blanche d’Apollon contraste avec cette carnation dorée pour Marsyas sur la droite. Apollon est très serein alors que vous avez le visage contracté par la douleur et le corps renversé en arrière de Marsyas. C’est vrai que la culture savante est symbolisée par la lyre, que vous avez tout à fait en bas à gauche du tableau qui est posée par terre, et la musique populaire est personnifiée par la flûte de pan, qui se trouve au pied de Marsyas, toujours au bas du tableau. C’est vrai qu’il y a ce fossé culturel et social qui existe entre les deux. Apollon, vous voyez, est tout en maîtrise, en impassibilité, en absence totale de sentiment, alors que Marsyas vocifère sa douleur. C’est une élégante chorégraphie, qui est accompagnée par des tissus qui viennent joliment enrouler les corps. On en oublierait presque le supplice que subit Marsyas, tant justement Guido Reni met de l’élégance dans les courbes de ses personnages. Guido Reni, c’est vraiment l’école de Bologne, c’était important de rappeler l’origine de ce grand peintre.
[Illustration : Laurent-Honoré Marqueste, “Persée et Gorgone”, 1887, sculpture]
Marthe Pierot : Alors on va rester un petit peu dans cette chorégraphie et cette idée de torture et de violence, mais dans la sculpture cette fois-ci, pour vous parler d’autres personnages, Persée et Gorgone. Un plâtre qui est réalisé par Marqueste, dont on a déjà parlé tout à l’heure quand Isabelle a parlé du petit Cupidon. Ici, il est question de la Gorgone, Méduse. Pour vous resituer un petit peu l’histoire, les gorgones, à l’origine, sont trois sœurs qui ont une apparence effrayante et des pouvoirs maléfiques. Mais la plus connue, c’est la Méduse Gorgone. La légende raconte que Poséidon, le dieu des mers, entraîna Méduse dans le temple d’Athéna pour la violer. Athéna est furieuse que son temple ait été souillé et décide, non pas de punir Poséidon, accrochez-vous bien, mais de se venger sur Méduse et ses sœurs et elle va les transformer. Elle va les transformer en créatures hideuses. C’est pour cela que la gorgone Méduse se retrouve avec des cheveux de serpents, des mains de bronze et surtout des yeux qui pétrifient. Persée, lui est un fils caché de Danaé, qui était la fille d’un roi, et de Zeus. C’est donc un demi-dieu, un peu comme Hercule. On voit que Zeus a encore eu d’autres conquêtes, dont Danaé. Ce demi-dieu vit sa vie, mais à un moment, on l’envoie en mission. Quelqu’un qui veut se débarrasser de lui, lui donne une mission jugée impossible : décapiter la gorgone Méduse. Il ne se laisse pas abattre, grâce à son courage et à des armes qui ont été fournies par des dieux, il réussit. Quelles sont ses armes ? Regardez en bas, au niveau de ses pieds, ces sandales ailées. C’est Hermès, le messager des dieux, qui va lui fournir ses chaussures, pour qu’il aille plus vite, et une faucille d’or pour trancher la gorge de Méduse. Athéna qui, entre parenthèses, est toujours en colère contre la Méduse, qui se fait un malin plaisir d’aider Persée, va lui fournir un bouclier qui sera poli, tellement poli qu’il va servir de miroir. Persée va donc l’utiliser pour pouvoir observer la gorgone à travers ce miroir, sans la regarder directement dans les yeux, pour ne pas être pétrifié. Il va donc trancher la tête de la Méduse et l’offrir à Athéna qui va la placer au centre de son bouclier. On peut voir dans cette chorégraphie, dans cette sculpture, que la Méduse est donc en bas, allongée, elle s’agrippe à des tissus. On a l’impression d’avoir des tissus au niveau de ses doigts et on remarque surtout la torsion de son buste, ses mains qui se cramponnent, sa tête qui est projetée en arrière et sa bouche hurlante avec ses yeux écarquillés. On va montrer quelques zooms, pour voir la position et surtout pour voir Persée qui est debout. Lui qui appuie son pied sur la hanche de la Gorgone, qui saisit la tête par les cheveux qui sont des serpents. On voit les serpents qui montent autour de son poignet pour le mordre. On voit vraiment sa main qui tient le glaive levé prêt à tuer la gorgone. La nudité est frappante de ces personnages, mais ce qui est encore plus frappant, c’est de voir l’opposition des réactions. Un peu comme on avait tout à l’heure avec Apollon qui était de marbre et Marsyas qui souffrait le martyr. On a cette même idée avec une violence extrême, des hurlements de douleurs de la gorgone et un Persée qui est calme et impassible. Le vainqueur ici ne fait aucun doute. Et juste pour terminer sur la Gorgone Méduse, il faut savoir qu’à l’époque, elle avait plutôt une version un peu archaïque. On la représentait avec un visage de sanglier, des yeux exorbités, des crocs et une langue pendante. Mais ses traits vont s’humaniser et se féminiser à partir de la Renaissance et de monstre, elle devient la Méduse, l’archétype de la femme fatale. Et c’est aussi pour ça que cette figure est toujours très présente dans la culture contemporaine, parce qu’elle est revendiquée par le courant féministe comme un puissant symbole de colère et de pouvoir.
[Illustration : D’après Jean de Bologne, “Mercure volant”, fonte Bernard Py, 1624, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Quelle histoire, je n’en reviens pas. Messieurs Dames, à présent on va parler de Mercure. Sachez que c’est Mercure qui avait armé Persée, le personnage dont Marthe vient de vous parler. Mercure ou Hermès, selon les questions de mythologie grecque ou romaine. Mercure, il est important de vous dire, Messieurs dames, que si on a deux noms, c’est que les latins, les romains, ont pillé la mythologie grecque et ont débaptisé les dieux pour leur donner d’autres noms, mais on gardait les histoires. C’est important. Maintenant revenons à Mercure, qui est le messager des dieux, qui est le dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs, de tous ceux qui se déplacent. Vous comprenez combien il se déplace aisément, regardez sa légèreté. Il est en équilibre sur la pointe du pied et il défie les lois de l’apesanteur. Il semble véritablement s’envoler. Regardez ses pieds, il a des ailes au niveau des chevilles, ici elles sont cassées, mais c’est ce qui lui permettait de voler, comme Persée que nous avons vu juste avant. Il a sur son petit chapeau, qu’on appelle un pétase, il a des ailes. C’est ce jeune homme athlétique qui se déplace très rapidement. Il avait dans sa main gauche, un caducée qu’il brandissait, un bâton autour duquel s’enroulaient des serpents, les serpents qui ont le pouvoir d’endormir par leur venin. C’était l’arme de Mercure. Ici vous avez un Mercure qui a été fondu par Bernard Py. C’est un maître fondeur qui va fondre une œuvre qui est réalisée, au départ, par un très grand sculpteur, Jean de Bologne, qui à la fin du 16e siècle, en Italie, est le plus grand sculpteur après Michel-Ange. Regardez la tête de Mercure qui est assez petite, la silhouette est gracile, son attitude est très élancée avec la torsion de son corps. On a quelque chose qui est très maniériste pour toutes ces raisons. On a des distances qui sont prises avec une anatomie réelle, il est extrêmement léger. C’est intéressant de dire que la statue originale, elle, est à Florence, et que cet exemplaire-là avait été envoyé par le grand-duc de Toscane au roi de France Henri IV pour son mariage. Cette œuvre est un cadeau diplomatique. Quand une œuvre plaît en Italie, elle connaît, s’il est possible de la traduire en bronze, d’autres versions. Voilà un cadeau pour le roi de France. C’est vrai qu’il est important de rappeler que les fondeurs de Toulouse, au 16e et jusqu’au 17e siècle, sont très réputés. Ce qui se passe concernant cette œuvre-là, c’est qu’on s’est rendu compte en 2010 qu’il fallait qu’on la fasse rentrer à l’intérieur du musée des Augustins parce que la pollution, l’humidité, les risques de vandalisme avaient contribué à l’abîmer. Elle était dans un jardin, elle était à l’extérieur. Donc il a fallu qu’on se dise “Maintenant rentrons cette œuvre à la maison”, c’est à dire au musée. Et enfin je voulais vous dire qu’il y avait un autre dieu sous le pied gauche d’Hermès. Vous avez une grosse tête, c’est celle en fait d’Éole, qui est le dieu du vent. Éole gonfle les voiles du bateau d’Ulysse dans la mythologie, mais Éole est celui qui permet à Mercure de voler encore mieux grâce à son souffle.
Marthe Pierot : Oui, on voit qu’il gonfle ses joues. On a un point de vue un peu particulier, mais c’est son menton. On voit les joues qui se gonflent, il y a ses cheveux bouclés qui sont derrière la tête allongée.
Isabelle Bâlon-Barberis : Le souffle est matérialisé par ce petit cône qui a servi également de fontaine. Pour vous expliquer les détails.
[Illustration : Jean-Jacques Pradier, “Chloris caressée par Zéphir”, 1849, sculpture]
Marthe Pierot : Je vous propose de rester dans la thématique du vent pour vous montrer la sculpture suivante.
Isabelle Bâlon-Barberis : Quelle transition !
Marthe Pierot : Vous avez vu ça ? Mais tout est réfléchi, bien sûr, c’est dans nos choix de coordination. Ici on a une sculpture qui s’appelle “Chloris caressée par Zéphir”. “Alors où est zéphyr ?” Vous allez me dire. Zéphyr c’est aussi un dieu du vent. C’est le fils d’Éole, dont on vient juste de vous parler. Zéphir c’est le dieu du vent de l’Ouest, le fils d’Éole. Ici de son souffle léger et doux, il caresse sa femme Chloris, qui est la nymphe du printemps. On l’appelle aussi Flore en romain, mais Chloros en grec, ça veut dire vert, d’ailleurs “chlorophylle” : qui aime le vert. Ce qui est très intéressant dans cette sculpture en marbre de Paros, marbre grec c’est qu’elle a une attitude de quasi-abandon. Regardez la tête inclinée, le regard vague, la bouche entrouverte, elle essaie de dissimuler pudiquement sa nudité, mais on sent qu’elle est frissonnante de plaisir et de désir. Son corps est envahi par le souffle de son mari. Et c’est ça qui est intéressant, c’est de voir finalement cette sensualité, ce léger érotisme qui peut troubler au19e siècle.
Et d’ailleurs, c’est un peu le créneau de Pradier, ce sculpteur qui parle beaucoup des corps des femmes avec beaucoup de sensualité. Il a toujours envie de parler des femmes dans son œuvre, alors il se sert de la mythologie, de l’histoire ou de figures allégoriques pour célébrer la beauté féminine, pour célébrer la sensualité des femmes. Et c’est parfois controversé par la critique. Parce que là finalement, on parle d’une déesse du printemps qui est censée être une jeune fille, pour parler du renouveau et de la jeunesse. Et là il nous montre plutôt un corps de femme très sensuel, mais un corps de femme réaliste avec un abdomen. Il y a quelque chose finalement qui peut déranger la critique de l’époque, parce que ce n’est peut-être pas l’image que l’on se fait du corps de la déesse du printemps. Mais c’est sa version à lui, en tout cas toujours très sensuelle. Puis ce qui est très beau, c’est de voir la délicatesse des représentations des fleurs qu’elle a dans les mains, dans les cheveux et surtout le plissé magistral de son drap qui tombe de manière très verticale, mais extrêmement juste, même au niveau de son coude, l’enroulé du drap qu’elle tient.
[Illustration : anonyme toulousain, chapiteau “Sirène se coiffant entourée d’un chasseur et d’un centaure”, 1151-1200]
Isabelle Bâlon-Barberis : Quelle belle description. On rêvait. Bon maintenant on va terminer, messieurs dames, avec une œuvre qui est la plus ancienne de toutes celles dont nous avons pu parler, puisque celle-ci s’inscrit dans la période romane. On est au 12e siècle. Il est question de personnages mythologiques réalisés sur un chapiteau du cloître, du monastère, de la Daurade à côté du pont Neuf. Vous avez dans la corbeille de ce chapiteau…
Marthe Pierot : Ancien cloître, il n’existe plus.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, tout à fait, et dont nous avons beaucoup de chapiteaux, ici au musée des Augustins. Donc vous avez, dans des enroulements végétaux plusieurs personnages. Et ces personnages sont tout à fait importants parce qu’ils transmettent un certain message. Alors vous avez, par exemple, au centre du chapiteau une sirène. Elle est le symbole de la séduction. Vous savez, elle chante et sa voix trouble les marins. Comment est-elle représentée ? Vous voyez que la main gauche de la sirène est en train de tenir un peigne, tandis que de sa main droite, elle a un petit miroir. Elle pousse la coquetterie jusqu’à se coiffer pour être plus belle encore, tandis que, sur la droite, vous avez un autre personnage mythologique. C’est un centaure qui est moitié homme, moitié cheval, et le centaure, son symbole, c’est l’absence de maîtrise de lui-même. Il est ivre en permanence et il court dans les sous-bois, en suivant les petites nymphes qui s’y cachent. Enfin, tout à fait sur la gauche, vous avez un personnage qui est tout à fait nu, et quel est le symbole ? La nudité, si elle est héroïque chez les Grecs, elle est un symbole de luxure au Moyen Âge, donc tout à fait négatif. Ces trois personnages, sur ce chapiteau, c’est tout ce que le christianisme combat et condamne. Et sur ce chapiteau on a une dénonciation de ces dérives. Ce chapiteau est très densément animé parce qu’en plus de ces personnages dont je viens de parler, il y a toutes sortes de petits personnages qui se cachent dans les angles, vous les voyez comme des oiseaux souvent. Et c’est vrai qu’il y a un goût vraiment pour le répertoire décoratif. Alors ici il n’est pas du tout question de la Bible, alors que normalement dans les cloîtres on vous enseigne les messages du christianisme. Ici il est question de la mythologie, alors c’est intéressant parce qu’au Moyen Âge, à Toulouse, on n’oublie pas la culture antique. Il est important de dire que finalement, avant le Moyen Âge, à l’époque des invasions barbares, et puis ensuite à l’époque de la religion chrétienne, tout cela n’a pas réussi à faire table rase de la mythologie. Elle survit, même elle s’adapte puisque c’est vrai qu’une sirène selon la mythologie grecque est moitié femme, moitié oiseau. Alors que vers les 8 et 9e siècles, la sirène devient moitié femme, moitié poisson. Vous voyez très bien ici sa belle queue qui se retourne.
Marthe Pierot : Oui donc c’est vrai qu’on a transformé un petit peu quelques figures mythologiques, mais on s’en sert quand même dans un but de moralité chrétienne. On détourne un peu finalement leurs origines.
Isabelle Bâlon-Barberis : La mythologie est christianisée. On peut le dire.
Marthe Pierot : Voilà donc on revient vers vous pour la conclusion. Enfin, on n’est pas vraiment parti, mais on apparaît en tout cas pour conclure ensemble sur cette thématique. Et on a vraiment vu que tous les archétypes des vices et des vertus humaines, toutes ces histoires qui sont racontées, constituent vraiment en fait une base dans notre culture occidentale depuis toujours finalement. Ils ont énormément inspiré les artistes. Et ces personnages sont très présents en littérature, en peinture, en sculpture, et on l’a bien vu, puisqu’on a des œuvres qui vont du 12e siècle jusqu’au 20e siècle. Le musée est très riche de leurs représentations, et ces personnages sont encore très présents dans notre mémoire collective.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, mais alors pourquoi cette mythologie est toujours tellement d’actualité ? Je crois que c’est parce qu’elle est pleine d’enseignements, à la fois de morale, de philosophie, de poésie. Et c’est vrai que ces nombreux mythes peuvent être encore beaucoup racontés aux enfants et aux adultes. Et je pense par exemple à Icare qui a voulu se rapprocher au plus près du soleil et qui s’est brûlé les ailes. Donc la leçon de celui qui, à force d’ambition, retombe à zéro.
Marthe Pierot : Ça nous fait réfléchir sur l’humilité.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’était tout à fait l’idée, oui.
Marthe Pierot : On peut s’apercevoir aussi que dans notre culture populaire, les héros grecs sont très présents dans les films, les séries, les jeux vidéo ou produits en tout genre. La mythologie grecque par exemple est très présente, omniprésente même, sur les écrans sans qu’on s’en aperçoive vraiment. Dans les grands films très connus comme “Harry Potter” par exemple, il y a beaucoup d’allusions à des histoires mythologiques, même si elles sont réalisées de manière un peu détournée. On retrouve quand même des références.
Isabelle Bâlon-Barberis : Et je pense également à ces grandes entreprises qui ont choisi de puiser leurs noms dans la mythologie, parce qu’effectivement ça résonnait bien. Par exemple, il y a Nike, Nike évidemment c’est le nom de la déesse grecque de la victoire dans tous les articles de sport, je pense également à Hermès, puisque Hermès c’est le messager des dieux. Donc on a une maroquinerie de grand luxe. Et puis il y a également Amazon, Amazon, les amazones étaient de redoutables guerrières.
Marthe Pierot : Exactement. Et puis cette culture arrive même jusqu’à notre propre langage. On a un héritage linguistique aussi, puisqu’il y a de nombreuses expressions qui font référence à la mythologie. Vous en connaissez, c’est certain, le “talon d’Achille”, “ouvrir la boîte de Pandore”, le “cheval de Troie”, ou même avoir un “calme olympien”. On a vraiment tout ça aussi dans notre dans notre langage.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, oui, mais même si on parle de notre propre continent, l’Europe, puisque Europe était une déesse orientale qui a été enlevée par Zeus, elle figure jusque sur nos billets de 5€. Les tout premiers billets de 5€, vous aviez Europe, son portrait en hologramme.
Marthe Pierot : On pourrait continuer encore très loin, mais on va s’arrêter là et merci beaucoup de nous avoir suivies pour cette conférence.
Isabelle Bâlon-Barberis : Et à bientôt pour une autre conférence bien sûr, au revoir.
Les héroïnes du musée
Les héroïnes du musée
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Les Héroïnes du musée”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2023]
Marthe Pierot : Messieurs, dames, Bonjour,
Isabelle Bâlon-Barberis : Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle conférence au musée des Augustins. Alors aujourd’hui, de qui parlons-nous ?
Marthe Pierot : Des héroïnes du musée.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai qu’au musée des Augustins, les femmes sont très représentées et on a fait une petite sélection pour vous parler de celles qui sont héroïques.
Marthe Pierot : Oui mais alors pour bien comprendre justement en quoi elles sont héroïques, c’était important de reconsidérer un peu la définition même d’un héros ou d’une héroïne. C’est important de se dire que c’est une personne qui s’est fait reconnaître pour ses actions. Et parce que ses actions sont extraordinaires ou courageuses, souvent elles ont été retransmises dans un récit. En tout cas, c’est une personne qui se dévoue à une cause.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, et c’est vrai que la définition va varier un petit peu, parce qu’à partir du 17e, et ça va vraiment s’imposer au 19e siècle, l’héroïne, c’est le personnage principal d’une narration, d’un récit, d’une pièce de théâtre, d’un roman. C’est pas vraiment qu’elle ait fait des choses extraordinaires, mais c’est le personnage principal et c’est celui qu’on va suivre.
Marthe Pierot : Tout à fait. Dans tous les cas ce qui est important aussi de comprendre, c’est qu’il y a un véritable phénomène d’identification. Parce qu’il y a une admiration irrépressible par rapport aux actes, par rapport à ce que la personne a fait. On a envie de lui ressembler et on a envie d’en savoir plus. Donc il y a ce lien qui existe aussi entre les héros et nous.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai. Alors on va voir un petit peu comment au fil des siècles, les femmes sont représentées. C’est intéressant de se dire que, par exemple, à l’époque du romantisme, au 19e siècle, la femme est toujours montrée sacrifiée, victime, vulnérable.
Marthe Pierot : Elle était ruine pour ça parce qu’elle est sacrifiée.
Isabelle Bâlon-Barberis : Et selon, toujours cette image-là.
Marthe Pierot : Mais heureusement ça évolue, ça change en fonction des époques et des histoires qui sont racontées. Et nous, c’est ce qu’on va vous montrer à travers 10 visuels du musée des Augustins qui vont retracer différents destins variés et donc différentes représentations d’héroïnes.
Isabelle Bâlon-Barberis : Allons-y
Marthe Pierot : Alors on commence avec notre premier visuel qui est une sculpture.
[Illustration : Victor Ségoffin, “Judith brandissant la tête d’Holopherne”, 1896, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, on va commencer avec Judith et on va vous la montrer 2 fois, avec donc 2 artistes différents qui l’ont représentée. Alors je commence avec celle de Victor Ségoffin. Il s’agit ici de cette héroïne, donc du peuple juif qui est connu pour avoir décapité au 6e siècle avant Jésus Christ le général Holopherne qui voulait envahir les terres de son peuple en Béthulie, c’est à dire la Palestine.
Marthe Pierot : Ici, Judith se montre vengeresse telle une justicière. Elle a envie de restaurer la foi de son peuple en la puissance de Dieu. Alors Ségoffin nous la montre tout en tension au moment où elle vient de tuer le général Holopherne. Son geste est théâtral et d’un grand dynamisme. On a l’impression de voir sur la scène un petit peu Sarah Bernhardt. Sa coiffure est courte, elle est ramassée autour de son visage, et vous voyez qu’elle est vêtue à l’orientale, notamment avec le plastron, un de ses pierreries. Au 19e siècle, le personnage de Judith connaît un grand regain d’intérêt dans les milieux orientalistes. Et c’est vrai que ce type d’héroïne, séduisante et dangereuse, qui essaie de jouer de ses charmes pour mieux perdre les hommes .
C’est un contrepoint tout à fait intéressant, sombre et fatal, qui s’oppose à toutes ces femmes qui sont évanescentes, qui s’évanouissent, et qui sont un petit peu mièvres, et qu’on voit beaucoup à la fin du 19e siècle. Mais ici, regardez les larges manches qui découvrent des bras puissants, presque masculins, et qui accentuent encore plus cette impression de force et de froide détermination. Vous voyez, elle est debout, la tête tournée vers la tête coupée du général. C’est vraiment un geste violent, un geste de triomphe avec, vous voyez, dans sa main le glaive, et de l’autre la petite tête, la dépouille dérisoire de cet homme. Notez encore la mâchoire puissante et les pieds nus qui disent un peu la modernité du personnage. C’est important de dire que cette œuvre, qui est en bronze, ne fait que 1,07m. Et finalement la taille de l’œuvre contredit la force de l’expression.
[Illustration : Francesco Curradi, “le triomphe de Judith”, vers 1630, tableau]
Marthe Pierot : Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c’est de la comparer avec une autre représentation où, là cette fois-ci, c’est en peinture que nous la retrouvons avec ce tableau réalisé par Francesco Curradi au 17e siècle. Ce peintre italien baroque, nous présente là une Judith tout en relâchement. Alors ce n’est pas tout à fait la même scène ici, c’est son retour victorieux. Et c’est un sujet qui est assez rare d’ailleurs, de montrer une Judith qui revient sur son camp, sur le camp assyrien, devant le prêtre, pour lui montrer l’action qu’elle vient de réaliser. Mais regardez, elle ne tient ni épée, ni tête, parce que ce sont ses servantes derrière qui tiennent l’épée et la tête dans un plat recouvert d’un drap. Finalement, elle, ce qu’elle tient, c’est sa robe. C’est important de le dire parce qu’on a ses vêtements qui sont extrêmement soyeux. Ces tissus qui sont très précieux. Et elle lève sa robe pour nous montrer cette botte métallique. Et c’est la botte métallique qui dit tout, qui raconte la personne qu’elle est, qui dit l’action qu’elle vient de réaliser, parce que c’est le seul élément qui nous parle de la guerrière qu’elle est en réalité, cette botte en métal.
On a quand même un visage qui est assez étonnant, parce que Curradi, ici ne lui a pas donné l’expression qu’on attendrait, comme si elle n’était pas concernée par ce qu’il venait de se passer. La manière dont elle avance, on a l’impression que c’est une parade très douce, mais elle a la tête baissée. Elle avance nonchalamment, et elle est très féminine, dans ce contexte un peu maniériste. Regardez ses mains, regardez son attitude. Il y a tous ces effets de tissus et de bijoux, qui prennent un peu plus de place que l’histoire. On se dit qu’on perd la symbolique de l’acte, on est noyé par l’artificiel, par ce décor assez artificiel finalement, avec tout ce cortège-là. On est quand même dans un contexte différent. Mais c’est important aussi de dire qu’elle est quand même au centre et qu’elle a une robe rouge, pour justement attirer notre regard quand même.
[Illustration : Antoine Rivalz, “mort de Cléopâtre”, vers 1710, tableau]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors comme nous vous avons présenté deux Judith, nous allons vous présenter deux Cléopâtre. Et ici c’est la mort de Cléopâtre. Cette dernière souveraine régnante de l’Égypte des Ptolémée. Alors elle meurt, environ en l’an 30 avant Jésus Christ à Alexandrie. Elle n’a que 39 ans. En se suicidant, elle évite l’humiliation d’être exhibée comme prisonnière lors d’un triomphe romain célébrant les victoires d’Octave, qui deviendra Auguste, le premier empereur romain en 27 avant Jésus Christ.
Alors elle devient une héroïne pour les artistes à partir du 18e siècle. Cléopâtre en littérature, au théâtre, et puis on sait qu’au cinéma on va, au 20e siècle, beaucoup la voir. Dans tous les arts peut-on dire. Et selon les auteurs anciens, Cléopâtre se serait suicidée en laissant un cobra, un cobra égyptien la mordre. Dans la toile de Rivalz, ce peintre toulousain qui est un grand portraitiste au 18e siècle. On voit le serpent qui monte le long de son corps, selon une diagonale marquée par la position de son corps. Justement, elle est assise, mais elle semble glisser vers la mort. Voyez en fait, la tête dans l’ombre et le clair-obscur. Les mains, la couleur de ses mains est en train de virer au noir parce que le sang n’y circule plus. Et vous avez encore sur cette poitrine, cette zone rosée, ce sein qui dit encore la vie et de manière assez érotique, je dirais. Là aussi, il y a donc cette lumière sur sa poitrine et la morsure est très proche. Le serpent donc remonte. On peut parler des effets très baroques dans le mouvement. Les effets de drapé,el rideau rouge et le dynamisme de cette composition sont aidés justement par tous ces tissus. Donc vous notez la petite nature morte avec le panier de figues sur la table où se cachait le serpent. Vous avez aussi cette Cléopâtre toute blonde, alors qu’on pourrait l’imaginer plus brune. Mais à cette époque là, au 17 et au 18e siècle, c’est ainsi qu’on la représente avec cette clarté dans les cheveux.
[Illustration : Jean André Rixens, “La mort de Cléopâtre”,1874, peinture]
Marthe Pierot : Et alors , justement, dans la représentation suivante, nous découvrons une Cléopâtre brune. Mais là, on est au 19e siècle avec ce tableau réalisé par Rixens. Mais encore une fois, il représente la mort de Cléopâtre et on s’aperçoit que c’est un sujet en histoire de l’art qui est très souvent représenté. Quand on parle de Cléopâtre, on ne parle pas forcément de la femme qu’elle était quand elle était en vie, quand c’était une femme stratège, puissante, influente. Mais finalement, on nous montre sa mort parce que c’est le prétexte pour nous parler d’une femme belle qui reste désirable dans la mort.
C’est une mort érotique, avec un corps sensuel qui est très souvent dénudé comme on le voit ici. Au 19e siècle, il y a une véritable fascination pour le personnage de Cléopâtre. Notamment avec l’expédition de Bonaparte en Égypte et le développement de l’orientalisme. C’est une personnalité, c’est une héroïne qui est très représentée à cette époque-là. Ici, on voit évidemment que le peintre veut nous parler de l’Égypte avec peut être un peu trop de décor, contrairement à l’autre tableau qui était plus sombre, plus épuré. Là on est dans un contexte un petit peu surfait. On a l’impression d’être dans les décors de cinéma de ces peplums ou de ces films en Technicolor, avec toutes ces couleurs saturées, avec tous ces objets surchargés.
Regardez, vous avez des hiéroglyphes au fond, vous avez la sculpture d’Isis derrière Cléopâtre, une servante, qui a cette position un peu d’art pharaonique avec la tête de profil, les épaules de face. Vous avez un tapis en panthère, un faucon aux ailes émaillées de bleu. Tout y est, c’est peut être un petit peu trop et c’est vraiment pour nous parler de l’exotisme de l’Égypte qui plaît énormément au 19e siècle. Dans tous les cas, on a cette Cléopâtre qui s’abandonne avec extase dans une mort très désirable dans ce décor un petit peu surchargé.
[Illustration : Pierre Prouha, “Psyché”, 1887, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Alors après cette femme couchée, cette horizontalité du corps, voyons à présent ce personnage de Psyché, debout. C’est une œuvre qui mesure 1m63. On est dans la taille réelle, et qui nous parle de cette amoureuse, l’amoureuse d’Eros dans la mythologie grecque.
Cette femme, gardait l’amour d’Eros à la condition qu’elle ne le regarde jamais. Mais un jour, sa curiosité est trop grande et elle décide d’allumer cette petite lampe à huile qu’elle tient de sa main gauche, donc à droite sur notre image, pour le regarder pendant son sommeil. Et malheureusement, une goutte d’huile va tomber sur le corps d’Eros. Il va se réveiller et il va lui en vouloir beaucoup parce que la condition était qu’elle ne le regarde jamais. Elle va perdre son amour, et toute sa vie durant, Psyché va tenter de le retrouver.
Sa vie, en quoi est-elle héroïque ? C’est parce qu’elle va réussir des épreuves très compliquées pour justement regagner et retrouver cet amour. Elle va finalement accomplir un petit peu comme Hercule au masculin, ses travaux. Elle se bat pour retrouver son amour. Alors c’est vrai qu’on a là un personnage qui nous parle de l’amour déchu et puis de l’amour divin qu’elle retrouvera. Un personnage où la figure féminine est élégante. Elle est un petit peu maniérée. Vous voyez, la tête est beaucoup trop petite par rapport à son corps. Ça c’est un effet de ce qu’on appelle le mouvement néoclassique. Pour qu’une femme soit très belle et très élancée, on va réduire son visage, les traits de son visage et on va complètement l’idéaliser. Mais c’était un canon qui existait il y a plus de 2000 ans et qui a beaucoup repris encore au 19e siècle. Vous voyez également cette idéalisation dans la longueur des jambes fuselées, dans cette toute petite poitrine, dans cette bouche fine, ce petit nez droit, et dans la délicatesse de ses doigts, qui sont artificiellement levés. Elle est la figure idéale. Elle est celle qui est aimée par le Dieu amour, le Dieu Eros, comme je vous l’ai dit. Le sculpteur n’étonne en rien. Prouha ne cherche aucunement à quitter les sentiers balisés par l’art académique. Et cette Psyché, elle est tout sauf réelle. Est ce qu’on peut s’identifier à elle ?
Marthe Pierot : Ben déjà, c’est un personnage qui n’existe pas. C’est un personnage de la mythologie, donc ce côté un peu idéalisé peut avoir du sens aussi.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, mais en fait, on peut se sentir en tout cas tout à fait touché par sa quête effrénée et par sa détermination.
[Illustration : Jen Riviere, “Théodora”, vers 1891, sculpture]
Marthe Pierot : Oui oui effectivement. Alors à présent nous allons parler donc d’une autre sculpture, mais cette fois-ci, c’est une sculpture en plâtre, en plâtre entièrement dorée, qui représente une impératrice, Théodora. Impératrice byzantine, on est au 6e siècle de notre ère. C’est une femme extrêmement intéressante parce que son histoire est assez mystérieuse, mais c’est vraiment l’histoire d’une ascension sociale. Elle est, on ne sait pas trop, mais elle semblerait être la fille d’un dresseur d’ours et d’une courtisane ou d’une danseuse. Et puis ce qui est important, c’est de se dire que lors de sa jeunesse, elle a reçu une très solide formation culturelle et religieuse et elle a des expériences dans la vie politique. Elle va se rendre à Constantinople, Istanbul aujourd’hui. Et elle rencontre Justinien, qui va devenir le futur grand empereur. Justinien va l’épouser. Il tombe amoureux de cette femme. Il est séduit par sa personnalité et non seulement il épouse, mais il va décider de l’associer officiellement au pouvoir. C’est la première fois qu’une femme atteint ce statut politique. Elle est sa principale conseillère. Elle est vraiment associée à toutes les décisions. Elle a beaucoup d’influence sur les réformes législatives de Justinien, de cet empereur-là. Et notamment elle fait avancer beaucoup de choses au niveau des droits des femmes. On est au 6e siècle quand même. Donc c’est dire la modernité et l’ambition de cette femme-là qui a fait avancer beaucoup de choses. C’est une personnalité qui avait beaucoup de facettes. Elle avait un tempérament affirmé, elle était à la fois habile et impitoyable. Mais c’est vraiment l’une des souveraines les plus influentes de son temps. Alors que finalement rien ne pouvait prédire cet avenir là au début de son enfance. Et c’est ça qui aussi qui nous plaît. C’est que c’est une personnalité qu’on a oubliée, alors que Cléopâtre on la connaît énormément, Théodora un peu moins. Il y a quand même un regain d’intérêt pour cette personnalité au 19e siècle, où elle devient une héroïne en littérature, au cinéma et au théâtre, avec Victorien Sardou qui lui consacre une pièce entière en 1884, dont Sarah Bernhardt sera l’actrice principale. On en a parlé tout à l’heure quand on parlait de Judith. On retrouve un peu cette coupe carrée que Judith portait en sculpture au début. Cette coupe qui est très 1900. Vraiment Sarah Bernhardt.
[Illustration : Francesco Cairo, “Mariage mystique de sainte Catherine”, vers 1650, tableau]
Isabelle Bâlon-Barberis : À présent, parlons du personnage de Sainte Catherine. On est un petit peu avant l’époque de Théodora, puisque nous sommes au début du 4e siècle en Égypte à Alexandrie. Catherine, qui est-elle ? Elle est cette jeune femme très intelligente, très instruite, qui a beaucoup fréquenté la bibliothèque d’Alexandrie justement, et qui a choisi le christianisme. C’est sa direction. Elle a tellement étudié cette discipline qu’elle est capable de convertir tout le monde autour d’elle. Ce qui rend fou l’empereur Maxence. En plus elle est très belle.
Il la demande en mariage mais ça ne l’intéresse pas du tout Catherine, puisque ce qui l’intéresse elle, c’est de se marier symboliquement au Christ. L’empereur est tout à fait humilié et cherche à la faire mourir. Vous avez donc sous le genou de Catherine, ce morceau de bois avec cet ergot de fer, qui est un élément de la roue crantée qui doit l’écraser. Ici Catherine se penche avec noblesse et humilité vers l’enfant Jésus. Regardez les éclats blancs de son vêtement qui nous parle de sa virginité. C’est vraiment le jour de son mariage mystique, de son Union, comme je vous le disais, avec Jésus, qui est en train de lui passer l’anneau au doigt. Regardez comme le calme règne. Le temps et suspendu. Le moment est solennel, les expressions sont infiniment douces. Il se passe, il s’accomplit un mystère. Nous sommes dans le surnaturel. Le visage traduit vraiment toutes ses vertus, un visage grave, un visage responsable. Elle sait que la voie sur laquelle elle s’engage l’amènera à la mort, mais rien ne serait la faire déviée de son cas. De très nombreuses représentations de Catherine existent en histoire de l’art, et de très nombreux peintres ont été frappés par sa force de caractère. C’est une femme qui veut choisir sa vie et non pas la subir . Elle dit quand même non, à l’homme le plus puissant de son temps.
[Illustration : Constance Blanchard, “Femmes grecques de Souli courant à la mort”, 1838, peinture]
Marthe Pierot : Alors on va poursuivre pour parler, non pas cette fois-ci d’une héroïne, mais peut être de plusieurs héroïnes. Et là nous sommes en Grèce, c’est le contexte d’indépendance grecque au 19e siècle, qui bouleverse énormément l’opinion publique, dont on parle beaucoup. C’est une scène assez dramatique qui se déroule sous nos yeux. Là, ces héroïnes, ces femmes, ce sont des souliotes. Elles habitent un massif montagneux en Grèce et elles sont très isolées. Et parce qu’elles étaient isolées, elles ont longtemps été protégées des Turcs ottomans qui envahissaient la Grèce. Mais voilà, au bout d’un moment, la troupe d’Ali Pacha arrive vers elles, on ne les voit pas dans le tableau. Les ennemis sont absents. Mais on les devine, regardez sur la gauche, on voit une fumée, on a l’impression que des troupes arrivent, on sent que c’est la fin qui approche. Il n’y a que des personnages féminins sur ce tableau, parce qu’on imagine que les hommes sont tous morts, que les ennemis ont tué tous les hommes, les maris et les frères de ces femmes.
Elles se rendent compte de ce qui va les attendre, et elles choisissent la mort plutôt que de se soumettre aux ennemis. Pourquoi elles choisissent la mort ? Parce qu’elles sont en haut d’une falaise. Regardez, ce mouvement vers la droite, on comprend qu’elles s’élancent, qu’elles vont se précipiter dans le vide. À droite, il n’y a que la mer et donc la mort qui les attendent. Ce qui est intéressant, c’est de voir effectivement toute la palette des émotions de ces femmes. Certaines sont désespérées, certaines sont apeurées, certaines sont déterminées. Il y a même peut être une héroïne parmi les héroïnes. Parce que vous avez cette femme en blanc qui prend toute la lumière au regard déterminé. On sent qu’elle voit les troupes approchées et qu’elle tire son petit garçon, qui se trouve au centre, qui ne veut pas partir, peut être qu’il veut se battre. Mais en tout cas le destin est scellé. Ce qui est très beau, c’est de voir la qualité des étoffes, qui nous disent l’Orientalisme, qui nous disent l’exotisme.
Regardez cette veste bleue, ces turbans que portent ces femmes. C’est aussi la qualité de ce tableau. En tout cas-là, on parle vraiment d’un suicide collectif de femmes qui choisissent leur mort plutôt que l’esclavage, plutôt que la soumission. Ces femmes qui sont héroïnes dans le sacrifice, s’inscrivent dans un tableau romantique, quand on voit la fougue des mouvements, la catastrophe qui s’annonce, la beauté de ces femmes dans justement cet acte extrêmement dramatique. On peut dire aussi que c’est un tableau romantique caractéristique du 19e siècle. Constance Blanchard, peint ce tableau avec un format très important, puisqu’il fait plus de 3 m sur 4. Ce qui est impressionnant, c’est qu’elle s’attaque à une actualité brûlante du moment et hautement politique. Ce qui n’était pas trop la place des femmes. Déjà qu’être peintre en tant que femme n’est pas évident, alors, quand on s’attaque à un sujet d’histoire et un format aussi grand, c’est dire la force de caractère de Constance Blanchard,
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est un petit peu notre héroïne.
Marthe Pierot : Elle est héroïne aussi, c’est important de pouvoir le dire effectivement.
[Illustration : Alexandre Antigna, “La halte forcée”, 1850, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors à présent, parlons de la femme chez Antigna. Alors qui est Antigna ?C’est avant tout le peintre des humbles, qui vont montrer leur détresse. Il va parler du peuple de manière infatigable et très vite, on va le classer dans les peintres réalistes. Il est proche de Gustave Courbet, qui est certainement le peintre réaliste le plus célèbre de la 2nde moitié du 19e siècle.
Alors c’est vrai qu’Antigna va aborder le problème des plus démunis, leurs conditions de vie. Il va s’intéresser à l’industrialisation de l’époque et à la misère qu’elle entraîne. Ici, il est question d’un exode rural. On est dans les années 1840. La nuit est tombée, l’hiver est là avec sa neige et le froid et ces gens sont obligés de s’arrêter parce que le cheval est couché. Nous avons une palette très froide. On a des gens à qui on a fait miroiter la ville et le travail, à qui on a dit “quitter votre campagne boueuse et vous aurez de meilleures conditions à la ville”. Ils y sont partis. Mais là, les choses se présentent mal pour eux. Vous voyez, le mari assis sur le cheval est désabusé. Le grand père ne peut pas aider, les enfants tentent d’aller chercher du bois pour réchauffer l’ensemble de la famille, et puis la femme. La femme est l’héroïne de ce tableau, puisqu’elle est quasiment centrale. Elle est ce pivot autour duquel tout s’organise. Elle est comme un chef d’orchestre qui dit certainement à ses enfants, de faire ceci ou cela, Son regard qui au loin se porte, au loin vers une lumière. Elle a une détermination évidente et elle est la seule qui se tient debout. La position qu’elle a donc nous dit toute sa dignité, tout son courage. Elle est certainement une allégorie de la force. En tout cas, elle est la femme du peuple exemplaire, celle qui rappelle un petit peu la Marianne de la Révolution.
Marthe Pierot : Oui, et là c’est intéressant parce qu’on vous montre une héroïne anonyme. Elle est inconnue, on ne sait pas de qui il s’agit. Elle n’a pas de prénom, elle est plutôt une allégorie .
[Illustration : Laurent Marqueste, “Velleda”, 1875, sculpture]
Marthe Pierot : Alors ici nous avons Velleda. C’était une prophétesse celte ou germanique du premier siècle de notre ère. Et à cette époque-là, il faut savoir que les tribus germaniques croient aux Divinités prophétisantes chez les femmes. Donc, les femmes sont des prophètes qui sont considérées comme des déesses vivantes, c’est dire l’influence qu’elles pouvaient avoir auprès de ces tribus. C’était le cas pour Velleda, qui était vénérée comme une déesse. Elle a eu beaucoup de pouvoir parce qu’elle a influencé ces tribus germaniques à lutter. Elle les encourage à lutter contre la domination romaine qui prend de plus en plus de place. Elle soulève, elle encourage son peuple gaulois à se soulever et à s’affranchir de cette domination. Mais elle finit en captivité à Rome où elle va mourir. Châteaubriant, un écrivain romantique du 19e siècle, s’inspire de ce personnage dans son récit les martyrs, mais va complètement changer sa fin. Il raconte qu’elle est prise en otage par un ennemi. Qu’elle va tomber folle amoureuse de lui. Et là on entre vraiment dans le cliché de ses héroïnes romantiques du 19e siècle, ou les sentiments de la femme lui coûtent la vie. Comme elle tombe amoureuse de l’ennemi, elle trahit son peuple et elle décide de se tuer en se tranchant la gorge.
Isabelle Bâlon-Barberis : Terrible.
Marthe Pierot : C’est un peu terrible. Ici, le sculpteur Laurent Marqueste, un sculpteur toulousain, va donc s’inspirer de ce personnage et de ce texte littéraire pour représenter une Velleda. Ce qui est intéressant, c’est qu’il choisit de nous parler d’une femme forte, affirmée et déterminée. Au lieu de mettre en scène la fin de sa vie, au lieu de mettre en scène le drame de son suicide dans une position alanguie ou de détresse, comme c’est très souvent le cas au 19e siècle, il va nous parler de cette femme forte et puissante. Observez son regard, on sent qu’elle est dans un moment de décision et on comprend toute l’influence qu’elle a pu avoir auprès de ses tribus germaniques. Et puis c’est aussi une sculpture qui témoigne de l’engouement pour les thèmes celtiques, à une époque où on en a un peu assez de la mythologie. Et on va aller puiser nos récits un peu plus au Nord, donc parler d’autres histoires. On a quand même une inspiration de la statuaire antique dans les codes vestimentaires, ou même dans le profil de cette femme qui est un profil à l’Antique avec ce nez dans la continuité du Front. On a un petit peu un mixte des 2. En tout cas c’était la dernière héroïne de cette conférence et on va revenir vers vous pour conclure.
Isabelle Bâlon-Barberis : Donc on a vu 10 visuels, 10 héroïnes, et on se rend compte que soit ces femmes sont historiques, elles sont réelles, je pense par exemple à Cléopâtre, ou alors elles sont fictives et notamment mythologiques avec Psyché.
Marthe Pierot : Oui. Dans tous les cas, réelles ou fictives, elles sont héroïnes quand même. Aujourd’hui, on voulait aussi terminer pour se dire qui sont les héroïnes de nos jours, de notre temps, alors que jadis on les célébrait pour leur dévouement et leur sacrifice, en leur accordant un rôle de martyr. On n’a pas forcément envie de ça aujourd’hui. On se dit qu’il y a cette idée de faire, cette idée d’action, cet engagement pour une cause parfois au péril de son confort ou de sa vie. Il y a quelque chose qui suscite une admiration dans tous les domaines, sportif, humanitaire, on peut vraiment aller très loin. Et dans tous les cas, ce phénomène d’identification dont on parlait, il est très subjectif. Il dépend de notre culture, de nos valeurs, de nos goûts, et il peut y avoir plein de modèles féminins qui nous correspondent.
Isabelle Bâlon-Barberis : Où peut-on les retrouver ces héroïnes ? On s’est rendu compte que pendant des siècles, dans la littérature et dans les musées, les tableaux nous parlaient de ces héroïnes. Aujourd’hui, elles sont leur représentation. C’est par le biais d’autres supports, d’autres médias comme le cinéma, mais ça fait un petit moment, les biopics sont peut-être les meilleurs sujets. On les retrouve beaucoup en photographie et également dans les réseaux sociaux où leurs actions sont très relayées, où elles ont une grande visibilité.
Marthe Pierot : Oui exactement. En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivi pour cette conférence qu’on a souhaité héroïque.
Isabelle Bâlon-Barberis : On se retrouve très vite, merci, au revoir.
Marthe Pierot : Au revoir.
Les 10 dernières acquisitions
Quoi de neuf au musée ? 10 dernières acquisitions
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Quoi de neuf au musée ? 10 dernières acquisitions”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2023]
Marthe Pierot : Messieurs dames, Bonjour. Bienvenue pour cette conférence en ligne du musée des Augustins où, aujourd’hui, nous allons voir ensemble ce qui est neuf dans les collections du musée.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, c’est vrai. Nous allons parler des dernières acquisitions. Quelles sont les œuvres qui entrent au musée des Augustins ? Alors il faut savoir qu’il y a encore quelques décennies, au musée des Augustins on mélangeait un peu tout. C’est à dire qu’il y avait de l’art ancien, de l’art antique, des arts décoratifs. Il y avait, bien sûr de l’art médiéval, il y avait de l’art classique, vraiment tout. C’était une époque où le musée des Augustins était le seul. Depuis, de nombreux musées existent, et on a essayé de centrer les choses. On va vous proposer des choses qui vont de l’an 1000 au début du 20e siècle, ce qui est quand même une grande période.
Marthe Pierot : Ouais. On voit vraiment en fait que les œuvres bougent et que l’identité du musée s’affirme en fonction et s’affine même. Et c’est intéressant de vous dire que la politique d’un musée, c’est aussi d’enrichir ses collections, en plus de les valoriser et de les protéger. Et que les procédures d’acquisition permettent parfois de combler des lacunes s’il manque des œuvres dans un mouvement artistique, ou même de compléter la série d’un artiste ou un point de vue particulier. Il y a une véritable réflexion autour de cette politique d’acquisition. Les collections ne sont absolument pas figées.
Isabelle Bâlon-Barberis : Quelqu’un qui a une activité extrêmement importante, c’est le conservateur. C’est, un jour en salle des ventes, un coup de cœur qu’il peut avoir, mais c’est aussi un combat qu’il mène à base de réflexion, d’arguments, de courrier,s de recherche pour obtenir une œuvre. Mais attention, un conservateur n’est pas un collectionneur. Il n’en a pas la liberté parce qu’il achète avec de l’argent public pour le public, au nom d’une collectivité, à laquelle il doit rendre des comptes.
Marthe Pierot : Mais c’est quand même le chef d’orchestre de tout ça. Alors on va voir ensemble quels sont les moyens d’acquérir une œuvre. Vous allez voir, il y en a plusieurs. On peut tout simplement acheter une œuvre dans une salle des ventes, dans une galerie d’art, ou alors hériter d’une œuvre en qui a été mentionnée sur un testament, on peut faire un don, un legs, ou alors tout simplement recevoir des subventions aussi. Il y a plein de moyens pour obtenir les œuvres d’art. Mais c’est intéressant de vous dire qu’il y a aussi une enquête qui a été réalisée sur l’histoire de l’œuvre qui va entrer dans nos collections. Parce qu’il est important de savoir si elle n’a pas été volée à un moment, spoliée. Il y a donc,toute une enquête qui est établie. C’est pas toujours facile de retracer l’histoire et l’identité d’une œuvre, mais il faut bien faire les choses dans les règles de l’art, ça c’est important.
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors précisément, nous allons remonter le temps et nous allons vous montrer 10 œuvres qui sont rentrées au musée, ces 5 dernières années. Allons y.
[Illustration : Amélie Beaury-Saurel, “Après déjeuner”, 1899, tableau]
Marthe Pierot : Alors on commence avec cette œuvre réalisée par Amélie Beaury-Saurel qui s’intitule “Après déjeuner” qui est entrée dans nos collections en 2017. On va vous faire une présentation chronologique au niveau des acquisitions. C’est un achat qui a beaucoup de sens parce qu’il complète la collection que nous avons de cette artiste. C’est en effet le 3e tableau que nous possédons d’Amélie Beaury-Saurel. Alors cette femme, on vous en a peut-être déjà parlé dans les autres conférences, mais c’est important de rappeler sa personnalité. Une femme engagée et militante qui est formée à l’Académie Julian, qui est une école ouverte aux femmes, à cette époque-là. Elle se spécialise dans le portrait. Mais c’est surtout sa position de directrice qui est importante, parce qu’elle reprend la direction de cette académie. Et en même temps, elle combat toujours pour l’égalité des sexes et elle soutient surtout l’éducation artistique des femmes. Et pour ça, elle recevra une Légion d’Honneur. On comprend la personnalité de cette artiste, quand on voit cette œuvre, quand on voit ce portrait de femme réalisé par une autre femme. Elle nous montre là, une femme affirmée, qui ne nous regarde même pas. Elle nous ignore complètement. Regardez toute la place qu’elle occupe avec son vêtement aux tissus très mousseux, très soyeux. Elle se tient droite, elle a une carrure un peu d’athlète, un menton très fort, une énergie, une vitalité. On imagine sa forte personnalité et son affirmation, surtout quand on voit qu’elle fume et qu’elle boit du café. Normalement, ce sont des choses qui appartiennent à l’univers masculin. Mais elle, elle s’en moque et c’est une véritable déclaration d’indépendance féminine. On ne sait pas vraiment si elle sourit. C’est assez énigmatique.
Est-ce qu’elle esquisse un léger sourire ? Est-ce qu’elle rit ? On ne le sait pas, mais en tout cas, elle nous ignore complètement. Ce qui nous plaît aussi, c’est que cette œuvre n’est pas une peinture à huile. C’est un fusain réalisé sur un papier marouflé, c’est à dire un papier collé sur de la toile. Et vous avez essentiellement du fusain, sauf à quelques endroits où vous avez des touches qui mélangent une autre technique, au niveau de la cigarette, la braise rouge et au niveau de son bouquet de violettes, ce sont des couleurs réalisées au pastel. La fumée de sa cigarette qui est blanche, est faite avec de la craie. Elle mélange les techniques. En plus de la liberté du sujet et de cette femme très indépendante, il y a aussi une liberté de cette technique-là, qui est complètement mélangée. Ce qui nous plaît, c’est le format de ce tableau parce que c’est un format inhabituel pour un dessin. En général les dessins sont plus petits, comme si c’étaient des études préparatoires. Là elle le présente comme une peinture à huile, comme un tableau entier. Même le cadre est très important, c’est précisément ça qu’il faut vous dire. On a acheté ce tableau avec le cadre d’origine et le verre d’origine. Il y avait une véritable volonté de la part de l’artiste de nous montrer un tableau abouti. Il s’agit presque plus d’une peinture que d’un dessin.
Isabelle Bâlon-Barberis : On peut en donner la dimension puisque c’est un tableau qui fait 1m de hauteur.
Marthe Pierot : Tout à fait. Et c’est important de vous dire aussi que comme c’est un dessin, c’est un tableau qui ne peut pas être exposé de manière permanente au musée des Augustins. Vous ne pouvez pas toujours le voir. Il est exposé 3 mois maximum pour éviter de l’abîmer. Et pour terminer, c’est une acquisition qui renforce la collection d’œuvres que nous avons de cette époque, c’est à dire la fin du 19e début 20e au musée. Et une acquisition qui complète aussi une prestigieuse série de tableaux peints par des femmes artistes.
[Illustration : François Lucas, “Jean-Charles Ledesmé, baron de Saint-Elix”, 1762, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Alors maintenant je vous propose de parler d’un homme. Et c’est le baron Jean-Charles Ledesmé, le baron de Saint-Elix. Alors c’est intéressant parce qu’en 2017, il y a eu ce qu’on appelle un mécénat participatif. C’était la première fois. Il y a eu, de la part du musée, cette volonté de créer cette levée de fonds, un appel aux dons du public via Internet. Chacun pouvait à hauteur de ses moyens, être mécène de cette œuvre. Alors c’était vraiment nouveau. Il y a eu un véritable combat pour que cette œuvre rentre au musée. On va voir pourquoi. Il faut savoir que cette statue était pour le château de Saint-Elix, dans le Comminges à 50 km au sud-ouest de Toulouse dans la direction de Saint Gaudens. C’est là, que cette œuvre devait être placée dans ce château de la Renaissance. Elle était destinée à son orangerie. C’est pour ça que cette œuvre, on l’a beaucoup appelée le jardinier. Alors ici, pour décrire un petit peu cette œuvre, un homme élégant, sans affectation, vous voyez comme il est soigné. Il a une posture propre à son siècle, le 18e, son costume est celui d’un militaire, vous voyez, l’épée a disparu. C’est une œuvre de terre cuite très délicate, que nous avons-là.
Il est à noter qu’elle était peinte en blanc, parce que la peinture blanche imitait le marbre pour donner encore plus de valeur à cette œuvre. Jean-Charles Ledesmé, le fameux baron, était un très grand amateur d’art. Il était également historien et avait à cœur d’embellir le parc de son château de nombreuses statues. Alors il va faire appel à François Lucas, le grand sculpteur toulousain qui était lié d’amitié avec le Baron. Pour en revenir à cette œuvre, c’est intéressant de dire que c’est une chance inouïe que nous l’ayons, parce que le château a vécu un tas de péripéties, et que le très beau décor qu’il existait, qui existait et dans le château et dans le jardin, c’est un décor qui a été très abîmé et qui a même disparu. Mais ce sont vraiment les tribulations d’une sculpture, puisque cette statue, on la retrouve à Marseille au début du 20e siècle, puis elle est en vente à Cannes en 2010. Cependant, elle va rentrer au musée un petit peu plus tard. Et c’est vrai que ça avait beaucoup de sens qu’elle réintègre la Haute-Garonne parce qu’elle y est née. Et intéressant de dire que le fameux château a été vendu pour la énième fois en juillet 2022. C’est très récent.
[Illustration : Jean-Paul Laurens, “La dame à la broderie”, vers 1900, peinture]
Marthe Pierot : Alors on continue, et cette fois-ci nous allons vous parler d’une œuvre qui est entrée dans nos collections en 2018, réalisée par Jean-Paul Laurens. Jean-Paul Laurens est un peintre et un sculpteur français qui a fait l’école des Beaux-Arts à Toulouse, mais toute sa carrière est essentiellement parisienne. C’est surtout un peintre connu pour ses scènes d’histoire. Mais attention, pas n’importe lesquelles. Il est très connu parce qu’il a la réputation d’utiliser des sujets qui font polémiques, parce qu’il a des convictions républicaines, il a un anticléricalisme affiché, donc il n’y va pas de main morte dans les sujets qu’il choisit et c’est pour ça qu’il sort du lot dans les peintres d’histoire du 19e siècle. Mais là, vous allez me dire, c’est pas du tout ce qui se passe. On a choisi de vous montrer un Jean-Paul Laurens beaucoup plus intime avec cette œuvre-là, parce qu’on nous parle d’une femme qui n’est pas un personnage héroïque de l’histoire. On ne connaît même pas son identité. Quand on voit la place que prend la robe, on peut même se demander s’il ne s’agit pas du portrait de la robe plutôt que de portrait d’une femme qui est assez anonyme. Nous sommes en intérieur et vous avez une femme qui est assise sur un siège, comme un trône, comme une reine, mais qui a un visage extrêmement fermé. Elle est frontale, mais elle est très figée. On a la sensation qu’elle est enfermée à l’intérieur. C’est la sphère qui était réservée aux femmes à cette époque. Regardez ce qu’elle fait, elle brode telle une Pénélope qui broderait sans jamais s’arrêter. Mais ce qui nous plaît dans ce tableau, c’est de voir la quantité énorme de tissus, de plissés. Regardez ses épaules très bouffantes, ce col de mousseline développé. Mais on voit à quel point elle est couverte. Aussi, rien ne dépasse. Ses manches vont jusqu’à la moitié de sa main, son cou et son visage sont presque recouverts. Ici, on a cette idée d’extravagance, mais aussi de chasteté. Mais c’est un vêtement qui est très à la mode au 19e siècle et même au début du 20e siècle. On est vraiment dans une robe contemporaine de l’époque du peintre, alors que d’autres éléments sont un petit peu plus éloigné au niveau des dates. Parce que regardez cette chaise en cuir avec des clous. Elle parle plus du 16e siècle, c’est une mode plus antérieure, tout comme le lambris qui recouvre le mur derrière, où là c’est une mode du Moyen Âge comme le vitrail un petit peu plus haut, alors que par exemple au fond à droite vous avez un secrétaire en bois foncé incrusté de nacre, on est vraiment au 19e. On se dit que le peintre est très éclectique, dans son style, et qu’il emprunte beaucoup d’objets qui appartiennent au passé. Mais c’est ça aussi la mode de la fin du 19e siècle. Une époque où on ne fait que revenir ou piocher dans les siècles passés. Ce qui est intéressant de souligner pour terminer, c’est de vous dire qu’on est à la même époque qu’Amélie Beaury-Saurel. Cette femme qui était très libre, qui fumait et qui buvait du café. On voit qu’on est très loin de la même indépendance.
[Illustration : Louis François Lejeune, “Promenade aux châteaux de Crac vers les sources de la Garonne”, 1833, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Bien. Et bien à présent, nous allons partir à la découverte d’un paysage avec la promenade au château de Crac vers les sources de la Garonne. Un tableau qui a été réalisé en 1833 par Louis François lejeune. Alors cette œuvre a été acquise par le musée des Augustins, parce qu’il se trouve que nous avions déjà une œuvre qui lui ressemble beaucoup et qui pouvait faire le pendant de celle-ci. Donc il était très intéressant de l’obtenir. C’est une galerie américaine qui va contacter le musée des Augustins, sachant qu’on a déjà des œuvres de ce peintre. Alors il est intéressant de dire que quand, en 2017, la galerie s’adresse au musée des Augustins, nous n’avons pas le budget pour l’acquérir. Mais il se trouve qu’en 2018, la galerie n’a toujours pas vendu ce tableau, mais elle a besoin de place, donc elle baisse un peu son prix. Et là, le conservateur du musée des Augustins redit sa motivation et peut donc concrétiser cette acquisition. Beaucoup de chance. Alors ce tableau tout à fait monumental, est rempli de lumière et vous avez des touristes en excursion qui sont en train de visiter ces châteaux du Moyen-Âge aux sources de la Garonne. Les Pyrénées, c’est extrêmement attirant pour les jeunes touristes, les jeunes sportifs, les anglais et les français du début du 19e siècle. Il y a des stations thermales et il y a ce goût pour les ruines du Moyen-Âge. Il y a ce souhait de revenir vers la nature. La révolution industrielle donne déjà l’envie aux gens de se retourner vers la mère nature et de la célébrer à travers ce type de grand tableau. C’est la vie en extérieur, c’est les bienfaits pour la santé physique, pour la spiritualité et vous avez autant d’hommes que de femmes qui partent à l’ascension périlleuse sur les chemins tortueux de ces châteaux. Regardez, combien le vent gonfle les vêtements, comment les foulards en spirale s’élèvent. Au premier plan, vous avez ces petits bergers dont les vêtements évoquent la paysannerie, autant que vous avez des touristes qui sont vêtus, eux à la mode citadine. Lejeune, le peintre, est un homme qui est couvert d’honneur. Il a fait une brillante carrière militaire et il s’installe à Toulouse. Et va même devenir le directeur des Beaux-Arts de Toulouse, ainsi que le maire de la ville en 1841. Voilà beaucoup de choses. Il a été le grand peintre des batailles napoléoniennes et il continue ici à arpenter la montagne à cheval pour découvrir de beaux sites. Les sites qu’il découvre sont souvent sublimes, remplis de son imaginaire et de son romantisme. Mais en même temps, il y met une certaine traduction du réel et un vrai souci de la topographie. Mais bien sûr, il exagère, romantisme oblige. Bien sûr, il veut arracher l’admiration des spectateurs. Alors il va allonger la chute d’une cascade. Il va véritablement surélever les reliefs, avec notamment ce format vertical que vous avez pour le tableau. Il va observer précisément, puis va ajouter beaucoup de fantaisie à tout cela. C’est un joyeux mélange. Il est à noter aussi que Crac, ce nom signifie forteresse dans la langue syriaque. Mais il y a cette volonté, de la part de Lejeune, de nous parler de l’époque des croisades en Terre Sainte, avec ce mot de Crac. Mais, c’est aussi une volonté de rappeler l’époque de la croisade contre les cathares dans les Pyrénées.
[Illustration : Rudolf Weisse, “Pietà”, 1901, peinture]
Marthe Pierot : Alors on quitte la lumière pour nous plonger dans l’obscurité de cette œuvre réalisée par Rudolf Weisse. C’est un artiste qui est né en Bohème, qui était alors une province de l’Autriche-Hongrie. Il fait vraiment partie de ces artistes autrichiens qui étaient actifs à Paris dans les années 1880. Mais c’est plutôt un artiste orientaliste, ce qui n’est pas évident ici, quand on observe cette scène de Pietà. C’est une œuvre qui rentre dans les collections du musée en 2018 et c’est un don de l’association des Amis du musée. Donc c’est aussi une manière de pouvoir recevoir des œuvres. Alors on voit ici surtout un goût que le peintre a pour la peinture ténébriste du 17e siècle. Regardez cette obscurité,. On a l’impression que la scène est noire, comme un gouffre où les personnes seraient aspirées à l’intérieur.
Ce qui est très fort aussi, c’est de voir ces jeux de lumière. Regardez le corps du Christ au Centre. Cette blancheur. Il triomphe par sa blancheur, mais aussi il capte toute la lumière. On a un corps arqué vers l’arrière. Il bascule vers l’arrière vers la noirceur, mais il a aussi des bras très rigides, vraiment des bras qui étaient tendus comme s’il était encore sur la croix. On note aussi la délicatesse du périzonium, ces petits draps au niveau de ses jambes rose pâle. Puis on note beaucoup de noirceur au fond, et une chevelure Rousse. Il s’agit de Marie Madeleine, qui a les cheveux lâchés et qui se prend la tête en signe de désespoir. Juste à côté, vous avez la Vierge Marie, qui est toute voilée, mais qui se penche vers son fils et qui ouvre son manteau de manière à le protéger, à l’enlacer. Ce qui est frappant aussi, c’est l’atmosphère très étrange de ce tableau, c’est de voir la forme, ce tombe dos, qui renforce l’idée cauchemardesque de ce trou noir, mais qui nous rappelle encore une fois la référence des peintures religieuses du 17e siècle, alors qu’on est au 19e. Et cette forme ronde, n’est pas tout à fait de l’époque. L’atmosphère, comme je l’ai dit, est inquiétante, étrange. On croirait presque un tableau de Jean-Jacques Henner avec, vous savez, ce sfumato tout à fait vaporeux et parfois les chevelures rousses, qui sont très présentes.
Isabelle Bâlon-Barberis : Comme dans la peinture symboliste.
Marthe Pierot : Oui, on a l’impression qu’il y a un petit peu de ça aussi. En plus des références du 17e siècle, vous avez un mélange de beaucoup de choses et un tableau tout à fait intéressant, même au niveau de son cadrage très resserré, qui permet de travailler les raccourcis, mais aussi qui nous recentre vraiment sur la scène principale et ce trio tout à fait angoissant.
[Illustration : Charles-Abraham Chasselat, “Le repos de Bélisaire”, 1812, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai. Alors vite de la lumière. Justement, sortons-en et parlons du repos de Bélisaire, réalisé par Charles-Abraham Chasselat en 1812. C’est une œuvre acquise en 2020 pour le musée des Augustins. Alors Bélisaire, qui est-il ? C’est un général romain qui a servi sous l’empereur Justinien à la fin du 6e siècle. Un homme souvent victorieux, un homme couvert de gloire, mais à la suite de conspiration, il finit par tomber en disgrâce, il est mis à l’écart. Et là commence son mythe. Le mythe de l’homme emprisonné, aveuglé, réduit à mendier. On ne sait pas si tout cela est vrai, mais ça va nourrir ce mythe. Beaucoup d’artistes vont parler de cela. Notamment, il y a le grand succès du roman philosophique d’un certain Marmontel en 1767 qui parle de lui. Le musée des Augustins, possède pas moins de 5 œuvres le représentant. Donc véritablement, c’est un homme qui va compter. Alors ici, quand on regarde ce tableau, nous sommes dans une scène très douce, très intime. Vous avez ce héros antique, qui est très néoclassique, dans la mesure où, regardez la toge qui l’enveloppe de ses nombreux plis. Regardez ce profil, où le nez est dans le prolongement du front. C’est un choix en extérieur, dans un édifice antique mais en ruine. Ca renforce ce sentiment de méditation d’une grandeur passée, je dirais. Il y a donc placé à côté de cet homme âgé à la chevelure blanche, cet enfant au pied du vieux guerrier. Ce qui est intéressant, c’est de voir qu’il y a toute l’intériorité de ce vieillard qui se recueille et de cet enfant qui dort. Qu’il y a ce vieillard qui est vaincu par la vie, qui est plongé dans une méditation douloureuse. Et ce vieillard, on peut savoir qu’elle était son activité, parce que sous le coude de l’enfant qui dort, il y a le casque de ce grand général qu’il a été. C’est le détail qui nous permet de comprendre qui il était. On note aussi qu’il y a toute cette délicatesse des traits du noble vieillard, et la beauté de cet enfant. La beauté qui est renforcée par ce jeu de lumière, qui se pose et sur le crâne rond du vieillard et sur l’épaule ronde de l’enfant. Il y a le vert acide du vêtement de Bélisaire, avec des camaïeux de brun assez soutenus. Et il y a véritablement une belle invention qui se détache des couleurs habituelles des autres représentations. C’est en fait une chose assez audacieuse que de choisir ce vert. Pour la composition, soyons sensibles aux 2 obliques parallèles, que vous trouvez avec le bâton de l’homme aveugle, et la position de l’enfant qui dort. Revenons sur le fait qu’on a ici 2 extrémités de la vie, avec un homme comme Bélisaire, qui attend la mort, et ce jeune enfant qui fait ressortir justement cette idée de jeunesse du monde. C’est vraiment une réflexion sur la vie qui s’écoule. Un bilan final d’une action, qui semble vaine ou qui semble dérisoire. Pour terminer, ce nimbe autour du crâne de Bélisaire. On a l’impression d’une auréole de lumière que le peintre a réalisé avec cette ombre.
[Illustration : Henri Deturck, “Tête d’étude”, 1895, peinture]
Marthe Pierot : Alors restons sur la thématique de la vieillesse et zoomons un petit peu plus sur un autre visage. Bon, on ne parle pas de Bélisaire, mais on ne sait pas vraiment de qui on parle ici. Le peintre Henri Deturck, est un peintre qui vient d’une famille très modeste du Nord de la France. Son père était tisserand, sa mère dentellière. Et grâce à une bourse, il va pouvoir suivre les cours de l’école des Beaux-Arts de Lille, être l’élève de grands professeurs et il deviendra aussi professeur de dessin lui-même. On le voit bien ici, quand on voit la qualité de son coup de pinceau. Alors c’est un tableau très intéressant parce qu’il est très intense, très précis et vous avez une force expressive qui est accentuée par un cadrage très serré. Là, on peut se dire qu’on a l’impression d’avoir un peintre caravagesque, même si on est en plein 19e siècle. Parce que vous avez le cadrage serré, vous avez le réalisme de cette vieillesse, le ténébrisme de l’œuvre, ce fond très noir, mais aussi de la lumière, qui est renvoyée par la carnation de cet homme-là.
C’est intéressant de voir un petit peu ce clair-obscur et la théâtralité de cet homme-là. Qui est-il ? Et bien on ne sait pas vraiment. Regardez au niveau de son crâne. Il y a un socle sur lequel repose sa tête et on voit du sang. Donc on comprend qu’il est mort.Il y a un accident qui vient de se réaliser. C’est assez brutal mais aussi récent parce qu’il y a encore beaucoup de couleurs au niveau de ses joues. On a l’impression que le sang afflue encore et que son expression est encore vigoureuse. Donc finalement ça s’est peut être passé il n’y a pas longtemps. Est-ce que le peintre connaissait cette personne ? Est-ce qu’il s’est rendu à la morgue pour croquer un clochard ? On ne sait pas vraiment. Alors on a du mal à savoir qui est ce vagabond, qui est cet anonyme. Mais ce qu’on remarque c’est cette auréole au-dessus de sa tête. Attention l’auréole a été ajoutée et c’est ça qui est très intéressant. La signature et l’auréole sont ajoutées quand le peintre veut présenter son œuvre au salon. Il va donner une dimension sacrée à son œuvre,. Peut être pour qu’elle soit moins rude et plus acceptable pour le jury, parce qu’il ne se sentait peut être pas de montrer cette tête de misérable inconnue au salon. D’une tête d’homme quelconque, il devient un Saint. Et il lui donne une respectabilité ici en ajoutant ce trait. Alors justement, regardons un petit peu de plus près les traits et les coups de pinceau réalisés par le peintre. Regardez la manière dont il esquisse vivement, dont il brosse largement et rapidement ce bout de tissu, ou même certaines parties de sa peau. Mais à d’autres parties, on a un pinceau qui ralentit, qui gagne en fluidité au niveau en fait de son visage ou de ses cheveux. Donc c’est intéressant d’avoir ces 2 styles. On a le réalisme de la vieillesse. Regardez ce corps osseux, amaigri par les années. Un visage qui a une peau très fine, très mince. On a vraiment cette idée d’avoir l’illustration du réalisme social qui est tout à fait contemporain au 19e siècle.
[Illustration : Andrea Commodi, “Portrait de femme”, vers 1600, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors à présent, on va sortir de cette atmosphère un petit peu morbide, disons-le, pour remonter dans le temps, puisque, des œuvres de notre sélection, c’est l’œuvre la plus ancienne. Il s’agit d’un portrait de femme réalisé autour de 1600 par l’italien Andrea Commodi. Le musée des Augustins a acquis cette œuvre en 2021. Et c’est intéressant de parler de l’acquisition d’une œuvre du 17e siècle, d’une œuvre qui vient enrichir la collection italienne du musée des Augustins, qui est déjà très importante. Alors ici, vous avez un portrait mystérieux, un portrait magnétique. Vous avez cette femme anonyme. Le décor autour d’elle est presque inexistant, et son vêtement est aussi d’une grande neutralité. Vous voyez comme elle nous fixe, et c’est vrai que ça nous captive. Elle a une allure quelque peu sévère. Son expression est assez retenue, son corsage brun est traité en aplat, on n’a pas de dégradé, et vous avez ce chaste col presque transparent, mais très soigneusement rendu au niveau de la nuque. Notez les manches nouées de son corsage par des rubans, nouées au niveau des épaules, qui font que ces manches sont amovibles, ce qui permettait de porter l’hiver comme été la même robe. Alors le visage est peint de manière extrêmement fine et fluide. Regardez la délicatesse de ces mèches, de ces boucles qui s’échappent. Il y a une carnation qui est très nuancée, comme un dessin au pastel. Il y a ce camaïeu de gris mais des lèvres rouges viennent piquer justement cet ensemble un petit peu monochrome, cette lumière froide. Les joues sont quand même réveillées par un blush, dont la couleur chaude est reprise par les reflets acajou de ses cheveux. Cette femme n’a absolument rien d’une coquette. Elle n’a aucun bijou précieux autour du cou, au niveau du l’aube de ses oreilles. Et sa pose est spontanée. Elle est légèrement voûtée. Vous voyez, elle vient un petit peu sur l’avant. Elle est comme saisie sur le vif. Elle est très loin des postures stéréotypées. On peut dire qu’Andrea Commodi a une approche naturaliste qui est assez proche de l’école caravagesque. Alors cette œuvre est entourée de mystère. Nous n’avons aucune information concernant l’identité du modèle et nous avons très peu de choses à comprendre du contexte social, puisque vous voyez, le fond est tout à fait vide. Alors le peintre, était actif à Rome et à Florence. Mais c’est vrai que c’est un peintre qui était connu par ses contemporains, mais on le connaît bien moins, bien que dans les musées de Nice et de Dijon, en France, il y a des toiles de lui.
Marthe Pierot : Oui, et c’est important de dire aussi que c’est l’œuvre la plus chère dans nos acquisitions qu’on vous montre là dans cette conférence là.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est une œuvre qui a été acquise pour la somme de 100 000€.
Marthe Pierot : Voilà, ça vous donne un ordre d’idée à peu près.
[Illustration : Auguste de Chatillon, “Le petit Savoyard”, 1845, peinture]
Marthe Pierot : Alors on continue avec un tableau un peu dans les mêmes tons, un ton ocre, brun doré, pour vous parler de ce petit savoyard réalisé en 1845 par Auguste de Châtillon. C’est une œuvre qui entre dans nos collections en 2021. Alors l’artiste est un sculpteur mais surtout un poète français et un peintre bien sur très proche de Théophile Gautier et de Victor Hugo. Il faisait partie de ce cercle littéraire et amical de ces artistes et de ces poètes. Il a même réalisé parfois des portraits des enfants de Théophile Gautier et de Victor Hugo. Alors l’artiste est un peintre sculpteur et aussi surtout un poète français qui était très proche de Théophile Gautier et de Victor Hugo. Il faisait partie de ce cercle de bohème littéraire et artistique. Ils se retrouvaient beaucoup avec ces 2 poètes. Il a même réalisé le portrait de la fille de Victor Hugo.
Mais au-delà de ses portraits intimistes de ses amis, il va aussi dans le genre de la peinture sociale et il nous propose souvent des belles figures de savoyards. Dans un contexte de 19e siècle très tourmenté, par les nombreuses révolutions qui sont présentes, il a envie de nous sensibiliser en nous parlant de l’enfance sacrifiée, comme il le fait ici. Regardez ce petit ramoneur. Alors les ramoneurs, on les connaît depuis très longtemps. On les connaît parce qu’ils font partie des illustrations populaires, on les voit avec leurs échelles sur le dos à chanter, à siffloter. Mais ils ont une histoire qui est très triste. C’est un métier qui existe depuis plus de 400 ans. Qui sont ces petits enfants? Il faut savoir qu’entre le 17e et le 18e siècle, le climat est de plus en plus rude et les hivers sont très difficiles. Donc les familles savoyardes vont délaisser le monde agricole pendant cette saison hivernale pour aller en ville et chercher du travail. Et c’est la même époque où les cheminées se multiplient dans les maisons et dans les grandes villes comme Paris. Il faut donner naissance à un nouveau métier insolite pour nettoyer toutes ces cheminées. Sauf que les montagnards sont beaucoup trop larges pour passer dans les conduits et racler la suie avec leur pelle. C’est là qu’on va commencer à recruter les plus jeunes enfants, des familles très pauvres, entre 6 et 12 ans, parce qu’ils sont assez petits pour faire ce travail très ingrat.
Le 19e siècle, c’est donc le siècle de l’embauche de ces petits ramoneurs savoyards. C’est une véritable tradition, mais aussi une exploitation, parce qu’on leur fait croire qu’ils seront nourris, logés, payés et éduqués, mais il n’en est rien. Ils travaillent entre 12 et 14h par jour. Ils sont même obligés de faire la manche, parfois, ou de faire d’autres métiers pour gagner leur vie. Et trés souvent ils mouraient de la tuberculose. C’est extrêmement tragique. Heureusement plusieurs lois de la fin du 19e siècle vont limiter le temps de travail et l’âge légal de travail pour les enfants. Ce qui va un petit peu mettre un hola à cette exploitation-là d’enfants.
Mais ici ce petit ramoneur que nous propose Châtillon nous touche aussi, par la jeunesse de cet enfant, mais aussi par son visage. Son visage qui est couvert de suie. On a l’impression qu’il porte un masque. Vous avez un visage très noir, des vêtements de haillons où la poussière s’accroche. Et tout ce noir-là contraste aussi avec le mur de la pièce qui est très chaud, au niveau de la lumière et de la couleur. Mais finalement vous avez pas énormément de couleurs. La palette est très limitée. On est plutôt dans les tons de brun et de blond. On a aussi beaucoup de réalisme au niveau du vêtement. Regardez ce vêtement qui est rafistolé de toutes pièces. Cet enfant qui n’a même pas de chaussettes, mais il mange un pain, il mange un morceau de pain comme s’il suçait son pouce. On sent qu’il y a quelque chose de très rassurant dans cet acte là. Et regardez la blancheur de la mie de Pain qui résonne avec la blancheur de ses yeux. Pour terminer, c’est intéressant de voir la signature et la date du peintre réalisées à la manière d’un graffiti sur le mur. C’est une jolie mise en abyme.
[Illustration : Alexandre Falguière, “Buste d’enfant”, 1870, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Absolument oui, et en fait, nous allons continuer avec ce petit garçon. C’est toujours l’enfance et ici il est question de notre dernière œuvre. Parmi notre sélection de 10 œuvres aujourd’hui, il est question de ce buste réalisé par Alexandre Falguière en 1870. Un marbre blanc d’à peu près 35 cm de haut. Comme ça, vous en avez une idée. Alors, comment la chose a eu lieu ? L’œuvre est rentrée au musée des Augustins en 2022, suite à l’action du conservateur général des sculptures du musée d’Orsay, qui a fait savoir au ministère de la culture que cette œuvre serait mise aux enchères et le musée des Augustins s’est positionné. On parle d’un achat par préemption, ce qui permet donc au musée des Augustins d’avoir la priorité sur cette acquisition. Cette acquisition est partie au prix de 3 900€, alors qu’au départ l’estimation était très haute, elle était à 40 000, pour vous parler un peu d’argent. Donc quelquefois on ne comprend pas toujours parce que c’est une œuvre d’une très grande qualité, mais qui est partie finalement à un prix assez modeste. Alors cette sculpture est extrêmement attachante. Pour quelle raison ? Falguière, a réalisé de nombreux enfants, mais pas de cette manière-là. Ici, il s’agit de la candeur, de l’innocence, de la pureté de ce petit garçon. Et évidemment, le marbre blanc rehausse l’âge tendre. Ce qui différencie cette œuvre des autres, c’est qu’on a une part de secret, une attitude très rêveuse. Cet enfant semble pris dans un moment d’absence. Et ce que fait Falguière, c’est qu’il attrape de manière tout à fait fugace, cet instant T. C’est un défi, parce que les enfants ne tiennent pas souvent en place quand on décide d’en faire leur portrait. Et certainement la photographie peut aider à fixer quelque chose au niveau notamment de l’expression intéressante. La composition est très proche des modèles de la Renaissance italienne avec ses très jolis bustes idéalisés. Ici il s’agit bien d’un petit garçon de son temps, parce qu’il porte un costume marin très en vogue à l’époque. Et le costume est effectivement tout à fait tendance. Mais la coiffure que Falguière prête à cet enfant et tout à fait moderne dans cette mesure où elle n’est pas terminée. Vous avez ces grosses boucles enchevêtrées. Cs gros rouleaux qui ne semblent pas terminer. Alors que le modelé est tout à fait délicat et très abouti. On a l’impression que quand Falguière a réalisé dans un premier temps cette œuvre avec de l’argile, il a donné à cette chevelure, ce côté très abondant. Et finalement, une fois qu’il traduit l’œuvre en marbre, il ne va pas plus loin au niveau de la chevelure. C’est ça qui va nous surprendre.
Isabelle Bâlon-Barberis : Voilà Messieurs dames, à présent nous allons conclure.
Marthe Pierot : Oui, bien sûr. Nous avons vu ensemble 10 œuvres qui sont entrées dans les collections du musée depuis 2017. Mais en réalité, il y en a beaucoup plus. On n’a pas été exhaustives, mais en 30 min, on ne peut pas. Et sachez que 23 œuvres sont entrées au musée des Augustins ces 5 dernières années. Mais c’est important de vous dire qu’une fois qu’une œuvre entre dans les collections publiques, elles y restent pour toujours. Elles ne peuvent plus sortir, elles sont inaliénables dans les musées de France. Donc c’est très important de bien réfléchir à la politique d’acquisition, parce que quand on achète, on s’engage à vie.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai, mais la question du budget, c’est une question véritablement essentielle. Il n’est pas illimité. Donc on a eu l’occasion de vous donner quelques notions des prix des œuvres dans cette petite conférence. Mais finalement et bien la mairie de Toulouse met à disposition des musées une enveloppe annuelle. Et les musées vont se répartir cette somme. Certains musées vont faire le choix d’œuvres très ambitieuses une fois de temps en temps, ou bien d’autres musées vont acheter donc plus régulièrement des œuvres moins chères.
Marthe Pierot : Oui mais en fait on a envie de se demander et bien comment on définit le prix d’une œuvre finalement ?
Isabelle Bâlon-Barberis : Mais le prix d’une œuvre dépend et bien de l’offre du marché de l’art. Il dépend de la côte d’un artiste. Il dépend de plein d’opportunités et ça c’est très fluctuant.
Marthe Pierot : Ouais tout est fait, en tout cas on va s’arrêter là pour le moment, même si d’autres œuvres continuent d’entrer dans nos collections. Peut-être que dans 5 ans on fera une nouvelle conférence pour vous montrer les nouvelles arrivées pourquoi pas, mais là on va se quitter pour nous aujourd’hui.
Isabelle Bâlon-Barberis : on se revoit très bientôt.
Marthe Pierot : Oui merci beaucoup et au revoir
Isabelle Bâlon-Barberis : au revoir.
De toutes les couleurs
De toutes les couleurs
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “De toutes les couleurs !”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2023]
[Marthe Pierot ] : Messieurs dames, Bonjour,
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bonjour
[Marthe Pierot ] : et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne avec Isabelle
[Isabelle Bâlon-Barberis] : et Marthe,
[Marthe Pierot ] : les 2 conférencières du musée des Augustins. Et aujourd’hui, on parle
[Isabelle Bâlon-Barberis] : des couleurs, on va en voir de toutes les couleurs. Alors les goûts, les couleurs, c’est ce sont des choses qui ne se discutent pas, vous le savez. Cependant, il est important de dire que les couleurs ont une histoire politique, psychique, culturelle. Cependant, leur valeur, donc symbolique, n’est pas du tout universelle . C’est vrai que selon les géographies, selon les sociétés, selon les religions, et bien elles sont interprétées différemment ces couleurs. L’histoire des couleurs remonte à la nuit des temps et c’est vrai que les couleurs ont laissé dans notre vocabulaire des traces. Par exemple, beaucoup d’expressions
[Marthe Pierot ] : oui, rire jaune
[Isabelle Bâlon-Barberis] : ou bien avoir une peur bleue,
[Marthe Pierot ] : être blanc comme un linge
[Isabelle Bâlon-Barberis] : ou bien broyer du noir.
[Marthe Pierot ] : Bon, il y a beaucoup d’expressions colorées.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : On peut s’arrêter là .
[Marthe Pierot ] : Oui, tout à fait. En tout cas, on avait vraiment à cœur aussi de vous expliquer quels liens existent et comment les couleurs sont considérées à travers l’histoire de l’art, à travers l’histoire tout court.
Il faut savoir que les pigments ont été inventés il y a 40 000 ans et par exemple, à l’époque de la préhistoire, les peintres préhistoriques utilisaient peu de couleurs parce qu’ils avaient peu de ressources et donc finalement, on a surtout du rouge, du noir et de l’ocre, parce que ce sont les couleurs ou les pigments dont ils disposent. Et puis, quand le temps évolue et bien évidemment, les palettes s’agrandissent, les couleurs se diversifient et par exemple, à l’Antiquité, on utilise plus de couleurs et surtout, on va les utiliser pour leurs dimensions symboliques. C’est la valeur symbolique qui nous importe. Et tout ça aussi va changer au fil du temps. Par exemple, au Moyen-Âge, le rapport avec le bleu change complètement et ça vous allez bien le comprendre dans notre conférence. Et c’est important de dire aussi qu’il y a un lien particulier entre les peintres et les couleurs en fonction des mouvements artistiques.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, mais il y a des moments en histoire de l’art, par exemple le 17e siècle, où il y a une vraie querelle entre les partisans de la couleur et les partisans du dessin. Est ce qu’un tableau a une valeur à cause de son trait ou à cause des teintes qui sont choisies ? Ça, c’était toute une querelle. Il y a d’autres moments dans l’histoire de l’art aussi qui traitent de la peinture et de son utilisation. Par exemple à la fin du 19e siècle avec l’impressionnisme. Et bien les impressionnistes utilisent les couleurs pures. Ils posent les couleurs primaires et les couleurs secondaires sur leur palette sans les mélanger, sans obtenir de dégradé. Ça ne les intéresse pas et même les ombres sont colorées. Après, un petit peu après, à l’époque de l’Expressionnisme, et bien ils veulent les peintres créer cette réaction émotionnelle. Et les couleurs qu’ils vont utiliser vont déformer le réel.
[Marthe Pierot ] : Oui, tout à fait. Alors nous, on va vous présenter 10 visuels du musée des Augustins qui vont justement retracer un petit peu ces choix de couleurs, cette évolution, ces significations et ces symboles qui changent selon les époques et selon les peintres. Et on va commencer tout de suite avec un partage d’écran. On commence avec ?
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, on va commencer avec le vert. On va se mettre au vert avec un tableau donc de René Grandidier.
[Illustration : René Grandidier, Paysage d’Arles, 1946, peinture]
Alors le vert, c’est un pigment qui est obtenu à base d’oxyde métallique, mais également à base de terre. Et c’est vrai que, c’est une couleur qui est ambivalente, voire ambiguë. D’un côté, elle est symbole de vie, de renouveau, de change, d’espérance, et elle est associée en fait au monde végétal très souvent. Mais d’un autre côté, et bien c’est une couleur qui est associée au poison, au malheur, au diable et à ses créatures. Alors ici avec le tableau de René Grandidier, nous sommes en Provence, nous sommes à Arles. Et c’est vrai que ce peintre toulousain avant de partir à Tahiti se gorger de nouvelles couleurs encore et bien il aimait le midi de la France. Il aimait nous parler notamment de ses couleurs très chlorophylle. Alors chloros en grec ça signifie le vert et c’est pour ça que vous avez cette fraîcheur. Ce vert très tendre. La saison, c’est l’été et vous voyez qu’il y a ses ombres portées, ce soleil au Zénith, des personnages aux bras nus. Tout un petit monde qui est dehors. Le mari, la femme, l’enfant, les chevaux, les chiens. Remarquez que les 2/3 du tableau sont vert. Plus cette petite touche d’orangé qui est la couleur complémentaire au niveau du toit de tuiles. Tout semble véritablement contaminé par le vert. Regarder le ciel est comme gagné par le vert. Il y a cette surface ondoyante de la prairie comme une mer. On a très envie d’y déplier une nappe pour un pique-nique. Pourquoi pas ? En tout cas c’est une couleur paisible. Une couleur qui est de toute éternité, celle qui a ressourcé l’homme. Il est l’homme en symbiose avec elle et il est relié à elle. Il est dépendant d’elle pour tout ce qu’elle lui apporte, cette nature verte. Donc c’est un tableau, je pense, qui fait du bien. Parce que c’est vrai que le lien avec la nature s’est perdu au profit de cette urbanisation. Mais c’est vrai qu’on réalise aujourd’hui, avec toutes les problématiques écologiques actuelles, qu’on a forcément besoin de cette nature, depuis notamment le confinement des années 2020. On sait très bien, qu’on a eu besoin de se reconnecter avec elle.
[Marthe Pierot ] : Oui, c’est un tableau qui fait du bien et qui est frais, en tout cas. Alors on va passer au bleu à présent. Et comme on l’a dit en introduction, et bien le bleu prend une dimension très importante au Moyen-Âge et il est associé au registre céleste. C’est la couleur de la Vierge Marie. Et là, on a choisi de vous montrer une sculpture pour parler des couleurs. C’est une vierge de pitié réalisée au 16e siècle.
[Illustration : Anonyme, Piétà des Récollets, vers1510, sculpture]
Et c’est important de le dire parce que les sculptures, au Moyen-Âge comme à l’époque de l’Antiquité, étaient entièrement peintes. Après le travail du sculpteur, il y a le travail d’un polychromeur qui allait réchauffer de ces couleurs les sculptures. Et c’est important de rappeler que les églises étaient sans électricité. Donc très sombre, à panne éclairée à la bougie. Donc il fallait des couleurs très vives pour que les sculptures soient vues. Alors c’est une sculpture qui a été restaurée. Le visuel après nous le montre très bien. Elle était entièrement recouverte de cette couche noire à cause de la pollution et de la suie des bougies qu’on allumait au pied de cette sculpture. Et donc grâce à une très belle restauration, on a pu retrouver toutes ces couleurs d’origine qui sont extrêmement vives. Alors vous avez ici une belle composition pyramidale. Avec un Christ qui marque une horizontalité, qui est allongé. Et vous avez Jean et Marie-Madeleine qui sont placés en symétrie entre Marie qui est elle, très grande pour signifier justement sa grandeur. On accentue énormément son importance ici. Jean, c’est celui qui est à gauche et qui pose sa tête sur la, enfin qui pose ses mains sur la tête du Christ. C’est le plus jeune des apôtres et un ami de Jésus. Marie Madeleine, on la reconnaît à droite parce qu’il y a ce vase rempli d’herbe et d’huile parfumée à ses pieds. C’était cette femme en pécheresse, vous savez, qui change de vie quand elle rencontre Jésus. Donc là, c’est le moment de recueillement. C’est le moment où la Vierge reçoit le Christ, le corps du Christ. Et dans un sentiment de douceur et de tristesse, tous ces personnages se concentrent avec retenue sur ce corps supplicié. Mais nous, ce qui nous intéresse, c’est que la douleur ici s’exprime par la couleur et non pas par le modelé. Parce que regardez, quand on zoome, et bien on a ces larmes qui s’échappent des yeux et qui sont peintes d’un bleu soutenu et qui ressortent sur le teint très clair des saints.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, mais il est intéressant donc de voir que les yeux sont donc réalisés comme des boutonnières. On disait un œil en boutonnière. On a comme cette petite fente qui découpe l’œil sur le visage.
[Marthe Pierot ] : Ouais, tout à fait, c’est intéressant. Alors en tout cas, on voit ici et on le voit avec ce zoom même quand on revient dans la sculpture générale, on voit qu’il y a vraiment un goût pour des couleurs très vives, des couleurs surtout primaires qui sont représentées ici. Mais il faut savoir que les polychromeurs possédaient une palette aussi savante et diversifiée que les peintres de panneaux. Et souvent, ce sont les mêmes artisans qui adaptent juste leurs compétences à des supports différents. Mais on note un petit décalage entre, et bien finalement la qualité de la sculpture et de la peinture. Parce que regardez, l’anatomie est extrêmement bien réalisée au niveau du modelé. Regardez les veines sur les pieds et les mains. Regardez la position arquée du Christ. Par contre, la peinture paraît un peu plus maladroite parce que le sang ne coule pas forcément dans le bon sens. Regardez au niveau du front du Christ et même ses larmes qui sont peut-être un peu trop multipliées au niveau des yeux des saints. Donc il y a ce petit décalage qu’on peut noter. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c’est ce bleu très profond que porte la Vierge sur son manteau.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, on avait envie de faire un petit rappel sur le bleu et la manière dont on peut le trouver. Et c’est vrai que les pigments pour le bleu sont différents. On a des pierres qui peuvent être soit le lapis lazuli, qui est en fait une pierre qui vient d’Afghanistan, qui est très chère, et donc qui est commandée par des gens qui sont très riches. Puisque le lapis lazuli pouvait valoir plus que l’or à certaines périodes. Il y a également l’autre pierre qui est l’azurite. Et c’est la pierre qui a été utilisée ici pour notre œuvre, pour notre pièta. Cet azurite, c’est une pierre beaucoup moins coûteuse, qui vieillit moins bien malheureusement, mais qu’on trouve un petit peu partout en Europe. Et puis il y a d’autres moyens d’obtenir du bleu. On le sait et on le sait très bien à Toulouse, parce qu’on pense au 16e siècle, à ce fameux Pastel. On peut penser aussi à l’indigo qui va donc le supplanter. Mais le pastel et l’indigo sont surtout utilisés pour la teinture des fibres, pour les vêtements et bien moins pour la teinture des panneaux. Et enfin, je voudrais juste dire que la première couleur de synthèse qu’on a créé, c’était le bleu, le bleu de Prusse, donc au 18e siècle.
[Marthe Pierot ] : Oui, en tout cas ce qui est intéressant et on va terminer sur ça pour le bleu, c’est vraiment de comprendre que le bleu était une couleur qui était extrêmement méprisée à l’époque de l’Antiquité. Elle était considérée comme barbare. Elle était donc très peu utilisée. On la nommait même pas. Et puis à partir du 12e siècle, elle devient la couleur emblématique de l’Occident chrétien. Le Roi Saint-Louis va la choisir, alors qu’avant lui, la couleur des rois c’était le rouge. Et puis finalement ce bleu devient le symbole de la monarchie et de la France. Donc on a vraiment une couleur qui prend beaucoup d’importance et qui devient finalement la couleur préférée du monde occidental aujourd’hui.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait,
[Marthe Pierot ] : Elle change de statut, c’est vrai.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Une côte d’amour qui diffère. Alors à présent, on va parler du violet. Parce que finalement, du bleu au violet, il n’y a qu’une touche rouge. Mais si vous voulez, on peut également trouver le violet à l’état naturel. Mais c’était assez difficile et ça remonte à très très loin. Parce que, à l’époque de l’Antiquité on allait trouver cette couleur là grâce à des coquillages. Grâce à ce qu’on appelle le coquillage qu’on appelait le murex. Ce coquillage là, il était très très profond, donc en mer Méditerranée, et il fallait que des pêcheurs très experts plongent et en remontant ils en mourraient souvent parce qu’ils ne faisaient pas ces fameux paliers de décompression qu’on connaît aujourd’hui. Donc si vous voulez on donne un chiffre, 12 000 mollusques donc 12 000 murex faisaient 1,5 g de teinture violette. C’est extrêmement coûteux et c’est uniquement la couleur que bien des empereurs, des gens comme Néron et avant lui Jules César s’habillait de pourpre. Alors dans le christianisme, un petit peu plus tard, ce sont les évêques et les papes qui vont utiliser cette couleur. La tenue violette est une tenue de pénitence. On faisait pénitence en la portant, c’est aussi une couleur de deuil. Et puis chez les artistes, le violet représente très souvent la porte vers l’au-delà. C’est une couleur toute symboliste. C’est une couleur mystérieuse voir inquiétante et énigmatique. Alors là, avec notre tableau de Maurice Denis, on est un petit peu dans ce contexte-là.
[Illustration : Maurice Denis, Nativité, 1894, peinture]
On a cette couleur spirituelle, voire mystique. C’est une ville contemporaine que vous avez sous les yeux . C’est certainement Paris vers 1900. Mais le sujet est parfaitement biblique et la Nativité ici est transposée dans une ville très urbaine. La crèche est transformée en garage. C’est vrai que si vous voulez, on retrouve une ville industrielle, où les cheminées des usines remplacent les clochers. Donc c’est vrai que Maurice Denis, il fait ce choix parce que c’est un peintre qui appartient au mouvement qu’on appelle le mouvement Nabi, qui signifie prophète en hébreu. Parce qu’il a envie de réintroduire le spirituel dans l’art en réaction aux peintres impressionnistes, qui ne traitaient que de la nature et de la vibration lumineuse dans les extérieurs. Donc ici on a le recueillement du peintre qui vraiment fait la part belle au violet. Dans ce violet qui concerne et les briques et le cheval à droite et tant de choses, il y a des sources très jaunes comme par exemple cette lumière électrique. C’est une ampoule électrique certainement, puisqu’on est à l’extrême fin du 19e siècle. Mais on peut parler d’électricité avec ce jaune très très intense de la lanterne au-dessus de Marie et de l’enfant Jésus.
[Marthe Pierot ] : Oui, qui dit l’industrialisation et l’urbanisation, une époque moderne. Et justement, comme on parle de ce jaune électrique, restons sur le jaune pour vous montrer ce tableau à présent et pour parler aussi de cette couleur, le jaune qui a une symbolique très complexe et qui a souvent un aspect négatif. Alors il faut savoir que pour faire du jaune on utilise des pigments nocifs voir toxiques. Comme par exemple l’or piment qui est à base d’arsenic ou le jaune de plomb. Donc finalement c’est peut-être aussi à cause de ça que le jaune était mal vu, parce qu’on le considérait comme du poison presque finalement. Alors dans ce tableau qui s’intitule Saint-Jean Chrysostome et l’impératrice Eudoxie,
[Illustration : Jean-Paul Laurens, Saint Jean Chrysostome et l’impératrice Eudoxie – 1893, peinture]
on voit un mur jaune immense qui prend beaucoup de place, qui fait face à un homme en blanc qui est un homme d’église. C’est le grand prêtre de Constantinople et il s’appelait Saint Jean Chrysostome. En grec, ça signifie la bouche d’or. Et là on voit qu’il s’exprime avec beaucoup de colère. Et il critique ou il menace cette femme qui est aussi habillée en jaune. Qui est l’impératrice Eudoxie . Et il critique son mode de vie qui n’était pas exemplaire selon la morale chrétienne. Elle aimait les fastes et les plaisirs. Donc il lui reproche tout ça. Et là nous sommes au 4e siècle après Jésus Christ à l’époque de ce tableau. Ce sont des personnages qui ont vraiment existé. Et il faut savoir que pendant un temps dans la peinture, habiller un personnage en jaune comme c’est le cas ici, c’est vraiment en faire un personnage mauvais. Parler d’un bourreau, d’un traître, d’un criminel. Judas était en jaune. C’est vraiment la couleur négative du mensonge, de la maladie, de l’hypocrisie et de la trahison. Alors que dans l’Antiquité gréco-romaine, c’était une bonne couleur. Elle symbolisait plutôt la richesse, la prospérité, la lumière. C’était une couleur bénéfique qui change complètement et qui se dévalorise après. Mais là, on a quand même ces lustres dorés qui scintillent et qui brillent, qui sont là aussi pour parler de richesse et pour justement nous parler de la richesse de cette impératrice. Et on note vraiment le contraste entre le décor de sa tribune, où il y a tous ces tapis tendus et ces mosaïques dorés, et l’austérité de cet homme d’Église qui est posé sur une chair en bois, très neutre, très simple, très rustique. Vraiment . On note aussi la modernité dans le dépouillement de ce tableau coup de poing, vraiment . Et la modernité du cadrage. Regardez, on ne voit pas le sol, on a l’impression que cette tribune, cette chair semble flotter vraiment et que cet homme en blanc est comme un ange déchu finalement. Et il ose défier les puissances de son temps. Et on voit la puissance de son argumentaire quand on décèle vraiment et bien son arcade sourcilière. Même si on ne voit pas son visage, on comprend les expressions de son visage. Les rides sur son front, ou même la main qui est extrêmement tendue, alors qu’elle, eudoxie, semble de marbre, complètement froide, sans expression par rapport à tous ses reproches. Il y a vraiment un contraste très noté dans ce tableau. Et puis le mur jaune, extrêmement dépouillé et il symbolise aussi, cette idée de d’austérité, de négative, de vide.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Pour moi, alors on va parler à présent du noir. C’est la négation de la lumière. C’est la couleur du mal, des damnés, du chaos. C’est la couleur également qui a une symbolique, qui est celle des ténèbres et du néant. Alors c’est une couleur qui symbolise l’absence de vie. Donc très tôt dans la lecture de la Bible, le noir apparaît comme tout à fait mortifère. C’est à dire porteur de mort. Alors vous avez un pigment qui est obtenu en général avec le charbon de bois.
[Illustration : Jean Joseph Benjamin-Constant, Portrait de ses deux fils – 1899, peinture]
Alors ici vous avez un tableau de Jean Joseph Benjamin-Constant qui nous présente ces 2 fils. 2 personnages qui semblent absorbés par la nuit. Vous voyez leurs vêtements très noirs, le fond noir, le lourd rideau noir à l’arrière de ces 2 personnages. Vous avez ici et bien cette absence de lumière. La lumière est piégée, elle est absorbée par la matière, et donc on est dans l’invisible. On est dans une couleur aussi qui nous parle de désespoir, d’absence de direction et d’absence justement de – comment dire – de dynamisme. Benjamin-Constant ici, quand il fait le double portrait de ses fils, et bien nous propose des personnages qui sont maladifs, qui sont remplis de tristesse et de mélancolie.
Alors ce qui est important de savoir, c’est que en peignant ce tableau, on sait que Benjamin-Constant, parce qu’on connaît la lettre qui en parle, il a eu le pressentiment de la mort prochaine de son fils. C’est Emmanuel, le fils de droite que vous distinguez donc à droite du tableau. Il n’avait plus véritablement le cœur à finir ce tableau. Et le tableau est parfaitement inachevé. Quand vous constatez que pour le personnage de droite, regardez la poche d’où sort un petit mouchoir qu’on appelle une pochette, et bien cette pochette n’est pas du tout rouge, rouge vermillon comme la cravate qu’on voit sous la barbe de Emmanuel. On a donc juste quelque chose qui est je dirais esquissé. Tout comme la main qu’il a sur la hanche. Une main repliée qu’il tient sur sa hanche et qui n’est pas non plus peaufinée parce qu’on en voit pas du tout les veines à la différence de la main qu’on voit pour l’autre frère. Alors ici, et bien vraiment on est dans ce noir qui plombe un petit peu la scène. Mais effet de surprise, coup de théâtre, remède au désespoir et au spleen, il y a dans ce tableau un autre personnage. Un autre être vivant, mais où est-il ? Regardez bien. On vous laisse encore 2 secondes, c’est fini. On a donc au centre du tableau les 2 petites oreilles, les 2 yeux et la petite langue rose d’un chien qui est noir comme les personnages, mais qui bien sûr, et bien contredit un petit peu la morosité par sa présence. Alors c’est important de dire que le noir au 19e siècle, et nous y sommes, c’est vraiment la couleur des hommes qui incarnent le sérieux, les responsabilités. Tandis que les femmes déployaient un éventail de couleurs qui renvoyaient à la frivolité au divertissement. Dans cette époque-là et et bien les couleurs sont extrêmement genrées.
[Marthe Pierot ] : Mais des femmes portaient du noir et c’est le cas ici dans ce tableau justement, où là on va parler de plusieurs couleurs.
[Illustration : Willem de Poorter, Lucrèce à l’ouvrage – 1633, peinture]
On voudrait parler de la symbolique des couleurs et de voir un petit peu ce qu’elles peuvent signifier. C’est un tableau qui a été réalisé par un peintre hollandais Poorter. On est au 17e siècle et il raconte ici l’histoire de Lucrèce. Lucrèce, c’est cette femme qui a la robe claire qui prend toute la lumière assise sur sa chaise. Et c’est une dame romaine du 6e siècle avant Jésus Christ. Elle est l’épouse d’un homme politique et très proche du roi de Rome qui s’appelait Tarquin Collatin. À première vue, la scène semble tout à fait calme. Lucrèce est en train de broder telle une Pénélope à l’ouvrage avec ses dames de compagnie. Mais sur la droite, vous avez une femme debout qui nous regarde. Elle nous interpelle par ce regard fort parce qu’en fait elle est là pour nous annoncer la suite funeste de l’histoire. Que va-t-il se passer ?
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Ah ! On est suspendu aux lèvres de Marthe !
[Marthe Pierot ] : Regardez sur la gauche, vous avez des hommes. Ce sont les soldats et l’époux de Lucrèce, Tarquin, qui sont là et qui surveillent en fait le comportement de Lucrèce. Et parmi tous ces hommes, il y en a un qui trouve que Lucrèce est à son goût.Et donc il va attendre que tout le monde parte. Il va attendre que Lucrèce se retrouve seule et il va la violer. Et suite à ce drame, suite à cette violence, Lucrèce se donne la mort. Et c’est assez rare en histoire de l’art de nous parler de cette scène-là. Généralement, on montre le suicide de Lucrèce. Mais là, le peintre veut nous parler de ce qui se passe avant. Et c’est assez rare en histoire de l’art. Mais toutes les couleurs sont-là pour nous dire la suite de l’histoire. Elles sont prémonitoires. Regardez le noir de la robe de la dame à gauche. Cette robe noire qui se répand au sol telle une flaque d’encre visqueuse. Elle annonce la mort. Et puis la robe rouge à droite qui dit la douleur et le sang à venir. Et puis les tons pastel de Lucrèce, vraiment, pour rappeler le côté chaste et pur et le lit qui est vert. Le lit à baldaquin avec ses rideaux clos. Le vert, on vous en a parlé tout à l’heure. Il peut avoir une connotation négative, symboliser le mensonge, le mal et le tourment. Et puis vous avez le gris de cette atmosphère lugubre, de cette pièce qui ressemble plus à une cellule de prison qu’à une chambre, où on a l’impression qu’une fenêtre haute laisse passer un tout petit peu de lumière, mais ce qui permet d’éclairer Lucrèce avec une diagonale très marquée, comme un projecteur braqué sur elle. Enfin bon, là tout est dit à travers les couleurs.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, quelle histoire, quelle histoire. On était très très pris par ce commentaire. Changeons de sujet. On vous propose ici et bien la Joconde du musée des Augustins. J’ai nommé la baronne de Crussol.
[Illustration : Elisabeth Louise Vigée Le Brun, Portrait de la baronne de Crussol, 1785, peinture]
Alors elle va donc nous permettre de parler du rouge. Donc le rouge est une couleur tellement ambivalente, qui symbolise tour à tour des choses tout à fait positives comme la puissance, l’amour, la lumière. Mais tout à fait négatives aussi. Elle nous parle d’enfer, de violence, de luxure. Donc c’est véritablement une couleur qui est très orgueilleuse, qui est pétrie d’ambition parce qu’elle a envie d’écraser toutes les autres.
On sait qu’il faut 22,6 millisecondes à votre œil pour voir le rouge. Le rouge, c’est la couleur que vous voyez en premier. Et cette couleur va bien sûr s’imposer. Notre bleu dont on parlait tout à l’heure, est beaucoup plus modeste, lui. C’est vrai. Donc le rouge qui est associé également à la Révolution. C’est la couleur du peuple. Bien qu’ici on vous parle d’une baronne et juste avant la Révolution Française. Alors les pigments que le rouge utilise ce sont des pigments qui sont à base de minerais ou de terre. Ça peut être également des pigments à base d’oxyde métallique comme le mercure. Mais au Moyen-Âge, le rouge, on pouvait l’obtenir en utilisant les racines d’une plante qu’on appelle la Garance. Et cela donnait en fait un rouge assez clair. Mais on pouvait obtenir également un rouge beaucoup plus carmin, beaucoup plus foncé, en utilisant la cochenille. Qui est un petit insecte qu’on écrasait et dont le suc donnait ce rouge foncé. Donc le rouge et le noir de ce tableau là, nous ne reprenons pas le titre du roman de Stendhal, mais ici ces 2 couleurs donnent énormément, je dirais de force, notamment à la baronne. Pourquoi ? Parce que regarder, elle a un visage qui n’est absolument pas maquillé. Elle a un visage au naturel. Mais la force du rouge justement et du noir, permettent de lui donner cette puissance. Alors la couleur dont elle choisit de s’habiller, c’est donc la couleur la plus éclatante et c’est la couleur de la séduction. Parce que comment une femme qui est coquette cherche à se faire le plus remarquer ? Et bien c’est en portant du rouge. Elisabeth Louise Vigée Le Brun était peintre officielle de la Reine Marie Antoinette. C’est une femme qui, à la fin du 18e siècle, est la première à vivre de son pinceau. Et c’est vrai qu’elle était tout à fait reconnue et que c’était une femme tout à fait indépendante financièrement grâce à son art.
[Marthe Pierot ] : Ce qui est rare à cette époque.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Absolument. Donc ici, en fait, c’est intéressant de dire que le rouge et le noir se retrouvent et dans le vêtement que porte donc la baronne et dans son chapeau.
[Marthe Pierot ] : C’est complémentaire. Et c’est ça qui est fort dans les couleurs de ce tableau. Alors on va rester un petit peu sur du rouge, mais on ajoute un peu de jaune pour tomber sur le orange.
[Illustration : Gabriel Guay, La dernière dryade – 1898, peinture]
Et donc on a ces couleurs primaires qui sont mélangées, qui permettent d’avoir du orange. C’est la couleur la plus chaude du cercle chromatique. Mais il y a assez peu de pigments qui permettent d’obtenir le orange pur. Il y en a quelques-uns, comme le réalgar par exemple, qui est une pierre.Et on a aussi, on peut imaginer le safran, le bois du Brésil, et plus tard, avec des composés chimiques comme le soufre, on peut obtenir du orange. Mais c’est souvent grâce à des mélanges que l’on obtient cette couleur. Et au Moyen-Âge, comme les mélanges étaient considérés comme impurs, c’est une couleur qu’on utilise pas énormément. En tout cas, c’est une couleur qui se nomme ainsi suite au fruit, l’orange. Et c’est peut être pour ça qu’on associe le orange à une couleur très optimiste qui est synonyme de bonne humeur et de vitamine. Alors là, le peintre nous parle du orange pour nous parler d’une saison de l’automne.
Vous l’avez compris. Il y a une véritable harmonie chromatique avec ce camaïeu de rouge, orangé ou de orange qui est déployé ici. Nous avons une forêt aux riches colorations automnales. Regardez les branches et les feuilles d’automne qui sont en train de tomber et de former un tapis au sol. Et puis on a cette abondante chevelure qui est aux couleurs en accord avec la saison. Alors le roux est très à la mode en 1900. Là on est quasiment en 1900. Toulouse Lautrec peignait beaucoup de rousses par exemple. Mais souvent c’est pour parler des femmes de mauvaise vie. Parce qu’il faut se dire, on se le rappelle, au Moyen-Âge, les femmes rousses étaient souvent accusées de sorcellerie au point de finir sur le bûcher. Il y avait cette mauvaise image des cheveux couleur feu finalement. Mais là aussi, c’est le peintre qui utilise ce roux pour jouer avec le contraste de cette peau extrêmement laiteuse. Cette peau blanche de porcelaine. Et donc il y a aussi un quelque chose de fort au niveau des contrastes. Et ici, il s’agit en fait d’une nymphe. Le tableau s’appelle “Dernière Dryade”. Les dryades sont les nymphes des bois. Elles protègent les forêts et le mot dryade vient du latin druce qui veut dire chêne. Et c’était l’arbre sacré dans le monde grec. Donc on est dans un contexte mythologique ici finalement. Ce n’est pas tout à fait réaliste et c’est ça qui nous plaît parce qu’il y a le réalisme de la saison. On sent le froid, on sent l’humidité. Regardez l’herbe ou la mousse qui pousse sur cette sculpture en pierre. Mais cette femme est complètement nue. On a froid quand on la voit. Mais parce qu’elle n’existe pas, c’est une nymphe. Et elle gravit les marches de ce temple et elle serre dans ses bras la sculpture du Dieu de la nature qui est Pan. Donc on a vraiment quelque chose de très mythologique ici dans cette situation très automnale.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Voilà alors c’est vrai qu’on va continuer. Avec Marthe, on a décidé finalement de vous proposer 2 visuels pour la même couleur parce qu’on a eu envie de parler d’autre chose. Marthe vient de vous évoquer donc cette nature qui était gagnée par la couleur rousse. Et ici on a envie de vous parler d’architecture avec une couleur qui est finalement un monochrome puisque vous avez toutes les nuances qui vont donc du jaune foncé au roux soutenu. C’est la colonnade du Patio des Lions de l’Alhambra.
[Illustration : Henri Regnault, Colonnade du patio des lions de l’Alhambra – vers 1869, peinture]
On est donc, au sud de l’Espagne. Nous sommes en Andalousie, ça sent déjà un petit peu l’Afrique et on a donc toute une chaleur qui fait du bien par rapport à l’humidité du tableau précédent. Alors Henri Regnault, c’est un peintre qui est au début de l’impressionnisme. C’est un peintre qui ne va pas vivre longtemps malheureusement. Il aurait certainement été très célèbre s’il avait pu exister un petit peu plus longtemps. Alors ici à Grenade, nous avons sa préoccupation qui est celle d’attraper la lumière et son passage à travers les colonnes rythmées de ce patio des Lions. En outre, véritablement la force du blanc de la cour qui renvoie la lumière. C’est véritablement une impression d’esquisse ou d’inachevé avec des zones floues. Regardez sur la partie droite en bas du tableau. On se rend compte que le tableau n’est pas véritablement peaufiné à cet endroit-là. Alors que du côté gauche on a des alvéoles de stuc qui concentrent la lumière. On a véritablement un travail qui est ciselé pour capter la lumière. Donc nous sommes dans les années 70. On est vraiment au début de l’impressionnisme. Et c’est vrai que la lumière tremblée, les touches fondues, sont tout à fait caractéristiques de ce mouvement.
[Marthe Pierot ] : Et nous allons terminer à présent avec le blanc. Alors au même titre que le noir, il y a cet éternel débat, est-ce que c’est une couleur ? Alors que le noir c’était l’absence de la lumière. Le blanc, lui, c’est le reflet de la lumière. Mais voilà, est-ce que c’est une couleur ? Et bien pour nos ancêtres, sachez-le, c’était une couleur à part entière, comme le noir. Dans la période byzantine par exemple, le blanc est associé à l’or et certaines sculptures de l’Antiquité étaient d’ivoire et d’or. Le blanc, c’est la couleur des anges, la couleur des saints, des justes. C’est la lumière divine, la grâce. Mais c’est aussi une couleur qui est associée à la pureté. Et c’est d’ailleurs pour ça qu’au 19e siècle on se marie en blanc. Et cette idée de pureté et d’homogénéité est renforcée par l’idée de la neige aussi. Cette neige immaculée. On a vraiment cette image-là. Mais quand même, pour nous, le blanc c’est quand même l’absence. L’absence de couleur. Et même dans notre lexique, c’est l’absence de beaucoup de choses. Parce que regardez. On parle d’une nuit blanche, c’est une nuit sans sommeil. Une page blanche, une balle à blanc. Bon pour aller très loin aussi. Mais il y a vraiment cette idée de manque et d’absence que reflète le blanc. En tout cas ce peintre là ose peindre le blanc et ce qui est paradoxal, c’est qu’il va peindre du blanc avec de la couleur. Vous avez-là vraiment une nappe.
[Illustration : Henri Manguin, Fruits et moustiers – 1907, peinture]
Et puis vous avez un plat en faïence qu’on appelle un moustier. On appelle cette faïence ainsi parce qu’elle est réalisée dans le village de Moustier qui est dans la région Paca, là où le peintre était actif. Et puis vous avez une fenêtre avec peut-être de la neige justement à l’arrière. Mais pour parler de toutes ces matières qui sont différentes et qui reflètent la lumière différemment, et bien il va ajouter des notes de mauve, de jaune ou de vert pour dire les accents du blanc. Et c’est ça qui nous plaît énormément dans ce tableau.
Alors est-ce qu’on est en hiver ? On n’est pas tout à fait sûr finalement. On peut interpréter autre chose en arrière-plan. Mais on remarque vraiment qu’il y a une tonalité très froide, mais qui est réchauffée par ce rideau multicolore à l’arrière et par la couleur de ses fruits très variés. Les couleurs chantent donc encore plus fort parce qu’elles sont sur cette base neutre. Et c’est ça qui est moderne dans cette peinture. Mais on est vraiment au 20e siècle ici et Manguin est l’un des principaux représentants du fauvisme. Alors le fauvisme, c’est un mouvement qui prône l’utilisation des couleurs pures et vives, traitées en aplat comme c’est le cas ici, avec vraiment une simplification des formes. Et le but, c’est de conserver toutes les recherches des impressionnistes sur la transcription de la lumière grâce à la couleur mais eux ils vont aller plus loin et parfois ils séparent même la couleur de la réalité de l’objet. Un peu comme l’expressionnisme. On est vraiment sur des sensations visuelles et des émotions. Bon, c’est un mouvement qui ne dure pas très longtemps en France. Mais vous connaissez peut-être les chefs de file comme André Derain ou Henri Matisse. Voilà à présent, on va revenir vers vous pour la conclusion.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Messieurs dames, vous avez vu que les couleurs sont chargées de codes très anciens auxquels nous obéissons inconsciemment. Et on a vu que les peintres, ils avaient finalement 2 choix. Le choix en fait d’être fidèle au réel. Ils utilisent l’orange pour l’automne. Ou bien ils choisissent d’être symbolique. C’est à dire qu’ils vont utiliser le violet pour nous parler de la Nativité, Qu’on a vu tout à l’heure avec Maurice Denis.
[Marthe Pierot ] : Qui est très spirituelle. Alors il y a effectivement le choix des peintres. Et puis il y à la manière dont nous, on va recevoir toutes ces couleurs et toutes ces informations. Et ça c’est très variable en fonction de nos goûts, de notre culture, de nos références qui sont propres. Et donc c’est extrêmement subjectif. Finalement, et on l’a bien vu. La signification n’est pas figée, elle évolue dans le temps. Ainsi, certains tableaux très anciens sont perçus différemment aujourd’hui parce qu’on n’a pas les mêmes codes. Mais on peut se demander comment on peut regarder ces tableaux sans passer à côté de leur sens ?
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Absolument. Parce que c’est vrai que certains tableaux anciens sont tellement cryptés, que si on ne connaît pas ces codes, et bien on passe à côté. C’est un petit peu dommage. Mais heureusement que, à partir donc du début du 20e siècle, et bien les couleurs, on les a reçues de manière beaucoup plus spontanée. Elles nous ont émues plus directement parce qu’elles se sont débarrassées de l’érudition ou du discours intellectuel. Donc finalement on a été touchés plus directement par elles.
[Marthe Pierot ] : C’est ça. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivies pour cette conférence qui était, nous l’espérons, colorée, [énergique]. Exactement. Et on vous dit à très bientôt
[Isabelle Bâlon-Barberis] : A une prochaine fois, au revoir.
Nostre Dame de Grasse
Nostre Dame de Grasse
[Conférence en ligne sur le thème “Rendez-vous avec un chef d’œuvre – Nostre Dame de Grasse”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2023]
Marthe Pierot : Messieurs, dames, bonjour
Isabelle Bâlon-Barberis : Bonjour
Marthe Pierot : Alors nous sommes Isabelle et Marthe, les conférencières du musée des Augustins et aujourd’hui on a rendez-vous avec un chef d’œuvre.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai, on avait très à cœur avec Marthe de vous montrer aujourd’hui Notre-Dame de Grasse. Vous savez que le musée des Augustins est fermé pour travaux. Cependant il a ouvert 4 mois cet été, donc cet été 2023. Mais Notre-Dame de Grasse ne faisait pas partie de la présentation scénographique. Et beaucoup de gens nous l’ont demandé. Alors on s’est dit, il fallait, il fallait qu’on en parle.
Marthe Pierot : Oui, tout à fait. Et puis il y a d’autres raisons aussi. C’est important de vous dire que c’est une sculpture qui a une histoire très complète, complexe aussi et à la fois passionnante, avec une grande campagne de restauration qui a été organisée autour d’elle dans les années 2000. Donc on s’est dit que c’était un véritable sujet et qu’on avait de la matière pour vous en parler pendant 30 minutes. Le challenge est là. 30 Min, une œuvre, il y a de quoi dire.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, alors cette œuvre-là constitue véritablement un chef d’œuvre de la fin du Moyen Âge. Et c’est vrai que c’est un petit peu la Joconde du musée des Augustins. Il y a des personnes qui n’entrent au musée des Augustins que pour la voir. Ils peuvent ressortir parce qu’ils sont tellement comblés que ça suffit.
Marthe Pierot : Oui. Alors c’est important de vous dire aussi qu’à l’origine, elle n’était pas au musée des augustins. Elle se trouvait en fait dans l’église du couvent des Jacobins. Et puis elle est arrivée dans les collections du musée en 1805, mais elle n’a pas toujours été ici.
Isabelle Bâlon-Barberis : Donc on va parler d’une période, je vous l’ai dit, qui est la fin du Moyen Âge. On se situe entre le 13 et le 15ème siècle, voilà ce qu’on appelle la période gothique.
Marthe Pierot : Et on va vous montrer donc des visuels sous tous ces angles où on va vraiment pouvoir voir cette culture et comprendre ce qui en fait un chef d’œuvre.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est parti.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, 1460-1470, statue d’applique]
Marthe Pierot : Alors pour commencer, avant de vous présenter l’œuvre, c’était important pour nous aussi de parler des origines de Marie. Pourquoi il y a ce culte et cette dévotion autour de Marie. C’est ce qu’on appelle le culte marial. Eh bien en fait, il se développe essentiellement à partir du 3e siècle en Orient. Mais il arrive vraiment en Occident à partir du 5e siècle. Et l’appellation de Notre-Dame d’ailleurs arrive beaucoup plus tard, il faut attendre les croisades, c’est à dire le 11e siècle. Et puis voilà, cette dévotion vraiment grandit, grandit. Il y a beaucoup d’effigies dans nos églises qui rendent hommage à Marie.
Et alors pourquoi elle est si importante en histoire de l’art notamment ? On la représente beaucoup parce qu’en fait c’est un intermédiaire extrêmement important. Elle a un rôle d’intercesseur, c’est à dire qu’en fait on passe par elle pour s’adresser au Christ, et ça c’est extrêmement important. Alors on la représente en histoire de l’art avec une sorte de codes. Donc on retrouve très souvent notamment une couronne. Elle a une couronne parce qu’elle devient la reine des cieux. Alors-là elle gouverne sur la terre entire. Elle a un rôle extrêmement important, donc c’est pour ça qu’on la retrouve souvent couronnée. Mais les vierges à l’enfant ne sont pas couronnées habituellement. La notre, c’est un cas particulier, mais on y reviendra. Et puis vous avez aussi souvent un manteaux. Un manteau qui est très grand, très ample, parce que l’objectif c’est justement de déployer son manteau au-dessus des humbles et des faibles pour mieux les protéger. Donc elle a vraiment ce rôle de vierge protectrice. Et juste pour terminer, c’était important aussi de vous dire que le culte qu’on porte à Marie est vraiment lié aux catholiques et aux orthodoxes. Mais les protestants, eux, respectent Marie pour son rôle, mais ne lui voue pas en fait un culte ou une dévotion particulière. Donc on n’aura pas de représentation de Marie dans la religion protestante.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai. Alors maintenant, on va essayer de vous la décrire par le menu. Et vous voyez bien qu’elle est assise sur un banc.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Un banc de Pierre ouvragé et elle tourne un visage donc rêveur vers la gauche. Donc vous avez d’emblée ce déséquilibre des attitudes qui confère à l’ensemble de ce groupe une impression de vie et de mouvement. Et ça, c’est saisissant. Donc de la tête et des épaules, l’enfant sort de ce schéma pyramidale dans laquelle la composition vient s’inscrire. Vous voyez comme elle est élégante avec son manteau ample et blanc qui est double de fourrure dorée. Et cette fourrure, ça s’appelle le vair : VAIR. C’est comme le soulier de Cendrillon qui est en fait un soulier fait de fourrure du petit gris. C’est à dire une variété d’écureuil de Russie.
Marthe Pierot : Pas en verre comme on le voit dans Disney. Là non, on se demanderait comment elle peut marcher avec.
Isabelle Bâlon-Barberis : Donc en fait, il est intéressant de voir aussi que la robe bleue est très ajustée, donc au niveau du haut du corps, et cela met l’accent sur cette toute petite poitrine et sur les membres frêles de cette toute jeune fille qui doit avoir à peu près 14 ans. Pourquoi ? Parce que nous sommes au Moyen Âge et que être adulte au Moyen Âge, c’est avoir 14 ans. On va se marier vers 13 ans, avoir des enfants à 14 ans, on meurt jeune. Donc les étapes de la vie commencent beaucoup plus tôt, étant donné que l’espérance de vie, c’était à peu près 40 ans.
Marthe Pierot : Oui, donc le sculpteur, il avait sûrement un modèle qui devait être une jeune maman de 14 ans.
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors vous notez également l’or du galon de la robe, ainsi que la couronne qui devait être rehaussée de perles et de pierres. Parce qu’on voit des petits percements, des trous réguliers. Mais il n’y a aucune trace de colle ou de rouille.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Donc on ne sait pas si les pierres ont véritablement été placées, notamment dans ce galon de la robe. Alors notez les carnations, les teints qui sont très pâles. Et il y a donc effectivement des bandeaux de cheveux ondulés et dorés qui forment de très jolies petites boucles.
Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Les yeux sont bleus, ceux de l’enfant également avec ces mêmes pommettes rosées. Et regardez pour l’enfant, il y a cette chemise très rouge.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Le rouge a subsisté à partir d’un col vert foncé. Donc lui aussi l’enfant a un petit visage triste qui obéit aux mêmes règles que celui de sa mère, avec juste ce qu’il faut de rondeur assez attendrissante.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Alors vous notez qu’il y a comme une perte des mains. Mais c’est parce qu’en fait, les mains ont été sculptées à part à la différence des mains de la Vierge. Et la perte de ses mains constitue la lacune la plus importante du groupe. Alors on a reconstitué ces mains donc au début du 19e siècle, et puis, après délibération du Conseil municipal on les a supprimé vers les années 1930. Soit un siècle plus tard, parce qu’on s’est aperçu vraiment que restaurer une œuvre, ça n’est pas la compléter. Enfin la bouche. La bouche qui est bien dessinée. La bouche de la Vierge qui vient esquisser une jolie petite moue.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Et regardez le menton saillant avec un petit bout rond et volontaire. Le front large est plat. Le nez long, presque donc aquilin. Et vous avez donc des yeux en amande relativement espacés.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Vous voyez ses mains, ce sourcil haut placé qui composent un visage triangulaire avec des traits fins.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Tellement charmants, tellement juvéniles.
Marthe Pierot : C’est vrai que c’est très agréable de la voir de près comme ça avec tous ces zooms. Mais si on revient à son apparence générale, ce qui questionne c’est vraiment cette position.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Pourquoi il y a cette position entre ces 2 personnages, entre l’enfant qui va d’un côté et la Vierge et Marie qui regardent complètement de l’autre ? Ils se font presque dos à dos. Et là en fait, il y a plusieurs hypothèses parce qu’on n’a pas vraiment la réponse, mais on peut vous en proposer plusieurs. Et notamment, il y a une des hypothèses qui pense que cette sculpture appartenait à un groupe. Qu’elle était au cœur d’un groupe. Et par exemple, il y avait les Rois mages à côté de l’enfant Jésus. C’est ce qu’on appelle l’adoration des Mages. C’est quand les Rois mages viennent rendre visite à l’enfant pour lui apporter des cadeaux. Si on a élaboré cette hypothèse, c’est parce qu’il y a d’autres vierges à l’enfant dans la région, et notamment sur un tympan d’une église à Toulouse, l’église Saint Nicolas. Et en fait, on vous le montre ici, on a donc une vierge à l’enfant et il y a les Rois mages d’un côté. Et puis il y a Joseph qui regarde la scène de l’autre côté.
[Illustration : Tympa de l’église Saint Nicolas]
Ce qui pourrait justifier peut être un tiraillement entre les 2 personnages. Parce qu’il y a beaucoup d’animation autour d’eux. Sauf que quand on observe ce visuel, on s’aperçoit en fait que l’enfant est attiré d’un côté, mais que la Vierge ne se tourne pas quand même. Donc voilà, on n’est pas tout à fait sûr de de cette hypothèse, mais c’est quand même intéressant de pouvoir observer ce qui se fait en même temps autour.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, alors on peut apporter une autre explication à ce côté écartelé. C’est vrai qu’elle semble se détourner de son fils pour ne pas lui montrer à l’avance et bien la souffrance, le chagrin qu’elle ressent. Elle ne peut pas se réjouir du bonheur d’être mère parce qu’elle sait ce qui va se passer. Et on a envie dans ce sens et bien de parler de l’autre élément de cette composition. Il y a la mère, il y a l’enfant, mais il y a un objet. Et cet objet c’est le livre. Et c’est le livre qui lui révèle peut être la suite de l’histoire.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Donc ce livre qu’elle tient sous son bras est ce que c’est une bible ? Et il y a là un brouillage chronologique. Parce qu’il est évident que quand Marie à son enfant dans les bras, son histoire n’est pas encore écrite. Mais l’œuvre a été réalisée bien plus tard. Et là on a l’impression que le sculpteur aime ce brouillage chronologique justement. Il est intéressant de dire également que tout semble accablant pour Marie, dans la mesure où la couronne est trop grande et que le manteau est trop lourd.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Marthe Pierot : Donc elle est vraiment triste et tout semble trop lourd pour ses épaules finalement. Alors on a envie aussi de se questionner sur sa provenance. On va essayer de décrypter un petit peu les mystères qu’il y a autour de Nostre Dame de Grasse, parce qu’il y en a des mystères, et on ne va pas répondre à tous. Et on vous l’a dit en introduction, à l’origine elle n’était pas au musée des Augustins. Elle se trouvait au couvent des Jacobins. Vous avez dans l’église, cette colonnade et puis vous avez une chapelle axiale, qui est la chapelle principale du chœur au bout de ces colonnes.
[Illustration : Vue de l’intérieur du couvent des Jacobins]
Et c’est là que se trouvait Nostre Dame de Grasse jusqu’en 1805 où elle arrive au musée des Augustins. Mais alors les questions que l’on se pose et les questions sont multiples. A-t-elle été faite pour être placée là ? Ou a-t-elle été réalisée et surtout par qui ? et pour qui ? et à quel moment ? On va essayer de répondre un petit peu à tout ça petit à petit, avec quelques indices qui se cachent dans l’œuvre.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui alors on avait envie de sauter de joie quand on s’est dit qu’il y avait du texte sous la sculpture et qu’on s’est dit qu’à partir de là, on allait tout comprendre et on allait tout savoir.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Mais vous allez voir, c’est pas si simple. Parce qu’il est noté au bas de son manteau et bien l’inscription Nostre Dame de Grasse. Alors les grasses, revenons sur ce terme. Ce sont les prières que les fidèles adressent à Marie, en espérant d’elles qu’elles soient l’intermédiaire idéal pour les transmettre à son fils, comme Marthe vient de vous le dire. Alors on sait qu’on a beaucoup de chance d’avoir cette inscription. Mais on peut être étonné dans la mesure où c’est là de la langue d’Oïl qui est utilisée. Ce qui nous éloigne d’une idée de la France. Si ça avait été de la langue d’Oc ou encore de l’occitan, on aurait eu non pas Notre Dame mais Nostra Dòna. et non pas de Grasse mais de gràcia. Donc en fait ici on n’a pas l’occitan. Et c’est vrai que ça nous plonge dans beaucoup de réflexions. Alors l’inscription a en effet sans doute été souhaitée et composée par le commanditaire. Mais on ne sait pas qui l’a commandé. Donc on n’est pas renseigné. Mais on peut aussi se dire, on peut très bien imaginer qu’un toulousain ayant commandé cette œuvre, un toulousain de souche est choisi la langue du roi. Ca aussi on peut se le dire. Donc voilà, on avance pas vraiment avec cette belle inscription.
Marthe Pierot : Et c’est encore plus compliqué parce que regardez, au centre, il y a en fait ce qui a la forme d’un blason, d’un écusson. Et donc dessus il y avait les armoiries du commanditaires très probablement. Donc on aurait pu trouver les commanditaire et donc là résoudre beaucoup de mystères. Et bien non, la révolution est passée par-là et après 1793, on détruit vraiment toutes ces armoiries. Il y a ce qu’on appelle le vandalisme révolutionnaire et tous les emblèmes qui sont caractéristiques de l’ancien régime avant la révolution ont été complètement détruits et bûchés. C’est comme ça que l’on dit. Donc on ne peut pas savoir qui est le commanditaire.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Par contre, on s’aperçoit qu’aux extrémités de l’écriture, il y a ce qui ressemble vraiment à une croix occitane. On reconnaît avec les petites boules sur le côté, donc on comprend bien qu’il y a un lien en tout cas avec la région.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Et puis autre indice possible, les motifs sur la chemise de livre. Parce qu’en fait ce que vous voyez-là, ce livre dont Isabelle vous a parlé, et bien il y a une chemise, une sorte de protection qui le recouvre, qui est en cuir, qui est fermé avec ses attaches, ses ferrures. Et puis on voit que c’est très tendu au début et très souple vers la fin. Et il y avait des motifs qui étaient peints dessus. Et souvent ça peut nous aider et nous donner des indications sur le lieu de création quant à ce qui se faisait selon une région ou une autre. Et bien non. Figurez-vous que ce n’est pas caractéristique d’une région. Ces motifs là, on les trouve très fréquemment dans l’enluminure et la peinture des Pays-Bas jusqu’à l’Italie. Donc un peu partout. Donc ça non plus, ça ne nous aide pas.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Isabelle Bâlon-Barberis : Voilà. Alors en fait, des scientifiques s’accordent à dire, qu’elle daterait des années 1460-1480. Parce qu’ils considèrent qu’il y a cet extraordinaire développement de ces drapés. Qui est tout à fait représentatif de la fin du 15e siècle. Parce que plus tard, les drapés sont représentés beaucoup plus fins, beaucoup moins encombrants. Voilà ce que l’on voulait vous dire.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”]
Donc Nostre Dame de Grasse à l’aspect d’une jeune femme avec des habits de cour. Et ça aussi c’est important pour la datation. Parce que justement, jusqu’au milieu du 13e siècle, la dame est idéalisée, elle est pure. Les chevaliers combattent pour leur dame et le roman courtois nous parle de l’élégance de ces figures tout à fait irréelles. Ça fait partie des sources qui nous aident à comprendre un petit peu pourquoi elle est à ce point idéalisée.
Marthe Pierot : Oui tout à fait. Donc grâce à ces details-là on peut imaginer une date. Donc vraiment on est à la 2e partie du 15e siècle. Voilà, mais l’enquête continue. Je ne croyais pas que ça s’arrête-là parce qu’on ne trouve pas le commanditaire. Bon, on a à peu près une date de réalisation, très bien. Mais qu’en est-il de l’auteur finalement ? Et ça c’est vraiment important parce qu’on s’aperçoit grâce à des analyses stylistiques qu’il y a une curieuse conjonction d’influence entre un courant meridional, un courant du Sud et une manière de faire typique du centre de la France. On le voit vraiment avec cette noblesse et cette gravité dans les expressions. On va le détailler un petit peu plus. Mais c’est important de vous dire qu’à une époque, ce n’était pas possible de laisser un chef d’œuvre anonyme. Il fallait absolument trouver un auteur. Donc on a avancé plusieurs noms pour essayer de résoudre un petit peu l’enquête et le mystère. Et notamment on a un moment parlé de Jacques Morel. Alors Jacques Morel, c’est un sculpteur qui a beaucoup voyagé. Il est passé par de nombreuses villes, à Lyon, à Montpellier, mais aussi à Toulouse dans les années 1425 à peu près. Et il a œuvré aux Jacobins à ce moment-là. Donc en fait on se dit que c’est super, ça tombe très bien. Et en plus on décèle des points communs avec d’autres œuvres, notamment des gisants.
[Illustration : Jacques Morel “ tombeau de Charles 1er, duc de Bourbon et Agnès de Bourgogne”, XVème siècle]
Il y a des gisants qui sont les gisants de Charles de Bourbon et d’Agnès de Bourgogne qu’on vous montre ici. Qui se trouvent dans une église en Auvergne Rhône Alpes. Et en fait on peut créer des rapprochements par rapport aux drapés dont on vous a un peu parlés tout à l’heure. Regardez la souplesse dans le traitement du tissue du manteau aux multiples ondulations. Donc là on se dit que finalement il y a un point commun et que ça peut marcher. Mais le problème, Isabelle vous l’a dit, on a daté Nostre Dame de Grasse de plutôt la fin du 15e siècle. Et en fait ce Jacques Morel était à Toulouse plutôt au début du siècle. Donc finalement ce n’est pas compatible et ça ne marche pas.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors, il se trouve qu’on avance un autre nom qui est celui de Pierre Viguier. C’est un sculpteur enraciné dans la région, toulousaine. Et il a été l’élève de Jacques Morel dont Marthe vient de vous parler. Et d’ailleurs il aurait travaillé avec lui à la cathédrale de Rodez. On est en Aveyron au milieu du 15e siècle. Et il serait l’auteur en Aveyron, de choux fries, qui sont ces petites feuilles que vous avez de part et d’autres du blason.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Des petites feuilles qui sont très dentelées. Qui sont très serrées. C’est vraiment un motif de sculpture que l’on retrouve à la Chartreuse de Villefranche de Rouergue. Et donc ce sont à peu près les mêmes que l’on retrouve à la base de Nostre Dame de Grasse.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”]
Mais ces décors végétaux sont fréquents à cette époque et il existe donc pas d’œuvre de référence qui permet d’identifier clairement le style de Pierre Viguier. C’est donc important de dire aussi qu’il existe au Moyen Âge des artistes qui travaillent en corporation. Il y a des dynasties, il y a des ateliers et il y a beaucoup de monde à l’intérieur de ces groupements.
Marthe Pierot : Oui, c’est pas possible de détacher un nom finalement ? En tout cas, il est évident de dire que Nostre Dame de Grasse s’inscrit vraiment dans le cadre d’une production locale diversifiée. Parce que comme on vous l’a dit tout à l’heure, on sait qu’il y a un foyer artistique toulousain très présent et qui aurait pu œuvrer à sa création. Mais il y a aussi des références stylistiques qui appartiennent aux ateliers bourguignons. En fait, la sculpture bourguignonne se développe beaucoup entre le 14e et le 15e siècle et elle a été très marquée par tous les ateliers d’artistes qu’il y avait autour du duc de Bourgogne qui était très important. En fait, il était aussi puissant qu’un roi à cette époque. Donc tous les artistes affluaient autour et ça a donné vraiment un style très particulier. Les caractéristiques sont vraiment un petit peu semblables à Nostre Dame de Grasse, c’est à dire qu’il y a beaucoup d’œuvres qui représentent de la douceur, de la sérénité, des attitudes émouvantes. Et puis on retrouve dans la sculpture bourguignonne ces étoffes très épaisses, des ondulations amples, des plis souples et généreux, des têtes inclines parfois, des visages triangulaires. Une forme de mélancolie aussi dans les visages. Donc on pourrait se dire que ça marche.
[Illustration : Claus de Werve “ Vierge à l’enfant”, XVème siècle]
Et en fait, ce qui est intéressant, c’est de voir une sculpture réalisée ou attribuée à Claus de Werve, qui est un artiste hollandais, mais qui s’est installé en Bourgogne au 15e siècle et qui nous propose une vierge à l’enfant. Ici on retrouve des caractéristiques similaires finalement. C’est à dire cette douceur entre les 2, ces émotions qui sont très développées. On a une vierge assise sur un banc. Regardez la manière dont tombent les plis. Ils sont parfois anguleux, parfois très ronds. Donc en fait on retrouve des choses qui sont assez semblables. Le livre aussi qui est de nouveau là. Mais par contre il y a des choses qui sont différentes par rapport à Nostre Dame de Grasse. C’est que là elle n’est pas couronnée. Elle est beaucoup plus âgée et surtout il n’y a pas l’opposition entre les 2 personnages.
Isabelle Bâlon-Barberis : Et oui. Donc en fait cette œuvre, véritablement, ce qui fait d’elle un chef d’œuvre, c’est que cette extrême douceur, et bien on a envie aussi de la rattacher à la renaissance italienne. Donc c’est vrai que les œuvres de Botichelli datent à peu près de cette fin du 15e siècle. Et c’est vrai que notre sculpteur en France est en avance parce qu’on est très loin, vous voyez, de la dureté des traits, de la gravité des traits des sculptures du Moyen Âge. Ici, il y a cette beauté idéale. Cette beauté qui est de grâce immatérielle. Et vous avez ici des éléments qui sont très travaillés, comme les cheveux qui sont ciselés.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Et autour des yeux et de la bouche en particulier, vous avez énormément de finesse, je dirais même de délicatesse.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Regardez les longs doigts effilés. Regardez cette ossature qui est finement notée au niveau des phalanges.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Le morceau de bravoure étant le traitement de drapés de la robe et du manteaux.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Vous avez à la fois une manière de creuser dans le calcaire profondément.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Et puis parfois, vous avez ces plages beaucoup plus lisses, comme sur les genoux de la Vierge.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Donc non, il y a cette alternance entre quelque chose de très vehement et quelque chose de très moelleux à la fois.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”]
Donc j’ai dit que c’était du calcaire. C’est important de parler bien sûr de cette matière. Donc on voit bien que le sculpteur fait preuve d’une maîtrise exceptionnelle à creuser profondément le calcaire. Et on voit très bien aussi les traces laissées par les outils. Volontairement d’ailleurs. Donc on a des mains très lisses.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Mais quand il s’agit de traiter de la fourrure comme c’est le cas ici, vous voyez ces gouges qui viennent s’enfoncer dans cette matière calcaire.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Et vraiment quand on la voit ici de dos, parce qu’il faut bien dire que c’est ce groupe sculpté est fait pour être montré de face. Le dos n’était pas du tout abouti. On voit quand même ces passages de ce qu’on appelle les gouges ou autres ciselés. Donc tout ça pour dire que ce groupe sculpté dans l’attitude, dans le drapé annonce des temps nouveaux. On est vraiment à la fin du 15e siècle et on sent très bien que le Moyen Âge lâche.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”]
Marthe Pierot : Oui exactement. Et alors c’est intéressant de vous parler de l’histoire de sa restauration parce qu’on vous a montré des photos où elle est magnifique, elle est sublime. Mais elle n’a pas toujours été comme ça et d’ailleurs on a un des photos de comment elle était avant. Attention les yeux.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse” – avant restauration]
Regardez Nostre Dame de Grasse, là on se dit qu’il y a eu du travail.
parce qu’on voit qu’elle a des croûtes noires partout sur le visage. C’est assez impressionnant de la voir comme ça.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse” – avant restauration]
Même l’enfant, l’ensemble, tout était noir parce que elle n’était pas forcément dehors, mais elle était exposée dans des galeries qui étaient ouvertes où il n’y avait pas de vitres et donc finalement elle était peut être protégée de la pluie, mais pas du tout de la pollution ou de la pollution atmosphérique. Il a vraiment fallu attendre quand elle était au musée, les années 1930 pour qu’on mette des vitres au niveau des baies où elle était exposée pour enfin fermer la salle. Non, même pas 1930, 1980. Vous imaginez, il y a pas si longtemps que ça qu’on l’enferme pour pouvoir la protéger de l’air et de la pollution, des variations climatiques. Mais bon, le mal était déjà fait. Elle s’était retrouvée complètement noire, illisible.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse” – avant restauration]
Et donc, on a eu envie de la restaurer, évidemment. Alors il faut savoir que sa restauration est très complexe. Déjà, pendant tout le 20ème siècle, il y a eu plein de tentatives de nettoyage, mais pas avec les bonnes techniques. Du brossage, du grattage, mais qui n’ont fait que contribuer à la perte de la polychromie de l’œuvre.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse” – avant restauration]
Et il a fallu attendre 2002 pour qu’une équipe de scientifiques, un peu les sauveurs, arrivent et proposent une restauration très très précise qui va durer entre 2 et 3 ans, avec toute une équipe, beaucoup d’acteurs qui seront impliqués. Les conservateurs du musée de Louvre, les conservateurs des Augustins, mais évidemment aussi des membres du centre de restauration et de recherche des musées de France, qu’on appelle le C2RMF. C’est un centre extrêmement important, des spécialistes de la Pierre et de la Polychromie. Bref, tout ce grand comité s’est réuni pour proposer une restauration, avec les restaurateurs aussi du musée. Et donc ça, c’était très important parce qu’on a pu avoir des précisions sur l’œuvre.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse” – détail de restauration]
Grâce à ça, on a pu retrouver la polychromie d’origine et on a surtout découvert qu’il y avait eu plusieurs repeints. Elle a été repeinte plusieurs fois et ça on va vous en parler.
Isabelle Bâlon-Barberis : Mais il est vrai qu’on l’a montré régulièrement en cours de restauration. C’est pour ça que comme sur cette photo que vous pouvez voir, on a donc une phase avant après que l’on a montré régulièrement au public. Alors c’est vrai qu’on peut à présent s’appuyer sur ce dessin.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse” – dessin coloré]
Ce dessin qui est très coloré mais qui vous donne une idée très fidèle de ses couleurs d’origine. Vous voyez comme les contrastes sont importants avec une saturation des couleurs, parce que dites vous bien que les églises n’étaient pas éclairées par l’électricité, quelques bougies, quelques cierges parfois. Et donc on les couvrait de couleurs pour qu’on puisse les voir un peu dans ce contexte obscur. Donc c’est vrai que vous notez le manteau qui est blanc uniformément. Voyez le décor de perles de l’encolure orné de pierres ou de verres colorés. Et puis il y avait des petites étoiles dorées sur la robe bleu avec d’autres dorures qui sont les dorures des cheveux, du livre ou de la couronne. Et notez ce teint très pâle rehaussé de joue rose, avec également une gamme qui est le bleu, blanc, or pour la Vierge. Ca c’est une tradition du Moyen Âge.
Marthe Pierot : Oui. Donc en fait c’était vraiment important de vous montrer ce dessin qu’il nous propose finalement ses couleurs d’origine.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui tout à fait, c’est vrai. Et il y a, comme Marthe vous l’a dit, 4 repeints. Pourquoi est ce qu’on se met à la repeindre ? Ça correspond entre le 16ème et le 18ème siècle à des rénovations architecturales de l’ensemble du couvent des Jacobins. Le couvent voulait faire peau neuve. Alors on allait ripoliner un petit peu toutes les œuvres qui se trouvaient dedans. Voilà.
Marthe Pierot : En fait on va voir que finalement on n’a pas toujours été fidèle à ces couleurs-là. Et ce qui est intéressant c’est qu’on va vous montrer des simulations faites par ordinateur qui reproposent les couleurs. Parce que quand on a restauré, on a gratté et on a enlevé les différentes couches picturales. On s’aperçoit vraiment tout ce qui a été réalisé effectivement depuis le 16ème siècle.
Isabelle Bâlon-Barberis : Voilà, c’est tout un ensemble de strates que l’on va comprendre. Alors premier repeint.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, premier repeint]
Marthe Pierot : Voilà le premier repeint, c’est au 16e siècle. Donc en fait on se rend compte que c’est juste après sa réalisation, 50 ans après sa réalisation. L’idée c’est peut être juste et bien un peu de la repimper, de nettoyer finalement un petit peu peut être la peinture, mais de garder la même gamme chromatique. C’est juste raviver la polychromie d’origine. Quand on dit polychromie, c’est le terme scientifique pour parler de couleurs bien sûr. Mais c’était peut être un nettoyage un peu agressif qui a contribué à abîmer l’ancien. On s’aperçoit aussi que les étoiles ne sont pas reprises, on les distingue à peine. Donc voilà, c’est des choix qui ont été faits parfois. Et puis la carnation est refaite, mais un peu plus marquée. Les joues sont plus roses. Il y a des rehauts beaucoup plus puissants ici, de couleurs. 2ème repeint.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, 2ème repeint]
Isabelle Bâlon-Barberis : Voilà 2ème repas. Nous sommes cette fois au 17ème siècle. Et là il y a une rupture stylistique avec les couleurs d’origine. Puisque le manteau de la Vierge de blanc, il devient rouge. La tunique de l’enfant de rouge, elle devient jaune pâle. Le livre en fait, il est traité de 2 manières différentes. Ce qui fait comprendre que justement cet objet n’était pas bien compris, puisque finalement il n’a pas les mêmes motifs d’un côté à l’autre.
Marthe Pierot : Alors que l’on avait dit, c’est une chemise de livre. C’est vraiment unique.
Isabelle Bâlon-Barberis : Voilà. Une chemise de livre, c’est intéressant de de préciserc que si la partie qui est sous le bras de la Vierge est flottante, c’est que le livre il était porté en le glissant sous la ceinture. Donc on pouvait marcher en ayant un livre sur soi. Voilà je ferme la petite parenthèse. Donc c’est important de vous dire également que le visage de la Vierge est beaucoup plus orangé, donc dans ce 2ème repeint. C’est pas fini.
Marthe Pierot : Et ça continue. Et attention encore les yeux, parce que là c’est très flashy.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, 3ème repeint]
Là, la modification est considérable. On s’éloigne encore plus des couleurs. Là, on se retrouve avec des bandes rouges et vertes sur la housse du livre et la tunique de l’enfant. Comme si c’était le même tissu. Donc c’est un petit peu intéressant. Il y a un quadrillage aussi sur le revers du manteau de la Vierge. Et puis on a aussi un maquillage qui est beaucoup trop fort. Des lèvres peintes en rouge vif et un trait noir qui borde ses paupières supérieures et des sourcils très foncés. Donc là elle change complètement.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, 4ème repeint]
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui. Et il se trouve qu’il y a un dernier et 4ème repeint au 18e siècle, dans la seconde moitié du 18e siècle. On peut le dire parce qu’on a découvert le bleu de Prusse et on sait qu’il apparaît à ce moment-là en France. Ce pigment donc n’apparaît précisément que vers 1715. Donc ça nous permet de dater ce 4ème repeint. Cette fois-ci la palette de couleurs est bien plus restreinte. Il y a ce gris blanc, l’ocre jaune, le bleu et le brun. Et la volonté de revenir à certainement ces couleurs d’origine, mais en moins en beaucoup moins délicat. Puisque vous avez donc une robe bleue, un manteau blanc, une doublure jaune qui remplace l’or et des yeux brun noir avec d’épais sourcils marron en forme de fer à cheval, ce qui durcit complètement les traits du visage. Et enfin, et ça c’est le clou du clou, la Vierge devient brune et l’enfant aussi. Donc une polychomie qui est tout à fait simplifiée. Mais cette nouvelle couche de peinture ne fait qu’alourdir l’œuvre. Et c’est vrai que ça vient épaissir ce groupe et on a des effets d’empattement que l’on pouvait profondément regretter.
Marthe Pierot : Mais en tout cas, on voit que selon les modes, la Vierge a un tout autre look à chaque fois. Alors le choix de la restauration justement ? Et bien c’était quand même d’enlever tous ces repeints qui sont très maladroits et de revenir à la polychromie originale. Déjà on s’est aperçu qu’elle était très adhérente sur la pierre. Peut-être que les multiples repeints ont protégé la polychromie d’origine. Et donc finalement c’était possible de retrouver la première couleur qui était vraiment la palette chromatique médiévale. Mais bon, comme on vous l’a expliqué, c’est une restauration qui a été très longue. Il y a eu beaucoup d’interventions : scalpel, solvant, loupe binoculaire, laser. Bref, tout a été fait, mais c’était important évidemment de faire une belle restauration. Mais on vous l’a dit, quand on a parlé des mains de l’enfant, on ne recrée pas quand on restaure, on n’a pas repeint non plus par rapport à comment c’était au début. C’est important dans une restauration de respecter un code déontologique très strict qui dit que tout doit être réversible. On peut, on doit pouvoir enlever ce qui a été fait, si à un moment on change de de méthode. Il y a une volonté de compatibilité avec les matériaux qu’on utilise. Il faut faire attention d’utiliser des matériaux qui ne vont pas altérer la pierre ou abîmer encore plus la polychromie. Donc c’est un vrai travail de chimiste. Et puis il y a la volonté de rendre l’œuvre plus lisible, c’est le but. Il faut vraiment créer une unité esthétique. Mais on ne complète pas, on ne refait pas, on harmonise finalement.
[Illustration : “ Vierge à l’Enfant : Nostre Dame de Grasse”, détail]
Isabelle Bâlon-Barberis : En tout cas, vous avez son extrême sensibilité. Son modelé qui lui a été restitué suite à ces belles restaurations. Mais il faut dire que avant les restaurations, même sous les 4 couches de peinture et sous la crasse, elle était émouvante, elle nous touchait quand même. Donc suite à cette restauration, bien sûr, elle est rayonnante. Et elle est cette œuvre majeure des collections du musée des Augustins. Elle est une des plus belles vierges gothiques qui soit. Alors pour conclure.
Marthe Pierot : Oui, on a quelques points juste pour terminer cette conférence et c’était important de vous dire que quand même, avec Isabelle, on a un petit peu enquêté pour trouver d’autres vierges à l’enfant assez semblables à la nôtre. ET bien il y en a pas tout simplement. Nul n’a son innocence, sa douceur, sa fragilité et aucune autre vierge à l’enfant ne trouve cette position d’opposition complètement, on peut le dire vraiment. Ce mouvement où tout les oppose. On a l’impression en fait d’avoir une mère qui est déjà fatiguée et épuisée par son enfant. C’est peut être une manière assez moderne de nous parler de la maternité finalement, et c’est ça qui nous touche.
Isabelle Bâlon-Barberis : Et donc c’est tout à fait ce qui la rend unique. Alors on ne sait pas qui était le sculpteur. Maintenant vous êtes au fait. Mais c’est vrai qu’on peut se dire qu’il a pris des risques. Il était un petit peu en roue libre, au risque peut-être même de déplaire parce qu’on ne sait pas comment l’œuvre a été reçue à la fin donc du 15e siècle. Et c’est vrai qu’il a cette audace de nous la montrer pleine de troubles. Alors qu’on imagine une vierge sereine, stable. Or là, il nous parle comme s’il nous parlait d’une nouvelle histoire. Une vierge qui est pleine de troubles, qui est pleine de doutes, et c’est vrai qu’il nous la montre terriblement humaine. On a eu la chance aussi de pouvoir s’appuyer sur les très belles photos de Daniel Martin et on tenait à vous le dire.
Marthe Pierot : Oui, parce qu’on a pu voir vraiment Nostre Dame de Grasse sous tous ses angles, avec des zooms assez extraordinaires, et ça c’était important. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivies. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine conférence.
Isabelle Bâlon-Barberis : À bientôt
Marthe Pierot : Au revoir.
Toulouse-Lautrec
Toulouse-Lautrec
[Conférence en ligne sur le thème “Henri de Toulouse-Lautrec, une vie de bohème”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2022]
Marthe Pierot : Bonjour à tous.
Isabelle Bâlon-Barberis : Bonjour.
Marthe Pierot : Bienvenue pour cette conférence en ligne qui aujourd’hui va traiter de Toulouse-Lautrec.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, c’est un enfant du pays avec un thème que nous avons choisi et nous l’avons intitulé : “Une vie de Bohème”.
Marthe Pierot : Oui, vous allez bien comprendre pourquoi. Mais comme dit Isabelle, c’est un enfant du pays parce qu’il est né à Albi. C’est tout proche d’ici de Toulouse. Il vient d’une famille très noble, d’une famille aristocratique. En fait il est le descendant de la grande lignée des célèbres comtes de Toulouse. Son père Alphonse était un comte, mais c’était un homme très excentrique. Il n’était pas très souvent avec son fils et il aura beaucoup de lubies, dont Toulouse-Lautrec héritera. En revanche sa mère, elle, va s’occuper seule de son fils, son seul fils vivant qui lui reste. Elle sera un petit peu oppressante. Elle lui fournit une éducation très stricte qui va l’étouffer et on comprendra pourquoi par la suite, il choisit de s’échapper un petit peu de cette ambiance.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, mais quand on parle de Toulouse Lautrec, il est évident que l’on ne peut pas ne pas parler de cet épisode tout à fait tragique dans sa vie qui est cette maladie qu’il a contracté très jeune. Pour comprendre cela, il est important de dire que ses parents étaient cousins germains, il y avait cette consanguinité qui, bien sûr, aura des conséquences biologiques désastreuses. Pour garder les biens – que ce soient des domaines, des châteaux – dans les familles nobles, l’on avait tendance à se marier entre soi. Toulouse-Lautrec va avoir tôt l’envie de quitter Albi, où ses parents ne s’étaient pas mariés par amour. Ce mariage était un mariage de convenance et il a vite rejoint la gaîté parisienne.
Marthe Pierot : Oui, tout à fait. Vous allez bien comprendre que Toulouse Lautrec est le peintre de la modernité. Il touche à beaucoup de techniques et c’est ça qui fait sa singularité. Il ne hiérarchise pas les genres. Il fait aussi bien de la peinture que de l’estampe, ou alors de la lithographie, du vitrail ou même de la photographie. On lui connaît par exemple 31 affiches publicitaires. C’est le précurseur de l’affiche publicitaire du 20e siècle. Mais il va réaliser 361 estampes avec toujours un trait très élégant et expressif, ça aussi c’est assez fort. Mais il va toucher à beaucoup de techniques différentes et c’est tout à fait intéressant de s’en rendre compte. Même la lithographie par exemple, on va beaucoup en parler. Mais sa fin de sa vie est faite de plaisir et d’alcool, et tout ça va altérer un petit peu sa santé. Il a beaucoup de délires, des crises de paranoïa à la fin de sa vie et même parfois des crises de paralysie. Il meurt très jeune à l’âge de 37 ans. On va commencer par le premier visuel.
Isabelle Bâlon-Barberis : Visuel qui n’est pas peint par Toulouse Lautrec.
[Illustration : Henri Rachou, “Portrait du peintre Henri de Toulouse-Lautrec”, 1883, peinture]
Marthe Pierot : Tout à fait.
Isabelle Bâlon-Barberis : Voilà ici un tableau du peintre Henri Rachou qui a été réalisé en 1883. C’est le portrait qu’il fait d’Henri de Toulouse Lautrec. Là nous avons un joli jeune homme qui avait néanmoins très tôt la hantise de ressembler un jour à Cyrano de Bergerac. Par la suite, Henri de Toulouse-Lautrec dira, que son visage enlaidissait de jour en jour. Mais il est important aussi de revenir sur ses difformités physiques. Et de dire que à l’âge de 13, puis de 14 ans, il tombe et ses jambes vont se briser. Il ne grandira plus et il va mesurer 1m52. Cette difformité physique, cette difficulté à vivre son corps, va le pousser à se jeter dans le tourbillon des plaisirs de la belle époque pour oublier cette infirmité. Indépendamment de sa maladie, il possède un talent évident pour le dessin dès son plus jeune âge. Dans sa famille, son père, ses oncles et ses cousins : tout le monde dessinait. Sa santé fragile va l’obliger à rester très souvent allongé. Alors, il dessine tout ce qu’il peut : les chevaux, les chiens, les gens. Il est important de dire que Toulouse-Lautrec avait dès l’enfance rejoint un grand lycée parisien. C’est le fait d’être un enfant bien né. Par la suite, il va entrer aux beaux Arts de Paris, mais trè vite cet enseignement académique ne lui convient pas. Il dira : “ma racine est dans la rue”.
Pour en revenir à notre tableau : Rachou admirait beaucoup Toulouse-Lautrec. Il aimait l’homme, mais si il admirait l’artiste, il n’appréciait pas forcément les choix d’Henri de Toulouse-Lautrec. Rachou sera même jaloux de la gloire posthume de Lautrec. Rachou a donné quatre tableaux au musée des Augustins et ce sont les tableaux que nous possédons toujours aujourd’hui. Important de dire qu’il a été conservateur du musée des Augustins pendant la première moitié du 20e siècle.
Marthe Pierot : Ce qui n’est pas rien, c’est intéressant.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait.
Marthe Pierot : Alors pour en revenir au tableau que vous avez sous les yeux et bien là, il représente un Toulouse-Lautrec très jeune qui a à peine 18 ans. Regardez, on le voit bien avec ce visage lisse et plein, très poupin. Il est soigneusement vêtu, on l’imagine tout à fait respectueux avec encore tous ses codes de bonne conduite qu’il a hérité de son éducation très stricte dont on vous a parlé au début avec sa mère. Henri Rachaud, qui est donc un peintre toulousain, était très proche de Toulouse-Lautrec. Ils avaient 13 ans de différence d’âge mais malgré ça, ils nouaient une très belle amitié. Toulouse-Lautrec va même habiter chez Rachou pendant un moment. Ils étaient très proches et on le comprend bien quand on voit ce portrait avec toute la tendresse qu’a eu Rachou de représenter Toulouse-Lautrec assis pour justement minimiser ses jambes trop courtes. Mais nous sommes dans un portrait extrêmement traditionnel, parce que Rachou est un peintre conventionnel. On a tout dans la tradition du portrait de l’artiste. La palette à la main, il pose gentiment dans l’atelier de Rachou et malgré tout – même si c’est assez conventionnel – sachez qu’il y a un petit clin d’œil. Toulouse Lautrec pose – ou semble poser – sa tête sur une sculpture : la sculpture d’une femme nue. Et avec ça finalement Rachou s’est un petit peu amusé. Peut être pour nous parler en fait de la vie de Toulouse-Lautrec qui, à cette époque déjà, aimait les cabarets et les maisons closes. Nous avons ici ce petit clin d’œil amusant malgré tout.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Notre second visuel est là.
[Illustration : Henri de Toulouse-Lautrec, “Conquête de passage”, 1896, huile et craie sur papier collé sur toile]
Isabelle Bâlon-Barberis : Nous avons une œuvre de Toulouse-Lautrec qui s’intitule “Conquête de passage”, réalisée en 1896. Il s’agit d’une œuvre réalisée sur du papier collé sur la toile. Lautrec utilise à la fois de l’huile et de la craie. C’est une étude préparatoire qui va servir à la réalisation d’une série de lithographies. Il y avait un album de 11 lithographies en couleurs qui nous parlait de la vie intime des courtisanes. Cette série s’appelait Elles. Elles, au pluriel. Concernant les femmes : Henri de Toulouse-Lautrec est tout à fait fasciné par la vie nocturne, où il les rencontre. Nous sommes à Montmartre, dans ce monde des plaisirs débridés de Paris : un univers véritablement aux antipodes de celui de son enfance pieuse. Lautrec est attiré par ces lieux où l’on danse, où l’on chante, par ses cabarets. Il a envie de nous parler de la réalité quotidienne des prostituées. Qu’elles soient buveuses d’absinthe ou également de ces femmes qui sont de simples blanchisseuses. Il porte toujours sur elles toujours un regard tendre, respectueux, sans jugement. Il les considère véritablement comme dignes d’être portraiturées. C’est vrai que cela est un sujet assez révolutionnaire. Mais déjà d’autres artistes représentaient ces femmes. Je pense à Degas, à Baudelaire et à Zola. Ce sont des thèmes qu’ils traitaient eux aussi déjà. Ici, vous avez cette femme debout, de dos, face à son miroir, en train de lasser son corset. Elle occupe presque tout l’espace de sa silhouette massive. À droite, un jeune homme imberbe est assis. Donc il y a la beauté d’un trois-quarts dos. La beauté d’une taille fine, d’un coude, d’un profil perdu. C’est une femme dont les formes fascinent Toulouse-Lautrec. Il va avoir à cœur de fixer soigneusement un très court instant, un instant qui l’émeut. Et voyez celui où elle resserre les coudes pour ajuster son corset. Le reste de son corps est esquissé à grands coups de pinceau parce que l’objet de la convoitise de Lautrec, c’est juste le milieu de son corps. Et ça c’est traité avec beaucoup de précision. Par contre le jupon est juste suggéré à larges coups de pinceau et de craie. Le reste du tableau est brossé vite.
Marthe Pierot : Justement, Isabelle vous parlait de cet homme. Regardez-le, il est vraiment relégué au bord – il sort presque de la composition – mais c’est intéressant de voir à quel point il est imperturbable devant cette femme. Son visage est véritablement abouti alors que le reste est esquissé. Mais comme il a voulu faire avec le corset et le jupon de la femme, Toulouse-Lautrec détaille ce visage pour insister sur ce regard. Ce qui est important c’est le regard de cet homme qu’il porte sur cette femme. Il scrute ses moindres faits et gestes, il n’en perd pas une miette. Ceci est très particulier : dans toutes les lithographies qu’il va représenter pour cet album dont vous a parlé Isabelle – Elles – et bien c’est la seule où il y a unhomme qui est présent ici. Après, il n’y aura vraiment pas d’hommes. Mais finalement Toulouse-Lautrec nous en parle parce qu’il a envie de souligner une opposition qui est importante : l’opposition de cet homme noble, très guindé. Regardez la manière dont il est habillé. Il vient d’une bonne famille – comme Toulouse Lautrec finalement – et il le met en opposition avec cette femme. Cette femme qui est libre, qui est dévêtue et qui appartient à une tout autre classe sociale. Finalement, Toulouse-Lautrec a envie, en tant que rejeton d’une noble famille lui aussi, de nous dire combien il sait -et il est bien placé pour savoir- combien de sensualité ou de désir se cache sous la façade aristocratique de celui qu’on appelle l’homme du monde.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai. Pour en revenir à elle, on peut se dire que ses hanches, ses épaules, ses formes opulentes se logent avec un petit peu de difficulté dans son corset. L’on pense qu’elle a connu de jours meilleurs, des jours où elle était un peu plus svelte. Si l’on peut revenir à cela. Alors on voit que Toulouse-Lautrec cherche le geste le plus juste. Il a un point de vue qui est celui de l’exclu. Celui qui observe le monde des êtres humains en bonne santé. Ces gens qui consomment pour quelques sous le corps appétissant des femmes. Toulouse-Lautrec va vouloir donc dépister et choisir des lieux, des situations qui n’était pas jusque-là apparues comme étant digne de faire l’objet d’une œuvre d’art. Nous l’avons un peu évoqué. Il veut le geste le plus sûr et l’intimité du geste. Il cherche la vérité du geste plutôt que la beauté. Il est passionné par le mouvement. Et c’est intéressant de dire qu’il aime ce qui n’est pas fini. Ce qu’on appelle le non-finito. Cet inachèvement qui, pour lui, recèle une force suggestive beaucoup plus essentielle. Il sait qu’à l’époque où la photographie vient de naître, la tâche de la peinture n’est plus de donner une vision objective des choses ou des gens. La peinture doit faire advenir un autre monde : celui des pensées et des sensations. C’est une chose tout à fait importante.
Marthe Pierot : Oui, pour en revenir sur la technique et le tableau, il est intéressant de se dire – au-delà de ce geste très juste – c’est la manière dont il va traiter le trait mais aussi les couleurs. Il y a des rehauts de couleur par endroits. C’est justement cela qui l’intéresse. C’est sa manière d’insister sur les détails les plus importants. Il y a très peu d’éléments de décor, comme l’a dit Isabelle, il ne va pas remplir le tableau, il ne va pas tout peindre. Il va vraiment s’attarder sur certains détails. Les couleurs, suffisent à animer le jeu des surfaces et des contours qu’il va combiner de manière très originale. Il alterne des tons clairs et des tons foncés. Des couleurs complémentaires avec ce vert émeraude qui ressort derrière le noir et le blanc. Et on a vraiment la sensation qu’il jette des petites taches comme une pluie fine de taches de couleur. Vous allez le voir, nous sommes très loin des couleurs très violentes et contrastées qu’il utilise dans ses affiches. Là, il va choisir des teintes beaucoup plus délicates et il insiste vraiment sur ces couleurs jetées sur le papier. La spontanéité de cette étude, qui est une étude préparatoire même si pour lui c’est terminé, on a un effet de style avec cette impression d’esquisse. A présent, regardez la lithographie.
[Illustration : Henri de Toulouse-Lautrec, “Conquête de passage”, 1896, lithographie]
Marthe Pierot : Ici, vous avez l’œuvre finale de cette série de lithographies. L’on s’aperçoit que le décor cette fois-ci est beaucoup plus détaillé. Vous avez un miroir, vous avez des rideaux, vous avez un tableau sur le côté et un canapé. Celui-ci, justementest important parce que cette fois-ci l’on comprend mieux la position de la femme. Regardez : elle a un genou plié et elle pose son pied sur le canapé. On comprend un petit peu mieux. Le décor est plus planté, mais pourtant, le propos ne change pas. Il était déjà très clair dans le dessin préparatoire. Le geste est toujours au centre – c’est çà qui compte- et le regard de l’homme est toujours bien marqué. Même s’il y a un peu moins de force dans son regard, l’homme est toujours présent. Il est même un peu plus habillé. On voit cette fois-ci des gants, on voit une canne avec un pommeau. Il est très bien habillé, Toulouse-Lautrec souligne la noblesse de cet homme-là, même parfois à le tourner en ridicule. Les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que le support cette fois-ci est du papier. Il change : c’est une lithographie. La lithographie est une technique d’impression à plat à partir d’un dessin qui a été réalisé en amont sur une pierre. C’est une technique qui permet la reproduction de dessins à multiples reprises. C’est un procédé qui a été inventé un siècle plus tôt en Allemagne et qui fascinait Toulouse-Lautrec. Il va donc prendre part à toutes les étapes de ce processus. Parfois des artistes ne s’engagent pas vraiment dans ce processus. Toulouse-Lautrec, lui, réalise toutes les étapes de la lithographie. Il véritablement un lithographe. Ce qui est amusant, pour terminer, c’est ce petit clin d’œil que vous avez dans ce tableau. Vous avez un tableau dans un tableau, une petite mise en abîme avec ce cadre qui se trouve vraiment sur la gauche du tableau. On peut y distinguer un satyre et une nymphe dessinée. Il s’agit d’une représentation d’une gravure d’un grand graveur italien de la Renaissance. Et là ici, dans l’oeuvre le sujet est un peu le même. Il y a cet enjeu de séduction, même si c’est beaucoup moins retenu dans cette gravure que ça ne l’est dans la lithographie de Toulouse-Lautrec. Là, on voit vraiment le satyre qui est pratiquement sur la nymphe. Mais, juste pour vous dire, que nous n’avons pas cette lithographie au musée des Augustins. Nous voulions juste vous la montrer afin de vous montrer un petit peu la destination de du dessin que nous avons.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Alors en fait maintenant nous allons vous parler d’une affiche que nous n’avons pas non plus, mais comment parler de Toulouse-Lautrec sans évoquer le monde des affiches ?
[Illustration : Henri de Toulouse-Lautrec, “Affiche Moulin Rouge, La Goulue”, 1891, Affiche]
Il est évident que Toulouse et Albi sont très proches. Vous pouvez aller voir au musée d’Albi les 31 affiches qu’il a réalisées au total. Nous n’avons pas d’affiches au musée des Augustins de Toulouse, mais neuf sont conservés à Toulouse au musée Paul Dupuy.
Quand Toulouse-Lautrec travaille l’affiche, il tourne le dos au château des contes de son enfance pour se consacrer au cabaret et aux maisons closes de Paris. Il va se noyer dans les couleurs et les lumières de ce monde artificiel et scandaleux. De ce monde désinhibé qui le fascine. Il va immortaliser des stars et il va vouloir en parler différemment, avec un vocabulaire particulier. Cette affiche “Moulin Rouge”, vous propose juste quatre couleurs en très fort contraste les unes avec les autres. Tout au devant de l’affiche, vous avez le fameux Valentin le désossé qui dansait d’une manière tellement souple. Il est coupé à mi corps, il est en ombre grisée. C’est le personnage repoussoir qui va mettre en valeur le personnage du milieu. Au milieu, le pivot de cette affiche, c’est une danseuse. Derrière elle, il y a des silhouettes noires qui permettent de faire ressortir cette danseuse. Cette danseuse, c’est la Goulue, qui est la seule à être représentée en couleurs et qui est la seule à prendre la lumière.
Marthe Pierot : Tout à fait. Il est intéressant de décortiquer l’affiche de cette manière-ci. Mais nous allons revenir à des œuvres que nous avons au musée des Augustins avec cet autre tableau.
[Illustration : Henri de Toulouse-Lautrec, “Femme se frisant”, 1876-1900, dessin]
Marthe Pierot : Ce tableau qui est aussi un dessin préparatoire pour cette même série de lithographies appelée Elles. Là aussi, vous avez encore une fois, une femme qui est saisie dans son intimité. C’est une femme qui se coiffe. Elle tient un fer à friser dans la main et elle boucle ses cheveux. Mais encore une fois, on a un trois-quarts dos, l’on ne la voit pas. On ne sait pas vraiment comment est son visage et même si elle se tient devant un miroir, c’est très intéressant de voir comment Toulouse-Lautrec choisit son cadrage, car il place la main de la femme devant son reflet. On ne peut pas voir son visage. Alors qu’on pourrait imaginer l’apercevoir à travers le miroir, et bien non, il nous la montre sans la montrer. Son visage est totalement invisible. Et puis, regardez sa chemise peut être un négligé ou un peignoir blanc très bien traité. Ce beau blanc avec ce col extravagant. Ce col qui remonte jusqu’au visage aussi. Donc on ne peut même pas voir le bas de son visage. Vraiment tout est mystérieux, et il joue avec ça. Pourtant, cette femme aux cheveux très rouges, on peut l’identifier avec cette couleur de cheveux. Il s’agit de Carmen Godin. C’est une femme qui a énormément inspiré Toulouse-Lautrec, qui réalise quinze toiles et dessins d’elle. C’était une ouvrière et une femme du peuple, un de ses modèles préférés.
Ce qui est très beau ici, c’est de voir en plus de ce trois-quarts dos, le mouvement qui encore une fois est toujours au centre. Ce mouvement, ce geste qu’elle réalise, ce geste un peu répétitif, ce geste finalement très ritualisé – le fait de se coiffer, il insiste sur cela. Car cela fait partie de ce rituel. Elle va s’habiller, se parfumer, se coiffer avant de rencontrer son client. C’est ça qui intéresse Toulouse-Lautrec. Et on retrouve un peu comme on l’avait avec le tableau de la femme au corset, ces jeux de couleurs et de contrastes de couleur avec ce rouge intense des cheveux qui contraste très bien avec ce vert émeraude et l’on retrouve encore le blanc. Voilà donc on a cette confrontation de couleurs complémentaires et on a cette tonalité qui rappelle cette femme qui nouait son corset.
19 46
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Ce sont les mêmes gammes de couleurs.
Marthe Pierot : Exactement, et la même destination pour cette lithographie, cette série de lithographies, donc on peut retrouver des ressemblances. Et puis il laisse apparaître le support. Ce carton orange qui lui permet de jouer avec une couleur en plus, d’absorber le pigment et d’avoir un effet très mât. C’est cela qui intéresse Toulouse Lautrec : le jeu des couleurs et des matières. Quand on regarde en bas à droite du tableau, on aperçoit une impression de petit logo. Ce petit rond en bas à droite est la signature de Toulouse-Lautrec. Il avait une signature très particulière et très moderne. Il signait avec un T mélangé dans un H et un L, le tout encerclé de ce petit disque. On a l’impression d’avoir un logo ou même d’avoir un esprit un peu japonisant comme un sceau japonais.
Isabelle Bâlon-Barberis : Exactement.
Marthe Pierot : Vous allez voir que le Japon a beaucoup inspiré Toulouse-Lautrec. Cette image-là est intéressante. Quoi qu’il en soit, et même si Toulouse-Lautrec nous parle souvent de l’intimité de ces femmes, de ces gestes un peu répétitifs qui paraissent la banalité ou le quotidien de ces femmes, il cherche toujours à renouveler notre regard en proposant un cadrage différent. En proposant une technique qu’il va innover. Il propose quelque chose de neuf dans une intimité qui pour lui, lui paraît inépuisable. Il a toujours envie d’immortaliser ces moments-là. Et c’est cela qui est moderne.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Alors on va continuer avec un autre visuel qui est réalisé par Toulouse-Lautrec.
[Illustration : Henri de Toulouse-Lautrec, “Portrait de François Gauzi”, 1888, huile et essence sur toile]
Isabelle Bâlon-Barberis : Cette fois-ci, il va représenter son ami François Gauzi. Nous sommes en 1888, c’est une toile qui est peinte à l’huile et à l’essence, c’est une particularité. Elle a toutes les apparences d’un pastel et pourtant, c’est une peinture à l’huile.
Puisque Marthe vient de vous parler de la signature façon sceau japonais dans le tableau précédent, il est intéressant ici de regarder qu’en bas à gauche cette fois, vous avez une signature dont vous pouvez lire “H.Treclau”. C’est donc du verlan. Vous voyez comme Henri de Toulouse-Lautrec est moderne. Henri de Toulouse-Lautrec s’adapte, car son père estimait que son fils Toulouse-Lautrec déshonorait le nom de la famille en signant Lautrec. C’est pourquoi Henri de Toulouse-Lautrec va inverser les syllabes de son nom de famille. Alors ici vous découvrez un homme droit avec les mains dans les poches, debout sur le seuil de la porte de son atelier, parce que Gauzi était aussi un peintre. Il se situe entre les deux portes.
Vous avez une fenêtre lumineuse cachée par l’escalier qui occupe le fond du tableau. Il est important de vous dire que Gauzi a rédigé un livre qui s’intitule Souvenir sur Toulouse-Lautrec dans les années 1930. Il va parler de ce qu’ils ont connu ensemble, de ce Montmartre que Toulouse-Lautrec et lui-même ont aimé. Le livre n’est sorti cependant que dans les années 1950. Gauzi restitue l’atmosphère des bals, des cabarets. Effectivement, il faut noter que Gauzi est plus connu comme biographe de Lautrec que comme peintre.
Maintenant, regardez ce tableau de format vertical. Son étroitesse est renforcée, il y a ici une audace et une inventivité, comme un nouveau rythme dans la composition. Cela est un héritage du japonisme de la fin du 19e siècle. Un courant important qui a influencé des gens comme Van Gogh, par exemple. Il y avait de très nombreux collectionneurs d’estampes japonaises à cette époque. Dans les estampes, vous avez cette construction d’un nouvel espace plastique qui mène l’œil, qui guide notre œil vers le haut de la composition. Comme si le point de fuite était placé tout en haut du tableau. Cette perspective abrupte héritée des japonais nous propose donc un angle inhabituel pour faire davantage ressortir le sujet. Vous voyez qu’il y a ici des perspectives intéressantes parce que ces portes ouvertes nous proposent quelque chose, comme un système de paravents japonais qui coulissent.
Il est important de dire également que, comme dans l’affiche dont je parlais précédemment : le Moulin Rouge, il y avait un parquet dont les lignes creusaient la perspective. L’on rencontre la même chose ici. Et vous avez véritablement ces lignes du parquet qui nous conduisent vers le haut du tableau. La composition ici est simple parce que le personnage est centré. Il y a la volonté de montrer un homme élancé, debout, fier. C’est intéressant de dire que c’est un homme qui est à l’opposé de la silhouette difforme d’Henri de Toulouse-Lautrec. Il y a de la part de Lautrec une admiration, une fascination pour ces hommes grands et forts. Le contraire de ce qu’il est.
Pour revenir à Gauzi, il serait intéressant de dire qu’il est né à Fronton, qui se trouve au nord de Toulouse. Mais en fait Toulouse-Lautrec et Gauzi se sont rencontrés à Paris. Les artistes côtoyaient les mêmes lieux, ces lieux de la nouveauté et de la modernité. Et tous les deux vont se passionner, par exemple pour la photographie. Ensemble ils vont fréquenter Montmartre.
Marthe Pierot : Oui, et c’est intéressant de savoir qu’au musée l’on possède deux tableaux de Gauzi, deux peintures de Gauzi. On a choisi de vous en montrer une qui est celle-ci.
[Illustration : François Gauzi, “Jeune femme au piano”, 1904, huile sur toile]
Marthe Pierot : Alors c’est intéressant parce que, finalement, on parle du lien qu’il y a entre Gauzi et Toulouse-Lautrec et qu’ils aiment tous les deux la modernité, pourtant ce tableau est quand même très conventionnel et très classique. C’est un petit peu ce qu’on pourrait qualifier de l’anti-Lautrec. Regardez, vous avez cette femme qui est toute sage. C’est une femme issue d’une très bonne famille et qui a reçu une parfaite éducation. Elle se tient droite, elle joue délicatement du piano. Elle est dans la retenue, elle se trouve dans un intérieur très bourgeois et on a la douceur de cet intérieur qui crée une ambiance très feutrée avec notamment une belle harmonie des couleurs. Regardez le rose et le jaune qui se marient très très bien, mais qui s’allie aussi parfaitement au vert du fond et du fauteuil. Mais vous avez quand même un petit contraste qui vient réveiller tout ça avec le piano. Le piano qui est très très noir avec la partition blanche qui ressort par-dessus. On retrouve cette alternance de blanc et de noir avec les touches d’ébène et d’ivoire. Mais on imagine que cette femme joue un morceau très calme. On est loin peut être des musiques dansantes, des cabarets ou des cafés concerts qu’on pouvait trouver dans l’ambiance de Toulouse-Lautrec. C’est peut être un morceau parfaitement classique. Elle est parfaitement droite.
Mais ce qui est intéressant et ce qui est un petit peu Toulouse-Lautrec içi, c’est le profil perdu. Encore une fois, on ne voit pas son visage ou très peu. Elle nous tourne presque le dos, on a un peu du mal à l’identifier. Ici, on peut retrouver la position qu’on avait avec cette femme qui se frisait les cheveux, par exemple, cette coiffure relevée et ce visage qui nous échappe. On a une très belle nuque blanche qui peut nous faire penser aussi à la nuque d’une geisha si on reste dans l’influence du Japon. Là aussi Gauzi joue un petit peu sur le mystère, et c’est aussi pour ça que l’on a choisi de vous montrer ce tableau de Gauzi. C’est la petite parenthèse.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Messieurs dames, nous allons maintenant revenir à une œuvre de Lautrec.
[Illustration : Henri de Toulouse-Lautrec, “La première communion”, 1888, huile et essence sur toile]
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est la dernière que nous allons vous montrer. Il s’agit ici d’une œuvre qui s’appelle « la première communion ». Elle date de 1888, réalisée sur du carton, toujours en utilisant de la peinture à l’huile et de l’essence. On a ici une petite reprise qui est la silhouette de François Gauzy, dont je vous ai déjà parlé tout à l’heure. Ici, c’est une œuvre pittoresque. Il est question d’une promenade dominicale d’une famille après la première communion d’une fillette. Alors ce qui est intéressant, c’est que nous sommes dehors. Nous sommes en extérieur, ce qui est rare pour la période parisienne de Lautrec. Il est important de dire que Henri de Toulouse-Lautrec refusa toujours de peindre des paysages, bien qu’il en ait peint beaucoup durant son adolescence. Mais c’est vrai que pendant son adolescence, il a connu une période un petit peu impressionniste où effectivement il donnait dans la peinture en plein air. Mais à Paris, il s’est beaucoup concentré sur le corps humain et les êtres vivants. Alors il y a ici, dans cette œuvre, des fragments de paysages néanmoins, de paysages urbains. Derrière la scène familiale, il y a cette rue de Paris, qui sert à mieux faire comprendre la vie des gens d’un quartier lors d’un jour extraordinaire pour la petite fille, celui de sa communion solennelle. Donc vous avez une perspective de la rue et du trottoir. Vous avez un magasin, vous voyez la vitrine avec les cols de chemises impeccablement repassés, et vous avez également au tout premier plan cette plaque d’égout qui est très réaliste. Alors le père de famille pousse une voiture d’enfant avec une petite fille en blanc. Derrière lui, il y a sa fille aînée en communion, puis derrière encore il y a sa femme endimanchée, qui tient par la main une autre petite fille. La scène est assez cocasse, elle est comique, elle est à la limite du bien élevé je dirais.
Marthe Pierot : Oui, puis Toulouse-Lautrec, il aime jouer avec ça, il aime placer de l’humour dans ses œuvres, un petit peu comme une caricature finalement. C’est un peu comme on pourrait retrouver avec Sempé aujourd’hui, par exemple, ce dessinateur. On a vraiment cette idée d’humour. Regardez par exemple le vêtement du père, ce pantalon qui est un peu trop court ou les jambes qui sont trop longues, on ne sait pas vraiment, ses pieds allongés. Et puis le regard de cette petite fille, c’est un jour important, c’est très solennel cette première communion, mais elle semble parfaitement amusée, elle est même fière, elle est entourée de ses 2 parents et elle rigole un petit peu de cette scène-là. Mais bon normal c’est la star de la journée. Donc on sent qu’elle est parfaitement heureuse dans sa robe blanche. Donc il y a vraiment cette idée d’humour qui est tout à fait intéressante. Et puis on retrouve cette esquisse, ce trait assez furtif, assez rapide, qui est propre à Toulouse-Lautrec. Mais on a l’impression que c’est une famille endimanchée, une famille d’ouvriers, mais qui s’est déguisée en petits bourgeois pour l’occasion. Et cette schématisation, cette déformation, cette caricature est caractéristique de Toulouse-Lautrec. Et c’est ça qu’il faut savoir. Pour lui, le monde entier était un cabaret, un immense théâtre où l’on pouvait croiser toutes les facettes de l’être humain. Et il avait envie de nous parler de toutes ces facettes-là Toulouse-Lautrec. Et ce qui est très beau, c’est que malgré ses souffrances et ses défaillances physiques, il avait envie de célébrer la vie, le rire et la drôlerie.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai tout à fait. Alors nous allons peut être conclure. Henri de Toulouse-Lautrec, vous avez compris qu’il était un amuseur, un pitre, un trublion de la peinture. Il est animé par des pulsions de vie, ça c’est évident, mais une vie très courte. Marthe vous l’a dit puisqu’il décède à l’âge de 37 ans. De son vivant, ses tableaux, à la différence de ses affiches, ne plaisent pas. En fait, il est mis à l’index, il est critiqué et il est éclipsé par ses grands contemporains que sont Cézanne et Van Gogh. Cependant, après sa mort, sa notoriété ne cesse de croître. Et c’est vrai que les plans qu’il a utilisé, les angles nouveaux dont il est l’auteur, le cinéma saura s’en servir.
Marthe Pierot : Oui, c’est très intéressant ça. Et c’est important aussi de dire que finalement, même s’il ne plaît pas, il est connu de son vivant. Il est connu et reconnu justement avec ses affiches qui feront toute sa notoriété quand même. Ses affiches qui sont placardées partout sur les murs de Paris. Finalement, c’était un street-artiste avant l’heure. Son art est dans la rue, un peu à la manière d’Ernest Pignon-Ernest aujourd’hui, si on continue avec ses comparaisons. Ce qu’il faut savoir, même si les sujets qu’il utilise, c’est à dire l’intimité de ces femmes qui se coiffent, qui se préparent, ce n’est pas le seul à les utiliser. Isabelle vous en a parlé quand elle vous expliquait que Renoir ou Degas pouvaient utiliser les mêmes sujets. Et bien Toulouse-Lautrec lui, a une manière très originale de les représenter. Il y a de l’impertinence dans ses propositions et c’est ce qui caractérise le peintre. Il cherche la nouveauté dans la technique, dans le support, dans le cadrage et c’est ça vraiment qui le caractérise. Il va former et déformer le trait, il va même préfigurer un petit peu les distorsions du dessin moderne. On peut dire que son œuvre, finalement, préfigure l’expressionnisme qui arrivera par la suite au 20e siècle, avec justement toutes ces discordances et ces grincements. Vous avez en tête la première communion par exemple, on est un peu dans cet esprit-là.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Voila, Messieurs dames, nous avons terminé, merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver dans d’autres conférences à très bientôt.
Marthe Pierot : Merci beaucoup et on espère que vous avez apprécié cette vie, cette courte vie pendant 30 minutes de Toulouse-Lautrec. Une vie de Bohème. Merci et à bientôt.
Les femmes artistes
Les femmes artistes
[Conférence en ligne sur le thème “Les femmes artistes”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2021]
Marthe Pierot : Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette conférence en ligne du musée des Augustins. Isabelle et Marthe, nous sommes les conférencières et aujourd’hui nous allons vous parler d’un sujet , qui nous tient à cœur, les femmes artistes.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, les femmes artistes, au musée des augustins, elles sont très représentées.
Et cela nous a déjà beaucoup intéressé, Marthe et moi. Et puis dans un 2e temps, on s’est dit que c’est un sujet de société, c’est un sujet d’histoire de l’art en même temps. On peut se demander pourquoi on les connaît moins. Certaines ont été très célèbres en leur temps, mais il y a comme une amnésie de l’histoire.
Marthe Pierot : Voilà, c’est important de dire qu’il y a eu quand même des femmes artistes, même si on en connaît moins, mais il y en a eu, mais quand même beaucoup moins que d’hommes artistes. Et ce qu’on a envie de voir ensemble, c’est pourquoi ? Pourquoi cette différence finalement ? Parce qu’elles ont eu un parcours véritablement semé d’embûches. Alors il y a eu plusieurs choses. Déjà, elles n’ont pas accès aux formations, aux formations officielles, aux institutions. Il faut attendre 1897 pour que l’école des Beaux-Arts ouvre aux femmes. Donc, en attendant, il fallait faire partie d’un atelier, être dans une famille d’artistes pour pouvoir exercer. Ensuite, elles n’ont aucune autonomie financière quand elles sont artistes. Quand elles sont peintres ou sculptrices, elles ne gagnent pas leur vie avec ça. Très souvent, elles dépendent d’un homme, d’un mari ou d’un père. Quand elles sont associées au milieu artistique, très souvent elles sont muse, mécène ou collectionneuse, mais très rarement artiste. En tout cas, le statut n’est pas reconnu et en plus de ça, quand elles créent, elles vont très souvent être cantonnées à un genre considérées comme mineur. C’est à dire portrait, scène de genre ou nature morte, et à des techniques qui sont dites féminines, par exemple le pastel. Elles sont marginalisées et très peu considérées.
Isabelle Bâlon-Barberis : Et on peut rajouter également que l’histoire de l’art a été écrite par des hommes. Ce qui peut expliquer certaines choses.
Marthe Pierot : Ce qui explique plutôt l’oubli exactement.
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors la période dont nous allons vous parler commence au 17e siècle et jusqu’à l’aube du 20e siècle. Nous allons passer en revue 12 œuvres du musée, et nous allons commencer tout de suite. Ces 12 œuvres nous donneront également l’occasion de parler de 12 parcours de femmes.
Marthe Pierot : Exactement. Et c’est tout de suite.
[Illutration : Louise Moillon, “Nature morte aux abricots”, 1634, peinture]
Marthe Pierot : Nous commençons avec Louise Moillon. Une artiste du 17e siècle qui naît dans une famille d’artistes peintres. Elle fait partie de ces femmes qui vont faire partie d’une même corporation, qui vont grandir dans un cadre privilégié. En tout cas, elle va pouvoir peindre très tôt, très jeune, et être soutenue dans son art. Dès 10, 11 ans, elle commence à peindre, et dès cet âge-là, sa technique est reconnue. Elle est issue d’un milieu protestant. C’est important de le dire, parce qu’au 17e siècle on est persécuté pour sa religion quand on est protestant.
Tout au long de sa vie son combat sera double, parce qu’elle est femme artiste, mais aussi parce qu’elle est protestante. Elle réalise beaucoup de natures mortes. Ses tableaux sont véritablement empreints de toutes ces vertus protestantes que sont la modestie, la simplicité. On parle vraiment d’une vie silencieuse et on le retrouve dans ces tableaux. Alors les natures mortes, en histoire de l’art, c’est vraiment ce genre qui met en scène des objets inanimés dans une composition organisée avec une recherche d’esthétisme et d’harmonie. Mais c’est un genre qui est considéré mineur, à côté par exemple de la grande peinture d’histoire. C’était un genre qui était dédié aux femmes majoritairement. Dans cette nature morte ici, qu’on appelle « Nature morte aux abricots », on reconnaît justement la simplicité, la rusticité et le dépouillement qui est propre à Louise Moillon. Il n’y a pas de fioriture. Il n’y a pas de vaisselle précieuse, juste un panier sur une planche de bois. Ce qui est intéressant c’est de voir le réalisme de cette composition quand on voit tous les abricots. Les taches d’épiderme qui sont représentées sur la peau, les petites gouttes de rosée en bas sur la table qui nous disent toute la fraîcheur du fruit. Et puis cet abricot qui est disséqué au premier plan, qui est tout à fait réaliste. Mais malgré tout, la composition est un petit peu idéalisé, car regarder la position de ces abricots, cette pyramide d’abricots où on a l’impression qu’ils flotteraient tous telles des bulles de savon, voilà.
Isabelle Bâlon-Barberis : Jolie expression.
Marthe Pierot : Et c’est très imagé, parce qu’on a vraiment cette impression-là que ces fruits défient un petit peu les lois de la gravité. Mais en tout cas, il y a quelque chose de délicieux à regarder
[Illustration : Elisabeth Vigée-Le Brun, “La Baronne de Crussol”, 1785, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait. Alors on va continuer et on va parler d’une femme, Elisabeth Louise Vigée Le Brun, qui elle a un parcours tout autre. Louise Moillon, dont vient de vous parler Marthe, a pu travailler en tant que peintre 10 années de sa vie. Concernant donc Madame Vigée Le Brun, elle a travaillé très longtemps. Elle est morte à 86 ans. C’est une femme dont la vie est à cheval sur le 18e et le 19e siècle. C’est un très très long parcours.
Son parcours, c’est tout le contraire, puisque la thématique qui sera la sienne, c’est le portrait et pas du tout la nature morte, et on sait qu’elle a fait à peu près 600 portraits. C’est une des plus grandes portraitistes du 18e siècle et c’est la première femme à vivre de son pinceau, c’est très très important de le dire. Mais elle est dans des conditions un petit peu particulières puisqu’elle est en quelque sorte la meilleure amie de la reine Marie Antoinette. Les commandes pour les têtes couronnées se multiplient. Elle a cette modernité de garder son nom de jeune fille Vigée, auquel elle va associer son nom d’épouse Le Brun. Mais elle tient à garder les 2. Autrement, c’est une femme qui est très à la mode, qui a son hôtel particulier à Paris. Mais quand survient la Révolution française, elle va vivre l’exil. Elle sera triomphalement accueillie dans les cours d’Europe mais elle ne pourra plus rester en France, puisque les têtes couronnées qu’elle peignait, sont décapitées ou doivent elles-mêmes justement quitter la France.
Ici il est question d’un portrait de la baronne de Crussol. Ce qui est intéressant, c’est qu’Élisabeth Louise Vigée Le Brun nous propose le naturel, la spontanéité et c’est ce qui la différencie des hommes peintres de la même époque, chez qui les modèles étaient plus guindés, plus sérieux, plus frontaux. Ici, on a l’impression que cette femme vient de pivoter sur elle-même, de se retourner et nous aperçoit. Cette spontanéité est très importante, ce naturel encore une fois. Ici ce qui est très intéressant également de dire, c’est la manière dont cette femme est habillée. Regardez le soin de la fourrure notamment, qui borde sa petite veste rouge. Cette manière de s’habiller, c’est celle de la Reine Marie Antoinette. Ce foulard qu’elle porte, c’est la manière de Marie Antoinette. La musique, la partition musicale de Gluck qu’elle lit, c’est le musicien préféré de Marie Antoinette. Donc Marie Antoinette, la Reine a de nombreux followers, on peut le dire comme ça,
Marthe Pierot : c’est une influenceuse.
Isabelle Bâlon-Barberis : Voilà absolument c’est une influenceuse. Ici, vous avez véritablement quelqu’un qui s’inscrit dans la tendance, dans la mode que la Reine édictait.
[Illustration : Marie Guillemine Benoist, “Le baron Larrey”, 1804, peinture]
Marthe Pierot : Alors, on poursuit avec Marie Guillemine Benoist qui était l’élève d’Elisabeth Louise Vigée Le Brun, dont vient de vous parler Isabelle, c’était une femme qui enseignait à d’autres femmes. C’est comme ça que Marie Guillemine Benoist commence à peindre et par la suite elle entrera dans l’atelier de David. Ce grand peintre du 19e siècle qui va soutenir l’accès à la formation artistique pour les femmes. Il va ouvrir son atelier alors que le Louvre refusait d’enseigner aux femmes, lui, il ouvre son atelier aux femmes et leur apprend même la peinture d’histoire.
Ce qui est très triste dans l’histoire de Marie Guillemine Benoist, c’est qu’elle peint beaucoup, mais son époux a un travail de haut fonctionnaire et elle va devoir renoncer à son travail de peintre au profit de la carrière de son époux. C’est un déchirement pour elle.
Ici, vous avez sous les yeux un de ses portraits. Un portrait qu’elle a réalisé en 1804. Un portrait à mi-jambe qui est tout à fait dans l’esprit Empire, c’est à dire à l’époque de Napoléon. À quoi on le voit ? Aux vêtements, cet uniforme avec ce pantalon blanc et la veste bleu nuit, mais aussi au mobilier, le seul fauteuil que l’on peut voir, est un fauteuil en acajou avec un velours vert olive. Tout ça nous parle de ce contexte et de cette époque de l’esprit Empire.
Alors, qui était cet homme : Le baron Larrey ? Et bien c’était un illustre chirurgien. Un chirurgien en chef de la grande armée de Napoléon. On le surnommait aussi le père de la chirurgie d’urgence. Et là, il tient à la main un papier et un crayon. En fait il a dans la main, le compte rendu de l’expédition du Caire de laquelle il a fait partie au côté de Napoléon. On comprend qui il est. On comprend son style et son époque grâce à tous ces indices, parce que rien d’autre ne vient nous donner d’autres indices. Le décor est entièrement vide. Rien ne vient détourner notre regard de cet homme qui est ici. Alors c’est tout à fait élégant, il est vraiment très soigné sur fond vide. On a quelque chose de plutôt classique.
Isabelle Bâlon-Barberis : Mais cette Marie Guillemine Benoist, on en a entendu parler récemment dans l’actualité je crois.
Marthe Pierot : C’est vrai qu’on connaît peut être son nom parce qu’on a parlé d’elle lors d’une exposition qui a eu lieu à Orsay en 2019, “le modèle noir de Guéricault à Matisse” qui est un portrait qui a beaucoup fait parler. C’est celui-ci.
[Illustration : Marie Guillemine Benoist, “Portrait de Madeleine”, 1800, peinture]
Marthe Pierot : Alors on ne l’a pas au musée des Augustins. On vous le montre rapidement, juste pour vous montrer ce qu’elle a aussi fait. Alors que notre baron Larrey ne faisait pas de vague et était tout à fait simple. Là, ici, elle prend une véritable prise de position politique, à la fois pour l’émancipation des femmes et les gens de couleur. Car elle réalise ce portrait à une époque où le régime napoléonien menace de revenir sur l’avancée des droits des femmes et veut rétablir l’esclavage dans les colonies françaises, qui venait à peine d’être abolies. Donc là, elle place cette femme noire sur un fauteuil de style, avec les couleurs de la France. On voit du bleu, du blanc et du rouge. Il y a une véritable revendication.
Isabelle Bâlon-Barberis : Exactement.
[Illustrations : Marguerite Gérard, “La visite”, 1820 / Hortense Haudebourt-Lescot, “Deux merveilleuses”, vers 1820]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors je vous propose à présent de considérer ces 2 tableaux. Je vais commencer par celui de gauche qui s’intitule “La visite”. Il est question de Marguerite Gérard. C’est une femme qui ne s’est jamais mariée et je pense qu’au début du 19e siècle, c’est important de le souligner. Elle a vécu sa vie au Louvre, plus de 30 années. Elle habite le Louvre. Les artistes avaient leur atelier au Louvre, non pas pour tous, mais pour beaucoup. C’est ainsi qu’elle a pu s’inspirer de toutes les toiles qu’elle voyait. Tout cela soutenu par son professeur et beau frère qu’était Fragonard. Ce grand peintre de la fin du 18e siècle.
Si vous voulez, elle a ce classicisme, ce raffinement, cette sensibilité, une très grande technique au bout de son art et cela dans des petits formats. C’est important de dire qu’il y a cette courte période après la Révolution française et jusque dans les années 1820, où les femmes vont produire ces tableaux de petits formats, ces scènes de genre où on a des personnages sans identité mais dont on peut imaginer l’histoire. Et ça aura un succès fou. On va raffoler, notamment à Paris, de ces petites scènes de genre. Ce sera vraiment une parenthèse enchantée pour ces femmes artistes à cette période-là avec ce thème-là, ce sujet-là.
Ici qu’est-ce qui se passe ? Chez Marguerite Gérard, c’est toujours la volonté de nous parler de choses d’une extrême bonne moralité. Ici, vous avez l’éducation d’une petite jeune fille. On imagine que sa maman est en noir au centre et qu’elle regarde attentivement son enfant qui se jette dans les bras de cette femme en bleu sur la gauche. On peut imaginer par exemple que c’est sa marraine. Et que cette dame en noir, la mère donc, se dit qu’il faudra peut-être un petit peu rectifier cette spontanéité. Parce qu’une petite fille peut être spontanée, mais plus tard il lui faudra être peut-être un petit peu plus retenu dans son attitude. Donc joli tableau de genre.
Marthe Pierot : On vous l’a montré à côté d’un autre qui retrouve, qui représente les mêmes codes, qui est aussi une scène de genre avec des personnages inconnus dans un format plutôt petit, réalisé par Hortense Haudebourt-Lescot. Le tableau qui se trouve à droite. On est en intérieur également, et on a ces 2 jeunes filles qui font une halte pour le goûter.
Regardez tout ce qui est disposé autour d’elles, et surtout regardez ce petit objet tout à droite, c’est un four portatif, c’est adorable. On comprend qu’elles sont en voyage, mais surtout on voit ces pâtisseries qui sortent tout juste du four qu’on imagine encore chaudes, et on comprend qu’elles étaient très pressantes de les goûter. Regardez, elles ne sont pas assises, ici il n’y a pas de table contrairement a à côté. Elles sont debout, elles grignotent, elles ont encore leurs vêtements et leurs manteaux. Et justement, quels vêtements elles ont ? C’est vraiment très particulier quand on regarde bien. Elles ont vraiment des foulards, des voiles sur la tête, un turban noué à la diable, des manteaux de toutes les couleurs. Elles sont en marge de tous dress code. C’est très difficile de comprendre comment elles sont habillées, mais on comprend surtout à quelle époque nous sommes. Parce que des femmes vêtues comme ça, on les appelait les 2 merveilleuses. Et quand on s’habille comme ça, c’est une période qu’on appelle le Directoire. Alors, après la Révolution, il y a une période terrible de privation totale qu’on appelle la Terreur. Quand la Terreur s’arrête, on lâche tout. L’excentricité est au pouvoir. C’est comme à la sortie du confinement, on se libère. Là on le voit dans les vêtements, on le voit dans ces merveilleuses, on comprend la manière dont elles sont habillées.
Isabelle Bâlon-Barberis : D’ailleurs, les garçons, on les appelait les incroyables.
Marthe Pierot : Exactement, les merveilleuses et les incroyables. Alors rapidement, Hortense Haudebourt-Lescot, pour parler d’elle, était aussi l’élève d’Élisabeth Vigée Le Brun, comme Marie Guillemine Benoist qu’on a vu précédemment. C’est vraiment une peintre officielle, dans la Cour, qui était reconnue de son vivant, qui fait beaucoup de scènes de genre et de peintures intimistes, mais qui était aussi très liée au milieu de l’art parce qu’elle était une grande mécène. On la connaît aussi pour ça.
[Illustration : Julie Charpentier, “Clémence Isaure”, 1822, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors nous allons continuer cette fois avec de la sculpture. Nous allons parler de Julie Charpentier. C’est une sculptrice peu connue du grand public. Elle a été, on le sait, formée par son père au Louvre. Lui-même était graveur et il résidait au Louvre. On est là dans un contexte favorable. Cependant, c’est vrai qu’on sait peu de choses d’elle. Alors, l’œuvre que vous avez sous les yeux, c’est un personnage mythique de l’histoire de Toulouse. Il s’agit de Clémence Isaure, qui est un personnage du 15e siècle et qui était muse en même temps qu’elle était mécène pour les poètes. On peut associer à son image, ce fameux concours des Jeux floraux puisqu’elle inspirait les poètes. Et ce concours des Jeux floraux qui a commencé le 3 mai 1323, existe encore aujourd’hui, chaque 3 mai il y a ce fameux concours. Clémence Isaure n’est plus là pour financer ou pour inspirer les artistes, mais en tout cas, Julie Charpentier lui rend hommage ici en nous la proposant dans ce beau marbre blanc. Ce qui est intéressant, c’est de voir qu’on a vraiment une femme du Moyen Âge, étant donné cette coiffure, ces tresses enroulées symétriquement de part et d’autre de son visage.
Et puis ce merveilleux voile qui est doté de ses plis nombreux. Regardez sous le menton, le nombre de plis extrêmement fins alors qu’on sait que le marbre est un matériau extrêmement dur. Ce qui est intéressant aussi, c’est de considérer le caractère commémoratif. On se souvient, de cette Clémence Isaure de par ses yeux vides, et le socle qui est décoré d’une lyre, parce qu’elle inspirait les poètes, et qui est également décoré de toutes ces fleurs qui étaient les petits trophées, les récompenses que les artistes, les écrivains, les poètes recevaient chaque année au mois de mai.
Marthe Pierot : Alors l’existence de Clémence Isaure est un petit peu remise en cause. C’est un petit peu une légende, un mythe toulousain.
[Illustration : Louise Joséphine Sarazin de Belmont, “Vue de Naples”, 1842, peinture]
Marthe Pierot : On retourne à la peinture. Cette fois-ci on a un très beau paysage sous les yeux, réalisé par Louise Joséphine Sarazin de Belmont. Une peintre paysagiste qui était l’élève de Pierre Henri de Valenciennes, qui lui aussi était un peintre paysagiste toulousain. Ce qui est intéressant, c’est que comme David, il ouvrait son atelier aux femmes et il enseignait notamment la peinture de paysage.
Sarazin de Belmont été fascinée par ce genre et a développé un goût très prononcé pour le paysage, pour la lumière. Elle va beaucoup voyager pour justement perfectionner un petit peu son étude de la lumière. Elle voyage seule, en Europe, mais aussi dans les Pyrénées où elle va pendant 3 mois s’enfermer dans une cabane perdue au loin dans la montagne pour étudier les variations de la lumière tous les jours au fil des saisons.
On comprend le tempérament de cette jeune femme très déterminée. Ici, quand on regarde la baie de Naples qu’elle nous propose, on comprend vraiment sa passion pour la lumière. Regardez cette douce lumière qui est plongé dans la baie, mais aussi cette très belle perspective atmosphérique. Au premier plan, tout est très sombre et dense, et à mesure que l’on s’éloigne, tout semble se dissiper, la couleur est plus claire, plus diluée. Regardez le Vésuve au loin, qui semble se fondre à l’horizon. On a Naples, qui est très justement représenté. C’est un tableau qui nous parle d’une ville avec une vérité topographique. Elle a vraiment étudié cette ville. Elle est allée à Naples.
Isabelle Bâlon-Barberis : Mais, et ce petit personnage en rouge qu’on aperçoit ?
Marthe Pierot : C’est vrai, on ne peut pas ne pas l’avoir vu. Effectivement, il y a quand même une petite anecdote dans ce paysage, parce qu’elle nous parle de Naples, certes, mais elle nous parle de cette femme en rouge qui était son amie. A la mort de son amie, elle décide de réaliser plusieurs tableaux pour lui rendre hommage. Regardez ce qu’elle fait, quand on s’approche un petit peu, on voit qu’elle donne de l’argent à une famille de mendiants. Elle représente ici son ami comme quelqu’un de très charitable, c’est une allégorie de la charité.
[Illustration : Félicie de Fauveau, “Portrait de François Bautte”, 1845, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : À la sculpture à nouveau avec Félicie de Fauveau et ce buste d’enfant. Il est question ici d’un buste pour commémorer ce petit garçon mort en bas âge, très certainement. Vous voyez cette couronne mortuaire qui se trouve en dessous de sa poitrine. Vous avez ici une vraie référence à la Renaissance italienne. Cette époque où on inscrivait les visages sur un fond rainuré de coquilles. Un clin d’œil à cette époque-là, une œuvre extrêmement douce. Cependant Félicie de Fauveau était d’un caractère de feu.
Marthe Pierot : Ça ne représente pas du tout son tempérament, cette douceur-là.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai. En fait on l’appelait l’Amazone. C’était une femme assez indomptable, elle, comme George Sand d’ailleurs, s’habiller en homme, portait les cheveux courts et revendiquait vraiment son indépendance. D’ailleurs, elle s’est engagée en tant que monarchiste, elle a fait de la prison pendant pas mal de mois. C’est quelqu’un qui, en étant parfaitement autodidacte, crée-là vraiment une nouveauté. On est au milieu du 19e siècle, les choses évoluent et on sait qu’elle n’a eu aucun professeur particuliere. Elle n’a pas eu un cadre familial qui aurait pu favoriser sa formation. Elle est autodidacte, je le répète, mais c’est important.
Marthe Pierot : C’est important parce qu’on voit vraiment que tous ces parcours de femmes sont différents.
[Illustration : Berthe Morisot, “Jeune fille au parc”, 1888, peinture]
Marthe Pierot : Ici, on a Berthe Morizot, qui elle, a grandi dans un cadre privilégié, à la différence de Félicie de Fauveau. Berthe Morizot, on entend parler de plus en plus d’elle. C’est une des figures clés du mouvement impressionniste. L’impressionnisme en histoire de l’art, c’est vraiment un mouvement qui marque une rupture avec les traditions académiques qui proposent des tableaux en extérieur avec des traits de pinceau très visibles, ce qu’on appelle la touche. C’est une nouvelle manière de peindre, c’est une nouvelle technique et ce sont des palettes qui sont très colorées.
Berthe Morizot, faisait partie de ce mouvement, elle était même une des fondatrices de ce mouvement, donc elle est reconnue vraiment de son vivant. Alors elle naît dans la bourgeoisie, je l’ai dit, dans un contexte un petit peu favorable à l’art, car son père était peintre, et donc avec sa sœur Edma, elles vont toutes les 2 se former auprès de grands noms, notamment Corot. Mais à la différence d’Edma, qui va arrêter de peindre quand elle se marie, Berthe Morizot n’arrêtera jamais. C’est vraiment très important pour elle de toujours continuer à peindre, même quand elle se mariera plus tard avec le frère d’Edouard Manet qu’est Eugène Manet. Et justement en parlant de Manet, elle rencontre Manet au Louvre, et entre les 2, entre Berthe et Manet, il y a une amitié qui naît, mais une amitié un petit peu encombrante. On sait qu’elle devient la muse de Manet, mais on sait aussi que Manet intervenait beaucoup sur l’étoile de Berthe Morizot. Là y a cette idée, un peu de domination ou de d’appropriation qu’on peut beaucoup retrouver dans les duos, homme/femme de peintre. Elle était quand même considérée et respectée de ses amis, mais on est quand même dans une période où le mépris des femmes peintres atteint des sommets, il ne faut pas oublier, même si on approche de la fin du 19e siècle. Alors rapidement ici, elle nous propose ce portrait de jeune femme dans un parc où la végétation est extrêmement foisonnante. La végétation prend beaucoup de place. Il y a quelque chose de très frais, de très naturel et de très sauvage dans cette peinture. Ce qui est impressionniste, c’est ça aussi cette idée de retranscrire un climat et une ambiance, une fraîcheur. C’est tout à fait agréable à regarder et très rafraîchissant.
[Illustration : Matylda, “tête d’homme”, 1884, sculpture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Parlons à nouveau sculpture avec cette tête sculptée, c’est le nom que cette œuvre porte, réalisée par une femme qui s’appelait Matylda. C’est une polonaise, on sait très peu de choses d’elle, elle est très peu répertoriée. Mais quel talent. Alors c’est une œuvre un petit peu différente de toutes celles qu’on a pu présenter pour, disons, l’histoire de son arrivée au musée des Augustins. Parce que c’est une acquisition relativement récente qui date de 2018.
C’est un véritable coup de cœur, qu’ont ressenti les 2 conservateurs du musée des Augustins, pour cette tête romantique en marbre blanc. Romantique parce que regardez la manière dont les cheveux sont traités, cette mèche sur le front libre, et puis ces cheveux et ces boucles à l’arrière de l’oreille, c’est somptueusement rendu. C’est une tête qui est pleine d’intériorité, dont la force dégage une gravité. D’autant plus que le visage est penché. Pourtant on ne sait rien de l’identité de cette tête. On a pensé que ça pouvait être le Christ en croix, dont la tête retombe sur la poitrine. Mais vous voyez, le vêtement est doté de ce petit bouton sous la barbe, donc ce vêtement-là, qui semble une petite chemise, n’est pas celui que porterait Jésus. En tout cas ce n’est pas l’essentiel. De toute façon, l’essentiel c’est justement l’impact de ce visage qui est très fort.
Marthe Pierot : Voilà. Et la volonté de conservateurs de continuer à enrichir les collections du musée de cette façon-là par des artistes femmes.
Isabelle Bâlon-Barberis : Tout à fait.
[Illustration : Amélie Beaury-Saurel, “Dans le Bleu”, 1894, peinture]
Marthe Pierot : Alors on revient à la peinture pour vous parler d’Amélie Beaury-Saurel. C’est important de préciser que cette femme, Amélie Beaury-Saurel, est la première des femmes que l’on vous a présentée jusque-là, qui va enfin intégrer une formation officielle, qui va rentrer dans une institution, dans une école. Ce n’est pas un atelier ouvert aux femmes ou un peintre, un père peintre, ici, c’est vraiment une formation. Elle va être à l’Académie Julian qui est une école qui était ouverte aux Femmes, ça c’est assez rare.
Mais alors attention Messieurs Dames, l’égalité n’est quand même pas parfaite puisque le prix pour rentrer dans cette école était le double pour les femmes. En tout cas, elle a pu étudier là-bas et elle se Marie au directeur. Elle reprend la direction de cette académie en 1907 et toute sa vie, Amélie Beaury-Saurel va se battre pour l’égalité des sexes. C’est une militante. Mais surtout, elle va tenter de soutenir au maximum l’éducation artistique pour les femmes. Elle veut vraiment encourager leur carrière professionnelle. Et c’est ce qu’elle fera quand elle sera à la direction de l’Académie Julian. On comprend ses engagements et ses positions quand on regarde ce très beau portrait de femme libérée. Regardez, elle ne nous regarde pas déjà, elle n’est absolument pas guindée, elle est décontractée. Elle rêve, elle fume, elle boit du café. Normalement ce sont les hommes qui font ces activités-là, et bien elle, elle s’en moque un petit peu de notre regard. Finalement, elle ne pose pas, ce n’est très probablement pas une commande. Amélie Beaury-Saurel a voulu saisir un moment volé, un instant, parce qu’elle était touchée par cette femme. En tout cas, elle échappe complètement au code de la bienséance parce qu’elle n’a pas cherché à s’habiller pour être représentée. Elle assume de se présenter en tenue d’intérieur et ça c’est intéressant. On a vraiment le regard d’une femme engagée qui peint une autre femme et ça c’est tout à fait intéressant. Et on a même envie un petit peu de se demander est ce que ce n’est pas un petit peu elle qu’elle peint finalement ?
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est peut-être son reflet, elle lui ressemblait assez.
[Illustration : Camille Claudel, “Paul Claudel en jeune romain”, 1895, sculpture]
Marthe Pierot : Et donc on va terminer avec une dernière sculpture.
Isabelle Bâlon-Barberis : Absolument. On va terminer avec cette sculpture réalisée par Camille Claudel. Camille Claudel est une très grande créatrice. Une femme qui fait ses choix, mais une femme qui va rencontrer de nombreux freins. Il est évident qu’être une femme artiste dans un monde d’hommes, c’est difficile. Marthe vous en a beaucoup parlé, mais c’est vrai que même au sein de sa famille, c’était compliqué. Sa mère ne rêvait pour elle que d’un mariage. Son père était son allié, mais elle va perdre son père, son père ne va pas mourir si tôt que cela, mais ce sera vraiment difficile pour elle de perdre cet allié. Elle va entrer dans un atelier mixte et l’atelier, c’est celui de Rodin. C’est très intéressant de le dire. Elle a été l’élève de Rodin, elle a été sa muse et elle a été son amante. C’est vrai que cette rencontre avec Rodin est véritablement décisive pour son or, pour son art et son or aussi. Le lapsus est révélateur. Mais elle est dans l’ombre de Rodin, ça c’est sûr. Elle vit de déchirement, puisque justement dans son couple et dans sa vie, rien n’est évident. C’est important de dire également que c’est quand elle se sépare de lui qu’elle réalise des œuvres et qui sont les plus fortes. Je pense que c’est important de le souligner. Ce sont des créations qu’elle réalise vraiment en solitaire. Et d’ailleurs elle est malade de solitude. La concernant, c’est important de dire qu’il a fallu dans les années 1980, un livre et un film pour la réhabiliter et pour qu’on s’aperçoive du talent et du génie qu’avait cette femme.
Marthe Pierot : Parce qu’elle était trop souvent associée à Rodin et oublier.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, complètement dans son ombre. Ici, quand elle fait le portrait de son frère, Paul Claudel en jeune Romain, étant donné, vous voyez la mèche de cheveux qui revient en pointe sur le front et la toge qui habille les épaules de de ce buste, elle nous parle d’un petit garçon et puis d’un homme qu’elle a beaucoup aimé, qu’elle a beaucoup admiré. Elle l’héroïse d’ailleurs d’une manière tout à fait flatteuse avec cette œuvre en bronze.
Marthe Pierot : Oui oui, parce qu’on vous a montré beaucoup de marbre. Là on vous montre le bronze, matériau très utilisé par Camille Claudel et qui lui permettait justement de jouer avec la lumière, ce qui rend l’œuvre très vivante.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, très vivante et très belle. Mais justement, Paul, son frère, qui va devenir l’écrivain qu’on sait, dans cette famille-là, c’est lui qui était l’artiste. Il n’en fallait qu’un et c’était lui, le choix était facile à faire. C’est quelqu’un cependant qui ne va pas véritablement la soutenir, ou alors pas aussi fort qu’on l’aurait souhaité, puisqu’on sait qu’elle a passé 30 années de sa vie internée, 30 années perdues pour la création mais ça, c’est tragique.
Marthe Pierot : Bien sûr, elle a une vie très tragique. Alors qu’on arrive à la fin du 19e siècle, on pourrait se dire que ça va mieux, finalement on se rend compte quand même que pour Camille Claudel, c’était très difficile d’affirmer ses choix d’être une artiste femme et de se revendiquer comme tel dans un milieu et dans un système très patriarcal. Mais on va essayer d’ouvrir et d’être un petit peu plus positive et encourageante et revenir vers vous pour conclure.
Vraiment se dire qu’à partir du 20e siècle quand même, beaucoup de choses vont se débloquer. Heureusement, et il y a des dates qui sont importantes qui contribuent vraiment à cette émancipation. C’est notamment 1944 le droit des votes pour les femmes et puis 1946 la Déclaration des droits de l’homme qui garantit à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Donc de plus en plus de femmes artistes vont s’assumer.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai, et au 20e siècle on peut citer les femmes artistes, on a beaucoup de noms qui nous reviennent. On pense à, par exemple, Tamara de Lempicka en Pologne, on pense à Frida Kahlo au Mexique, en France, on pense à Suzanne Valadon, on pense à Niki de Saint Phalle qui nous a quitté il y a peu. Il y a tellement de noms. Mais si vous voulez, au musée des Augustins, nous ne les avons pas évoqués parce que nos collections s’arrêtent au tout début du 20e siècle et c’est pour ça que nous n’avons pas abordé donc ces femmes du 20e.
Marthe Pierot : Donc les choses évoluent petit à petit, mais c’est encore un combat, vraiment il faut une réelle revendication pour ces femmes, pour pouvoir exister en histoire de l’art, pour être représentées dans les musées, ce n’est pas gagné quand même. On sait aussi qu’au niveau du marché de l’art c’est compliqué, elle ne représente que 2% du marché, selon une étude en 2019, donc c’est vraiment très faible. C’est encore une lutte, c’est encore un combat. C’est important, toujours, d’en parler pour que ça rentre dans la norme. Ces femmes artistes qui ont existé. Et avec Isabelle, on a envie de se dire que dans l’idéal, on aura atteint l’égalité pleine et entière quand on n’aura plus besoin de préciser si une œuvre a été créée par une femme ou pour par un homme. Quand on pourra enfin dégenrer l’art et la création, ça serait super, mais on n’y est pas encore et on a encore besoin de combat.
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors ce combat, il peut être mené par les musées et notamment le musée des Augustins, en tentant d’acquérir des œuvres réalisées par des artistes femmes, il les rend visibles, il leur donne cette visibilité.
Marthe Pierot : Ouais, et c’est le rôle du musée.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est son rôle.
Marthe Pierot : Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir suivi pour cette très belle thématique. Et puis à bientôt pour une prochaine conférence,.
Isabelle Bâlon-Barberis : on l’espère. Au revoir.
Irrésistible clair-obscur
Irrésistible clair-obscur
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Irrésistible clair-obscur : la peinture caravagesque au musée”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2022]
Marthe Pierot : Messieurs dames bonjour,
Isabelle Bâlon-Barberis : Bonjour
Marthe Pierot : Et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne du musée des Augustins.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau thème “Le Caravagisme les caravagistes”
Marthe Pierot : Exactement ? Et alors dès qu’on prononce le mot de caravagisme ou de Caravage, et bien tout de suite, il y a un véritable succès, c’est l’adhésion immédiate. Il y a un véritable engouement. Mais Caravage, qui est-ce ?
Isabelle Bâlon-Barberis : En fait il s’appelait, Michelangelo da Caravaggio. En fait, vous savez bien que Michel-Ange c’est déjà pris. Donc on va l’appeler du nom de son village de Lombardie où il naît à la fin du 16e siècle. C’est important de dire qu’il va connaître un succès foudroyant d’emblée. Et tant de peintres vont dans son sillage peindre. Ça va donner même le mouvement qu’on appelle le caravagisme
Marthe Pierot : Exactement. Et alors, pourquoi tant de fascination autour de ce peintre justement ? Et bien parce qu’il a tout du peintre maudit. Il est à la fois génie et voyou.
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors, il est un génie parce que il peint autrement. C’est une utilisation révolutionnaire de la lumière qu’il fait. Il va peindre salon des contrastes très marqués. Ce clair-obscur qu’on appelle également le ténébrisme. Et c’est vrai qu’il va avoir envie aussi de mélanger les gens de la rue et les gens de la Bible en allant à l’essentiel. Il n’a pas du tout l’obsession du beau, il veut le vrai.
Marthe Pierot : Tout à fait, mais il est aussi voyou parce que justement sa vie est faite de turbulences. Il est maître de scènes sanglantes. Le crime fait complètement partie de sa vie, en fait, il a tué un homme lors d’un duel et il sera condamné à mort pour ça. Il va passer le reste de sa vie en cavale et il meurt à 38 ans. Donc hein, pour vous dire un petit peu le tempérament de cet homme.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai. Alors en fait, pourquoi tant de peintres suivent son sillage.
Marthe Pierot : C’est un peu notre sujet.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, absolument. Alors c’est vrai que les peintres ont envie d’en finir avec cette idéalisation. Ils ont envie de rompre avec le maniérisme de la peinture qui a précédé, la préciosité. Et puis c’est vrai que des peintres le suivent parce que les peintres vont faire ce voyage en Italie. Il y a ce voyage initiatique et quand il découvre Rome, donc autour de 1600, 30% de la peinture qui se fait à Rome, c’est de la peinture caravagesque. Donc évidemment ça leur donne des idées. Mais il faut savoir que 30 ans après la mort de Caravage, on est en 1640, il tombe dans l’oubli. Et il faut attendre le début du 20e siècle en fait, pour qu’on oublié un petit peu sa vie sulfureuse et qu’on considère combien il était un génie. Et pourquoi ?
Marthe Pierot : Tout à fait. Alors, juste pour bien comprendre une définition rapide du caravagisme. C’est donc ce mouvement pictural qui naît au début du 17e siècle et qui caractérise tous ces peintres qui vont suivre l’esprit de Caravage et qui dure donc très peu de temps finalement, 30 ans. Et pour bien illustrer tout ça, on a choisi de commencer par vous montrer un visuel de Caravage. Attention, il n’est pas au musée des augustins, on aimerait, mais c’est pour vraiment bien illustrer un petit peu l’esprit du caravagisme.
[Illustration : Caravage, “L’arrestation du Christ”, 1602, peinture]
Marthe Pierot : Alors ici, vous avez donc un tableau de Caravage qui se trouve donc à Dublin, qui s’intitule l’arrestation du Christ. Et donc là, on peut bien comprendre ce mouvement quand on voit justement ces fameux puissants contrastes de clair-obscur. Vraiment, cette lumière qui est dirigée comme un projecteur sur les visages des personnages qui ressortent sur un fond très très sombre. Et le fond très sombre justement, nous empêche et bien d’aller trop loin et surtout permet aux personnages d’être très proche de nous. En plus de leur dimension en taille réelle, grandeur nature et ce cadrage si propre à Caravage. Ce cadrage qui est coupé à mi-corps. Donc on a le drame de la scène, le drame de l’éclairage. On repère aussi évidemment les traits qui sont extrêmement réalistes. Caravage, comme vous l’a dit Isabelle, il peint les gens du peuple, ils cherchent à faire vrai. Regardez les rides, les expressions sur les visages, la vérité des mains. Mais aussi surtout l’empressement, la force du mouvement avec toutes ses têtes qui se chevauchent et se superposent dans cette composition en largeur. Donc là vous avez un peu compris qui était Caravage.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui exactement. Alors maintenant, si on revient au musée des Augustins, et bien on est devant un tableau qui a exactement les mêmes dimensions que celui dont Marthe vient de vous parler.
[Illustration : Wenceslas Coebergher, “Ecce Homo”, 1604-1610, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est un tableau qui fait donc et bien 133 cm sur 170. Voilà donc c’est assez troublant parce que c’est la même dimension que l’œuvre de Caravage. Ici, il est question d’un tableau qui s’appelle “Ecce Homo”. Un tableau en fait qui représente et bien 3 sujets à la fois. Le premier sujet, c’est la présentation du Christ au peuple par Ponce Pilate. Ponce Pilate présente Jésus à la foule. C’est un sujet fréquent en peinture. Mais vous avez également un autre sujet qui est celui du Christ aux liens ou également aux outrages. En fait, à gauche, un homme est occupé à lier le Christ à une colonne tronquée avec des liens, c’est à dire de la ficelle. Et enfin, le 3e sujet, c’est la flagellation. Vous avez le corps triomphant de Jésus. Ses vêtements déchirés et des hommes qui préparent ces verges, qui sont des baguettes en bois de bouleau. Donc en fait, on a 3 sujets en un seul.
Et vous avez comme chez Caravage ici, un cadrage qui va à l’essentiel. Les personnages sont coupés à mi-corps et on a l’impression donc de pouvoir les toucher, d’être directement très proche d’eux. C’est une volonté de faire participer les fidèles à la souffrance de Jésus. Donc notre regard ne peut pas se perdre dans un paysage, une ville ou des détails extérieurs. On est tout de suite avec eux. Donc, comme chez Caravage également, il y a de nombreux personnages qui se massent. Vous avez donc 2 soldats à gauche qui ferment la composition. Vous avez des personnages dont les mains sont veinées. Des mains qui sont rougis. Et ça c’est en fait vraiment le réalisme. Et vous avez la virilité. La pure énergie musculaire des bourreaux.
Donc vous avez un Coebergher qui va en tant que peintre, nous proposer un sujet qui est dans son œuvre très isolé parce que lui il était architecte, ingénieur, il était beaucoup de choses. Mais là en fait il traite de ce sujet-là. Alors ce n’est pas du tout caravagesque que cet anachronisme. Les 2 personnages que vous avez à droite du tableau qui sont présents dans la scène, alors qu’ils ne sont pas du tout des personnages du premier siècle de notre ère. Un archaïsme, c’est le support en bois qui est une pratique médiévale. Mais au 17e siècle, on abandonnait peu à peu le support en bois. Et puis quelque chose qui n’est pas caravagesque, c’est ce turban à la turque porté par Ponce Pilate, le personnage central. Un Caravage n’a pas recours à ce type de couvre-chef. Donc vous n’avez pas non plus un clair-obscur violent. La lumière est relativement égale sur l’ensemble du tableau et vous n’avez pas, comme Marthe vous en a parlé tout à l’heure, ces convulsions, ces empressements, cette urgence. Donc vous voyez ici, le caravagisme est tout à fait à nuancer.
Marthe Pierot : Tout à fait. Alors on continue avec ici cette fois-ci un portrait.
[Illustration : Nicolas Tournier, “Un soldat”, vers 1630, peinture]
Un portrait en demi-figure et il est typiquement caravagesque parce que regarder ces effets de lumière qui donnent une tension très dramatique. Son visage est très éclairé, le fond est très sombre, donc on a un vraiment un soldat qui est isolé sur fond uni. Et on retrouve un petit peu le costume de fantaisie qui est mis à la mode par Caravage. C’est à dire cette armure aux reflets très brillants comme le tableau de « L’arrestation du Christ », si vous vous rappelez de l’armure, mais aussi et bien le chapeau à plumes. Alors l’idée ici, ce que Nicolas Tournier, le peintre a voulu faire, c’est vraiment de nous parler d’une expression, d’une vérité, d’une œuvre pris sur le vif.
Regardez le visage de ce soldat, les rides sur son front, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte. Voilà, on a vraiment l’impression qu’il vient de se retourner. Tout est en tension et tout est en mouvement. Regardez en fait son geste. Il y a probablement une épée qu’il est prêt à dégainer. L’épée est suggérée ici, mais on le comprend tout à fait. Donc il y a beaucoup de vérité encore une fois. Finalement, Nicolas Tournier nous parle plus de l’archétype d’un soldat très vivant qu’une personne en particulier. On ne sait pas qui il est. Mais ce qu’on sait, c’est qu’il se servait très souvent de ces personnages isolés pour ensuite les replacer dans des compositions à plusieurs personnages. Voilà, il faisait ce réemploi là. C’était très courant. Mais alors Nicolas Tournier, qui est-il ? Pour vous dire quelques mots sur lui parce qu’on va souvent parler de ce peintre. Et bien c’est un peintre de Franche-Comté qui va séjourner 7 ans à Rome et à ce moment-là il sera donc très influencé par le clair-obscur. Mais on peut dire de lui qu’il y a 2 grandes périodes dans sa vie. Une à Rome mais ensuite une à Toulouse où il va aussi beaucoup travailler. Mais on peut dire que c’est vraiment un peintre du silence, de la retenue et de l’émotion et même du ténébrisme. Et c’est peut être en lien avec sa religion protestante. Mais ça on vous en parlera après.
Juste pour terminer sur ce tableau, vous avez aussi une harmonie chromatique qui est très très belle, avec justement des gammes de gris et de métal ponctués de notes chaudes comme le jaune du vêtement, le roux de la barbe et des jeux de matière tout à fait intéressants entre le métal ou la plume par exemple.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai. Alors maintenant on va continuer avec un beau portrait féminin cette fois.
[Illustration : Valentin de Boulogne, “Judith”, vers 1625, peinture]
Il est question d’une Judith. C’est Valentin de Boulogne qui l’a réalisé. Ce peintre est le plus grand des caravagesques français. Toute son existence d’artiste va se dérouler à Rome. Il a connu de grands honneurs là-bas. Il a même peint pour Saint-Pierre de Rome au Vatican. Alors il était le professeur de Tournier, le peintre dont Marthe vient de vous parler. Et ce tableau-là a été accroché dans la chambre de Louis 14. Excusez du peu. Alors Judith. Elle est ce personnage qui délivre le peuple juif, son peuple, en tuant le général Holoferne. Nous sommes en Palestine au 6e siècle, donc avant Jésus Christ. Alors le sujet, il est caravagesque, étant donné que le Caravage a beaucoup traité, et bien cette Judith et Holoferne. Mais ici, il n’y a pas de violence, il n’y a pas ce côté sanguinolent. Vous avez ici et bien une lourde somnolence justement du personnage de Judith. Il y a un contraste entre sa beauté et la richesse des accessoires, des bijoux, le le bouillonnement des étoffes. Sa féminité est ici tout à fait assumée. Et elle contraste avec l’horreur de ce qu’elle vient de faire. Cette Judith est encore dans la tension de la lutte et de l’énergie qu’elle a déployée. Et elle est aussi déjà dans cette gravité d’une victoire qui lui coûte évidemment. Donc simplicité de la mise en page, cette figure est isolée à mi-taille, et vous avez en fait son doigt pointé qui souligne le rôle exemplaire de son acte. Vous voyez, elle est une allégorie de la justice. Vous notez au niveau de son index en haut à gauche du tableau, cette trace de repentir, comme Caravage. Et bien, Valentin de Boulogne ne fait pas de dessin préparatoire. Si bien qu’il est amené à rectifier sur son tableau. Donc un geste.
Marthe Pierot : Tout à fait, c’est effectivement ce qu’on appelle un repentir. Alors on continue, et cette fois-ci on va parler d’une violence qui n’est pas suggérée, comme le tableau précédent, mais une violence qui est bien réelle, qui est concrète et même directe.
[Illustration : Le Guerchin, “Martyre de Saint Jean et Saint Paul”, 1632, peinture]
Marthe Pierot : Il y a quelque chose de beaucoup plus cru dans ce tableau réalisé par Le Guerchin. Donc on l’appelait ainsi, mais il s’appelait Barbieri mais on ne connaît plus sous le nom du Guerchin. Et donc là vous avez le martyre de Saint Jean et Saint Paul qui est présenté ici. Alors Le guerchin, c’est un peintre italien qui a vraiment 2 styles, 2 périodes dans sa vie. Mais avec ce tableau, on est encore au début de sa carrière où il travaille énormément, les couleurs chaudes et les effets de lumière qui sont en fait assez nuancés. Finalement, on a un contraste mais qui est beaucoup plus calme que ce que Caravage aurait pu proposer. Avec bien sûr plus de violence pour Caravage. Mais on a cette même référence à la vérité et à la violence. La scène du martyre que vous avez en bas est très très dure et sans concession. Regardez le geste précis et déterminez de ce bourreau à la musculature très étudiée, qui prend beaucoup de place et pourtant qui est de dos. Et on a vraiment des scènes aussi brutales et directes chez Caravage. Tous les 2, ils cherchent la beauté dans la sublimation de la laideur et de la violence. Mais alors justement, quel est ce sujet ? De quoi on parle ? Vous avez vu le titre, on vous l’a dit, Saint Jean et Saint Paul, mais ce ne sont pas Jean et Paul que l’on connaît habituellement, c’est à dire l’Évangéliste et l’apôtre. Ici, il s’agit de 2 frères romains martyrisés. Ils ont été décapités en l’an 363 parce qu’ils n’ont pas voulu vénérer les idoles. Ils étaient chrétiens à une époque où ce n’était pas accepté. Donc ils se retrouvent décapités. Mais c’est une histoire qui est très rare, qui est très peu représentée dans l’histoire de l’art occidental. Et donc le peintre avait beaucoup de liberté pour réaliser ce tableau car il y a peu de référence à cette histoire-là.
Donc on peut vraiment voir un tableau qui est divisé en 2 parties. Vous avez la partie inférieure qui est heurtée et spectaculaire, mais la partie supérieure qui est beaucoup plus tempérée et classique. Regardez cette vierge à l’enfant qui occupe la moitié du tableau. Et pourtant, elle a beau être -à, elle est très distante et elle n’atténue absolument pas l’horreur de la scène qui se déroule à nos pieds. Le crime a quand même lieu. Par contre, on peut remarquer derrière elle finalement la couleur des nuages. Tout est en feu, on a l’impression qu’il brûle.
[Illustration : Nicolas Tournier, “Portement de la croix”, après 1635, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis :
Alors je vous propose de continuer à présent avec un tableau qui s’appelle “le portement de croix” et nous retrouvons Nicolas Tournier, ce peintre du soldat dont Marthe vous a parlé. Donc vous avez dans ce tableau une énergie de l’homme, une tension de celui qui porte la croix. Bien sûr, c’est Jésus. Et puis sur la gauche, vous avez ce soldat tout caravagesque dans le reflet de son armure. Il y a cette composition moderne ce cadrage étonnant et étroit. Caravage donc aurait néanmoins utilisé beaucoup plus de noir pour le fond notamment, et les chairs auraient été beaucoup plus blanches. Le contraste aurait été plus fort. Tournier qui est rentré d’Italie et bien n’est plus en concurrence avec tous les peintres romains. Et il reprend un petit peu son style à lui. Il se fait un peu plus archaïque. Son protestantisme austère et dépouillé réapparaît. La composition, vous voyez, est un peu raide, voir géométrique. Au cours de ces dernières années, Tournier abandonne le caravagisme au profit de ce style un petit peu austère, d’une très belle simplicité, mais qui n’aura pas de descendance en peinture. En tout cas, vous notez bien la force de l’oblique, de même bras tendu vers le bas, celui du soldat et celui du Christ. Chaque personnage est isolé dans sa réaction face à l’épreuve. Vous avez des visages très impassibles. Vous avez une belle éloquence des mains et vous n’avez donc aucune concession qui soit faite au pittoresque. Parce que le fond est sombre, il ne s’y trouve rien et le fond est bouché. On est comme enfermé et il y a donc une partie des visages dans l’ombre. Ce tableau est assez bouleversant dans sa simplicité et l’univers de Caravage serait en fait plus physique, plus théâtral. Mais nous sommes chez donc Tournier ici. Et c’est vrai qu’on a cette notion de silence et de retenue.
Marthe Pierot : D’ailleurs il y a une petite anecdote sur ce tableau qu’on pourrait dévoiler.
Isabelle Bâlon-Barberis : Effectivement parce que ce tableau c’est l’histoire d’un portement de croix retrouvé. Parce que ce qui s’est passé c’est que on a vu jusqu’en 1818 et bien dans les registres, les collections du musée ont ce tableau. Et puis voilà que ce tableau disparaît mais qu’on le retrouve en 2009. C’est une galerie de Londres qui vient de l’acheter à Florence. On considère que l’œuvre est un caravagesque anonyme. Alors le musée des Augustins va être contacté pour identifier cette œuvre. Et au bout d’un certain temps, on va se dire que c’est bien un Tournier et qu’il appartenait à l’Église toulousaine qui était l’Église des Pénitents noirs. Mais il nous faudra donc encore du temps et notamment attendre 2017 pour que cette œuvre revienne au musée des Augustins.
Marthe Pierot : C’est un peu compliqué mais il a disparu au 19e et il revient en gros en 2017 au musée.
Isabelle Bâlon-Barberis : Mais c’est pour ça que peut être a-t-il été volé et donc il a été redécoupé donc le cadrage est peut être un petit peu plus étroit que dans le tableau de départ.
[Illustrations : Nicolas Tournier, “Saint Pierre”, vers 1625, “Saint Paul”, vers 1630, peintures]
Marthe Pierot : Voilà. Alors à présent nous aimerions rester avec Nicolas Tournier, mais vous présenter une confrontation ou une comparaison avec ces 2 tableaux, ces 2 portraits d’apôtres, ces 2 figures isolées à mi-corps. Moi je vais commencer par celui qui se trouve à gauche, c’est à dire Saint Pierre. C’est une acquisition très importante pour le musée des Augustins. Et ce qui est encore une fois caractéristique de Nicolas Tournier, c’est de retrouver la simplicité de la mise en scène. Ce mur nu, le dépouillement qui est propre au peintre. Il ose le vide, il n’y a rien derrière ces deux saints. Donc encore une fois, on a cette référence à sa religion protestante aussi. On retrouve également pour ces 2 tableaux, le jeu d’éclairage dans ce typique clair-obscur caravagesque avec des visages extrêmement éclairés sur un fond très sombre. Mais alors Pierre, qui est il ? Et bien, c’était le disciple de Jésus et il deviendra apôtre. Alors à la base il s’appelait Simon, mais Jésus le nomme ainsi car il le choisit pour poser ou fonder la première Pierre de l’Église.
17:41
Voilà, et il lui confiera même les clés du paradis, les clés du Royaume du ciel. Et c’est pour ça qu’il a cette grande clé dans la main, si vous la distinguez. Alors ce qui est très beau de voir, c’est justement la réalité de son visage. Ses rides profondes qui sont soigneusement dessinées sur son front et autour de ses yeux. Mais aussi de la maigreur de ses mains. En fait, il nous touche avec son humanité, ce Saint Pierre, et ce regard empreint de doutes nous rappelle un petit peu l’histoire de cet apôtre. Qui en fait a renié avoir connu le Christ au moment de son arrestation. Mais bien sûr, après, il le regrette, il se repent par la suite. Mais là, Nicolas Tournier a envie d’appuyer sur cette humanité fragile, sur cette terrible fébrilité, la faiblesse de ce corps décharné. Finalement, il y a une force dans son regard, mais une vérité dans la vieillesse qui est tout à fait touchante et juste. On note aussi le le doigt levé vers le ciel, un peu comme notre Judith de tout à l’heure.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai. Alors maintenant, moi je vais vous parler du tableau que vous avez sur votre droite avec cette figure isolée, comme pour Pierre à l’instant donc vous avez ici Paul avec à l’intérieur de son bras, l’épée de sa décapitation et également ce rouleau de papier. Paul est un personnage qui est cabossé par la vie et c’est celui qui se convertit soudainement après une vision aveuglante de Jésus. Ensuite il va étudier, il va méditer. Et Paul, et ce juif, ce citoyen romain de Rome qu’on appelait Saül, qui persécutait les disciples de Jésus avant de se revendiquer lui même apôtre. Donc, au cours de sa mission itinérante qui va s’étaler entre les années 40 et 60 du premier siècle de notre ère, et bien, il va écrire de nombreuses lettres, et ce qui est important, c’est que ces lettres pauliennes, comme on les appelait, et bien, sont écrites avant les Évangiles, et ce sont les documents les plus anciens du christianisme. D’où le rouleau de papier, d’où l’importance du blanc, de la lumière qui est renvoyée par ce rouleau de papier blanc. Ca c’est très très important. Alors vous avez une expression, tellement humaine du personnage visage barbu, avec forme très arquées des sourcils, un front ridé ici aussi. Et c’est vrai que il est très proche du soldat dont Marthe vous a parlé au tout début de cette présentation. On dirait son frère ou lui même. En tout cas, c’est vrai que il est considéré comme une des plus belles demi-figures de Nicolas Tournier.
[Illustration : Mathias Stomer, “Adoration des mages”, avant 1640, peinture]
Marthe Pierot : Alors on va quitter un petit peu Nicolas Tournier pour parler d’un autre peintre et d’une composition avec beaucoup plus de personnages cette fois-ci. Il s’agit d’un tableau réalisé par Matthias Stomer. Stom on l’appelle aussi stomer. C’est un peintre du siècle d’or hollandais, c’est à dire de la première moitié du 17e siècle qui est considéré comme l’un des meilleurs représentants de l’école caravagesque d’Utrecht.
C’est une ville qui se trouve aux Pays-Bas et en fait on comprend que même jusque dans les Pays-Bas, et bien on peignait avec le style de Caravage. Le Caravagisme allait bien jusqu’au nord. Donc ce peintre fait sa carrière en Italie, à Rome, puis à Naples, et il va jusqu’en Sicile. Et il travaillait beaucoup pour les peintures d’églises, et il réalisait des grands sujets bibliques avec une prédilection pour le scène nocturne, comme on peut le voir ici. Où on a justement des lumières qui sont très contrastées, un fond très sombre, des coloris vifs et riches pour nous parler des Rois mages. En effet, ici vous avez les Rois mages qui viennent rendre visite à l’enfant Jésus pour apporter des présents. Regardez, vous avez Melchior, celui qui est à genoux au centre de la composition qui apporte de l’or, mais vous avez derrière lui Gaspard, le plus jeune qui offre de l’encens et Balthazar juste à côté qui offre de la myrrhe. Et ces 3 Rois mages ont été guidés par l’étoile. L’étoile que vous pouvez remarquer en haut à gauche du tableau avec un des rayons qui est plus grand et qui permet en fait de tracer une très belle diagonale sur le tableau pour nous faire comprendre la composition de cette œuvre-là.
Ce qui est très intéressant, c’est de voir justement la richesse des coloris, qui est la somptuosité des vêtements, qui contraste parfaitement avec la rusticité du lieu où ils se trouvent. Mais de voir aussi la lumière. La lumière qui émane de cet enfant qui n’est pas du tout naturelle. C’est la lumière divine. Jésus est la lumière du monde. Et regardez, elle est éblouissante, aveuglante. Regardez comment elle se reflète sur le regard et le visage de Melchior. Mais aussi regardez le linge blanc que tient la Vierge Marie qui permet justement à la lumière d’être renvoyée et qui rebondit aussi sur le turban de Balthazar. Donc vous avez un beau jeu de lumière ici qui est très très beau et qui contraste avec cette nuit très profonde. Ce qui installe une certaine intimité dans ce lieu. Et voilà, ça c’est intéressant. Et puis on retrouve la réalité des rides aussi du lieu. Mais ce qui est très intéressant aussi, c’est de remarquer ce jeune garçon tout à droite qui sollicite notre attention, il nous regarde, il vient nous chercher pour nous faire rentrer dans le tableau. C’est un jeune page comme un serviteur. Et ça, c’était une manière aussi de nous sensibiliser, d’émouvoir les fidèles. Parce que ce tableau au format ambitieux était destiné à être placé dans le maître-autel d’une église.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, absolument. Et on va continuer avec un autre maître-autel.
[Illustration : Jan Janssens, “Le couronnement d’épines”, vers 1647, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : En fait, ici, il s’agit du couronnement d’épines. Et c’est vrai que c’est un peintre, Jan Janssens, qui est un maître dominant à Gand et qui va séjourner à Rome, qui va cristalliser autour de lui un foyer caravagesque. Et il va produire de nombreux retables, donc ces très grands tableaux qui se trouvent véritablement au-dessus de l’autel, dans l’axe de la nef de l’église. Donc Janssens, le peintre, va réduire la composition en largeur pour qu’elle s’adapte à ce format vertical. Il y a une très forte demande des églises à l’époque de la contre-réforme militante des Pays-Bas du Sud. C’est la Belgique aujourd’hui. Donc ce couronnement d’épines, c’est un des sujets de prédilection liés à la dévotion empathique pour les souffrances du Christ. Le Christ nous regarde. Son regard est étrange et insistant, comme le petit garçon chez Stomer dont Marthe vient de vous parler. Le Christ par ce regard qu’il nous envoie, nous implique dans le drame.
C’est toujours cette idée de nous émouvoir dans ce contexte de contre-réforme catholique. Et c’est un petit peu un malaise que l’on peut ressentir, parce qu’il nous regarde avec beaucoup d’insistance. Alors c’est le thème du Christ humilié, du Christ moqué par ces bourreaux hideux qui rient de leurs rires grotesques. Ils sont ses gardes insultant le Christ et qui prennent plaisir à accomplir leur horrible tâche. Vous avez 2 bourreaux qui enfoncent avec des bâtons la couronne d’épines. La fausse couronne royale avec un bâton de roseau qui est lui un sceptre de pacotille. Le peintre souligne la nature noble mais tout à fait vulnérable de Jésus en faisant vraiment ressortir la pâleur de son torse et de ses bras nus dans la lumière Vous avez ce très beau modelé du corps du Christ.
Donc ce sujet religieux se confond avec une scène de rue. Vous voyez à gauche, le personnage avec son chapeau à plumes. Et puis ces mauvais garçons qui sont très caravagesques et qui rappellent néanmoins ce que Jérôme Bosch avait fait un siècle avant, avec des personnages tout à fait horribles.
[Illustration : Dirck Van Baburen, “Bacchus”, début du XVIIe, peinture]
Marthe Pierot : Tout à fait. Alors le tableau suivant, donc, on revient sur un personnage isolé, un fond unique, mais c’est un portrait. Mais un portrait de qui ? Qu’est ce qu’on peut voir ? On a cet homme-là qui presse une grappe de raisin dont le jus coule dans une coquille d’huître avec une peau de bête. Mais qui est-ce donc ? Rassurez-vous, on va vous le dire. Il s’agit bien sûr et bien de Bacchus ou Dionysos, c’est à dire le dieu du vent, de la vigne et des excès. Et il nous regarde avec cet air moqueur qui nous rappelle et bien le regard des personnages précédents dont vient de vous parler Isabelle, ces bourreaux avec ces visages un peu déformés. Alors il a en fait une peau de bête, une peau de panthère. Parce que dans son histoire, on raconte qu’il grandit en Asie, donc très souvent on l’associe avec ce vêtement exotique pour nous rappeler ses origines. C’est un tableau qui a été offert au musée. C’est un don et c’est une œuvre réalisée par Dirk Van Baburen qui est l’un des plus grands représentants du caravagisme d’Utrecht dans cette école des Pays-Bas dont on a déjà parlé avec Stomer. Mais là, il met en scène un Bacchus dans une attitude assez comique. Il y a tout de l’anti-héros dans la manière dont il est réalisé. En fait, il n’est pas du tout idéalisé, pourtant c’est un Dieu, mais il ressemble au mauvais garçon du tableau d’avant justement. Un homme des tavernes, et il est beaucoup plus humanisé. On a l’impression ici que la rue entre dans le tableau plutôt que la divinité grecque ou romaine. Et ça c’est intéressant de vouloir l’humaniser comme ça.
Alors on a justement cette attitude qui nous intrigue quand même. Ce regard moqueur est assez étonnant. Mais sachez que Dionysos ou Bacchus, c’est celui qui apporte le vin et donc l’ivresse dans le monde grec. Il dérègle complètement l’ordre de ce monde en apportant ce nouveau breuvage et toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Donc là, il nous le montre un petit peu avec ce regard qui est limite provoquant. En tout cas, on a un naturalisme caractéristique du Nord, avec un Bacchus rustique et sauvage, un peu dépravé, avec quelque chose de très réaliste, comme Caravage aurais pu le faire. D’ailleurs il a réalisé des Bacchus. Et ce qui est très beau dans ce tableau, c’est de voir la lumière qui est plutôt diffuse. Une lumière assez chaude. On n’a pas de contraste brutal. Mais vous avez le blanc de l’huître qui ressort énormément qui accroche vraiment notre regard. Et justement, on pourrait se demander mais pourquoi une huître ? Alors sachez qu’on en consommait beaucoup. Et finalement on se servait de la coquille d’huître comme récipients. Par exemple, les peintres pouvaient déposer leurs couleurs à l’intérieur quand ils réalisaient leur peinture. Mais il y a aussi une autre idée avec un symbole un peu plus négatif qui est associé à l’huître, c’est que à l’époque, dans l’Antiquité, on pouvait utiliser la coquille d’huître comme un bulletin de vote et on gravait dedans le nom des bannis du monde grec. Et ensuite on jetait l’huître. Donc est-ce que c’est une manière de nous montrer qu’il est banni ? Finalement on ne sait pas. Mais ce n’est pas toujours très positif.
Isabelle Bâlon-Barberis : Oui, en tout cas c’est une question qui reste un petit peu en suspens.
[Illustration : Nicolas Tournier, “Le roi Midas”, 1620-1625, peinture]
Isabelle Bâlon-Barberis : Alors on va donc terminer avec notre dernier visuel qui est à nouveau un tableau de Nicolas Tournier. Et c’est vrai que ce tableau fait partie de sa période romaine, on est entre 1620 et 1625. C’est un tableau qui a été donné récemment au musée des Augustins. À présent le musée des Augustins donc possède 9 œuvres de ce peintre de Franche-Comté. Et en 2001, quand le musée avait fait donc une exposition monographique consacrée à Tournier, on avait réuni à peu près une trentaine de toiles. Donc le musée des Augustins possède un tiers de sa production donc c’est très important. Alors l’iconographie, à présent, de quoi traite ce tableau ? Et bien elle n’est pas très fréquente. On voit ici un roi, je pense que vous avez noté et la couronne et bien les pointes de fourrure d’hermine, et également la pourpre, c’est à dire le manteau rouge de ce roi. Donc on a les éléments qui permettent d’identifier un roi. C’est un roi, donc qui s’appelle Midas, c’était le roi de Phrygie. C’est aujourd’hui en Turquie. Et Midas tout seul ici, ne figure pas avec justement Apollon ou Marsyas, qui sont en général justement les 2 personnages qu’on lui associe. Parce que ces 2 personnages, il est chargé de les juger lors d’un concours musical entre justement Apollon et Marsyas. Alors Midas est un musicien. Il a certains talents et il va donc et bien départager Marsyas d’Apollon. Il va déclarer vainqueur Marsyas, alors que les muses ont préféré Apollon. Scandale. Eh oui. Apollon va se venger et il va affubler le roi Midas, d’horribles oreilles d’âne que vous découvrez dans ce tableau dans un 2e temps. Regardez bien. Je pense que vous les voyez à présent. Midas tentera de les cacher sous un bonnet phrygien. Mais évidemment à tout moment, on pouvait découvrir ses oreilles qui faisaient de lui un monstre. D’accord. Donc le roi Midas, en fait, est la seule œuvre mythologique que Nicolas Tournier ait réalisée. Caravage lui a utilisé très souvent des figures de la mythologie comme Marsyas, comme Bacchus. Marthe vous en a parlé comme Méduse, mais en représentant le roi légendaire tout seul ici de trois quarts, c’est vrai que la composition est tout à fait étonnante. Le roi est de trois quarts, il est presque de dos. Caravage avait fait cela, il avait osé. Il a eu cette audace de telle présentation des personnages. Vous voyez, on a l’impression que son épaule est coupée. Donc on a ici de très beaux effets de matière. On insiste encore une fois pour le dire. Et puis ce côté tout à fait cocasse, presque troublant d’oreilles d’âne qu’on découvre après coup.
Marthe Pierot : Exactement. Alors à présent, on va revenir vers vous pour conclure. C’est vrai que nous avions à cœur de vous montrer et bien tous les tableaux du musée des Augustins qui ont été influencés par le génie de Caravage, soit par le cadrage, soit au niveau de l’éclairage ou même des sujets qui ont été choisis.
Isabelle Bâlon-Barberis : C’est vrai et on voulait vraiment insister sur cette politique d’acquisition des œuvres qui insiste sur ce moment de la peinture tout à fait formidable qui était le début du 17e siècle. Et c’est vrai que par le biais de dons, par le biais d’acquisitions ou d’achats, le musée s’enrichit dans cette tranche début 17e siècle.
Marthe Pierot : Exactement, et vous verrez aussi qu’il y a une volonté de mettre en lumière et bien ce mouvement-là dans la nouvelle scénographie que vous pourrez découvrir à la réouverture, puisqu’un mur entier de peinture caravagesque est dédié à présent, donc c’est très très beau à voir.
Isabelle Bâlon-Barberis : Absolument, vous vous régalerez.
Marthe Pierot : Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine conférence.
Isabelle Bâlon-Barberis : À bientôt.
Le corps mis à nu
Le corps mis à nu
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Le corps mis à nu”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2024]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Messieurs, dames bonjour, Marthe et moi, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle conférence sur un joli thème aujourd’hui.
[Marthe Pierot ] : Oui, le nu. Le corps mis à nu plus exactement. Nous allons voir tout ça dans les collections du musée. Mais pour commencer, il faut savoir que le nu est un genre artistique à part entière, et c’est même un des plus importants dans l’histoire de l’art occidental. Mais quand on parle de nu, le nu, qu’est-ce que ça veut dire ? Et bien le nu correspond à une représentation du corps très idéalisée. Et dès l’Antiquité, le nu en faites renvoie à la beauté, au sens moral et esthétique, et pas vraiment à la sexualité. Mais on en reparlera plus tard. Donc dans ce sens, le nu correspond plutôt à des figures héroïques et masculines. Historiquement, le nu est donc masculin.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui. Mais en revanche, la nudité serait féminine. Et quand on parle justement de nu féminin, il est question donc de quelque chose de charnel, de quelque chose d’érotique qui nous dit aussi la vulnérabilité de la femme qui est dévêtue, donc sans protection. Et d’ailleurs souvent quand il y a une nudité féminine, et bien il y a un léger voile qui n’est là en fait que pour renforcer le désir qu’on peut avoir du corps féminin. Donc intéressant de se dire que la nudité féminine n’est jamais tout à fait totale.
[Marthe Pierot ] : Oui, c’est vrai. C’est une nuance importante à soulever. Alors il faut aussi savoir que la manière dont on va représenter les corps nus diffère, selon les époques, selon le siècle où l’œuvre a été réalisée, selon des canons qui sont propres à des époques et à des sociétés. Même si on s’aperçoit qu’il y a parfois une constante dans la manière de représenter certains nus avec des codes de représentation très stéréotypés qui parcourent les siècles.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Mais justement, en fait, on se rend compte que la nudité est un sujet, donc absolument évident et qui existe depuis toujours dans l’histoire de l’art. Quand on pense justement à ces statuettes de Vénus préhistoriques qu’on a pu retrouver dans les Pyrénées il y a 20 000 ans. Quand on pense aux dieux et aux déesses de la mythologie grecque, on se dit que voilà, ça fait très longtemps que le nu est là.
[Marthe Pierot ] : Oui, et bien sûr, la culture qui représente le plus de nu, c’est évidemment l’Antiquité, la Grèce antique, où là il y a une prolifération de représentations de nu. Mais pour vraiment parler du nu comme un idéal de perfection et de beauté absolue.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors c’est vrai qu’au Moyen Âge, il y a, christianisme oblige, une manière d’occulter le nu. En fait, on trouvera Adam, Eve et quelques individus luxurieux plein de péchés et de vices qui seront montrés nus. Mais c’est tout.
[Marthe Pierot ] : Oui, mais le nu revient au moment de la Renaissance, puisque la Renaissance reprend l’Antiquité comme modèle avec tous ces codes de représentation. Et la Renaissance, c’est aussi l’époque du progrès scientifique, de l’humanisme. On s’intéresse au corps humain et donc le nu va aussi intéresser pour son côté anatomique et scientifique.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et on peut dire enfin que, au 19e siècle, et bien les nus vont peupler les salons. On va avoir de plus en plus de représentations et surtout de femmes, avec un corps fantasmé, un corps stéréotypé qui met, qui définit un canon de la beauté dont notre société actuelle est encore très imprégnée.
[Marthe Pierot ] : Oui, tout à fait. Et bien allons découvrir tout ça au travers de nos dix visuels.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Allons y.
[Illustration : Bernard Lange, Philopoemen à Sellasie – 1829, sculpture]
[Marthe Pierot ] : Alors on va débuter avec cette sculpture, qui s’intitule “Philopoemen à Sellasie”. Bon, c’est un nom un peu compliqué, mais en fait Philopoemen c’est le nom de cet homme. Et Sellasie en fait correspond à une ancienne ville du Péloponnèse. Et donc ce moment correspond à une bataille, qui a eu lieu donc dans cette ville au 3e siècle avant Jésus Christ. Alors c’est une sculpture qui a été réalisée par Bernard Lange qui est un sculpteur toulousain. Mais qui était surtout conservateur au Louvre et restaurateur en chef des antiques. Donc la restauration c’est l’essentiel de son travail. Et donc il a vraiment une sensibilité très affirmée pour l’art de l’Antiquité. Et dans cette sculpture, il nous montre donc ce jeune guerrier très courageux qui est blessé. En fait regardez, il est en train de s’extraire un morceau de javelot de sa cuisse pour continuer le combat. Ca c’est un signe de vertu et de courage quand même. Il a encore son épée à la main. Mais il a quand même pris le temps de se débarrasser de sa cuirasse qu’on retrouve en bas derrière ses jambes, et c’est une manière aussi de mettre en lumière sa musculature et son corps. On remarque une silhouette très précise, une ligne pure et surtout un visage qui n’exprime aucune émotion, enfin surtout de la détermination mais pas de la douleur. Alors que ça doit être un moment assez douloureux quand même. Finalement on est d’accord. Mais là c’est l’idée de mettre en avant son courage surtout. Et puis on apprécie aussi la finesse et le détail de sa chevelure. Et puis le plissé du drapé. Et donc avec tout ça, on note que il y avait vraiment un goût très prononcé pour et bien l’Antiquité, et c’est ce qu’on appelle le néo-classicisme parce qu’on est au 19e siècle et on revient à toutes ces références de la culture antique. Donc on a ici véritablement un nu héroïque. Là on y est dans cette représentation là, et il y a des proportions très idéales. C’est ça qui fait référence au nu parfait de l’Antiquité, il y a tous ces canons.
Alors quand on parle de canon, qu’est ce que ça veut dire ? En fait, il faut savoir qu’il y a Polyclète cet homme, il a proposé une théorie de l’esthétique du corps nu avec des règles très précises, et c’est ça qu’on appelle le canon. Cette règle, elle se base sur une histoire d’équilibre et de rapport de proportions entre les différentes parties du corps. En gros, le corps doit mesurer une certaine taille et tout est proportionnel à ça. Et ça révolutionne complètement notre rapport au corps humain. Parce que tout est défini selon des lois mathématiques bien strictes et la beauté a donc à ce moment-là une valeur quantifiable et numérique. Par exemple, la tête doit entrer sept fois dans la hauteur du corps, ou le pied doit correspondre à un certain pourcentage, toujours par rapport à la hauteur du corps.
Donc tout est calculé. Mais parfois le résultat est un peu étrange. Par exemple, ici, la tête nous semble ridiculement petite. Voilà donc là on peut le dire. Et c’est important aussi de dire qu’en plus de représenter l’héroïsme avec ce nu parfait, il y a cette idée de montrer des corps très dynamiques et en forme pour représenter ou symboliser une cité, une ville qui est puissante et forte. À l’époque de l’Antiquité, c’était une manière de montrer que la cité grecque était très très forte. Donc le nu est un instrument politique aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors on va passer maintenant à une autre œuvre.
[Illustration: Alexandre Renoir, Horace enfant – 1850, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Il est question de “Horace enfant”. C’est un nu antique encore une fois, idéalisé encore une fois, pour une œuvre qui elle est aussi du 19e siècle, comme celle dont Marthe vient de vous parler. Mais ici, c’est un autre âge, puisqu’il s’agit de l’adolescence. Vous avez le type même de l’éphèbe. C’est à dire du très beau jeune garçon, et sa sensualité est assez frémissante. Elle s’oppose à la froideur des modèles néoclassiques qu’on peut voir à la fin du 18e siècle et au début du 19e. Alors-là, il est couché, notre Horace sur son manteau avec une jambe gauche qui est repliée sous la jambe droite. Il a les mains près de la tête et voyez, vous distinguez une colombe posée sur le sol près de ses pieds. Et elle porte dans son bec une branche de laurier. Elle veut en couvrir le jeune homme. Il y a toute une inscription latine qui nous fait comprendre qu’elle cherche avec les feuilles à soustraire aux vipères et aux ours, le corps donc vulnérable de ce jeune garçon.
Alors ce jeune garçon c’est le poète Horace lui-même. Ce poète latin du premier siècle avant Jésus Christ. Il raconte donc dans ses textes des épisodes de son enfance. Et il se décrit comme un enfant protégé des dieux. Et là je pense qu’il manque pas d’air. Parce que voilà, il se montre sous un très beau rôle. Un adolescent qui est couronné de lierres et de lauriers. Et c’est vrai que le sculpteur choisit d’illustrer les vers ou les lignes de ce poète pour faire sa sculpture ici. Alors Renoir, et je dirais Alexandre Renoir, c’est un sculpteur. Ne confondons pas avec le peintre Renoir, nous propose la thématique de ce nu couché qui est souvent traité en histoire de l’art.
Et souvent on pense à l’hermaphrodite couché, qui est une sculpture célèbre du musée du Louvre. Il existe aussi beaucoup d’exemples de Vénus qui sont elles-mêmes couchées. Mais voyez, ce qui s’oppose à ce dont Marthe vient de vous parler avec un personnage qui était très vertical, le Philopoemen de tout à l’heure. Mais la position à l’horizontale que nous avons ici, favorise le délassement, une sensualité assez affolante d’un corps qui s’offre, qui ne contrôle plus rien justement, qui n’a plus aucun réflexe de pudeur qui consisterait à se couvrir. Là, ça ne fonctionne pas. Le corps s’abandonne et on notera en fait ici que ce corps adolescent est d’une réelle ambiguïté. Il y a bien sûr le prénom Horace qui évoque le côté masculin. Mais regardez le mouvement de pâmoison de la tête vers l’arrière, les bras gracieux, les boucles en cascade, les muscles non encore marqués. Tout évoque ici le corps féminin.
[Marthe Pierot ] : Et la position allongée, comme tu l’as dit.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, bien sûr. Donc en fait, l’œuvre semble conçue pour créer une ambiguïté. Et c’est vrai que ici, il y a la partie la plus intime de ce corps qui est caché par un tissu et qui fait que le doute peut subsister. Garçon ou fille ? La question reste posée.
[Marthe Pierot ] : Tout à fait. Et on peut pas sauver le drap pour savoir ? Alors on va passer à la peinture.
[Illustration : Marco Basaiti : La vierge à l’enfant entre saint Sébastien et sainte Ursule – Vers 1500, peinture]
[Marthe Pierot ] : Avec une œuvre plus raide que la souplesse proposée par la sculpture précédente. Mais c’est aussi l’occasion de parler du Moyen Âge avec ce peintre de Venise. Et nous sommes en fait vers les années 1500. On est vraiment à la fin du Moyen Âge.
Mais on en a parlé un petit peu en introduction, le nu au Moyen Âge, c’est compliqué. Il faut vraiment savoir que la nudité est très mal perçue par la société. Et justement, la mode c’est plutôt de se couvrir, surtout pour les femmes. Il ne faut absolument pas montrer sa peau. Mais il y a quand même du nu dans l’imagerie chrétienne, c’est important de le dire. Il y en a même plusieurs, il y a plusieurs catégories.
Par exemple il y a le nu naturel. C’est ce qui correspond aux premiers hommes, notamment à Adam et Eve, et même aux enfants. Parce que les enfants symbolisent l’innocence. La nudité du nouveau-né est souvent représentée, et c’est normal, et on le voit ici avec cet enfant au milieu du tableau.
Puis vous avez le nu temporel. C’est le nu qui qualifie la pauvreté. Un job par exemple, souvent dénudé pour symboliser justement la pauvreté de cet homme.
Le nu vertueux, autre catégorie. Et là c’est le nu qui est réservé au Christ. Un corps glorifié, idéalisé ou même pour les martyrs. Les martyrs qui sont nus ou à moitié nus pour susciter la pitié, la douleur et la modestie.
Et enfin vous avez le nu criminel. Alors celui-ci c’est le pire. C’est celui qui dénonce le mal, le péché, la luxure. Et c’est un nu qui est très souvent représenté par les femmes. Voilà alors dans ce tableau, qu’est ce qu’on a ? Et bien on a plusieurs nus, ou en tout cas des personnages qui sont traités différemment. Vous avez une vierge à l’enfant au milieu qui est entourée de 2 martyrs. 2 martyrs qui en fait ont reçu des flèches. C’est l’instrument de leur martyr et c’est pour ça qu’ils tiennent les flèches à la main.
A droite, Vous avez une femme. C’est sainte Ursule. C’est une chrétienne du 3e siècle qui a été massacrée par les Huns. C’est cette tribu d’Asie centrale qui envahit l’Europe. Et en fait de l’autre côté, vous avez un homme qui est saint Sébastien. Il ressemble un petit peu au Christ dans sa représentation. Comme s’il était vraiment sur la croix. Mais là, c’est un arbre que l’on a ici. Ce qui est intéressant, c’est que ce sont 2 martyrs qui ont reçu des flèches. Donc le martyr les réunit. Mais leur représentation est très différente. Parce que la femme se retrouve déjà devant un rideau. Elle est un peu à huis clos pour symboliser le monde intérieur et elle est habillé jusqu’au cou. L’homme en revanche, lui est dévêtu. Là on a un corps glorieux. On est dans ce nu vertueux justement pour symboliser la force, le courage, le martyr, la douleur, la pitié . Mais si cette femme avait été nue, elle symboliserait la luxure et non pas le courage. Donc c’est vraiment très différent au niveau du symbole. Et alors pour terminer, c’est intéressant de parler aussi de la représentation de saint Sébastien dans l’iconographie. Parce qu’en fait, c’est une image qui s’est vue réappropriée par la communauté homosexuelle dès le 19e siècle. Et on a souvent des saint Sébastien qui sont jeunes, voir androgynes, musclés et sensuels à la fois. C’est troublant. Et tout ça a été vraiment lancé un peu par le tableau de Pérugin. Ce grand peintre italien qui propose vers les années 1500, un saint Sébastien tout à fait rêveur avec un contrapposto et un pagne qui recouvre à peine son sexe et qui laisse du coup place à l’imagination. Quand on le voit ça troublait beaucoup de personnes. Donc voilà, ça commence comme ça cette représentation du saint Sébastien, comme un homme très sensuel et androgyne. Voilà.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Très bien. Alors maintenant nous allons continuer et on va trouver ici la première femme nue de notre exposé avec le tableau qui s’intitule “la générosité d’Alexandre”.
[Illustration : Jérôme-Martin Langlois, La Générosité d’Alexandre – Alexandre cède Campaspe, sa maîtresse à Apelle – 1819, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors ici, le nu signifie autre chose. Ici, le nu, c’est l’érotisme. Et c’est non plus la vertu du martyr dont Marthe vient de vous parler. Ça n’est plus non plus la gloire d’un héros ou d’une héroïne. On passe donc véritablement à cet érotisme. Au total ici, 3 personnages, mais seule une femme. La femme donc, qui est plutôt dévêtue, qui n’a pas forcément choisi de l’être. Une femme au canon néoclassique, très strict, tout de blancheur, de pureté, de jeunesse, de douceur. Ici, c’est une scène en intérieur, une scène de l’histoire romaine. Vous avez la peau de porcelaine de la femme à droite à peine couverte d’un voile en mousseline qu’elle tente de remonter un peu pour cacher sa nudité, sa vulnérabilité. Donc elle n’est pas entièrement nue et on comprend son embarras. On voit bien qu’elle rougit. Regardez ses joues.
Donc ici, l’idée de nudité repose vraiment sur le dévoilement. Maintenant, le personnage central. Alexandre le grand. Le grand chef militaire, le roi de Macédoine au nord de la Grèce, qui au 4e siècle va conquérir des territoires en allant jusqu’en Inde. Mais ici, et bien en fait, c’est un Alexandre d’opérette, rose, blond, assez sensuel. Regardez son torse qui s’offre à notre vue. Mais lui justement, il offre quelque chose au personnage de gauche. Le personnage de gauche, c’est son peintre officiel, il s’appelle Apelle. Et en fait, Alexandre a bien remarqué que ce peintre va complètement craquer pour cette adorable poupée rose et blonde qu’est Campaspe la favorite d’Alexandre. Alors, on comprend au regard et à la tête baissée de Campaspe qu’elle n’a absolument pas son mot à dire. Qu’elle est résignée, qu’elle n’a pas le choix et qu’elle est ici un objet, une marchandise, un trophée. Donc, sur le chevalet à gauche, voyez comme un hommage à la peinture, une mise en abyme puisque le peintre peint un tableau, et évidemment, il peint Campaspe nue. Et il est considéré très inconvenant pour une femme de poser nu. Mais le paradoxe, c’est que l’histoire de l’art est remplie donc de femmes nues. Et cela évidemment nous parle surtout du désir masculin.
[Marthe Pierot ] : Oui, tout à fait. Alors on va poursuivre avec une autre peinture qui nous montre aussi cette idée de poupée de porcelaine avec ces mêmes codes de représentation ou ces mêmes stéréotypes d’une peau très blanche, d’une femme qui est nue.
[Illustration : Gabriel Guay, La dernière dryade, 1898, peinture]
[Marthe Pierot ] : Alors là, on est plutôt à la fin du 19e siècle, on est presque au 20e siècle pour ce tableau réalisé par Gabriel Guay. Et en fait, pour un petit peu nous faire passer le nu sans problème, sans s’attirer la foudre des critiques, il nous parle réellement d’un sujet mythologique. C’est pas évident. C’est sa manière à lui de justifier le nu. Parce qu’en fait c’est une dryade et le nom nous l’indique d’ailleurs le nom du tableau. Donc les dryades, ce sont ces nymphes qui peuplent les forêts qui les protègent. Le mot dryade vient du latin druce qui veut dire chêne, et ça c’est important. Mais donc ici qu’est ce qu’elle fait ? Et bien elle est dans cette forêt. Elle gravit les marches d’un petit édifice qui est un monument qui représente le Dieu de la nature, Pan. Et il y a une inscription dessus, donc quand on zoome, on le voit une inscription qui signifie : Pan aimé des dryades amoureuses. Voilà donc il y a ce lien entre le Dieu de la nature et les dryades. Mais ce qui est intéressant, c’est de voir véritablement et bien l’harmonie chromatique de ce tableau, l’intensité des couleurs et ce contraste entre la peau laiteuse, très blanche, et la rousseur de la saison.
Vous avez tout un camaïeu de rouge orangé avec cette forêt qui a des couleurs très automnales. Ces feuilles qui tombent au sol et cette chevelure qui répond avec la couleur de la saison. Bref, tout est là. Mais ce qui est important c’est de regarder un peu plus loin dans le tableau et d’observer qu’au fond, au fond, l’ambiance est plus sombre. Il n’y a plus de couleur orange, plus de feuilles sur les arbres. On sent que l’hiver arrive. On voit même l’humidité avec la mousse sur ce monument en pierre. On sent le froid. On sent la fin d’une saison. On sent la fin de quelque chose. C’est la nature qui meurt, c’est le principe de l’automne. Mais Regardez le titre du tableau “la dernière dryade”. C’est la dernière, comme si la forêt allait disparaître, comme si c’était un monde qui s’écroulait ou la nature qui s’effondrait. Alors si on posait un discours contemporain dessus, on pourrait se dire que c’est une œuvre un peu écologique finalement. Voilà, mais on est vraiment, surtout à ce moment-là, au 19e siècle, dans les réalités de la scène, parce que cette femme est nue dans une forêt où il fait très froid. Mais c’est pas important parce qu’elle n’existe pas vraiment. On est plutôt dans le désir et dans le rêve ici et elle est représentée de dos. Un peu comme le vêtement qui est à moitié là et qui nous donne encore plus envie de voir. Et bien là le fait de l’avoir de dos et bien on ne la voit pas finalement. Il y a cette idée d’inconnue, elle nous échappe et ça c’est très érotique.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, c’est le teasing j’aimerais dire d’aujourd’hui. Alors à présent on va passer à un immense tableau qui fait 3m50 sur 5m20.
[Illustration : Paul Gervais, La folie de Titania – 1897, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Donc là on vous le précise. On ne le dit pas toujours, mais quand les tableaux sont un petit peu hors gabarit, c’est bon de le de le mentionner. Alors il s’agit en fait d’un tableau qui fait référence à la pièce de de William Shakespeare intitulé “Le songe d’une nuit d’été”. Donc une pièce du 16e siècle. Alors l’histoire se déroule dans une forêt étrange, un petit peu magique, le temps d’une nuit, une nuit d’été ensorcelante au sens propre. Parce que les personnages sont ensorcelés. Victimes de sort qui leur ont été jetés.
Alors il est question de Titania, le personnage qui nous regarde, qui est face à nous. Leur maîtresse, c’est la reine des fées, et elle est follement amoureuse d’un homme un humain. Alors en fait, le roi des elfes, son mari, a manigancé ce sortilège pour punir Titania de son infidélité. Voilà un petit peu l’histoire. Donc vous avez un cyprès, des lacs, des bois, des collines au loin, et cet homme à la tête d’âne, assis sur le banc de pierre. Autour de lui, il y a donc toutes ces femmes. Alors au sol, vous avez ce tapis de mousse avec des violettes et des roses coupées. Des couleurs donc atténuées. Et puis toutes ces femmes qui posent véritablement. Ces 4 femmes qui sont des fées mais qui sont très stéréotypées, qui sont toutes pareilles, qui répondent au code de la représentation et de l’idéalisation. Un petit peu comme notre dryade dont dont Marthe vient de vous parler.
[Marthe Pierot ] : Et je dirais même qu’elles sont 5.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, 5 à côté. Il faut bien les compter. Et en fait. Et bien elles ont des attitudes un peu confuses, un peu gênées, mais un petit peu de fausse pudeur je dirai. Alors l’atmosphère est douce mais un peu grotesque aussi. Et il faut se dire qu’au matin, suite à cette nuit, tout rentrera dans l’ordre. C’est 5 nus féminins iront se rhabiller et tout sera fini. Alors c’est intéressant de dire que à l’époque, quand ce tableau est montré, c’est un tableau qui est jugé comme inconvenant parce que justement, il n’y a pas de voile qui accompagne les corps de ces femmes. Il n’y a pas un atout, il n’y a pas donc un ruban ou quelque chose. Elles sont vraiment entièrement nues et elles sont en grandeur nature. C’est ça qui pouvait véritablement surprendre. Donc Gervais, l’auteur de ce tableau, est assez coutumier de ces femmes voluptueuses et aguicheuses, et c’est vrai qu’on le reconnaît à cela. Il y a comme un peu de grivoiserie et de sentimentalité. Alors la vie, bien sûr, c’est la littérature. Mais Shakespeare à bon dos quand même, parce que Gervais nous parle surtout du désir des hommes. Donc Gervais, je vous l’ai dit, se fait un peu esquinter par la critique. Mais c’est vrai que il est très aimé, parce que Gervais c’est un peintre décoratif. Et c’est vrai que dans des grands cafés, dans des grandes institutions et même au Capitole de Toulouse, à la mairie de Toulouse on retrouve ces immenses tableaux qui nous parlent d’un Gervais décorateur.
[Marthe Pierot ] : Alors je trouve que c’est important de préciser quand même que c’est 5 femmes sont nues, mais que la seule personne qui est habillée c’est l’homme. L’homme n’est pas nu parce qu’ici il est question d’érotisme. Donc en fait l’homme n’a pas cette place là. Donc c’est pas l’idée de l’héroïser là. C’est juste d’érotiser ces femmes. Alors bon on reste sur le nu, évidemment, c’est notre sujet, mais on retourne à la sculpture ici avec cette sculpture réalisée en 1894.
[Illustration : Eugène Thivier, Cauchemar – 1894, sculpture]
[Marthe Pierot ] : On est vraiment à la fin fin fin du 19e siècle par un sculpteur parisien très peu connu qui s’appelle Eugène Thivier et qui nous montre ici une femme qui est allongée. Alors elle est allongée sur un lit, on reconnaît le drap avec les plis et elle ferme les yeux, donc elle dort. Mais pendant qu’elle dort, une créature horrible grimpe sur son corps. En fait, elle fait un cauchemar et cette créature est une métaphore. Elle symbolise le cauchemar. C’est une sculpture plutôt allégorique. Mais Eugène Thiviers s’inspire d’un tableau du même thème. Un tableau réalisé un siècle avant par Füssil qui s’intitule aussi “le cauchemar”. Et en fait, on a vraiment cette idée d’un démon qui prend le corps d’une femme, qui monte sur le corps d’une femme, quitte à l’étouffer. Et d’ailleurs, on retrouve cette sensation d’oppression quand on fait des cauchemars. Mais pour abuser d’elle sexuellement. C’est ce qu’on appelle un incube. Voilà, c’est la représentation de l’incube qu’on voit dans le tableau de Füssil et donc ici que Eugène Thivier semble reprendre. Mais c’est assez symboliste aussi comme œuvre. Parce qu’il est question surtout du rêve, d’ésotérisme. On traite quelque chose d’immatériel en le rendant un peu concret avec cette créature horrible. Mais ne nous cachons pas, c’est surtout l’occasion rêvée et le prétexte idéal pour le sculpteur pour nous représenter un nu féminin voluptueux dans l’esprit du siècle, à la fois morbide et érotique. On est vraiment dans cette frontière là toujours un peu étrange.
Et on a une œuvre qui est une synthèse entre un style très néoclassique, parce que le corps féminin reprend tous les canons de beauté, et néogothique, parce que cette sculpture, nous fait penser à une gargouille ou à un monstre médiéval hybride, avec une corne unique, une queue velue, des ailes de chauve souris, des griffes. Et il y a une opposition très intéressante entre la laideur d’un corps qui est raide et hirsute, qui est celui du monstre qui renforce d’autant plus la beauté et la douceur de ce corps sensuel de la femme et lisse exactement exactement.
Mais ce qui est très important dans cette sculpture, et on garde le meilleur pour la fin. C’est que ce démon, n’est pas un incube, ce n’est pas un démon masculin. Ce démon a une poitrine, c’est un démon féminin. Ah là là !! Donc en général, quand il y a ces démons féminins, on parle de succube. Ce sont des démons qui abusent des hommes pendant leur sommeil. Chacun son tour.
Mais là ce n’est pas un homme qui dort, c’est une femme. Donc tout est mélangé, c’est n’importe quoi. Mais c’est un délice pour un psychanalyste, de voir cette sculpture parce que on parle du sommeil et donc de l’inconscient. C’est intéressant de traiter tous ces sujets. Le cauchemar qui réveille nos angoisses les plus les plus enfouies. Et le fait que les démons soient une femme, on ne peut pas s’empêcher de se demander si ce n’est pas une partie d’elle-même en fait finalement. Comme son inconscient, l’autre “je”, son côté obscur, son dark side, comme on pourrait dire, qu’elle tente de repousser.
Et justement, regardez, elle tente de le repousser d’une main, mais de l’autre main, elle s’agrippe au drap comme si elle prenait du plaisir. Et ça, c’est troublant parce qu’on est entre un mélange de plaisir et d’horreur, de peur et de désir. Et il faut savoir que le plaisir sexuel féminin est très souvent diabolisé.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et alors dans l’œuvre suivante, c’est quelque chose que nous retrouvons puisqu’il y a cette femme au serpent.
[Illustration : Anonyme, La femme au serpent – XIIe siècle, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors de quelle époque est-elle ? Peut être du 12e siècle ? Peut-être date-t-elle d’encore avant ? Il s’agit ici d’un marbre qui fait un peu plus de 1m de haut. Et nous sommes devant une des plus anciennes œuvres du musée des Augustins, ici avec cette période qui serait le 12e siècle. Alors on pense qu’elle provient du côté de Bagnères de Luchon. D’une église qui se trouve tout à côté du lac d’Oô justement. Et elle a été extraite de cette église en 1820. Et c’est vrai que c’est une pièce qui fascine vraiment. Elle présente une intimité qui est un peu dérangeante puisqu’il est question de la femme et de l’animal ici encore une fois. Mais ici c’est un serpent. Ce n’est pas cette créature qui avait tout de la gargouille dont Marthe vous a parlé.
Alors en fait, vous avez un travail de sculpture qui est assez rudimentaire puisqu’on comprend que le sculpteur va à l’essentiel pour traiter de ce corps. Il va surtout et bien traiter de la matrice, c’est à dire du bas ventre et des seins de cette femme. Mais regardez le reste du corps. Les jambes, les pieds, les bras ou les mains sont traités grossièrement comme rapidement. Et ce corps sculpté est aussi un petit peu à l’étroit dans un cadre qui semble un peu trop petit. Et alors maintenant, le sculpteur qui était-il ? Ben on n’en sait rien parce qu’au Moyen Âge on a très rarement une idée des noms des artistes.
Est-ce que ce sculpteur était malhabile ? On peut pas non plus le dire, mais en tout cas, ce qui est important pour lui, ce n’était pas véritablement un corps abouti. Mais c’était de faire passer un message moral. Même si c’est un peu énigmatique, ce message. Parce que finalement, il est question d’une femme qui donc enfante d’un serpent, d’un démon, et ce démon semble lui mordre le sein. Le spectacle est d’ailleurs assez difficile à soutenir du regard.
Mais dans un contexte chrétien, on pourrait parler de l’incarnation du péché, du vice, avec ce serpent qui rappelle bien sûr le péché originel. Et vous avez en fait un supplice qui est réservé à la femme débauchée et luxurieuse ou adultère. Une punition qui chercherait à nous dire qu’elle doit souffrir là par où elle a péché. Et là vous avez en fait une interprétation tout à fait négative. Un nu qui est criminel.
Mais si on regarde les choses un petit peu autrement, dans un sens plus positif, cette femme est en train d’allaiter un serpent. Et la signification peut être tout autre puisque dans l’iconographie antique, on trouve des œuvres qui illustrent la terre mère, la terre nourricière. Et cette culture peut être antérieure à la période romane. Cependant, l’iconographie de cette plaque de marbre n’est pas isolée. On connaît d’autres représentations de femmes qui allaitent un reptile dans de nombreuses églises romanes, comme à Moissac par exemple. Malgré tout la différence capitale ici, c’est que la femme ne fait pas que allaiter le serpent. Elle le met au monde et là, c’est compliqué. Mais ce détail a certainement toute son importance.
[Marthe Pierot ] : Alors on change de siècle d’époque et on revient à la peinture pour vous présenter un nu féminin peint par une femme.
[Illustration : Amélie Beaury-Saurel, Académie – 1890, peinture]
[Marthe Pierot ] : Ca change beaucoup de choses, vous allez voir. Alors déjà c’est une femme qui existe. Alors elle est anonyme. On ne connaît pas son identité. Mais cette fois-ci l’artiste ne cherche pas à justifier son nu par une figure de la mythologie ou un personnage complètement irréel de la littérature.
C’est une femme de son temps, c’est une Madame tout le monde. Comme c’est une Madame tout le monde, et bien, elle est réaliste dans sa représentation. Le réalisme du corps, on le voit par cette poitrine qui est un peu lourde, les vergetures ou les cicatrices qui se trouvent sur le côté de sa hanche. Et puis elle a un visage sans affectation, des cheveux attachés, elle ne pose pas, elle ne nous regarde même pas. Et elle semble très déterminée dans un décor qui ressemble à une jungle. Ce qui ajoute un côté très sauvage à cette femme presque indomptable. Elle tient d’ailleurs un roseau, comme si elle tenait une lance, un peu comme une amazone, ces grandes guerrières.
Ce tableau, le titre est important, il s’intitule Académie. Une académie en histoire de l’art, c’est l’exercice de représenter le nu d’après un modèle. Et c’est une étape de formation très importante pour l’artiste. L’artiste nous montre donc sa virtuosité. Et souvent c’est un exercice ou quasiment essentiellement, c’est un exercice réservé aux hommes comme la peinture d’histoire et d’autres sujets en histoire de l’art. Mais là, Amélie Beaury-Saurel le fait aussi et en fait, c’est tout à fait à l’image de la peintre et de la femme engagée et militante qu’elle était. Elle s’est formée dans une académie qu’on appelait l’Académie Julian. Elle reprend la direction de cette académie et en même temps que ce poste de directrice, elle continue à peindre. Elle encourage les femmes à peindre. Elle soutient l’éducation des femmes. Mais elle peint beaucoup de portraits sans commande et ce sont très souvent des portraits anonymes de femmes contemporaines, pas des personnages d’histoire. C’est ce sujet, c’est ce créneau qu’elle aime bien et qui est le sien et qui est tout à fait à l’image de ces combats aussi. Mais c’était intéressant de comparer avec un tableau de la même époque réalisé par un homme, Henri Martin, ce peintre toulousain.
[Illustration : Henri Martin, Beauté – 1900, peinture]
Et là cette fois-ci cette femme sur le côté, ce n’est pas une femme réelle, c’est une allégorie. Une allégorie de la beauté, du printemps. Bon, on est aussi en extérieur, mais à la place des roseaux qui nous font penser à des lances, on a une flopée de petites fleurs blanches qui tombent sur cette femme. Et puis regardez aussi, elles ont toutes les 2 la poitrine dégagée. Mais là ici, à droite sur Henri Martin, on a vraiment une poitrine très néoclassique. Vraiment une petite poitrine qui correspond au canon de l’Antiquité. Et elles ont toutes les 2 un drap au niveau de la hanche. Mais il y en a une qui le tient, l’autre qui ne tient pas son drap. On a l’impression qu’il va tomber, que sa jupe va tomber. Qu’est ce qu’elle fait ? elle tient ses cheveux qu’elle ouvre un peu comme une cape, donc on a vraiment cette idée de cheveux lâchés aussi qui contribue à l’érotisme. Donc on a un caractère très sensuel. Le visage est imprécis. Tout est vaporeux, mais on est vraiment dans cet onirisme là qui est propre à l’idéalisation réalisé par un homme. On est très loin du concret. On est très loin du vrai avec Henri Martin. C’est intéressant d’avoir les 2 ici.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors on continue avec 2 nus qui sont un couple d’amoureux réalisé par Auguste Seysses.
[Illustration : Auguste Seysses, Le retour – 1898, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors en fait, ce couple d’amoureux nu, debout, tendrement lassé, est parfaitement indifférent à ceux qui les entourent.
Alors le sculpteur est l’élève de Falguières, qui est ce grand grand sculpteur toulousain qui s’était installé à Paris. Et vous avez en fait une œuvre ici, que l’on peut rapprocher du Baiser de Rodin, réalisé 20 ans avant. Voilà, alors ici, c’est le moment assez émouvant où 2 amoureux se retrouvent après une longue séparation. Puisque l’œuvre s’intitule “Le retour”. Et cette œuvre a eu beaucoup de retentissement et de succès pendant et après la Première Guerre mondiale.
Elle signifiait l’idée du retour du soldat. Alors notez la présence d’un drap chaste entre les 2 corps. Il n’y a pas de peau à peau aux endroits les plus intimes de leur anatomie. Il y a un drap qui freine si peu, je dirais quand même l’érotisme. Alors ce tissu qui traîne au sol est intéressant. Il semble être une robe qui frôle le sol en suivant un mouvement qui peut être comme un mouvement de danse. Et ce qui est assez étourdissant ici, c’est l’illusion du mouvement bien sûr, donc de la vie. Et c’est vrai que je reviens sur cette idée de la danse, parce que vous avez vraiment l’idée d’un tourbillon sentimental, qui semble les ravir au monde.
On pense à une valse à 1000 temps ici, avec des cheveux qui sont follement enroulés et qui prolongent le mouvement dansé. Regardez la position des pieds. Il y a 4 pieds qui semblent avancer, reculer un peu façon danse de salon. Et regardez son talon à elle qui ne repose sur rien. Ce lâcher prise, cet abandon, son extase puisque ses appuis au sol, et bien donc elle les perd. Elle perd pied. Donc au sens propre du terme. Et c’est intéressant de voir les mains de l’homme qui semblent comme enfoncées dans la peau. Cette peau qui est une chair en pierre. Ses mains semblent comme imprimées dans la pierre. Et tout ça pour nous dire l’ivresse de cette étreinte. Alors le corps ici, les 2 corps sont intéressants parce qu’ils sont réalistes. Justement, on est presque rentré dans le 20e siècle. Et ils sont tout à fait non idéalisés. On est très loin des canons néoclassiques dont on a pu vous parler. Et il y a une volonté de se rapprocher du réel. Tout cela pour toucher, pour émouvoir le plus grand nombre. On n’a pas les codes néoclassiques, où tout le monde est beau, grand, jeune.
[Marthe Pierot] : ils sont quand même très beaux.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Ils sont quand même très beaux, mais il y a aussi un retour pour reprendre le titre vers des proportions plus normales entre guillemets. Donc c’est ce qui nous parle d’une certaine modernité parce que on a vu beaucoup de femmes qui étaient nues avec des hommes habillés autour. Mais ici l’homme et la femme sont nus ensemble. Et ils sont tous les 2, je dirais logés à la même enseigne. Il n’y a plus de différence dans la manière de traiter la nudité.
[Marthe Pierot ] : Oui tout à fait. Et c’est très joli de terminer sur ça, sur cette égalité de traitement en tout cas. Et bien on va conclure cette conférence.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors le nu symbolise la force ou le fantasme selon qu’il concerne le corps masculin ou le corps féminin. Donc il y a cette notion d’héroïsme et d’érotisme, cette oscillation dont nous avons parlé. Et c’est vrai que, au fil des siècles, il est prétexte à une étude anatomique élaborée qui vise la beauté idéale.
[Marthe Pierot ] : Oui, et on s’aperçoit aussi qu’il y a beaucoup plus de femmes nues que d’hommes nus, surtout au 19e siècle en représentation, donc ça questionne forcément. Et puis là, il y a une différence de traitement, vous l’avez vu, et donc l’utilisation du corps des femmes, ce qu’on en fait, comment elles sont érotisées évidemment est un signe quand même d’une société très patriarcale. Et ça se reflète dans l’histoire de l’art occidentale.
Mais c’est important aussi de savoir qu’aux 19e et 20e siècle, proposer du nu c’était aussi la garantie d’un scandale et donc d’un coup de publicité. Donc quand il faut faire sa place sur le marché de l’art, on joue ou on surfe en tout cas sur cette mode-là croustillante.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Croustillante. Mais c’est vrai que ça commence, on va le dire, dès la fin du 19e siècle avec des gens comme Courbet. Avec un réalisme qui fait que le nu n’est plus du tout cet idéal de beauté. Et c’est vrai qu’au 20e siècle, bien sûr les choses se précisent avec des gens comme Picasso qui va complètement soit élargir, soit fragmenter le corps. Avec des gens comme Egon Schiele également, qui propose quelque chose de pas du tout idéalisé. Je pense également à Suzanne Valadon. Femme qui propose un corps de femme qui n’est plus un corps qui fait vraiment rêver, mais on a en fait un corps qui est montré pour aller au-delà du genre, au-delà de la beauté. Il y a quelque chose que le corps nous dit.
[Marthe Pierot ] : Tout à fait. C’est vrai. Et c’est intéressant en tout cas de se questionner sur toutes ces représentations de nu au fil des époques. De remettre ou de replacer les œuvres dans leur contexte évidemment, mais de poser un regard actuel et contemporain sur la signification de ces nus. Et c’est aussi ça le rôle des musées, c’est d’exposer les œuvres, mais d’en parler.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Voilà. Merci de nous avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle conférence.
[Marthe Pierot ] : À bientôt. Merci beaucoup.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Au revoir.
Natures mortes
Natures mortes
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Natures mortes : Vanités et beauté”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2023]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Messieurs dames, Bonjour,
[Marthe Pierot] : Bonjour
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Voilà, on est ravi de vous retrouver Marthe [et Isabelle]. Voilà pour une nouvelle conférence, sur un nouveau sujet.
[Marthe Pierot] : Oui [lequel ?] Les natures mortes. Donc pendant 30 minutes, on va parler de ce genre en histoire, de l’art, de ce genre artistique qui met en scène des objets inanimés dans une composition recherchée, évidemment étudiée avec une volonté esthétique. Mais aussi souvent vous allez voir avec une intention plutôt symbolique.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et on se rend compte qu’au fil du temps, il y a une évolution de ce genre, la nature morte. On se souvient qu’au temps de l’Égypte ancienne, on en voyait déjà. Elles étaient reproduites sur les parois des sarcophages. Et ensuite, à l’époque de la Grèce, on sait qu’il y a des trompe l’œil qui sont nombreux. Et à l’époque des romains, on retrouve de très belles natures mortes sur les murs des villas de Pompéi.
[Marthe Pierot] : Et puis il y a une pause pendant un millénaire, quand même presque.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, absolument. A l’époque du Moyen Âge, il y a une discrétion du genre, et c’est vrai que l’objet n’est plus que accessoire ou quelquefois il est intégré à une grande composition, mais l’objet n’a pas le premier rôle.
[Marthe Pierot] : Et puis il y a un regain d’intérêt pour la nature morte au 16e siècle, mais en Europe du Nord. Donc la Hollande, les Pays-Bas, vont vraiment s’attarder sur ce genre, le développer, et les objets deviennent un sujet à part entière. Finalement, on se libère-là cette fois-ci de la présence humaine. Alors pourquoi en Europe du Nord ? Et bien il y a plusieurs contextes. Déjà le contexte religieux, parce que ce sont des pays protestants et donc on rejette complètement l’imagerie traditionnelle religieuse. Les peintres vont s’attaquer à d’autres sujets et donc la nature morte.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et dans cette géographie, il y a le contexte économique parce qu’il y a une très grosse production picturale, étant donné que les riches marchands, les marchands très prospères de Amsterdam, d’Anvers, qui sont les premiers ports du monde sont demandeurs. Et c’est vrai que la nature morte dans ce contexte hollandais notamment va occuper la première place sur le marché de l’art .
[Marthe Pierot] : Oui, tout à fait. Et il faut savoir que en même temps, en France, en revanche, il y a beaucoup d’écoles qui voient le jour et qui vont imposer une stricte hiérarchie des genres en histoire de l’art. Et malheureusement, la nature morte se retrouve tout en bas de l’échelle. Elle n’a pas du tout le même succès en France que dans les pays du Nord.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors une des raisons qui explique le développement de ce genre pictural, c’est ce contexte de grande découverte. Quand en 1492 on découvre l’Amérique, et bien il y a un afflux de nouvelles plantes et ça donne naissance à la botanique. Et les botanistes aiment particulièrement ces nouveautés-là. Alors il y a des peintres qui s’empressent de vouloir les reproduire au plus juste.
[Marthe Pierot] : Exactement, c’est vrai. Alors on commence avec une œuvre du 17e siècle, réalisée par une femme, et c’est assez rare de parler d’une femme peintre à cette époque.
[Illustration : Louise Moillon, Nature morte aux mûres – vers 1640, peinture]
[Marthe Pierot] : Et pourtant, Louise Moillon est reconnue de son temps. Elle reçoit beaucoup de commandes et elle est confirmée comme l’une des femmes peintres les plus célèbres. Alors sa carrière, cependant, est très brève, 11 ans à peine. Et sur une production d’une dizaine d’années, elle réalise 30 natures mortes et le musée des Augustins en possède 3. Elle vient d’une famille d’artistes. De toute façon quand on est une femme à cette époque-là, pour peindre, il faut quand même faire partie d’une corporation. Donc sa famille était dans le milieu comme on peut dire, et elle baigne dès son plus jeune âge dans un milieu artistique très riche. Et elle commence très très jeune. Son talent est précoce. Et son style, c’est vraiment l’austérité dans les natures mortes. On le voit très bien ici, elle dépouille ses œuvres de toutes fioritures ou d’accessoires coûteux, pas de faïence, de cristal, de couverts d’argent. Ici, une simple table rustique en bois de pin, un panier en osier, mais avec une réalisation extrêmement juste. Et elle dispose sur ce tableau, deux pêches et un abricot à droite, et avec, dans le panier, des branches de mûriers et de framboisiers chargés de fruits. Et tout à gauche, il y a une nèfle. On a donc une composition plutôt simple avec des couleurs restreintes. Les motifs sont peu nombreux. C’est une approche dépouillée et austère qui lui est très personnelle et qui fait aussi parfaitement lien avec sa religion parce que Louise Moillon était protestante. Je vous laisse imaginer sa vie. Être femme peintre à cette époque au 17e et protestant quand on est persécuté pour sa religion, ça ne devait pas être simple d’exercer. Pourtant, elle a réussi à traverser les affres du temps. Mais ses tableaux, en tout cas, sont véritablement une célébration de la vie silencieuse, comme l’est la religion protestante. On le voit très bien ici. Ce qui est intéressant, c’est de noter aussi cette très belle diagonale qui découpe le tableau en 2 avec un clair-obscur, une partie très sombre et une autre plus claire. Et de vous dire aussi qu’elle peint sur du bois. C’est du bois de chêne et c’est donc en fait particulièrement représentatif du style hollandais de peindre sur du bois de chêne. Il faut savoir qu’elle rencontre énormément les artistes flamands alors qu’elle est en France, mais parce que les artistes protestants arrivent à Paris après l’Edit de Nantes. Donc il y a une communauté qui se forme à ce moment-là et elle va pouvoir les fréquenter et peindre un petit peu dans la même veine, avec une véritable valeur tactile au niveau des objets et des textures. Une précision des objets, un style précis mais dans une austérité assez importante.
Malgré tout, Louise Moillon cherche vraiment à flatter nos sens. Parce que quand on voit ces belles mûres ou ces framboises, on a envie de les toucher, de les goûter, de les sentir, de sentir ce sucre ou d’entendre même le grincement du panier. Elle flatte tous nos sens et on a même des gouttes de rosée de vent qui nous dit la fraîcheur des fruits. Et donc on a un certain charme dans cette rusticité et des couleurs très délicates, même si elles sont très restreintes. Il y a une véritable recherche de fraîcheur et l’esthétisme ici avec Louise Moillon.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors c’est ça qui est intéressant, c’est à présent de parler de tout autre chose. On a quelque chose de tellement plus sophistiqué ici avec Paul Liégeois.
[Illustration : Paul Liégeois, Nature morte de fruits – 1600-1700, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Ici en fait, on a affaire à un peintre de nature morte. Un peintre français, mais certainement d’origine flamande. Il était actif, lui, à Paris au 17e siècle. Et vraiment, il est en rupture avec la rusticité dont Marthe parlait concernant Louise Moillon. Parce qu’ici, vous avez des composantes très riches. Regardez les matières. Vous avez des étoffes comme le velours, le satin, la soie bicolore, le rouge et le mauve, et le tissu qui est frangé d’or. La table de bois rustique de Louise Moillon est ici remplacée par une cheminée de marbre veinée et voyez les objets d’orfèvrerie, de métal précieux, des objets de liturgie, qui sont une survivance de l’époque médiévale. Vous avez ce vase rond qu’on appelle une pyxide. En fait, c’est un vase à parfum cylindrique avec son couvercle plat. Et regardez toutes les incrustations, les gravures comme un coffret précieux. Vous avez également à côté de ces objets, vous avez de splendides fruits comme les pêches ou le raisin, avec des peaux veloutées. Vraiment un effet de texture ici. Il y a l’idée de l’immuable, qui était le marbre et le métal, qui s’opposent au transitoire avec les fruits. Donc d’un côté la permanence et de l’autre côté la fragilité. Les étoffes précieuses, les pièces d’orfèvrerie qui elles ne servent pas du tout aux besoins du quotidien, comme chez Louise Moillon avec son panier d’osier. Il y a également une idée de réversibilité. Parce que le tissu est présenté des 2 côtés, comme la médaille et son revers. La beauté OK, mais c’est éphémère. L’opposition entre la vie de ces fruits qui ne va pas durer et les matières froides et durables qui elles ne sont pas putrescibles. Donc opposition vraiment également entre le riche et le dur, le marbre et le métal, le souple, les feuilles, les tissus froissés. Donc c’est vrai qu’il y a des accords chromatiques, le rouge et le jaune, le vert et le mauve. Et aussi ici une composition selon la diagonale, parce qu’on retrouve en fond, sur la gauche, le noir, alors que sur la droite vous avez une partie bien plus éclairée. Mais tout ça s’équilibre dans ce très bel assemblage. C’est vrai que ce discours traduit une idée symbolique. Quand les objet disent la brièveté de la vie, par exemple, les feuilles qui commencent à sécher, les tâches sur les fruits, c’est une fuite du temps. La durée limitée de la vie est exprimée. Et ça, ça s’appelle une vanité, n’est ce pas ?
[Marthe Pierot] : Oui, tout à fait. On les retrouve beaucoup dans la nature morte. Et justement ça sera le cas de la prochaine, où il est vraiment question aussi de fugacité de la vie, de vanité, de temps qui passe dans une composition assez similaire parce qu’elle est très dense, où on a tous ces objets et ces fruits qui sont sur une table.
[Illustration : Pieter Van Der Bosh, Nature morte de fruits, raisins, grenades – vers 1650, peinture]
[Marthe Pierot] : Mais là c’est un peintre bien néerlandais qui réalise ce tableau au cœur du 17e siècle. Et dans ce tableau très dense, tout est crypté, tout a une place et un sens. Et donc on est vraiment dans cette idée de vanité aussi, parce que là les objets sont-là pour nous symboliser le temps qui passe et pour nous faire réfléchir sur la mort. Alors on va décortiquer un petit peu tout ça. On voit tous ces fruits entassés qui déjà sans ordre particulier, illustrent l’abus inconsidéré des plaisirs des sens. Mais qui traitent de la corruption aussi, parce que, regardez, dans l’ombre, des fruits commencent à pourrir. Un grain de raisin pourri, mais le coin de certaines pommes aussi. Et puis la mort fait donc son chemin et ce qui paraît frais et éternel, le plaisir sucré est véritablement associé au caractère éphémère de la vie. On a également cette poire qui est très très belle, qui a une taille très très grande, un peu trop grande d’ailleurs. [Peut-être bien un coing]. Voilà une sorte de mélange, un fruit hybride on va dire. En tout cas, sa couleur est très lumineuse. Elle accroche notre regard, elle est en position haute, elle est là pour éclairer le tableau. Donc il y a aussi des recherches esthétiques dans la composition et pas que symbolique. Mais par exemple, quand on voit la noix au premier plan, on peut symboliser ça aussi avec l’intérieur du crâne. Comme si la noix, le cœur de la noix, le fruit correspondait aux circonvolutions du cerveau. La grenade comme symbole de fertilité et d’abondance, et le citron, avec cette écorce pelée en spirale, représente le déroulement de la vie. Mais on peut aller encore plus loin et voir des symboliques plus religieuses. Comme la noix pour la chair de Jésus, la grenade pour le sang du Christ, la pomme qui est le fruit défendu d’avant d’Adam et Eve, le péché originel ou le raisin comme symbole de la passion de Jésus. Donc on peut toujours trouver beaucoup de sens à tous ces fruits qui ne sont pas là au hasard. Et puis c’est intéressant de voir comment se compose cette œuvre sur un fond très noir aussi, comme le précédent, très obscur.
On a 2 niveaux de support. Support inférieur qui est en bois, très austère et puis supérieur avec le velours et avec toute la préciosité des objets qui sont sur cette table et cette nappe en velours. La Coupe d’argent avec une divinité gravée dessus, le pied qui est une référence intellectuelle. Mais on a aussi un plat en faïence pour parler de la richesse, une flûte en cristal derrière, on voit le léger reflet avec les rehauts de blanc pour parler de la fragilité et le panier pour évoquer quand même la modestie. Le panier derrière la poire. Et pour terminer, c’est juste pour vous dire un tableau qui a subi sûrement un agrandissement. Parce qu’en fait le premier plan en bois est un ajout plutôt maladroit. Il n’était pas là au début. Donc on peut imaginer qu’il y a 2 signatures sur cette œuvre de Peter Van der Bosh.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Très bien. Alors on va quitter le monde des fruits pour celui des fleurs avec ce vase de fleurs de William Van Aelst.
[Illustration : William Van Aelst, Vase de fleurs – 1651, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors les fleurs ici comme les fruits précédemment, se détachent sur un fond très sombre. Et le bouquet est parfaitement asymétrique. Ce qui le rend parfaitement dynamique. Voyez comme la disposition des fleurs suit une oblique. Il y a des fleurs qui sont tout à fait naturalistes. Le bouquet que vous avez-là est impossible cependant, dans la mesure où la floraison de toutes ces fleurs ne se produit pas au même moment. Cependant, ici, elles sont toutes en fleurs. Donc c’est inconcevable. Mais le tableau, et en tout cas l’œuvre d’art, permet cette réunion de toutes ces fleurs ensemble.
Alors c’est vrai que les natures mortes de fleurs sont très nombreuses, car on l’a un petit peu expliqué en introduction, mais avec les grandes découvertes, il y a cette arrivée en Europe de plantes qui sont inconnues et qui suscitent un énorme intérêt. Il y a une accumulation de spécimens que l’on peut voir dans des cabinets de curiosité et également dans les jardins botaniques. Il y a suite à ça des catalogues qui se créent, une volonté de classifier tout cela. Et c’est l’apparition d’une illustration scientifique et des peintres sont là pour en rendre compte. Si vous voulez, c’est intéressant aussi de parler du type de fleurs que nous avons ici. Puisque vous découvrez cette tulipe blanche et rose qui est donc originaire d’Iran ou d’Afghanistan. Elle est un symbole d’immortalité, mais quand elle arrive en Occident, elle va générer une mode, une mode pour la tulipe. On va l’acclimater, on va créer pour elle des serres. Et c’est vrai que la demande est extrêmement forte, tellement forte en 1630, que les prix vont flamber et certains artistes même vont échanger leur œuvre contre des bulbes. Il y a une spéculation extraordinaire qui atteint des sommets jusqu’à un crash en février 1637. Donc cette période-là on l’appelle aujourd’hui, celle de la Tulipomania [C’est fou. Aujourd’hui ça n’a plus du tout la même valeur]. Ca c’est sûr, mais donc il n’y a pas qu’elle. Auprès de cette tulipe, vous avez la très belle pivoine qui vient de Chine. Vous avez également la rose. Qui est un symbole associé à la Vierge Marie. Vous avez également le pavot, tout à fait hallucinogène. Regardez donc la libellule sur le coquelicot rouge, à gauche. La libellule qui symbolise la transformation. Elle s’extirpe de son enveloppe pour devenir autre chose. Et puis vous avez cette petite chenille qui s’approche du vase qui dit la brièveté de la vie. Donc c’est vrai qu’elle est caméléonesque notre chenille, parce qu’elle prend les couleurs du pied du vase. Elle est dorée, elle est précieuse comme lui. Donc dans ce bouquet il y a vraiment beaucoup de gaieté, une exubérance de couleurs. Et on a l’impression que le vent l’agite comme une chevelure. Et c’est vrai aussi que ce tableau nous permet de mieux comprendre un moment de l’économie des Pays-Bas. Il y a une autre lecture au-delà d’un plaisir esthétique.
[Marthe Pierot] : Comme beaucoup de natures mortes en tout cas au 17e siècle. Alors on continue et on reste dans les peintres du Nord avec Van Schrieck qui était en fait un ami de William Van Aelst dont vient de vous parler Isabelle.
[iIllustration : Otto Van Schrieck, Serpents, crapauds et papillons – 1639-1678, peinture]
[Marthe Pierot] : Ils ont voyagé en Italie ensemble. Et puis après Van Schrieck s’installe à Amsterdam et il se spécialise vraiment dans la représentation des sous-bois. C’est à dire vraiment, il va parler de la nature, mais de la nature humide et du microcosme qui se passe, de cette nature très discrète qu’on ne voit pas tout de suite. Ce monde qui n’apparaît pas vraiment au premier plan. Et de ça aussi le principe de la nature morte, c’est de montrer ce qui est discret. Alors là, c’est pas tout à fait une nature morte, c’est plutôt une peinture de scène animalière de sous-bois. Mais on montre quand même finalement un microcosme, quelque chose de finalement d’assez caché [et qui fait sens] et qui fait tout à fait sens, parce que dans ce qu’on voit alors, au fond il y a un horizon montagneux, vaporeux dont on ne définit pas vraiment la géographie. Mais surtout, au premier plan, on voit des animaux et c’est important de comprendre ce qui se passe. Parce que vous avez un serpent qui est en train d’attaquer ou qui va attaquer une grenouille, ou un crapaud qui mord, lui qui dévore un papillon. Et en fait, vous avez ici le cycle de la vie qui est raconté avec ces proies qui sont mangées, ces reptiles qui se mangent entre eux. Voilà, il y a vraiment cette idée de parler aussi encore une fois, de la fugacité, de la fragilité de la vie, de l’aspect très éphémère, avec justement ces animaux qui s’entretuent. Donc on a quelque chose d’assez violent finalement dans cette nature-là qui est représentée.
Mais ce qui est très beau, c’est de voir aussi la justesse de la réalisation de cette peinture. Parce qu’on a vraiment une précision extrême au niveau des formes végétales. Regardez la nervure des feuilles très délicate, la peau luisante du reptile, la mousse au premier plan qui est réalisée à partir d’une éponge, les papillons qui ont été faits avec des vrais ailes de papillon que le peintre utilisait comme pochoir. Il était vraiment fasciné par la nature et par les insectes, parce qu’il faut savoir que ce peintre avait un enclos avec des reptiles et des insectes partout. Il avait beaucoup de livres de botanistes très célèbres qu’il étudiait. Et il avait des tiroirs remplis de bêtes mortes chez lui. Il faut imaginer sa maison, mais en tout cas, ça donne une représentation hyper-exacte des espèces animales et végétales qu’il réalise à partir d’observations. Donc on a ce microcosme, on a ce ce rocher humide qui met en scène la violence des luttes animales. Et c’est vraiment une volonté de parler de ce qu’on peut qualifier du memento mori. Souviens toi que tu vas mourir. Et puis on a autre chose aussi, on a cet arbre mort derrière qui annonce peut être la mort. Mais il est envahi de lierre. Le Lierre qui est une plante qui résiste, qui s’accroche, qui est tenace pour dire la vie, qui continue à exister aussi quand même malgré tout. Et ce qui est très beau dans ce tableau, c’est de voir la palette très sombre qui est déployée. Mais surtout la beauté de ces papillons très délicats qui sont comme un éclat de lumière, dans l’aspect très sombre de cette roche humide. On a vraiment un jaune qui tranche sur le noir. C’est ce qu’on voit en premier. Et ça, c’est très délicat de la part du peintre.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors nous allons continuer avec une fantaisie d’artiste. Nous passons au 18e siècle à présent.
[Illustration : Pierre Hubert Subleyras, Fantaisie d’artiste – 1701-1750, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Pierre Hubert Subleyras qui est un peintre du Gard, de Saint Gilles à côté de Nîmes. Et c’est vrai que ici et bien on remarque d’emblée une accumulation d’objets, un assemblage dense voir complexe. Cependant, tout est étudié ici. Ce désordre est tout à fait organisé. Cette composition, on va dire qu’elle est faussement négligée. Elle fait sens en fait, et il y a plusieurs sens à ces objets. On peut lire cette nature morte comme étant une allégorie des 5 sens. Puisque vous avez la peinture avec la palette et les pinceaux qui nous parle de la vue. Vous avez la sculpture avec ces sculptures blanches en marbre qui nous parle du toucher. Vous avez, avec les partitions musicales et le violon, le sens de l’ouie. Avec le vin et le verre, et bien vous avez le goût. Et bien sûr, avec donc les fleurs rouges et roses, vous avez l’odorat. Donc il y a les 5 sens. C’est un thème fréquemment représenté en peinture au 18e siècle. Mais on peut parler également d’un hommage aux beaux-arts. Quelqu’un comme Chardin qui est le grand grand peintre des natures mortes au 18e siècle, avait déjà évoqué cela dans ces tableaux, en parlant de peinture, de sculpture donc et également d’architecture, ce qui n’est pas le cas ici. Mais il y a ce côté méli-mélo artistique et c’est vrai que sont réunis par exemple ici des chefs d’œuvre de la sculpture antique. On sait que Subleyras s’est rendu à Rome. Il a découvert des chefs d’œuvre de l’Antiquité. Comme par exemple sur la gauche, vous avez ce dos qu’on appelle le torse du Belvédère, qui est une statue antique. On ne connaît pas sa provenance, mais elle exerce une fascination considérable sur les artistes qui sont nombreux à venir la dessiner.
Vous avez tout à fait à droite, cette tête renversée en arrière, qui est en fait une statue en marbre de Paros. Et c’est une statue du 5e siècle avant Jésus Christ. Et au centre, vous avez la statue de Sainte Suzanne qui est une martyr du 3e siècle et qui est drapée à l’antique. Même si l’œuvre ici est du 17e siècle, elle est l’œuvre du sculpteur François Duquesnoy. Donc il y a 3 références qui sont liées à l’Antique et vous avez véritablement ce courant classique qui est très présent ici. Donc Subleyras est en fait connu pour être un peintre d’histoire. Mais finalement ici, et bien ce n’est pas du tout le cas. Le tableau qu’il nous propose est un tableau mystérieux qui tient une place à part dans sa production. Mais on peut penser qu’ici ça n’est pas une commande et qu’il est parfaitement libre de réunir les objets qu’il aime. Donc ceux qui sont à portée de main dans son atelier et qu’il compose de manière très personnelle et poétique. Un tableau qu’on peut lire comme un rébus. Le titre du tableau qui est “Fantaisie d’artiste”, nous parle de cette fantaisie au sens littéraire du terme. Une œuvre d’art dans laquelle l’imagination se donne libre cours.
[Marthe Pierot] : Exactement, c’est ça qui est joli. Et c’est vrai que là on a des objets pour la première fois, on sort des animaux ou des fleurs et des fruits. Bon, on revient avec les fruits. Et en fait là on fait un bond dans le temps un petit peu parce qu’on est au début du 20e siècle avec cet artiste toulousain, Marc Lafargue, qui est poète, critique d’art et aussi peintre.
[Illustration : Marc Lafargue, La coupe de pêches – 1896-1927, peinture]
[Marthe Pierot] : Et qui est surtout un autodidacte et réalise beaucoup d’œuvres de manière assez discrète. Donc on le connaît peu, mais le musée des Augustins possède beaucoup de ces œuvres qui ont toujours ces ambiances très fraîches et ces couleurs plutôt vives ou tranchées. Et ce qui est intéressant, c’est de noter tout de suite le cadrage de cette nature morte où on zoome tout de suite sur le sujet avec un cadrage serré tellement serré que finalement les choses sont un peu coupées. Parce que finalement, le plat à droite n’est pas entier et le haut de la bouteille est également coupé. Mais ce qui nous plaît surtout avec ce tableau, c’est l’audace du blanc sur blanc. Là, on se dit que tout est blanc, les objets, c’est à dire la bouteille, le compotier, le plat, la nappe et le mur au fond. Au siècle précédent les peintres avaient envie de chercher à faire ressortir les différentes matières et les différentes couleurs dans leur composition. Mais lui Lafargue, il écrase complètement le blanc sur le blanc avec vraiment désinvolture. On a un blanc qui est quand même teinté de gris pour apporter du relief, mais c’est vraiment un monochrome. Et puis il y a évidemment ce jaune au centre avec ces pêches qui nous font penser à des citrons aussi tellement c’est frais et acide. Mais ce jaune avec des petites touches vertes et rouges qui représentent soit la végétation ou soit les motifs sur les plats qui viennent quand même réveiller un petit peu ce tableau. Mais voilà, c’est ça qui est intéressant aussi, c’est de voir la modernité de ses couleurs très fraîches et de cette touche qui est très large, très rapide, très épaisse. Elle est parfaitement moderne. On est plus loin dans le temps et on le voit parce que les peintures d’avant étaient très lisses, très léchées, très dessinées, et là on a quelque chose de plus moderne. C’est évident et ça se voit. On est bien loin d’une peinture très propre et polie.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et bien on va continuer avec le 20e siècle [oui, on reste dans la modernité], voilà avec donc ses harants d’Alfonse Faure.
[Illustration : Alfonse Faure, Nature morte : harengs – av. 1947, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Nous sommes après la seconde Guerre mondiale et c’est un peintre toulousain qui doit beaucoup à Cézanne. Alors Cézanne voulait conquérir Paris avec une pomme et il a repopularisé la nature morte. Et donc ici on a effectivement un morceau de nappe qui est peut être pas aussi froissé que chez Cézanne, mais c’est vrai qu’il nous propose une perspective tout à fait instable et nouvelle. Du genre de celles qu’on peut trouver dans les natures mortes de Bonnard par exemple.
Vous voyez la table, elle semble basculer au point de faire glisser les objets. La stabilité était tellement importante au 17e siècle, et ici, en fait, elle est un petit peu mise à mal. Donc c’est intéressant de voir que, à présent, le sujet n’a plus tant d’importance. Ce qui compte c’est la force picturale, la captation des lumières sur les éléments. On a vu jusqu’à présent des fleurs, des fruits et des objets précieux, mais là voilà qu’on a de l’animalité puisqu’on a des poissons. Et c’est vrai que souvent dans les traditions de nature morte, on peut trouver des chasses avec des gibiers, de la pêche avec des poissons. Et c’est ce qu’on retrouve ici. Chez Chardin, peut être connaissez-vous un tableau qui s’appelle la raie ? Et c’est vrai que l’animal est saisissant voir troublant. Mais ici c’est du hareng et ça nous propose un produit de la pêche, un repas maigre avec un simple torchon pas tout à fait une nappe, des planches rustiques qui sont visibles. Donc c’est assez frugale ce repas à base de poisson, d’œuf et d’un peu de vin. On voit que dans l’assiette, il y a le strict nécessaire. Mais c’est un très très beau morceau de peinture. Ce sont nos yeux qui se régalent. Au 17e siècle, il y avait des natures mortes avec ce qu’on appelait les cuisines pauvres et dans ce cas-là, il y avait des harengs, du pain, de l’eau claire. Il y avait également les cuisines riches qui étaient des natures mortes avec des objets très précieux, très chers et même des produits exotiques. Donc ici, avec ce tableau du 20e siècle, on retrouve le poisson, comme on a beaucoup pu le trouver dans les siècles précédents en nature morte. Quand et bien il y avait et bien à côté de lui un pichet de vin qui signifiait le sang du Christ, le sang du sacrifice. Mais on se rend compte que les poissons qui étaient une référence aux chrétiens, ici ces références sont vidées de leur sens. Les symboles ne fonctionnent plus. C’est la nature mode du 20e siècle qui est bien différente.
[Marthe Pierot] : Oui, comme le tableau précédent finalement, on est juste dans le plaisir de la contemplation et on se libère un peu de toutes [ces connotations intellectuelles]. Ouais, c’est vrai, dont il faut parfois les codes. Alors on continue toujours dans la modernité et là on arrive vers la destruction ou la déconstruction avec cette gouache sur papier.
[Illustration : Pierra Daura, Service à thé – vers 1928, peinture]
[Marthe Pierot] : On précise la matière évidemment parce qu’en image ce n’est pas évident. Le service à thé de Pierre Daura. Pierre Daura est un artiste espagnol assez engagé qui va complètement tomber amoureux du Lot dans les années 20 et il est très présent à Saint-Cyrq-Lapopie – si vous connaissez ce petit village – et notamment connu parce qu’il va redonner à ce village qui avait été quasiment ruiné, tout son lustre et sa gloire, justement par le pouvoir de son art et de sa notoriété. Donc on parle de lui là-bas.
Il y a même les célèbres maisons Daura qui sont des résidences internationales d’artistes. Et ce qui est important de dire concernant ce peintre, c’est que vers la fin des années 1929, avec ses amis, ils forment une association d’avant-garde qui se nomme “cercles et carrés”, tenant de l’abstraction et de la géométrie, donc complètement illustrée par Mondrian ou Picasso.
C’est une association qui fait face à l’omniprésence à la même époque du surréalisme. Le surréalisme, c’est vraiment, c’est ce qu’on considère comme ces peintures qui proposent des associations aberrantes d’objets et des compositions très irréelles comme le faisaient Magritte ou Dali. Et donc là, en fait, on est vraiment dans le cubisme. Le cubisme qui propose une déconstruction du réel mais jamais abstraite. C’est fragmenté, c’est cassé, mais c’est toujours figuratif. L’idée, c’est de démultiplier les points de vue de l’objet pour pouvoir le voir sous toutes ses formes ou sous tous ses aspects. Et là, on a vraiment un cubisme assumé parce que les lignes se découpent énergiquement dans ce service à thé. Il y a une brutalité des angles vifs. On a des carrés et des formes strictes un petit peu partout. Regardez même la nappe, il y a un motif quadrillé aussi dessus. Et puis on a la gaîté et l’audace des couleurs qui tranchent, le bleu, le orange, le rose. Alors on a vraiment, voilà cette composition très très riche et très très forte.
C’est l’heure du thé, on reçoit. Enfin, on peut distinguer en fait une théière et une tasse qui eux offrent un peu de rondeur. Finalement dans tout ça, c’est ce qui nous rassure un petit peu par rapport à tous ces angles très vifs. C’est un repère aussi. On arrive à les reconnaître alors que les autres objets sont plus compliqués. On distingue des livres, peut être pour faire la part belle à la détente qu’offre le thé. Et puis on a une table avec peut-être une chaise derrière orange dont le orange répond au pied de la table. Et puis on a une sorte de pied noir ou une ombre de noir à droite qui, avec Isabelle, nous fait penser un peu à une jambe, comme si la table allait marcher. Il y a quelque chose de presque irréelle finalement ici. Voilà donc c’est intéressant aussi d’avoir ces mobiliers qui évoquent la stabilité, mais d’avoir aussi la rondeur du service à thé qui apaise un petit peu tout ça. Mais en tout cas, comme le tableau précédent, la lecture n’est pas cryptée. Là ce n’est pas une allusion aux caractères fugaces de la vie, ou une vanité ou une allégorie. C’est le plaisir des formes et des couleurs.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Exactement. Alors nous allons terminer par un dernier visuel et un tableau qui est également l’œuvre d’un peintre espagnol. Il s’agit de Carlos Pradal.
[Illustration : Carlos Pradal, Nature morte : œufs et oignons – 1967, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Une œuvre de 1967. Elle est assez proche de nous. Carlos Pradal, c’est un peintre espagnol qui a travaillé principalement à Toulouse. Ses parents ont fui le franquisme pour se réfugier en France et il a été autodidacte. Mais il a quand même donc accéder à l’école des Beaux-Arts de Toulouse. Et c’est intéressant de dire qu’à la fin du franquisme, il va retourner en Espagne et il s’y fera connaître.
Donc Carlos Pradal, c’est quelqu’un qui veut donner aux objets une présence plus forte que leur réalité. Ça c’est en fait un beau défi. Il a réalisé de nombreuses séries sur des viandes, des billards, des pichets, mais là on a des œufs et des oignons. Alors la composition est amusante parce qu’elle est tout à fait horizontale. Il va aligner façon électro-encéphalogramme plat ces éléments. Et c’est vrai que c’est assez incongru. On a l’impression que l’oignon et les œufs sont enfilés comme sur une brochette. Donc ce qui est très important c’est la touche de Carlos Pradal. Elle est large, elle est rapide et vous voyez l’application de matières colorées, de strates denses et épaisses. Oui, il a recours à ce qu’on appelle des empattements. Ces plages de couleurs sont très onctueuses. Elles coulent sans contrainte et il les travaille au couteau. C’est un rythme très dense. Il y a quelque chose d’un petit peu saturé et vous avez par exemple quelque chose d’onctueux. J’en ai déjà parlé, mais on a l’impression d’une texture qui pourrait être celle du beurre par exemple.
Donc c’est une maçonnerie qui est ici obtenue. Et c’est aussi bien sûr un travail sur la matière parce que le fond est très noir et c’est vrai que, le dessin est comme remplacé par la couleur. Donc on voit qu’il y a, comme Marthe en parlait déjà, cette déconstruction des contours habituels. Et c’est vrai qu’il y a une déformation qui flirte un petit peu avec l’abstraction. Entre figuration et abstraction, comme Nicolas de Staël avait pu trouver ce créneau. C’est vrai qu’il y a ici des référents qui sont figuratifs, qui sont conservés, mais qui sont tellement modifiés ou simplifiés à l’extrême, que finalement reste le plaisir de la couleur. Parce que justement le sens des choses devient complètement allusif. Et c’est le pouvoir expressif qui est exalté. Notons qu’en 1986, le musée des Augustins de Toulouse a consacré une grande rétrospective à Carlos Pradel.
[Marthe Pierot] : C’est vrai. Alors, peut être qu’on vous a ouvert l’appétit avec toutes ces natures mortes. Mais en tout cas, on va conclure pour terminer cette conférence. Et c’était important pour nous de terminer par 2 peintres espagnols. Parce que finalement, c’est un bel hommage à la peinture espagnole qui a énormément œuvré en dans la nature morte. C’est important de le dire. C’est juste que le musée n’en possède pas beaucoup. Mais évidemment, on n’oublie pas des grands peintres comme Zurbarán ou Goya qui ont fait des fabuleux morceaux de peinture aussi dans la nature morte.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, mais on s’aperçoit qu’au fil des époques, le genre évolue. Effectivement, on va laisser de côté la dimension symbolique. On va cesser de décrypter, de décortiquer, de savoir pourquoi tel objet est plutôt là qu’ailleurs. Et c’est vrai qu’au 20e siècle, on va vraiment évacuer toute cette dimension explicative et symbolique.
[Marthe Pierot] : Oui, il y a vraiment une liberté, juste un plaisir du sujet et de la beauté finalement, tout simplement. Et il y a un véritable plaisir aussi pour les peintres dans la réalisation de la nature morte. On l’a bien vu. On fait la nature morte depuis toujours et encore aujourd’hui, parce qu’en fait, c’est une véritable liberté pour l’artiste. Il peut associer ou créer ou imaginer des combinaisons totalement libres finalement, et c’est intéressant pour lui. Et puis c’est aussi un très très bon exercice pour travailler sur les différentes textures et les effets de matière. Il va pouvoir donc s’exercer sur le reflet du verre, les aspérités d’une terre cuite, comment traduire la douceur et la rondeur d’un fruit ou encore la fraîcheur d’une porcelaine ou la rudesse d’une table. On peut aller très loin.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Parce que’à tous ces effets de matière dont Marthe parle, on est très sensible. Et c’est vrai que on va trouver que la nature morte est d’autant plus apaisante, qu’elle est familière, que l’assemblage des objets dans un tableau peut procurer une harmonie douce, reposante même qui invite à la contemplation.
[Marthe Pierot] : Oui, tout à fait. En fait, on aime vraiment les natures mortes et on a envie de vous demander, est-ce que vous aussi c’est quelque chose que vous appréciez ? et pourquoi vous aimez les natures mortes ?
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Ca c’est une belle question.
[Marthe Pierot] : En attendant, on va se quitter ici et merci beaucoup.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et à une prochaine fois.
[Marthe Pierot] : Au revoir.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Au revoir.
Lumières du Nord
Lumières du Nord
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Lumières du Nord”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2023]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Messieurs, dames bonjour, Marthe et moi, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle conférence sur un joli thème aujourd’hui.
[Marthe Pierot ] : Oui, le nu. Le corps mis à nu plus exactement. Nous allons voir tout ça dans les collections du musée. Mais pour commencer, il faut savoir que le nu est un genre artistique à part entière, et c’est même un des plus importants dans l’histoire de l’art occidental. Mais quand on parle de nu, le nu, qu’est-ce que ça veut dire ? Et bien le nu correspond à une représentation du corps très idéalisée. Et dès l’Antiquité, le nu en faites renvoie à la beauté, au sens moral et esthétique, et pas vraiment à la sexualité. Mais on en reparlera plus tard. Donc dans ce sens, le nu correspond plutôt à des figures héroïques et masculines. Historiquement, le nu est donc masculin.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui. Mais en revanche, la nudité serait féminine. Et quand on parle justement de nu féminin, il est question donc de quelque chose de charnel, de quelque chose d’érotique qui nous dit aussi la vulnérabilité de la femme qui est dévêtue, donc sans protection. Et d’ailleurs souvent quand il y a une nudité féminine, et bien il y a un léger voile qui n’est là en fait que pour renforcer le désir qu’on peut avoir du corps féminin. Donc intéressant de se dire que la nudité féminine n’est jamais tout à fait totale.
[Marthe Pierot ] : Oui, c’est vrai. C’est une nuance importante à soulever. Alors il faut aussi savoir que la manière dont on va représenter les corps nus diffère, selon les époques, selon le siècle où l’œuvre a été réalisée, selon des canons qui sont propres à des époques et à des sociétés. Même si on s’aperçoit qu’il y a parfois une constante dans la manière de représenter certains nus avec des codes de représentation très stéréotypés qui parcourent les siècles.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Mais justement, en fait, on se rend compte que la nudité est un sujet, donc absolument évident et qui existe depuis toujours dans l’histoire de l’art. Quand on pense justement à ces statuettes de Vénus préhistoriques qu’on a pu retrouver dans les Pyrénées il y a 20 000 ans. Quand on pense aux dieux et aux déesses de la mythologie grecque, on se dit que voilà, ça fait très longtemps que le nu est là.
[Marthe Pierot ] : Oui, et bien sûr, la culture qui représente le plus de nu, c’est évidemment l’Antiquité, la Grèce antique, où là il y a une prolifération de représentations de nu. Mais pour vraiment parler du nu comme un idéal de perfection et de beauté absolue.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors c’est vrai qu’au Moyen Âge, il y a, christianisme oblige, une manière d’occulter le nu. En fait, on trouvera Adam, Eve et quelques individus luxurieux plein de péchés et de vices qui seront montrés nus. Mais c’est tout.
[Marthe Pierot ] : Oui, mais le nu revient au moment de la Renaissance, puisque la Renaissance reprend l’Antiquité comme modèle avec tous ces codes de représentation. Et la Renaissance, c’est aussi l’époque du progrès scientifique, de l’humanisme. On s’intéresse au corps humain et donc le nu va aussi intéresser pour son côté anatomique et scientifique.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et on peut dire enfin que, au 19e siècle, et bien les nus vont peupler les salons. On va avoir de plus en plus de représentations et surtout de femmes, avec un corps fantasmé, un corps stéréotypé qui met, qui définit un canon de la beauté dont notre société actuelle est encore très imprégnée.
[Marthe Pierot ] : Oui, tout à fait. Et bien allons découvrir tout ça au travers de nos dix visuels.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Allons y.
[Illustration : Bernard Lange, Philopoemen à Sellasie – 1829, sculpture]
[Marthe Pierot ] : Alors on va débuter avec cette sculpture, qui s’intitule “Philopoemen à Sellasie”. Bon, c’est un nom un peu compliqué, mais en fait Philopoemen c’est le nom de cet homme. Et Sellasie en fait correspond à une ancienne ville du Péloponnèse. Et donc ce moment correspond à une bataille, qui a eu lieu donc dans cette ville au 3e siècle avant Jésus Christ. Alors c’est une sculpture qui a été réalisée par Bernard Lange qui est un sculpteur toulousain. Mais qui était surtout conservateur au Louvre et restaurateur en chef des antiques. Donc la restauration c’est l’essentiel de son travail. Et donc il a vraiment une sensibilité très affirmée pour l’art de l’Antiquité. Et dans cette sculpture, il nous montre donc ce jeune guerrier très courageux qui est blessé. En fait regardez, il est en train de s’extraire un morceau de javelot de sa cuisse pour continuer le combat. Ca c’est un signe de vertu et de courage quand même. Il a encore son épée à la main. Mais il a quand même pris le temps de se débarrasser de sa cuirasse qu’on retrouve en bas derrière ses jambes, et c’est une manière aussi de mettre en lumière sa musculature et son corps. On remarque une silhouette très précise, une ligne pure et surtout un visage qui n’exprime aucune émotion, enfin surtout de la détermination mais pas de la douleur. Alors que ça doit être un moment assez douloureux quand même. Finalement on est d’accord. Mais là c’est l’idée de mettre en avant son courage surtout. Et puis on apprécie aussi la finesse et le détail de sa chevelure. Et puis le plissé du drapé. Et donc avec tout ça, on note que il y avait vraiment un goût très prononcé pour et bien l’Antiquité, et c’est ce qu’on appelle le néo-classicisme parce qu’on est au 19e siècle et on revient à toutes ces références de la culture antique. Donc on a ici véritablement un nu héroïque. Là on y est dans cette représentation là, et il y a des proportions très idéales. C’est ça qui fait référence au nu parfait de l’Antiquité, il y a tous ces canons.
Alors quand on parle de canon, qu’est ce que ça veut dire ? En fait, il faut savoir qu’il y a Polyclète cet homme, il a proposé une théorie de l’esthétique du corps nu avec des règles très précises, et c’est ça qu’on appelle le canon. Cette règle, elle se base sur une histoire d’équilibre et de rapport de proportions entre les différentes parties du corps. En gros, le corps doit mesurer une certaine taille et tout est proportionnel à ça. Et ça révolutionne complètement notre rapport au corps humain. Parce que tout est défini selon des lois mathématiques bien strictes et la beauté a donc à ce moment-là une valeur quantifiable et numérique. Par exemple, la tête doit entrer sept fois dans la hauteur du corps, ou le pied doit correspondre à un certain pourcentage, toujours par rapport à la hauteur du corps.
Donc tout est calculé. Mais parfois le résultat est un peu étrange. Par exemple, ici, la tête nous semble ridiculement petite. Voilà donc là on peut le dire. Et c’est important aussi de dire qu’en plus de représenter l’héroïsme avec ce nu parfait, il y a cette idée de montrer des corps très dynamiques et en forme pour représenter ou symboliser une cité, une ville qui est puissante et forte. À l’époque de l’Antiquité, c’était une manière de montrer que la cité grecque était très très forte. Donc le nu est un instrument politique aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors on va passer maintenant à une autre œuvre.
[Illustration: Alexandre Renoir, Horace enfant – 1850, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Il est question de “Horace enfant”. C’est un nu antique encore une fois, idéalisé encore une fois, pour une œuvre qui elle est aussi du 19e siècle, comme celle dont Marthe vient de vous parler. Mais ici, c’est un autre âge, puisqu’il s’agit de l’adolescence. Vous avez le type même de l’éphèbe. C’est à dire du très beau jeune garçon, et sa sensualité est assez frémissante. Elle s’oppose à la froideur des modèles néoclassiques qu’on peut voir à la fin du 18e siècle et au début du 19e. Alors-là, il est couché, notre Horace sur son manteau avec une jambe gauche qui est repliée sous la jambe droite. Il a les mains près de la tête et voyez, vous distinguez une colombe posée sur le sol près de ses pieds. Et elle porte dans son bec une branche de laurier. Elle veut en couvrir le jeune homme. Il y a toute une inscription latine qui nous fait comprendre qu’elle cherche avec les feuilles à soustraire aux vipères et aux ours, le corps donc vulnérable de ce jeune garçon.
Alors ce jeune garçon c’est le poète Horace lui-même. Ce poète latin du premier siècle avant Jésus Christ. Il raconte donc dans ses textes des épisodes de son enfance. Et il se décrit comme un enfant protégé des dieux. Et là je pense qu’il manque pas d’air. Parce que voilà, il se montre sous un très beau rôle. Un adolescent qui est couronné de lierres et de lauriers. Et c’est vrai que le sculpteur choisit d’illustrer les vers ou les lignes de ce poète pour faire sa sculpture ici. Alors Renoir, et je dirais Alexandre Renoir, c’est un sculpteur. Ne confondons pas avec le peintre Renoir, nous propose la thématique de ce nu couché qui est souvent traité en histoire de l’art.
Et souvent on pense à l’hermaphrodite couché, qui est une sculpture célèbre du musée du Louvre. Il existe aussi beaucoup d’exemples de Vénus qui sont elles-mêmes couchées. Mais voyez, ce qui s’oppose à ce dont Marthe vient de vous parler avec un personnage qui était très vertical, le Philopoemen de tout à l’heure. Mais la position à l’horizontale que nous avons ici, favorise le délassement, une sensualité assez affolante d’un corps qui s’offre, qui ne contrôle plus rien justement, qui n’a plus aucun réflexe de pudeur qui consisterait à se couvrir. Là, ça ne fonctionne pas. Le corps s’abandonne et on notera en fait ici que ce corps adolescent est d’une réelle ambiguïté. Il y a bien sûr le prénom Horace qui évoque le côté masculin. Mais regardez le mouvement de pâmoison de la tête vers l’arrière, les bras gracieux, les boucles en cascade, les muscles non encore marqués. Tout évoque ici le corps féminin.
[Marthe Pierot ] : Et la position allongée, comme tu l’as dit.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, bien sûr. Donc en fait, l’œuvre semble conçue pour créer une ambiguïté. Et c’est vrai que ici, il y a la partie la plus intime de ce corps qui est caché par un tissu et qui fait que le doute peut subsister. Garçon ou fille ? La question reste posée.
[Marthe Pierot ] : Tout à fait. Et on peut pas sauver le drap pour savoir ? Alors on va passer à la peinture.
[Illustration : Marco Basaiti : La vierge à l’enfant entre saint Sébastien et sainte Ursule – Vers 1500, peinture]
[Marthe Pierot ] : Avec une œuvre plus raide que la souplesse proposée par la sculpture précédente. Mais c’est aussi l’occasion de parler du Moyen Âge avec ce peintre de Venise. Et nous sommes en fait vers les années 1500. On est vraiment à la fin du Moyen Âge.
Mais on en a parlé un petit peu en introduction, le nu au Moyen Âge, c’est compliqué. Il faut vraiment savoir que la nudité est très mal perçue par la société. Et justement, la mode c’est plutôt de se couvrir, surtout pour les femmes. Il ne faut absolument pas montrer sa peau. Mais il y a quand même du nu dans l’imagerie chrétienne, c’est important de le dire. Il y en a même plusieurs, il y a plusieurs catégories.
Par exemple il y a le nu naturel. C’est ce qui correspond aux premiers hommes, notamment à Adam et Eve, et même aux enfants. Parce que les enfants symbolisent l’innocence. La nudité du nouveau-né est souvent représentée, et c’est normal, et on le voit ici avec cet enfant au milieu du tableau.
Puis vous avez le nu temporel. C’est le nu qui qualifie la pauvreté. Un job par exemple, souvent dénudé pour symboliser justement la pauvreté de cet homme.
Le nu vertueux, autre catégorie. Et là c’est le nu qui est réservé au Christ. Un corps glorifié, idéalisé ou même pour les martyrs. Les martyrs qui sont nus ou à moitié nus pour susciter la pitié, la douleur et la modestie.
Et enfin vous avez le nu criminel. Alors celui-ci c’est le pire. C’est celui qui dénonce le mal, le péché, la luxure. Et c’est un nu qui est très souvent représenté par les femmes. Voilà alors dans ce tableau, qu’est ce qu’on a ? Et bien on a plusieurs nus, ou en tout cas des personnages qui sont traités différemment. Vous avez une vierge à l’enfant au milieu qui est entourée de 2 martyrs. 2 martyrs qui en fait ont reçu des flèches. C’est l’instrument de leur martyr et c’est pour ça qu’ils tiennent les flèches à la main.
A droite, Vous avez une femme. C’est sainte Ursule. C’est une chrétienne du 3e siècle qui a été massacrée par les Huns. C’est cette tribu d’Asie centrale qui envahit l’Europe. Et en fait de l’autre côté, vous avez un homme qui est saint Sébastien. Il ressemble un petit peu au Christ dans sa représentation. Comme s’il était vraiment sur la croix. Mais là, c’est un arbre que l’on a ici. Ce qui est intéressant, c’est que ce sont 2 martyrs qui ont reçu des flèches. Donc le martyr les réunit. Mais leur représentation est très différente. Parce que la femme se retrouve déjà devant un rideau. Elle est un peu à huis clos pour symboliser le monde intérieur et elle est habillé jusqu’au cou. L’homme en revanche, lui est dévêtu. Là on a un corps glorieux. On est dans ce nu vertueux justement pour symboliser la force, le courage, le martyr, la douleur, la pitié . Mais si cette femme avait été nue, elle symboliserait la luxure et non pas le courage. Donc c’est vraiment très différent au niveau du symbole. Et alors pour terminer, c’est intéressant de parler aussi de la représentation de saint Sébastien dans l’iconographie. Parce qu’en fait, c’est une image qui s’est vue réappropriée par la communauté homosexuelle dès le 19e siècle. Et on a souvent des saint Sébastien qui sont jeunes, voir androgynes, musclés et sensuels à la fois. C’est troublant. Et tout ça a été vraiment lancé un peu par le tableau de Pérugin. Ce grand peintre italien qui propose vers les années 1500, un saint Sébastien tout à fait rêveur avec un contrapposto et un pagne qui recouvre à peine son sexe et qui laisse du coup place à l’imagination. Quand on le voit ça troublait beaucoup de personnes. Donc voilà, ça commence comme ça cette représentation du saint Sébastien, comme un homme très sensuel et androgyne. Voilà.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Très bien. Alors maintenant nous allons continuer et on va trouver ici la première femme nue de notre exposé avec le tableau qui s’intitule “la générosité d’Alexandre”.
[Illustration : Jérôme-Martin Langlois, La Générosité d’Alexandre – Alexandre cède Campaspe, sa maîtresse à Apelle – 1819, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors ici, le nu signifie autre chose. Ici, le nu, c’est l’érotisme. Et c’est non plus la vertu du martyr dont Marthe vient de vous parler. Ça n’est plus non plus la gloire d’un héros ou d’une héroïne. On passe donc véritablement à cet érotisme. Au total ici, 3 personnages, mais seule une femme. La femme donc, qui est plutôt dévêtue, qui n’a pas forcément choisi de l’être. Une femme au canon néoclassique, très strict, tout de blancheur, de pureté, de jeunesse, de douceur. Ici, c’est une scène en intérieur, une scène de l’histoire romaine. Vous avez la peau de porcelaine de la femme à droite à peine couverte d’un voile en mousseline qu’elle tente de remonter un peu pour cacher sa nudité, sa vulnérabilité. Donc elle n’est pas entièrement nue et on comprend son embarras. On voit bien qu’elle rougit. Regardez ses joues.
Donc ici, l’idée de nudité repose vraiment sur le dévoilement. Maintenant, le personnage central. Alexandre le grand. Le grand chef militaire, le roi de Macédoine au nord de la Grèce, qui au 4e siècle va conquérir des territoires en allant jusqu’en Inde. Mais ici, et bien en fait, c’est un Alexandre d’opérette, rose, blond, assez sensuel. Regardez son torse qui s’offre à notre vue. Mais lui justement, il offre quelque chose au personnage de gauche. Le personnage de gauche, c’est son peintre officiel, il s’appelle Apelle. Et en fait, Alexandre a bien remarqué que ce peintre va complètement craquer pour cette adorable poupée rose et blonde qu’est Campaspe la favorite d’Alexandre. Alors, on comprend au regard et à la tête baissée de Campaspe qu’elle n’a absolument pas son mot à dire. Qu’elle est résignée, qu’elle n’a pas le choix et qu’elle est ici un objet, une marchandise, un trophée. Donc, sur le chevalet à gauche, voyez comme un hommage à la peinture, une mise en abyme puisque le peintre peint un tableau, et évidemment, il peint Campaspe nue. Et il est considéré très inconvenant pour une femme de poser nu. Mais le paradoxe, c’est que l’histoire de l’art est remplie donc de femmes nues. Et cela évidemment nous parle surtout du désir masculin.
[Marthe Pierot ] : Oui, tout à fait. Alors on va poursuivre avec une autre peinture qui nous montre aussi cette idée de poupée de porcelaine avec ces mêmes codes de représentation ou ces mêmes stéréotypes d’une peau très blanche, d’une femme qui est nue.
[Illustration : Gabriel Guay, La dernière dryade, 1898, peinture]
[Marthe Pierot ] : Alors là, on est plutôt à la fin du 19e siècle, on est presque au 20e siècle pour ce tableau réalisé par Gabriel Guay. Et en fait, pour un petit peu nous faire passer le nu sans problème, sans s’attirer la foudre des critiques, il nous parle réellement d’un sujet mythologique. C’est pas évident. C’est sa manière à lui de justifier le nu. Parce qu’en fait c’est une dryade et le nom nous l’indique d’ailleurs le nom du tableau. Donc les dryades, ce sont ces nymphes qui peuplent les forêts qui les protègent. Le mot dryade vient du latin druce qui veut dire chêne, et ça c’est important. Mais donc ici qu’est ce qu’elle fait ? Et bien elle est dans cette forêt. Elle gravit les marches d’un petit édifice qui est un monument qui représente le Dieu de la nature, Pan. Et il y a une inscription dessus, donc quand on zoome, on le voit une inscription qui signifie : Pan aimé des dryades amoureuses. Voilà donc il y a ce lien entre le Dieu de la nature et les dryades. Mais ce qui est intéressant, c’est de voir véritablement et bien l’harmonie chromatique de ce tableau, l’intensité des couleurs et ce contraste entre la peau laiteuse, très blanche, et la rousseur de la saison.
Vous avez tout un camaïeu de rouge orangé avec cette forêt qui a des couleurs très automnales. Ces feuilles qui tombent au sol et cette chevelure qui répond avec la couleur de la saison. Bref, tout est là. Mais ce qui est important c’est de regarder un peu plus loin dans le tableau et d’observer qu’au fond, au fond, l’ambiance est plus sombre. Il n’y a plus de couleur orange, plus de feuilles sur les arbres. On sent que l’hiver arrive. On voit même l’humidité avec la mousse sur ce monument en pierre. On sent le froid. On sent la fin d’une saison. On sent la fin de quelque chose. C’est la nature qui meurt, c’est le principe de l’automne. Mais Regardez le titre du tableau “la dernière dryade”. C’est la dernière, comme si la forêt allait disparaître, comme si c’était un monde qui s’écroulait ou la nature qui s’effondrait. Alors si on posait un discours contemporain dessus, on pourrait se dire que c’est une œuvre un peu écologique finalement. Voilà, mais on est vraiment, surtout à ce moment-là, au 19e siècle, dans les réalités de la scène, parce que cette femme est nue dans une forêt où il fait très froid. Mais c’est pas important parce qu’elle n’existe pas vraiment. On est plutôt dans le désir et dans le rêve ici et elle est représentée de dos. Un peu comme le vêtement qui est à moitié là et qui nous donne encore plus envie de voir. Et bien là le fait de l’avoir de dos et bien on ne la voit pas finalement. Il y a cette idée d’inconnue, elle nous échappe et ça c’est très érotique.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, c’est le teasing j’aimerais dire d’aujourd’hui. Alors à présent on va passer à un immense tableau qui fait 3m50 sur 5m20.
[Illustration : Paul Gervais, La folie de Titania – 1897, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Donc là on vous le précise. On ne le dit pas toujours, mais quand les tableaux sont un petit peu hors gabarit, c’est bon de le de le mentionner. Alors il s’agit en fait d’un tableau qui fait référence à la pièce de de William Shakespeare intitulé “Le songe d’une nuit d’été”. Donc une pièce du 16e siècle. Alors l’histoire se déroule dans une forêt étrange, un petit peu magique, le temps d’une nuit, une nuit d’été ensorcelante au sens propre. Parce que les personnages sont ensorcelés. Victimes de sort qui leur ont été jetés.
Alors il est question de Titania, le personnage qui nous regarde, qui est face à nous. Leur maîtresse, c’est la reine des fées, et elle est follement amoureuse d’un homme un humain. Alors en fait, le roi des elfes, son mari, a manigancé ce sortilège pour punir Titania de son infidélité. Voilà un petit peu l’histoire. Donc vous avez un cyprès, des lacs, des bois, des collines au loin, et cet homme à la tête d’âne, assis sur le banc de pierre. Autour de lui, il y a donc toutes ces femmes. Alors au sol, vous avez ce tapis de mousse avec des violettes et des roses coupées. Des couleurs donc atténuées. Et puis toutes ces femmes qui posent véritablement. Ces 4 femmes qui sont des fées mais qui sont très stéréotypées, qui sont toutes pareilles, qui répondent au code de la représentation et de l’idéalisation. Un petit peu comme notre dryade dont dont Marthe vient de vous parler.
[Marthe Pierot ] : Et je dirais même qu’elles sont 5.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, 5 à côté. Il faut bien les compter. Et en fait. Et bien elles ont des attitudes un peu confuses, un peu gênées, mais un petit peu de fausse pudeur je dirai. Alors l’atmosphère est douce mais un peu grotesque aussi. Et il faut se dire qu’au matin, suite à cette nuit, tout rentrera dans l’ordre. C’est 5 nus féminins iront se rhabiller et tout sera fini. Alors c’est intéressant de dire que à l’époque, quand ce tableau est montré, c’est un tableau qui est jugé comme inconvenant parce que justement, il n’y a pas de voile qui accompagne les corps de ces femmes. Il n’y a pas un atout, il n’y a pas donc un ruban ou quelque chose. Elles sont vraiment entièrement nues et elles sont en grandeur nature. C’est ça qui pouvait véritablement surprendre. Donc Gervais, l’auteur de ce tableau, est assez coutumier de ces femmes voluptueuses et aguicheuses, et c’est vrai qu’on le reconnaît à cela. Il y a comme un peu de grivoiserie et de sentimentalité. Alors la vie, bien sûr, c’est la littérature. Mais Shakespeare à bon dos quand même, parce que Gervais nous parle surtout du désir des hommes. Donc Gervais, je vous l’ai dit, se fait un peu esquinter par la critique. Mais c’est vrai que il est très aimé, parce que Gervais c’est un peintre décoratif. Et c’est vrai que dans des grands cafés, dans des grandes institutions et même au Capitole de Toulouse, à la mairie de Toulouse on retrouve ces immenses tableaux qui nous parlent d’un Gervais décorateur.
[Marthe Pierot ] : Alors je trouve que c’est important de préciser quand même que c’est 5 femmes sont nues, mais que la seule personne qui est habillée c’est l’homme. L’homme n’est pas nu parce qu’ici il est question d’érotisme. Donc en fait l’homme n’a pas cette place là. Donc c’est pas l’idée de l’héroïser là. C’est juste d’érotiser ces femmes. Alors bon on reste sur le nu, évidemment, c’est notre sujet, mais on retourne à la sculpture ici avec cette sculpture réalisée en 1894.
[Illustration : Eugène Thivier, Cauchemar – 1894, sculpture]
[Marthe Pierot ] : On est vraiment à la fin fin fin du 19e siècle par un sculpteur parisien très peu connu qui s’appelle Eugène Thivier et qui nous montre ici une femme qui est allongée. Alors elle est allongée sur un lit, on reconnaît le drap avec les plis et elle ferme les yeux, donc elle dort. Mais pendant qu’elle dort, une créature horrible grimpe sur son corps. En fait, elle fait un cauchemar et cette créature est une métaphore. Elle symbolise le cauchemar. C’est une sculpture plutôt allégorique. Mais Eugène Thiviers s’inspire d’un tableau du même thème. Un tableau réalisé un siècle avant par Füssil qui s’intitule aussi “le cauchemar”. Et en fait, on a vraiment cette idée d’un démon qui prend le corps d’une femme, qui monte sur le corps d’une femme, quitte à l’étouffer. Et d’ailleurs, on retrouve cette sensation d’oppression quand on fait des cauchemars. Mais pour abuser d’elle sexuellement. C’est ce qu’on appelle un incube. Voilà, c’est la représentation de l’incube qu’on voit dans le tableau de Füssil et donc ici que Eugène Thivier semble reprendre. Mais c’est assez symboliste aussi comme œuvre. Parce qu’il est question surtout du rêve, d’ésotérisme. On traite quelque chose d’immatériel en le rendant un peu concret avec cette créature horrible. Mais ne nous cachons pas, c’est surtout l’occasion rêvée et le prétexte idéal pour le sculpteur pour nous représenter un nu féminin voluptueux dans l’esprit du siècle, à la fois morbide et érotique. On est vraiment dans cette frontière là toujours un peu étrange.
Et on a une œuvre qui est une synthèse entre un style très néoclassique, parce que le corps féminin reprend tous les canons de beauté, et néogothique, parce que cette sculpture, nous fait penser à une gargouille ou à un monstre médiéval hybride, avec une corne unique, une queue velue, des ailes de chauve souris, des griffes. Et il y a une opposition très intéressante entre la laideur d’un corps qui est raide et hirsute, qui est celui du monstre qui renforce d’autant plus la beauté et la douceur de ce corps sensuel de la femme et lisse exactement exactement.
Mais ce qui est très important dans cette sculpture, et on garde le meilleur pour la fin. C’est que ce démon, n’est pas un incube, ce n’est pas un démon masculin. Ce démon a une poitrine, c’est un démon féminin. Ah là là !! Donc en général, quand il y a ces démons féminins, on parle de succube. Ce sont des démons qui abusent des hommes pendant leur sommeil. Chacun son tour.
Mais là ce n’est pas un homme qui dort, c’est une femme. Donc tout est mélangé, c’est n’importe quoi. Mais c’est un délice pour un psychanalyste, de voir cette sculpture parce que on parle du sommeil et donc de l’inconscient. C’est intéressant de traiter tous ces sujets. Le cauchemar qui réveille nos angoisses les plus les plus enfouies. Et le fait que les démons soient une femme, on ne peut pas s’empêcher de se demander si ce n’est pas une partie d’elle-même en fait finalement. Comme son inconscient, l’autre “je”, son côté obscur, son dark side, comme on pourrait dire, qu’elle tente de repousser.
Et justement, regardez, elle tente de le repousser d’une main, mais de l’autre main, elle s’agrippe au drap comme si elle prenait du plaisir. Et ça, c’est troublant parce qu’on est entre un mélange de plaisir et d’horreur, de peur et de désir. Et il faut savoir que le plaisir sexuel féminin est très souvent diabolisé.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et alors dans l’œuvre suivante, c’est quelque chose que nous retrouvons puisqu’il y a cette femme au serpent.
[Illustration : Anonyme, La femme au serpent – XIIe siècle, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors de quelle époque est-elle ? Peut être du 12e siècle ? Peut-être date-t-elle d’encore avant ? Il s’agit ici d’un marbre qui fait un peu plus de 1m de haut. Et nous sommes devant une des plus anciennes œuvres du musée des Augustins, ici avec cette période qui serait le 12e siècle. Alors on pense qu’elle provient du côté de Bagnères de Luchon. D’une église qui se trouve tout à côté du lac d’Oô justement. Et elle a été extraite de cette église en 1820. Et c’est vrai que c’est une pièce qui fascine vraiment. Elle présente une intimité qui est un peu dérangeante puisqu’il est question de la femme et de l’animal ici encore une fois. Mais ici c’est un serpent. Ce n’est pas cette créature qui avait tout de la gargouille dont Marthe vous a parlé.
Alors en fait, vous avez un travail de sculpture qui est assez rudimentaire puisqu’on comprend que le sculpteur va à l’essentiel pour traiter de ce corps. Il va surtout et bien traiter de la matrice, c’est à dire du bas ventre et des seins de cette femme. Mais regardez le reste du corps. Les jambes, les pieds, les bras ou les mains sont traités grossièrement comme rapidement. Et ce corps sculpté est aussi un petit peu à l’étroit dans un cadre qui semble un peu trop petit. Et alors maintenant, le sculpteur qui était-il ? Ben on n’en sait rien parce qu’au Moyen Âge on a très rarement une idée des noms des artistes.
Est-ce que ce sculpteur était malhabile ? On peut pas non plus le dire, mais en tout cas, ce qui est important pour lui, ce n’était pas véritablement un corps abouti. Mais c’était de faire passer un message moral. Même si c’est un peu énigmatique, ce message. Parce que finalement, il est question d’une femme qui donc enfante d’un serpent, d’un démon, et ce démon semble lui mordre le sein. Le spectacle est d’ailleurs assez difficile à soutenir du regard.
Mais dans un contexte chrétien, on pourrait parler de l’incarnation du péché, du vice, avec ce serpent qui rappelle bien sûr le péché originel. Et vous avez en fait un supplice qui est réservé à la femme débauchée et luxurieuse ou adultère. Une punition qui chercherait à nous dire qu’elle doit souffrir là par où elle a péché. Et là vous avez en fait une interprétation tout à fait négative. Un nu qui est criminel.
Mais si on regarde les choses un petit peu autrement, dans un sens plus positif, cette femme est en train d’allaiter un serpent. Et la signification peut être tout autre puisque dans l’iconographie antique, on trouve des œuvres qui illustrent la terre mère, la terre nourricière. Et cette culture peut être antérieure à la période romane. Cependant, l’iconographie de cette plaque de marbre n’est pas isolée. On connaît d’autres représentations de femmes qui allaitent un reptile dans de nombreuses églises romanes, comme à Moissac par exemple. Malgré tout la différence capitale ici, c’est que la femme ne fait pas que allaiter le serpent. Elle le met au monde et là, c’est compliqué. Mais ce détail a certainement toute son importance.
[Marthe Pierot ] : Alors on change de siècle d’époque et on revient à la peinture pour vous présenter un nu féminin peint par une femme.
[Illustration : Amélie Beaury-Saurel, Académie – 1890, peinture]
[Marthe Pierot ] : Ca change beaucoup de choses, vous allez voir. Alors déjà c’est une femme qui existe. Alors elle est anonyme. On ne connaît pas son identité. Mais cette fois-ci l’artiste ne cherche pas à justifier son nu par une figure de la mythologie ou un personnage complètement irréel de la littérature.
C’est une femme de son temps, c’est une Madame tout le monde. Comme c’est une Madame tout le monde, et bien, elle est réaliste dans sa représentation. Le réalisme du corps, on le voit par cette poitrine qui est un peu lourde, les vergetures ou les cicatrices qui se trouvent sur le côté de sa hanche. Et puis elle a un visage sans affectation, des cheveux attachés, elle ne pose pas, elle ne nous regarde même pas. Et elle semble très déterminée dans un décor qui ressemble à une jungle. Ce qui ajoute un côté très sauvage à cette femme presque indomptable. Elle tient d’ailleurs un roseau, comme si elle tenait une lance, un peu comme une amazone, ces grandes guerrières.
Ce tableau, le titre est important, il s’intitule Académie. Une académie en histoire de l’art, c’est l’exercice de représenter le nu d’après un modèle. Et c’est une étape de formation très importante pour l’artiste. L’artiste nous montre donc sa virtuosité. Et souvent c’est un exercice ou quasiment essentiellement, c’est un exercice réservé aux hommes comme la peinture d’histoire et d’autres sujets en histoire de l’art. Mais là, Amélie Beaury-Saurel le fait aussi et en fait, c’est tout à fait à l’image de la peintre et de la femme engagée et militante qu’elle était. Elle s’est formée dans une académie qu’on appelait l’Académie Julian. Elle reprend la direction de cette académie et en même temps que ce poste de directrice, elle continue à peindre. Elle encourage les femmes à peindre. Elle soutient l’éducation des femmes. Mais elle peint beaucoup de portraits sans commande et ce sont très souvent des portraits anonymes de femmes contemporaines, pas des personnages d’histoire. C’est ce sujet, c’est ce créneau qu’elle aime bien et qui est le sien et qui est tout à fait à l’image de ces combats aussi. Mais c’était intéressant de comparer avec un tableau de la même époque réalisé par un homme, Henri Martin, ce peintre toulousain.
[Illustration : Henri Martin, Beauté – 1900, peinture]
Et là cette fois-ci cette femme sur le côté, ce n’est pas une femme réelle, c’est une allégorie. Une allégorie de la beauté, du printemps. Bon, on est aussi en extérieur, mais à la place des roseaux qui nous font penser à des lances, on a une flopée de petites fleurs blanches qui tombent sur cette femme. Et puis regardez aussi, elles ont toutes les 2 la poitrine dégagée. Mais là ici, à droite sur Henri Martin, on a vraiment une poitrine très néoclassique. Vraiment une petite poitrine qui correspond au canon de l’Antiquité. Et elles ont toutes les 2 un drap au niveau de la hanche. Mais il y en a une qui le tient, l’autre qui ne tient pas son drap. On a l’impression qu’il va tomber, que sa jupe va tomber. Qu’est ce qu’elle fait ? elle tient ses cheveux qu’elle ouvre un peu comme une cape, donc on a vraiment cette idée de cheveux lâchés aussi qui contribue à l’érotisme. Donc on a un caractère très sensuel. Le visage est imprécis. Tout est vaporeux, mais on est vraiment dans cet onirisme là qui est propre à l’idéalisation réalisé par un homme. On est très loin du concret. On est très loin du vrai avec Henri Martin. C’est intéressant d’avoir les 2 ici.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors on continue avec 2 nus qui sont un couple d’amoureux réalisé par Auguste Seysses.
[Illustration : Auguste Seysses, Le retour – 1898, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors en fait, ce couple d’amoureux nu, debout, tendrement lassé, est parfaitement indifférent à ceux qui les entourent.
Alors le sculpteur est l’élève de Falguières, qui est ce grand grand sculpteur toulousain qui s’était installé à Paris. Et vous avez en fait une œuvre ici, que l’on peut rapprocher du Baiser de Rodin, réalisé 20 ans avant. Voilà, alors ici, c’est le moment assez émouvant où 2 amoureux se retrouvent après une longue séparation. Puisque l’œuvre s’intitule “Le retour”. Et cette œuvre a eu beaucoup de retentissement et de succès pendant et après la Première Guerre mondiale.
Elle signifiait l’idée du retour du soldat. Alors notez la présence d’un drap chaste entre les 2 corps. Il n’y a pas de peau à peau aux endroits les plus intimes de leur anatomie. Il y a un drap qui freine si peu, je dirais quand même l’érotisme. Alors ce tissu qui traîne au sol est intéressant. Il semble être une robe qui frôle le sol en suivant un mouvement qui peut être comme un mouvement de danse. Et ce qui est assez étourdissant ici, c’est l’illusion du mouvement bien sûr, donc de la vie. Et c’est vrai que je reviens sur cette idée de la danse, parce que vous avez vraiment l’idée d’un tourbillon sentimental, qui semble les ravir au monde.
On pense à une valse à 1000 temps ici, avec des cheveux qui sont follement enroulés et qui prolongent le mouvement dansé. Regardez la position des pieds. Il y a 4 pieds qui semblent avancer, reculer un peu façon danse de salon. Et regardez son talon à elle qui ne repose sur rien. Ce lâcher prise, cet abandon, son extase puisque ses appuis au sol, et bien donc elle les perd. Elle perd pied. Donc au sens propre du terme. Et c’est intéressant de voir les mains de l’homme qui semblent comme enfoncées dans la peau. Cette peau qui est une chair en pierre. Ses mains semblent comme imprimées dans la pierre. Et tout ça pour nous dire l’ivresse de cette étreinte. Alors le corps ici, les 2 corps sont intéressants parce qu’ils sont réalistes. Justement, on est presque rentré dans le 20e siècle. Et ils sont tout à fait non idéalisés. On est très loin des canons néoclassiques dont on a pu vous parler. Et il y a une volonté de se rapprocher du réel. Tout cela pour toucher, pour émouvoir le plus grand nombre. On n’a pas les codes néoclassiques, où tout le monde est beau, grand, jeune.
[Marthe Pierot] : ils sont quand même très beaux.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Ils sont quand même très beaux, mais il y a aussi un retour pour reprendre le titre vers des proportions plus normales entre guillemets. Donc c’est ce qui nous parle d’une certaine modernité parce que on a vu beaucoup de femmes qui étaient nues avec des hommes habillés autour. Mais ici l’homme et la femme sont nus ensemble. Et ils sont tous les 2, je dirais logés à la même enseigne. Il n’y a plus de différence dans la manière de traiter la nudité.
[Marthe Pierot ] : Oui tout à fait. Et c’est très joli de terminer sur ça, sur cette égalité de traitement en tout cas. Et bien on va conclure cette conférence.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors le nu symbolise la force ou le fantasme selon qu’il concerne le corps masculin ou le corps féminin. Donc il y a cette notion d’héroïsme et d’érotisme, cette oscillation dont nous avons parlé. Et c’est vrai que, au fil des siècles, il est prétexte à une étude anatomique élaborée qui vise la beauté idéale.
[Marthe Pierot ] : Oui, et on s’aperçoit aussi qu’il y a beaucoup plus de femmes nues que d’hommes nus, surtout au 19e siècle en représentation, donc ça questionne forcément. Et puis là, il y a une différence de traitement, vous l’avez vu, et donc l’utilisation du corps des femmes, ce qu’on en fait, comment elles sont érotisées évidemment est un signe quand même d’une société très patriarcale. Et ça se reflète dans l’histoire de l’art occidentale.
Mais c’est important aussi de savoir qu’aux 19e et 20e siècle, proposer du nu c’était aussi la garantie d’un scandale et donc d’un coup de publicité. Donc quand il faut faire sa place sur le marché de l’art, on joue ou on surfe en tout cas sur cette mode-là croustillante.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Croustillante. Mais c’est vrai que ça commence, on va le dire, dès la fin du 19e siècle avec des gens comme Courbet. Avec un réalisme qui fait que le nu n’est plus du tout cet idéal de beauté. Et c’est vrai qu’au 20e siècle, bien sûr les choses se précisent avec des gens comme Picasso qui va complètement soit élargir, soit fragmenter le corps. Avec des gens comme Egon Schiele également, qui propose quelque chose de pas du tout idéalisé. Je pense également à Suzanne Valadon. Femme qui propose un corps de femme qui n’est plus un corps qui fait vraiment rêver, mais on a en fait un corps qui est montré pour aller au-delà du genre, au-delà de la beauté. Il y a quelque chose que le corps nous dit.
[Marthe Pierot ] : Tout à fait. C’est vrai. Et c’est intéressant en tout cas de se questionner sur toutes ces représentations de nu au fil des époques. De remettre ou de replacer les œuvres dans leur contexte évidemment, mais de poser un regard actuel et contemporain sur la signification de ces nus. Et c’est aussi ça le rôle des musées, c’est d’exposer les œuvres, mais d’en parler.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Voilà. Merci de nous avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle conférence.
[Marthe Pierot ] : À bientôt. Merci beaucoup.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Au revoir.
Clémence Isaure
Clémence Isaure
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Clémence Isaure, mythe ou réalité”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2022]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Messieurs dames, Bonjour,
[Marthe Pierot] : Bonjour et bienvenue pour cette conférence en ligne du musée des Augustins
[Isabelle Bâlon-Barberis] : avec Marthe
[Marthe Pierot] : et Isabelle, les conférencières du musée. Et on sera ensemble pendant 30 Min pour vous parler de Clémence Isaure.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Absolument. On va vous parler d’une figure féminine très célèbre. Beaucoup de gens semblent la connaître sans la connaître vraiment. C’est pourquoi nous revenons sur elle aujourd’hui. Elle prend place au musée des Augustins au sein d’un ensemble à son effigie. Et elle a longtemps été en réserve. Et c’est vrai que là, on a beaucoup de plaisir justement à parler d’elle parce que elle occupe une belle place aujourd’hui au musée.
[Marthe Pierot] : Tout à fait. Alors c’est aussi l’occasion pour nous de vous présenter un aperçu de la sculpture française du 19e siècle. Parce que bien que Clémence Isaure soit un personnage du Moyen Âge, elle est très représentée au 19e siècle et on va pouvoir parler ensemble des mouvements comme le troubadour, le romantisme. Voilà, on est dans dans cette dans cette atmosphère là et on va pouvoir vous présenter des sculptures qui se trouvent au musée.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Absolument. Alors c’est vrai que elle est réelle ou elle est légendaire. En fait son histoire fascine et il est important de dire que on parle d’elle parce qu’il existe en fait un concours qu’on appelle le concours des Jeux floraux. Sans lui en fait, on ne se souviendrait pas d’elle.
[Marthe Pierot] : Exactement.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Qu’est ce que c’est que ce concours ?
[Marthe Pierot] : Oui et bien voilà, on va dire 2 mots sur ce fameux concours des Jeux floraux. En fait, ils ont été institués au 14e siècle à Toulouse, à l’initiative de 7 troubadours qui souhaitaient organiser un concours de poésie et ils voulaient récompenser les meilleurs poètes en leur décernant des trophées de fleurs en métal. Mais ce qui est très important aussi de vous dire, c’est que les poésies étaient réalisées en langue d’Oc et à cette époque, Toulouse est rattachée à la France. Toulouse qui a longtemps été un comté indépendant et en fait en étant rattaché à la France, elle perd un petit peu de son identité. Donc organiser un concours de poésie avec la langue régionale, c’était une manière aussi d’exister encore malgré cette période de l’histoire. Et en fait, la première fois que ce concours a lieu, c’est le 3 mai 1324. Donc il existe bien depuis le 14e siècle. Et c’est un concours qui a pris de l’importance, qui s’est institutionnalisé, parce qu’il deviendra par la suite une académie. Mais on ne parle de Clémence Isaure qu’au 15e siècle. Il faut attendre un petit peu pour que on puisse parler de ce personnage toulousain qui est associé à ce concours.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors lançons-nous dans le vif du sujet. On va commencer à regarder donc quelques visuels concernant Clémence.
[Illustration : Jean-Paul Laurens, “La première séance solennelle des Jeux Florau”, 1912, peinture]
[Marthe Pierot] : Dont le premier n’est pas au musée des Augustins. C’est important mais c’est vraiment pour vous faire comprendre surtout les Jeux floraux. Qu’est ce que c’est les Jeux floraux ?
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Absolument. Alors pour ça on part au Capitole. Alors vous avez donc devant vous une grande fresque qui s’intitule « Première séance solennelle des Jeux floraux ». On est en 1912 et c’est Jean-Paul Laurens qui a représenté donc cette grande fresque. Alors ce peintre-là est réputé pour des scènes historiques. C’est un peintre qui est très présent au musée des Augustins. Mais il est également au Capitole de Toulouse, c’est à dire la mairie de Toulouse. En fait, dans ce tableau, nous sommes au 14e siècle et nous sommes après l’époque des croisades contre les albigeois qui avaient mis à feu et à sang le midi donc de la France. Et la ville de Toulouse retrouve alors un son antique prospérité, sa joie de vivre. Il y a en fait un concours organisé pour justement les poètes. Et c’est vrai que le nom de Jeux Floraux est en l’honneur de la déesse Flore, à l’époque de la Rome antique.
Ici, dans ce tableau et sur la gauche en rouge, vous avez Arnaud Vidal de Castelnaudary, le premier poète lauréat de ce concours. C’est un homme qui a gagné la violette d’or et il est l’auteur d’un poème dédié à la Vierge Marie. Regardez donc en contrebas sont ainsi les 7 troubadours qui écoutent ses vers. Et puis vous avez derrière les troubadours et devant également, toute une foule dense, une foule attentive.
Où sommes nous ? Nous sommes au jardin des Augustines. C’est un jardin que l’on situerait aujourd’hui à peu près du côté de l’église Saint-Aubin. Alors ce qui est très intéressant, c’est que vous avez sur la gauche un mur d’enceinte qui est le mur du 14e siècle. Et tout à fait au fond, vous avez le clocher de Saint-Sernin. L’ensemble en fait est un montage parce que ça n’est pas du tout du tout la topographie réelle. Mais c’est plutôt un regroupement qui permet au mieux de reconnaître la ville de Toulouse.
[Illustration : Léo Laporte-Blairsy, “Clémence Isaure”, 1903, sculpture]
[Marthe Pierot] : Alors on va vous montrer à présent, et bien, la première représentation de notre Clémence Isaure de la conférence, mais ce n’est pas du tout la plus ancienne. Mais là, vous avez une très belle statuette en bronze réalisée par Léo Laporte-Blairsy en 1903. Et donc là vous avez cette Clémence Isaure dont on vous parle depuis le début. Donc vous l’avez compris, c’est un personnage médiéval semi légendaire. On a toujours du mal à savoir si elle a vraiment existé. Mais en tout cas, on parle d’elle parce qu’on lui attribue la restitution des Jeux floraux au 15e siècle. Donc elle aurait existé entre 1450 et 1500. En fait, sur un livre de comptes où se trouvait l’argent versé qui était versé aux poètes pour les aider à rimer, il y avait son nom. C’est pour ça que on l’associe, comme une bienfaitrice des Jeux floraux. Les Jeux floraux avaient lieu chaque année, mais malheureusement, à cause de la peste ou des désordres financiers de la ville, il y a des années où ils n’ont pas pu avoir lieu. Et donc elle, elle manifestait le désir d’assurer cette perpétuité des Jeux poétiques et donc verse de l’argent pour qu’ils aient lieu chaque année, à la condition que tout le monde puisse y participer. C’est à dire les citoyens et les étrangers et même les femmes étaient admises à concourir.
Elle y tenait et ça c’est important. Donc on a vraiment cette femme qui est associée à ce jeu, à ces jeux floraux. Elle est mécène mais elle sera aussi une muse parce que beaucoup de poètes et d’odes vont parler d’elle. Elle inspire énormément les poésies.
Alors si on en revient à cette sculpture. Regardez, elle a cette coiffure à double Hénin. Ce chapeau qui nous fait penser un petit peu au chapeau des contes de fées. En général, les fées ont un seul Hénin, un simple hénin. Ici il y en a 2. Mais c’est une coiffure qui est parfaitement médiévale. Et on va voir un petit peu mieux tout à l’heure, mais elle a aussi les cheveux qui sont enroulés en macaron, comme des tresses enroulées autour des oreilles. Donc là on est dans une coiffure parfaitement médiéval, mais son vêtement l’est un petit peu moins.
Regardez ce lourd manteau très ample et fluide. Il est tout à fait simple, et ça, c’est extrêmement moderne de simplifier ses formes pour évacuer toutes les fioritures. On a l’impression fidèlement un petit peu que l’art nouveau est passé par-là. On est au 20e siècle, avec justement ce jeu de rythme et de courbe assez simple, et l’esprit floral, cet esprit un peu nature parce que, regardez, elle tient une petite gerbe de fleurs.
[Illustration : Léo Laporte-Blairsy, “Clémence Isaure”, 1903, sculpture Détail zoomé]
Regardez, quand on zoome sur son visage, on voit bien ses cheveux, ses tresses, sa coiffure, mais on voit aussi son visage qui est très doux, enfantin, presque timide. Elle a un sourire apaisant et elle regarde vers le bas. Pourquoi Isabelle ?
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Eh bien, elle regarde vers le bas. Le visuel suivant va nous le dire, parce qu’elle cherche à qui elle pourrait bien décerner ses fleurs. Elle cherche le poète lauréat.
[Illustration : Léo Laporte-Blairsy, “Clémence Isaure ou la Poésie Romane”, 1913, sculpture, vue en extérieur place de la Concorde]
[Marthe Pierot] : et parce qu’elle était destinée à être en hauteur.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Effectivement. Alors, ce qui est très intéressant messieurs dames sur cette photo, c’est de comprendre que effectivement, il y a ce piédestal et ce visage penché pour regarder donc en direction du poète à récompenser. Mais ici, tout a changé finalement. Alors d’abord, où sommes nous ? Nous sommes à Toulouse, place de la Concorde, dans le quartier des Chalets. Et vous avez le projet réalisé. Alors elle garde la coiffure dont Marthe vient de vous parler, ce double hénin, mais la tête est plus penchée encore. Et c’est vrai qu’elle ne porte plus ce grand manteau telle une cape qu’elle avait donc sur la maquette mais une robe simple et fluide qui n’est pas vraiment médiévale et qui laisse apparaître sa sensualité de femme.
Il y a quelque chose de beaucoup plus affirmé également dans son attitude. On a un très joli tombé de la robe et ses formes sont soulignées. Le déhanché est marqué. Exit hein, la petite fille de tout à l’heure. Et au lieu de tenir une gerbe à la main comme précédemment, elle a une couronne. Alors cette statue, C’est l’histoire d’un sauvetage. Parce que pour la petite histoire, comme toutes les sculptures de bronze de Toulouse, elle a été démontée en 1942 pour être fondue car toutes les statues de bronze devaient servir à l’effort de guerre. Elle échappe donc à la réquisition. C’est un miracle pour nous et elle est remise à son emplacement d’origine en 1949. Cette œuvre a été financée par un pharmacien, pour embellir le quartier des chalets qui était le sien. Et cette œuvre va allier et l’esthétique et le côté pratique parce qu’elle est la dernière fontaine utilitaire de Toulouse. On a développé tellement le réseau de borne-fontaine qu’on a plus à aller vers une fontaine centrale. Alors en 1909, il y a eu ce concours ouvert aux artistes toulousains et Laporte-Blairsy, lui, et bien il va, tout en étant choisi, ne pas du tout tenir compte des consignes du jury ni de la vie des Toulousains. Il n’en fait qu’à sa tête. Parce que vous voyez, ce double hénin est démesurément grand et le visage de Clémence disparaît sous la coiffe. Ça choque les toulousains et ça choque la critique. Et la critique, donc ne reconnaît pas là la Clémence légendaire. C’est pour ça qu’en fait cette statue, on ne va pas l’appeler donc Clémence Isaure, mais la Poésie Romane, parce que la Clémence Isaure n’est pas reconnaissable. Ici, elle est trop moderne.
Elle est trop différente de l’originale à laquelle les toulousains étaient habitués et justement dont Marthe va nous parler.
[Marthe Pierot] : Et oui, quelle est cette sculpture originale ? En fait, on peut dire la première sculpture de Clémence Isaure, la statue officielle, elle est là, sous vos yeux de cette photo, donc en noir et blanc, nous montre une sculpture qui se trouve à l’hôtel d’Assezat.
[Illustration : Anonyme, “Clémence Isaure”, 14e retouchée en 1627 par Pierre Affre, sculpture]
Et en fait à l’origine c’est une statue funéraire qui se trouvait dans l’église de la Daurade à Toulouse. Alors était-elle sur le tombeau notre Clémence Isaure ? Où est ce le gisant d’une inconnue ?
Et bien c’est là que la partie complexe de l’histoire débute. Cet aspect un peu nébuleux parce que finalement c’est très très compliqué de démêler le vrai du faux et de trouver vraiment et bien quel est le fin mot de l’histoire. On a plusieurs théories. En fait, selon un poème du 16e siècle, et bien il est écrit que les toulousains ont accepté que cette statue qui se trouvait sur le tombeau d’une illustre famille qu’on appelait les Ysalguier soit la sculpture de Clémence Isaure.
Donc elle a été réemployée, réutilisée pour représenter Clémence Isaure, même si à l’origine ce n’était pas le cas. C’était le gisant d’une autre personne. Mais plus tard, d’autres théories ont affirmé qu’il y avait vraiment une dame toulousaine qui était la descendante d’une famille qu’on appelait les Isaurès et que on aurait érigé une statue à son honneur pour la placer dans l’église de la Daurade. Donc on ne sait pas vraiment en fait quelle est l’origine de cette sculpture ? Mais ce qu’on sait, c’est que ce gisant date du 14e siècle et notre Clémence Isaure, comme on vous l’a dit, c’est un personnage du 15e siècle. Donc cette culture est antérieure à notre personnage, donc finalement on l’a réutilisée. Est ce que c’est pour lui rendre hommage ou est ce que c’est pour donner naissance à un mythe ? C’est ça qu’on ne sait pas.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Parce question reste posée.
[Marthe Pierot] : Exactement parce que Clémence Isaure, c’est vraiment la création d’un mythe peut être on se demande ? Parce que aucun document officiel ne parle vraiment d’elle. Ni les cadastres, ni les registres d’impôts, ni les notaires ne peuvent justifier de son existence. Après il faut savoir qu’il y a eu un terrible incendie en 1463 qui ravage les 2/3 de la ville, donc beaucoup de documents ont été perdus à la suite de cet incendie.
Et en fait, on parle de Clémence Isaure parce qu’on a écho de son testament. Aujourd’hui, on ne sait pas du tout où se trouve ce testament, mais beaucoup de personnes en ont parlé, où elle évoquait ses dernières volontés et ce testament a été copié puis gravé sur une plaque de bronze placée sous sa statue. Regardez, vous voyez, sur le socle, il y a une plaque de bronze avec les extraits de ce fameux testament. Donc on ne sait pas vraiment qui l’a copié ? Qui a trouvé ce testament ? C’est là que c’est très très flou. Et dès le 18e siècle, il y a 2 clans : les clémencistes et les anti-clémencistes parce qu’on remet en question son existence.
Mais quoi qu’il en soit, comme on l’avait dit en introduction, on a trouvé quand même son nom sur le registre des comptes municipaux de la ville de Toulouse. Donc on sait qu’il y a une bienfaitrice qui portait ce nom-là, en tout cas c’est certain. Mais après jusqu’où a-telle été impliquée dans les Jeux Floraux ? On ne sait pas.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui alors regardons bien cette fameuse sculpture, cette toute première représentation énigmatique, qui donc daterait du 14e siècle. Alors à l’origine, sachez que c’est un gisant, c’est à dire une statue couchée, et qu’elle était donc à la Daurade, comme Marthe vous l’a dit. Puis on sait qu’elle va partir au Capitole, dans la salle de réunion des Capitouls, où se tenait justement la cérémonie des Jeux Floraux. Et une fois qu’elle est au Capitole, on la met debout, on la redresse. Et elle a donc un curieux aspect. Certainement parce que justement, et bien elle n’était pas faite pour être debout. Il se trouve qu’au 17e siècle, elle est quelque peu recomposée. On est en 1627, et un sculpteur toulousain qui s’appelle Pierre Affre, et bien va la blanchir, va lui couper les bras qui sont mal faits et va en ajouter d’autres en marbre.
Il va lui retirer le lion qu’elle avait à ses pieds et il va également retirer le chapelet de ses mains et placer dans sa main droite un bouquet de 4 églantines dorées. Enfin au 19e siècle, elle est placée à l’hôtel d’Assezat et aujourd’hui elle est dans la grande salle du rez-de-chaussée qu’on nomme la salle Clémence Isaure où les assemblées de toutes les sociétés savantes se réunissent.
Et cet hôtel d’Assezat héberge aujourd’hui donc des académies, des sociétés savantes pour la médecine, pour la géographie. Des sociétés véritablement très anciennes.
[Marthe Pierot] : Oui, donc c’est vraiment une structure qui a été transformée, modifiée à maintes reprises, même déplacée. Mais en fait, c’est une sculpture, donc on vous l’a dit, qui est considérée comme la première représentation de Clémence Isaure donc l’image que les toulousains ont d’elle. Et elle va inspirer d’autres sculpteurs qui vont réaliser par la suite d’autres représentations, comme c’est le cas ici où Julie Charpentier propose ce buste réalisé d’après la sculpture dont on vient de parler.
[Illustration : Julie Charpentier, “Clémence Isaure”, 1822, sculpture]
Alors Julie Charpentier, elle a grandi au Louvre dans son enfance parce qu’elle y habitait. Son père était graveur et on pouvait loger, habiter au Louvre. Elle a été l’élève d’un grand sculpteur qui s’appelait Pajou. Mais c’est surtout une artiste précoce qui se forme elle-même. Elle est autodidacte. Elle répondra à beaucoup de commandes de l’État et réalise des œuvres à caractère commémoratif essentiellement. Mais elle est très peu connue du grand public. En tout cas, ici, on retrouve sur ce buste dont elle s’est inspirée, et bien, tous les éléments médiévaux. Regardez son vêtement ! On a le voile, et puis on a ce fermail, ou cette broche plutôt qui resserre son tissu, ce qui permet de jouer avec les plis et qui est enrichi d’une image de la Vierge.Et on a la coiffure encore une fois très médiévale avec ses 2 macarons qu’on voit très bien. C’est le chignon sur les oreilles à la manière d’une Leia de Star Wars finalement. Une coiffure qu’on retrouve beaucoup encore aujourd’hui. Et on a donc ce voile par-dessus cette coiffure. Donc on a voilà cette image très très médiévale ici. Et ce qui est particulièrement magnifique dans cette sculpture, ce qui fait la singularité de cette œuvre, c’est la manière dont Julie Charpentier réalise les plis du voile et des vêtements. Elle sculpte un marbre très très dur et elle arrive à nous faire ressentir la finesse du tissu. Regardez, tous ces plis qui se multiplient sous son cou. On a vraiment l’impression qu’on a quelque chose d’extrêmement fin ici. Et ça, c’est très, très beau et très habile de la part de Julie Charpentier.
Alors elle est posée sur un socle où se trouve la Lyre du poète, parce que les poètes étaient accompagnés de musique et la Lyre est entourée de plusieurs fleurs qui représentent ces fameux trophées qui étaient décernés au poète selon les différentes catégories du concours. Il y avait le souci, l’églantine, le Lys, l’amarante et la violette. Par exemple, la violette était décernée au meilleur poème. Mais l’églantine récompensait les sonnets et le lys lui était remis aux meilleurs hymnes dédiés à la Vierge. Donc il y avait plusieurs catégories dans ce concours. En tout cas, vous avez ici un bel exemple de ce qu’on appelle la sculpture troubadour. C’est à dire sculpter au 19e siècle, des œuvres qui rappellent l’esthétisme du Moyen Âge. Donc là, on l’a vu avec le vêtement, mais les valeurs aussi. On a envie de revenir aux valeurs du Moyen Âge. On sculpte ici un personnage qui date du 15e siècle. Et Jules Charpentier réalisait beaucoup d’œuvres dans cet esprit-là troubadour. On remarque aussi dans ses yeux qu’il n’y a pas d’iris, ce qui accentue le caractère funéraire de l’œuvre, mais qui nous donne aussi une impression de recueillement intérieur. Elle est comme absente, son regard est vide, mais tout ça est propice à la méditation, donc c’est assez intéressant de la regarder de ce point de vue là. Et sachez que c’est l’État qui a commandé cette œuvre à Julie Charpentier. À la base, elle devait être installée à l’Église de la Daurade, là où on bénit les trophées. Mais elle n’a jamais pris place à cet endroit-là. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ce qui est intéressant de savoir, et même important, c’est que Julie Charpentier est une des rares femmes, à la fin du 19e siècle, à s’être aventurée dans une carrière de sculptrice.
À cause du poids des conventions, on considérait que la sculpture était réservée aux hommes parce que c’était très dur, que ça nécessite un effort physique. Donc il y a peu de femmes sculptrices dans cette société là au 19e siècle. Mais il y a aussi Félicie de Fauveau, dont on va vous parler Isabelle, justement. Ces 2 femmes sont importantes.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors on va continuer donc avec cette autre femme sculptrice, qui en 1845, réalise cette maquette pour un monument à Clémence Isaure instituant les Jeux floraux.
[Illustration : Félicie de Fauveau, “Maquette pour un monument à Clémence Isaure instituant les Jeux Floraux”, 1825, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Donc ici il s’agit d’un plâtre. Sa hauteur est d’à peu près 50 cm pour vous donner une idée. Et on a ici une sculptrice qui va faire parler d’elle. Alors en fait pour parler de Félicie du Fauveau, c’est intéressant de dire que sa famille s’était installée en Italie un petit peu avant la Révolution française. Et puis au moment de la restauration dans les années 1814, la famille donc de Fauveau ruinée par de mauvais placements, rentre en France. Alors, à la mort de son père, Félicie va donc s’engager dans une carrière artistique pour subvenir aux besoins de sa famille. Et sa vie va être des plus aventureuses. Elle va fréquenter le salon de la Duchesse de Berry et elle va lutter pour le retour de la monarchie en participant notamment à l’insurrection vendéenne en 1832. Alors c’est vrai que suite à cet engagement, et bien elle sera condamnée à perpétuité. Elle fera 8 mois de prison et choisira l’exil en Italie, à Florence où elle restera jusqu’à sa mort. Elle va réaliser là-bas beaucoup d’œuvres donc qu’elle enverra en France. Son art, on peut dire qu’il est contre-révolutionnaire, puisque elle choisira une fidélité au Moyen Âge. Alors pour parler encore un petit peu d’elle. Disons que cette femme était extrêmement originale. Elle s’habillait en homme. Elle portait une redingote et les cheveux coupés courts pour affirmer certainement et revendiquer son indépendance et ses goûts masculins. Donc voyez son engagement politique dont j’ai parlé et on l’a surnommé je me souviens l’amazone de la sculpture.
[Marthe Pierot] : Ça me permet d’avoir une image, un peu du caractère de cette femme.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors faut savoir aussi qu’elle écrivait. Qu’elle était historienne et qu’elle aimait donc passionnément le Moyen Âge. Donc elle est vraiment une représentante, de ce qu’on appelle le gothique troubadour, avec Julie charpentier, dont vous a parlé Marthe tout à l’heure. Alors ici, cette œuvre, c’est un plâtre qui évoque vraiment l’univers littéraire et poétique du Moyen Âge. Donc une œuvre qui, si on regarde dans les détails, compte encore quelques traces de peinture colorée. Alors c’est une œuvre qui propose des éléments de l’architecture du Moyen Âge. Vous voyez à la base ce piédestal, et puis donc ces petites colonnes. Ce socle vous propose, comme un chapiteau qu’on pourrait placer dans un cloître du Moyen Âge. Mais il y a aussi les costumes des personnages qui sont médiévaux.
[Illustration : Félicie de Fauveau, “Maquette pour un monument à Clémence Isaure instituant les Jeux Floraux”, 1825, sculpture – détail]
Alors Clémence est assise et penchée comme courbée, elle domine de minuscules troubadours. Et vous avez également son regard qui est dirigé vers justement ce petit tableau religieux que l’on appelle un triptyque et dont la forme est ogivale.On comprend qu’elle inspire les poètes. Et c’est vrai, elle est l’allégorie de la poésie. Les poètes ont un désir profond, ils veulent fonder des tournois lyriques en l’honneur de la Vierge Marie. Et c’est vrai que regardez comme il s’accroche à elle, telle a une vierge. Et au long manteau d’une vierge, au long manteau protecteur.
Alors cette maquette fut remise au conseil municipal de Toulouse, mais à la demande du conseiller municipal, l’œuvre en grandeur réelle n’a jamais été réalisée. Donc on a que cette maquette. Alors en fait, on ne connaît pas véritablement les raisons, qui font que cette œuvre n’a pas été réalisée grandeur nature. Des raisons financières ? Peut être ? En tout cas c’est important de dire que Félicie était célèbre pour son engagement légitimiste tapageur. Elle était très engagée politiquement. Et que peut être ça n’a pas plu ?
[Marthe Pierot] : Oui, c’est possible, c’est possible.
[Illustration : Henri Martin, “L’apparition de Clémence Isaure aux poètes toulousains”, 1893, peinture]
Alors on va vous montrer à présent une œuvre peinte qui n’est pas au musée des Augustins. Mais ça nous intéressait aussi de voir comment elle est représentée en peinture également. Alors là, vous avez donc l’apparition de Clémence Isaure aux poètes toulousain qui est une œuvre réalisée par Henri Martin. Elle se trouve au Capitole de Toulouse. Mais sachez qu’il y a des œuvres d’Henri Martin au musée également, qui est un peintre toulousain. Henri Martin, un peintre post-impressionniste et il est vraiment dans le divisionnisme de la touche. Regardez cette touche qui est courte, qui est parallèle, qui est séparée. Mais surtout, ce qui est caractéristique du peintre, c’est cette atmosphère diffuse. Ce chromatisme un petit peu idéalisé qui est propice au rêve. C’est le mauve en fait, de ce tableau qui appartient vraiment au courant symboliste. Cette idée de rappeler le rêve un petit peu, le côté finalement onirique. Et il y a l’ambiance de la forêt, de la forêt secrète aussi accentue un petit peu le mystère de ce tableau. Alors vous avez une Clémence Isaure qui est tout en blanc à droite.
Regardez, elle est toute vêtue de blanc avec ce diadème de violette autour de la tête. Elle est en blanc comme une vierge, parce qu’elle est très souvent comparée à une vierge. On vient de le voir dans la maquette, tout à l’heure où les troubadours s’accrochaient à elle comme un manteau d’une vierge. Isabelle vous en a parlé ? Et bien là on a cette idée de blanc et de personne immaculée parce que sa vie était une vie de célibat. Et on lui associe cette idée de virginité parce qu’on raconte que celui qui devait être son futur mari meurt au combat. Et que depuis, Clémence Isaure demeura vierge et ne se maria jamais. Et le nom de dame d’ailleurs est souvent réservé aux veuves. Et ce qui peut expliquer le legs qu’elle fait à la ville, parce que comme elle est veuve, elle n’a pas d’enfant et elle n’a rien à transmettre, donc elle donne tout son argent à la ville pour les Jeux floraux. Donc elle se trouve dans ce bois sacré. Il y a donc des troubadours qui sont à ses pieds, qui sont pétris de dévotion devant elle. Et elle tend une charte, c’est la charte de poésie.
Donc on a cette idée de pureté et cette idée de poésie aussi, avec les muses qui se trouvent derrière elle. Et sur le côté, vous avez une sculpture. Une sculpture toute petite qui est une statue de Paladia Tolosa. C’est la protectrice de la ville de Toulouse depuis l’époque romaine. Elle fait référence à la célèbre Palace Athéna. Voilà donc vous avez cette dame médiévale par excellence, tout en poésie, dans ce tableau réalisé par Henri Martin.
[Illustration : Bernard Griffoul-Dorval, “Clémence Isaure”, 1ère moitié du XIXe, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors nous poursuivons en revenant à la sculpture, si vous le voulez bien, avec une œuvre réalisée par le grand sculpteur Griffoul-Dorval. Ici et bien nous propose une Clémence, debout, de face, accoudée à sa lyre. Il s’agit également ici d’une statuette en plâtre d’environ 50 cm de hauteur. Alors, la main gauche de Clémence maintient, s’appuie contre un tronc d’arbre coupé horizontalement, vous le voyez et sa tête est penchée légèrement à gauche. Ses cheveux sont dénoués avec souplesse et sa tête est ceinte d’une couronne de lauriers. Donc rappelons que si le poète est lauréat, c’est qu’il a une couronne de lauriers, donc autour de la tête. Alors vous avez cet ample vêtement qui est ceinturé, mais en taille basse avec quelque chose qui semble rouler sur le bas du ventre. Elle est sage cette Clémence. Regardez ses bras pudiquement croisés et son vêtement est très couvrant. Autour de son cou, on distingue un crucifix, elle est rêveuse. On imagine qu’elle est toute seule dans un jardin un peu humide, loin du monde. Et c’est vrai que sa rêverie la même dans une réalité qui n’est pas la nôtre et qui a inspiré les poètes. Elle est un peu lessive, presque désabusée ou ennuyée. En tout cas un romantique dans son état d’âme. Le sculpteur, lui, Griffoul-Dorval va participer au renouveau de l’école toulousaine de sculpture. Celle qui était menée notamment par le grand Falguière que l’on connaît un peu plus. Si Griffoul-Dorval, donc, est connu, c’est parce que sur la place Dupuy, il y a 2 beaux griffons et également le médaillon du général Dupuy qu’il a réalisés. Mais cependant sa sculpture la plus célèbre, c’est celle de Riquet, l’auteur du canal du Midi, en haut des allées Jean Jaurès. Alors il y a beaucoup d’œuvres de Griffoul-Dorval qui sont conservées, notamment au musée des Augustins. Mais si on revient à notre statuette que vous avez devant les yeux, et bien ce projet n’a pas été réalisé. En général, quand les sculptures n’étaient pas retenues, quand elles n’étaient pas traduites en bronze ou en marbre, elles étaient en général détruites immédiatement. Donc ici c’est une rescapée, et on a sauvé sa grâce. On va pas s’en plaindre.
[Marthe Pierot] : Ouais, tout à fait. Alors vous avez une sculpture qui est assez similaire, donc vous avez bien celle-ci en tête. Et bien regardez celle-là à présent réalisée par Antoine Augustin Préault en 1844.
[Illustration : Antoine Augustin Préault, “Clémence Isaure”, 1844, sculpture]
C’est une statuette qui est en plâtre patiné. En fait, c’est une commande à la base. On a commandé donc un ensemble de statues monumentales pour décorer les jardins du Luxembourg à Paris et pour représenter et bien les reines de France et les femmes illustres. On avait cette volonté donc de mettre à l’honneur les femmes avec un ensemble de statut monumental et Clémence Isaure en faisait partie. C’est dire l’importance de cette figure toulousaine qui allait jusqu’à Paris. Donc là, vous avez dans cette maquette, dans cette statuette, une attitude un peu à l’anguille nonchalante, une jeune femme rêveuse, un petit peu comme on l’avait avec l’autre. Mais même si elle est proche de la version de Griffoul-Dorval, ici elle est encore plus anchée voir désabusée. Regardez, elle lève son bras comme si elle était offerte et elle soutient mollement sa tête, alors que dans celle de Griffoul-Dorval, ses 2 bras étaient ramenés chastement sur le devant. Elle est un peu plus sensuelle ici. Et puis regarder son pendentif, tout à l’heure, on avait une croix. Ici, on a plutôt un pendentif très graphique qui vient creuser sa poitrine. L’idée de la religion ici est évacuée. On a plus envie de nous parler d’une femme sensuelle, à la taille serrée, aux hanches dégagées, aux formes voluptueuses. Regardez comment ses plis très lourds lui donnent aussi beaucoup d’inertie. Préault était un romantique. Il était amoureux du corps de la femme et donc avait envie de représenter une Clémence Isaure un peu pour aussi utiliser ce prétexte là et nous parler d’une femme avec des belles formes généreuses. Seul subsiste quand même le laurier qui rappelle sa fonction, et qui rappelle le poète qu’elle récompensait.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui alors il faut savoir, ça c’est très intéressant, que cette sculpture a servi pour réaliser un bronze. Un bronze qui est de la même taille, que l’œuvre dont Marthe vient de vous parler.
[Illustration : Antoine Augustin Préault, “Clémence Isaure”, 1844, sculpture, voir double en extérieur et modèle en bronze]
Donc une à peu près 70 cm de hauteur. Et vous avez ici et bien une œuvre qui appartient au musée du Louvre. Cette œuvre que vous avez à gauche sur l’écran, et bien elle est au Louvre. Et c’est une magnifique version réalisée par un certain Thibault qui était le fondeur. Alors vous avez cet effet coulé qui donne à la matière douceur et souplesse, et c’est une sensualité d’autant plus accrue. Mais sur la droite de votre écran, vous avez l’œuvre achevée – pardonnez-moi – la sculpture monumentale qui est localisée, Marthe vous l’a dit, au jardin du Luxembourg. Vous voyez que ici elle retrouve son crucifix sur sa poitrine et elle a un visage aux traits moins menus. Plus masculin, parce qu’elle est destinée à être vue de loin. En fait, il faut savoir que elle est de très grande taille, elle fait environ 2m50. Donc ici le résultat est dénué du maniérisme qu’elle avait dans un format plus petit.
[Marthe Pierot] : Alors pour conclure, à présent, parce que nous avons terminé avec nos visuels et nos œuvres du musée ou de l’extérieur quand on se permet quelques ouvertures, on aimerait vous montrer un dernier visuel pour vous faire comprendre quelque chose d’important.
[Illustration photographie: Une sculpture de Clémence Isaure en arrière plan et au premier plan les trophées en forme de fleur récompensant les lauréats des Jeux Floraux]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai parce que dans ce visuel, vous comprenez que les Jeux floraux et ce concours continuent encore. D’ailleurs, au premier plan, vous avez les trophées en forme de fleur qui seront décernés au lauréat de l’année. Et à l’arrière plan, notez la fameuse statue, la toute première, celle du 14e siècle, dont nous vous avons parlé.
[Marthe Pierot] : Et les poésies sont en français maintenant de manière générale. Mais il y a quelques catégories du concours qui récompensent les poésies occitanes aussi.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui encore. Oui c’est vrai, c’est vrai que depuis près de 7 siècles, on entend promouvoir la poésie occitane sous toutes ses formes et d’une manière plus générale, la littérature occitane. Voir tout simplement, je dirais la langue occitane.
[Marthe Pierot] : Alors on revient vers vous pour conclure ou terminer notre conclusion et parler à nouveau de notre Clémence Isaure. C’est intéressant de se dire en fait que quand il y a un vide biographique comme c’est le cas avec Clémence Isaure, c’est très facile de construire une légende. Alors il n’y a pas de fumée sans feu. Évidemment, on a bien parlé d’une femme qui s’appelait peut être Clémence où il y a un lien avec les Jeux Floraux mais on ne sait pas jusqu’où elle a été investie dans ces Jeux Floraux et donc on a pu construire beaucoup de choses et c’est difficile aujourd’hui de démêler le vrai du faux. Et les discussions sont encore ouvertes, parfois tumultueuses. Personne n’est vraiment d’accord sur son existence ou sur ce qui est un petit peu exagéré. Mais ce qui est très intéressant de se dire, c’est que si c’est un mythe en histoire, sachez qu’elle est bien une réalité en art. On l’a vu en sculpture, elle est très représentée, elle existe. Et même en littérature, on parle beaucoup d’elle parce que les poètes écrivaient sur elle. Elle est présente dans les poésies et les odes qui sont réalisées depuis le Moyen Âge. Donc elle existe bien en histoire de l’art, ça c’est certain.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Donc elle existe en art. Mais c’est vrai aussi qu’il faut se dire que c’est au 19e siècle que ces représentations explosent vraiment. Et c’est vrai que dans notre conférence, à l’exception de ce gisant du 14e siècle, on s’est bien rendu compte que c’était vraiment au 19e. Alors pourquoi cette floraison au 19e siècle ? Alors on peut tenter d’avancer quelques raisons. Une première raison, c’est peut être cet engouement pour ce mouvement qu’on appelle le gothique troubadour qui fait renaître le Moyen Âge avec un goût vraiment pour les valeurs et pour l’esthétisme du Moyen Âge. Et on peut dire également que si elle revient, c’est que elle est un sujet consensuel à une époque pleine de révolution, une époque où l’on rejette les représentations religieuses ou les représentations des rois. Et bien elle, elle ne fait pas du tout polémique, au contraire, elle fait du bien. Et c’est vrai que aujourd’hui, au 21e siècle, on a cessé de la représenter, mais peut être qu’un jour elle reviendra encore, on ne sait pas ?
[Marthe Pierot] : En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivies pour cette conférence, d’avoir découvert un petit peu avec nous, et bien cette figure énigmatique mais emblématique de Toulouse.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et essentielle à Toulouse,
[Marthe Pierot] : Essentielle, notre Clémence Isaure. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine conférence.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : À bientôt.
Le paysage
Le paysage
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Le paysage, une fenêtre sur le monde”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2022]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Messieurs dames, Bonjour.
[Marthe Pierot] : Bonjour.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bienvenue pour cette nouvelle conférence.
[Marthe Pierot] : Exactement. Aujourd’hui donc, avec le musée des Augustins, on va parler paysage. Alors pour commencer, il faut savoir que le paysage en peinture occidentale a longtemps fait figure de parent pauvre. En effet, si dès le 15e siècle, il apparaît dans les pays du Nord ou en Flandre, il faut attendre un petit peu plus en France pour que le paysage devienne un sujet autonome, un sujet à part entière. Qu’il faudra plutôt attendre le 17e siècle et au fur et à mesure, il va gagner du terrain. Et dès le 19e siècle, il connaît une éclatante revanche et devient le sujet favori de beaucoup de peintres.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, mais en fait le paysage on l’aime depuis très longtemps. En Égypte ancienne sur les murs, il y a des dessins qui sont extrêmement évocateurs du paysage. Et puis quand on pense à la Rome antique, et bien on sait que les romains adoraient faire peindre à fresque, les murs de leur maison afin de se sentir dans un jardin, même en hiver, afin de respirer comme s’ils étaient dehors. Et puis ce qui se passe aussi, c’est que après arrive le Moyen Âge et à l’époque le Moyen Âge et bien le paysage va disparaître. Le sacré va prendre toute la place et véritablement le paysage va perdre du terrain.
[Marthe Pierot] : Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c’est qu’on s’aperçoit quand on entre dans les salles du musée qu’il y a une véritable adhésion pour le paysage. Le public est tout de suite satisfait quand il voit des paysages parce qu’il y a cette impression d’ouverture, d’espace et de liberté. Et en effet, en fait, on est très très loin des histoires aux récits complexes qui nécessitent la compréhension d’une époque, de ses valeurs ou d’une grande histoire. Le paysage évacue toute approche intellectuelle et il nous reconnecte instinctivement avec ce dont on a vraiment besoin finalement. Cette liberté-là.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Et en fait, les peintres qui vont créer des paysages vont comme créer des fenêtres sur le monde pour nous permettre de nous évader. Dans leur cadre triangulaire plutôt rectangulaire, ils vont créer comme des fenêtres, d’où le titre de notre conférence. Et c’est vrai que on va voir qu’au fil des époques, les paysages sont différents. On va vous proposer, des paysages marins, des paysages urbains, des paysages champêtres. Et on va s’apercevoir que selon ces paysages, selon des géographies différentes, le paysage est perçu tout à fait différemment.
[Marthe Pierot] : Exactement. Et on va commencer là où tout a commencé finalement, avec notre premier visuel dans les Flandres.
[Illustration : Anthony Jansz Van Der Croos, “La Haye, vue du nord (les dénicheurs d’oiseaux)”, 1655, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Il s’intitule « La Haye vue du Nord ». Il a également un second titre, « les dénicheurs d’oiseaux ». Le peintre est un certain Van Der Croos. Nous sommes au 17e siècle et les peintres du Nord ont une passion pour les paysages. C’est vrai qu’ils vont, par leurs paysages, nous proposer un miroir de la nature. En fait, ces donc peintres hollandais sont en grande partie protestants et le thème religieux, le sacré n’est pas leur préoccupation. Eux, ils vont nous parler de paysage, de canaux qui permettent justement de vider la mer qui remplit les vastes plaines du plat pays. Et c’est vrai que il va y avoir de très nombreux commanditaires, une bourgeoisie aisée qui souhaite orner donc les maisons de tableaux de petits formats. On est en plein siècle d’or hollandais et la floraison de peintres est importante dans un formidable essor économique qui va porter justement cette peinture.
Van Der Croos, c’est le peintre des paysages de rivières, de forêts, de petits villages à l’arrière plan, et c’est ce que nous découvrons ici. Donc une ville extrêmement détaillée, bien que lointaine, mais avec des clochers, avec des tourelles qui sont tout à fait reconnaissables encore aujourd’hui. Donc voyez comme l’horizon est bas, le ciel prend deux tiers de la place du tableau.
Et c’est avec une minutie de cartographes que Van Der Croos s’est exprimé. Vous voyez des personnages pardonnez-moi qui sont extrêmement réels. Ce ne sont pas ces personnages mythologiques qu’on a pu voir très longtemps dans les tableaux. Ici vous avez vraiment et bien un ciel où des nuages jouent, mais sur la droite vous avez des personnages. Notre tableau est anecdotique parce qu’il y a une petite histoire. Il est topographique, parce qu’il y a de l’architecture. Et il est aussi un peu moral puisqu’on a des personnages occupés ici à quoi donc ?
Et bien celui qui est en bas et qui pointe de son index, celui qui est en haut, est en train en fait de nous faire la leçon. D’ailleurs, si on regarde bien au pied de l’arbre, il y a quelques écritures nous disant : « Même si on sait qu’une action est mauvaise, on ne peut cependant s’empêcher de la commettre ». Donc voyez qu’avec ce tableau là vous avez du grain à moudre pour la beauté de l’image mais aussi pour la leçon morale.
[Illustration : Francesco Guardi, “Le pont du Rialto à Venise”, ap. 1760, peinture]
[Marthe Pierot] : Tout à fait. Alors on voyage un petit peu. On descend dans le sud, on quitte les paysages nordiques pour retrouver la lumière du Sud. Là vous reconnaissez peut être nous sommes en Italie, plus exactement à Venise.
Donc effectivement on a commencé par des paysages nordiques pour vraiment bien comprendre que le paysage occupe une place très importante en Flandre pour les raisons qu’Isabelle vous a expliquées.
Mais effectivement, en France, c’est un petit peu plus compliqué. Le paysage n’est pas très bien noté, si on peut dire ça comme ça. Parce que dès le 17e siècle, l’académie royale de sculpture et de peinture est créée et elle va établir une stricte hiérarchie des genres picturaux. Et le paysage est tout en bas de la liste. Vraiment au début, les numéros un, ce sont les peintures d’histoire, les peintures religieuses de ce qu’on appelle le grand genre. C’est vraiment la peinture qui traite des grands sujets. Puis ensuite on a les portraits, la scène de genre, le paysage et la nature morte. Donc c’est vraiment un genre mineur, le paysage.
Mais cependant, en Italie se développe un une catégorie de paysages assez particulière, des paysages urbains qu’on va nommer des veduta. On appelle ça le vedutisme, parce que veduta ça veut dire vu en italien. Vous l’avez bien compris, ce sont des paysages qui proposent des points de vue de villes italiennes avec beaucoup de précision. Et donc là, ce genre en peinture se développe énormément en Italie dès la fin du 17e siècle et au début du 18e siècle. En même temps que le tourisme se développe lui aussi.
Beaucoup d’anglais, qui ont évidemment pas mal d’argent, vont voyager à travers l’Europe et l’Italie et vont souhaiter ramener un souvenir des villes italiennes qu’ils ont découvertes. Et pour ça, et bien ils vont commander auprès de peintres qui ont cette minutie là des points de vue des villes pour les ramener chez eux. Donc les peintres réalisent ces petites vues de petits formats pour pouvoir les vendre à ces touristes là en quelque sorte. C’est un petit peu comme quand aujourd’hui on ramène une carte postale. Mais avant la photo évidemment, il y avait ces petits paysages, ces petites peintures. Et donc notre peintre Francesco Guardi qui est un des plus grands peintres vénitiens du 18e siècle, travaille énormément ce genre là et réalise beaucoup de paysages urbains.
Et il nous propose ici une belle vue de Venise, mais avec beaucoup de poésie. Dans cette nature là, regardez la lumière, elle est diffuse, elle estompe les contours et transforme tous les objets et les personnages ont des petites taches colorées. On est vraiment sur de la minutie, tout est très très fin et regardez l’eau qui scintille à l’aide de ces petites touches blanches. On a vraiment l’impression d’avoir une eau agitée, mais un petit miroitement aussi avec des beaux reflets. Il y a beaucoup de gondoles et donc de gondoliers qui de toutes leurs forces rament dans l’eau. Ce qui donne cet effet aussi d’agitation. En fait, on s’aperçoit vraiment que la ville de Venise, qui est une grande ville commerçante, est très animée. Ici, tout est dense. Tout est vraiment dynamique et on a cette vie qui grouille vraiment au premier plan avec beaucoup de minutie.
La peinture est libre, vibrante. Regardez la finesse de ces petits draps qui sont au niveau des fenêtres et qui semblent s’envoler au vent. Là, on sait qu’on est en Italie, vraiment. Et ce qui est très fort aussi, c’est d’avoir justement accordé beaucoup de place au ciel parce que on respire. La ville est très dynamique, en bas, il y a beaucoup, beaucoup de mouvement et d’agitation, mais heureusement il y a un ciel très important qui nous permet de prendre un peu d’air.
Et ce qui est très fort aussi dans ce tableau, c’est le travail de perspective. Donc on est dans dans une vérité topographique, mais aussi on a quelque chose de très juste au niveau de la perspective, parce que vous avez des lignes qui sont imaginaires mais qui sont horizontales et qui convergent toutes en un point de fuite unique qui se trouve sous le pont au niveau de cette façade qui accroche toute la lumière. Vous avez cette façade là et toutes les lignes convergent ici pour nous emmener loin dans le tableau.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Exactement. Donc avec ce tableau, c’était Venise. Alors restons en Italie.
[Illustration : Pierre Henri de Valenciennes, “Vue des environs de Rome”, vers 1800, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et retrouvons un peintre français. Un peintre toulousain, même s’il s’appelle Pierre Henri de Valenciennes. Et il va ici donc nous montrer un tableau qui permet véritablement la respiration. Le tableau dont Marthe vient de vous parler était grouillant.Et ici, vous avez un tableau extrêmement apaisé.
Intéressant de vous dire que c’est un tableau peint en 1800, mais qui est encore peint sur du bois, ce qui constitue un petit archaïsme. Donc le voyage en Italie, fait vraiment partie de la formation des peintres et Pierre Henri de Valenciennes, il a fait ce voyage, il a pu séjourner là-bas en Italie, et c’est vrai qu’il a aimé étudier la perspective. Il a développé une nouvelle sensibilité par rapport à la nature. Et il a eu vraiment à cœur de dire à ses élèves de se frotter au plein air. Alors on sait qu’en 1800, qui est aussi la date du tableau, il a produit un traité des éléments de perspective à l’usage justement de ces élèves. Et quelques années après, on sait qu’il a obtenu la création d’un prix de Rome du paysage historique. Cela fait prendre des échelons au paysage. Ce genre qui était un petit peu le parent pauvre comme Marthe vous l’a dit. Donc notre tableau pour rentrer à l’intérieur vous donne vraiment une notion d’espace formidable. Et d’autant plus que je vous rappelle ces dimensions, c’est un tableau qui fait 35 cm sur 48, donc c’est un très petit format. Cependant la notion d’espace est là et elle n’a rien à faire avec le format. Puisque ici vous avez une échelle qui permet de comprendre justement la taille des personnages par rapport aux édifices. Notre tableau, c’est le néoclassicisme qui fait suite au baroque et à tous ses tourments. Mais avec le Néoclassicisme, on sent qu’il y avait cette volonté de revenir à la rigueur de la composition, au calme, à des choses qui sont très posées, qui sont aussi douces par exemple que la musique, que ce petit berger sous l’arche du pont est en train d’émettre avec sa petite flûte, lui qui est assis auprès de son chien devant les moutons.
Donc, si vous voulez, vous avez ici un sujet, tout à fait ancestral, un sujet de campagne. Mais c’est vrai que c’est intéressant de se pencher sur le fait qu’il y a des choses immuables. Un jour, l’homme a bâti des monuments immenses, même si la végétation gagne en haut de ce qui peut être un ancien théâtre à l’antique. Et il y a cette maman et son enfant tout à fait à droite qui vous donne cette échelle et qui nous amène à nous questionner sur la place de l’homme dans la nature.
Combien il est fragile, et combien la nature finalement est plus puissante que lui. Combien ses aînés ont édifié des bâtiments solides qui ont traversé les millénaires, alors que lui même est si fragile. Il y a une perspective atmosphérique dans ce tableau, c’est à dire que au premier plan, on a des contrastes marqués alors qu’à l’arrière plan tout se dissout, tout se décompose, se dissout véritablement dans l’éloignement.
Et donc c’est pour ça qu’on parle de paysage atmosphérique. Et finalement, dans ce tableau, on ne sait pas si c’est l’aube ou le crépuscule.
[Marthe Pierot] : Tout à fait. C’est là tout le mystère et la poésie de l’œuvre.
[Illustration : François Gazard, “Une tempête”, 1800, peinture]
[Marthe Pierot] : Alors on va quitter ce paysage très tranquille pour être vraiment dans les tourments et la violence d’un paysage qu’on va appeler romantique, dans le tableau suivant. Donc là, vraiment, on est au 19e siècle et il y a un mouvement pictural qui est le romantisme et qui va permettre au paysage de prendre encore plus d’importance. Parce qu’en effet, et bien, les peintres qui sont romantiques, vont utiliser et charger tous les paysages de leur état d’âme. Alors s’ils sont mélancoliques, ils vont chercher les bords de lacs et les soleils couchants. Mais s’ils sont passionnés ou exaltés, ils recherchent une nature sauvage, des sommets inviolés ou une mer déchaînée. Et là ici, on est face à une mer complètement déchaînée. Donc imaginez, et bien, les états d’âme de ce François Gazard quand il peint ce tableau, cette tempête où on parle d’exaltation des sentiments et de violence, des rapports humains et de la nature. Alors c’est une composition très animée. Mais ce qui est très fort, c’est de voir ce ciel qui prend quasiment toute la place. Les trois quarts du tableau. Et la noirceur de ce ciel. Mais on a aussi beaucoup de nuances, beaucoup de changements. Regardez en bas à gauche, vous avez des lueurs oranges qui nous donnent l’impression que le ciel est en feu. Mais vous avez une trouée lumineuse très importante aussi, qui est là pour guider notre regard. Parce que quand on suit les faisceaux lumineux, et bien on peut arriver vers une scène très importante. Où vous avez donc tous ces personnages là qui en bas sur le rocher vers la droite, tirent d’une corde un bateau pour essayer de sauver le bateau d’une naufrage. Donc c’est un sauvetage ici qui est mis en lumière. Mais ce qui est fort aussi, c’est de noter le mouvement circulaire de ce tableau qui est très présent. On a l’impression que tout tourne dans un même flux infernal. Mais heureusement, le phare est là. Le phare est au centre. Il est droit, c’est le pivot, c’est le pilier. Il tient et tout tourne autour. Et puis vous avez tous ces personnages dont l’échelle est très petite et c’est volontaire. C’est pour nous montrer à quel point la nature est forte, à quel point elle prend le dessus par rapport à l’homme. Mais vous avez toute cette palette des émotions humaines, avec des personnages qui sont dans des situations très difficiles. Dans cette barque, au milieu, on a le personnage qui lève les bras au ciel. Mais en bas à gauche, on a un autre personnage qui s’accroche au rocher comme il peut, une famille éplorée au premier plan. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Et puis vous avez ces vagues qui sont dressées comme des montagnes. Bref, on n’aimerait pas se retrouver au milieu de cette tempête, ça c’est certain.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et n’y a-t-il pas un peintre qui au même moment aimait aussi les tempêtes ?
[Marthe Pierot] : Oui oui mais tout à fait. On peut évoquer, ouvrir une petite parenthèse pour parler de William Turner qui effectivement était un peintre qui avait la même fascination pour les phénomènes climatiques et les cataclysmes naturels. Et Gazard notre peintre est tout à fait contemporain de William Turner. Donc voilà il avait cette influence là. D’ailleurs juste Gazard était un peintre toulousain mais qui a quand même été conservateur du musée de Versailles. Ce qui n’est pas rien. Et une petite parenthèse aussi. Ce que je voulais vous dire, c’est que ce qui était étonnant dans ce paysage, c’est qu’on ne sait pas du tout où on se trouve. Il y a beaucoup de mystère. Tout à l’heure, on était dans les environs de Rome, c’était clair. Ici, on est vraiment dans un paysage qui est là pour nous parler de la nature qui est plus forte que tout, pour nous parler de cette notion de sublime. Mais finalement, la géographie n’est pas si précise et ce n’est pas si important.
[Illustration : Charles de Tournemine, “Souvenir d’Asie mineure”, 1858, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors à présent, je vous propose donc de partir vers l’Orient avec Charles de Tournemine. Alors voyez ça, c’est un paysage orientaliste. Souvent, quand on pense orientalisme, on pense à ses harems, à ses odalisques enfermées. Mais il existe aussi un orientalisme d’extérieur. Alors l’Orient, de toute façon, était connu pour les Français de cette époque, puisque il y a eu à la fin du 18e siècle déjà l’expédition de Napoléon Bonaparte au Caire en Égypte. Et puis il y a eu la guerre d’indépendance des Grecs contre les Turcs. Et puis il y a eu l’affaire de l’Algérie. S’installer en Algérie, ça représentait véritablement un enjeu. Donc en fait, on a beaucoup parlé au public français de l’ailleurs, de l’étranger. Et cet Orient, ici, et bien, il est bien sûr tout à fait poétique. Alors ici il s’agit d’un peintre Tournemine qui est né à Toulon. Et ce qui est intéressant, c’est que dès sa plus jeune adolescence, il devient mousse. Il s’embarque sur des bateaux qui vont lui faire faire le tour du bassin méditerranéen. Il va infiniment aimer cela. Puis il reviendra. Il exposera à Paris et il reprendra le voyage parce qu’il en avait vraiment le goût. Alors nous sommes en Asie mineure, comme le dit le titre du tableau. L’Asie mineure c’est l’Anatolie. C’est une partie de la Turquie aujourd’hui. Il y a séjourné 3 mois. Il a pu prendre des notes, il a pu remplir des croquis afin de trouver matière à ses tableaux. Donc dans son paysage qu’est ce qu’il place ? Il place beaucoup d’espace, ça c’est une chose. La profondeur est évidente. Il y a une végétation attendue, le palmier c’est l’arbre par excellence du voyage avec sa chevelure souple qui semble flotter au vent. Et puis il y a cet oasis, ce point d’eau où viennent paître les troupeaux. Donc vous avez ici cet endroit de fraîcheur certainement extrêmement agréable. Les humains, ce sont des hommes qui sont, vous voyez, enturbannés ou dont les têtes sont enroulées par des chèches. Ces tissus très fins qui protègent du soleil ou du vent. Donc on s’aperçoit qu’en fait il y a un réel exotisme. On voit par exemple ces positions alanguies, allongées des personnages fumant la sebsi. C’est à dire cette très longue pipe. On est vraiment en Orient pour toutes ces raisons. Il y a aussi un bétail avec de très longues cornes et donc vous avez ici et bien beaucoup d’éléments. On peut citer également l’architecture, mais est-ce que c’est un mirage ? Ou est ce que c’est vrai ce que l’on voit là-bas ? Un dôme, des minarets, est-ce que c’est Sainte-Sophie ? Puisque si nous sommes en Turquie on peut en parler, mais elle n’est pas tout à fait du côté de l’Anatolie. Peu importe la réalité topographique, on est dans le rêve, on est dans l’imaginaire et c’est vraiment de toute façon ce que le peintre veut nous faire ressentir. C’est à dire qu’en fait ici les gens sont demandeurs de cet ailleurs et vous avez Tournemine qui leur sert ce qu’ils attendent.
[Illustration : Gustave Courbet, “Le ruisseau du Puits noir”, 1865, peinture]
[Marthe Pierot] : Et bien, pour contrebalancer un peu tous ces propos, on va vous montrer un paysage réaliste qui ne cherche pas à plaire mais qui cherche à faire vrai. C’est notre paysage suivant, réalisé par Gustave Courbet. Donc Courbet est un grand peintre réaliste. Au 19e siècle, il réalise beaucoup de paysages, notamment, et bien, en Franche Comté, parce que c’est la géographie dont il vient. En fait, il vient de la Franche Comté, il est né de là-bas et il représente très souvent des paysages de la Gorge, de la Brême. Vraiment, c’est cet endroit là qui se trouve pas très loin de Ornans et là on est dans le ruisseau du Puits noir. Donc il réalise beaucoup de tableaux de cet endroit là. Et là il nous propose et bien un paysage qui n’est pas du tout idéalisé. Pourquoi ? Et bien là on le voit tout de suite, la lumière n’est pas la même. Le paysage est sombre, humide, peut être un peu froid. L’horizon est bouché. Alors que jusque-là on vous montrait des paysages avec un ciel prédominant très ouvert, là tout est fermé, tout est bouché. Vous avez une toute petite place qui est accordée au ciel et tout le reste semble nous écraser. D’autant plus que cette falaise est immense et on a vraiment on ressent le poids du minéral ici. Cette falaise qui nous donne l’impression de nous écraser. Et elle est d’autant plus marquée parce que la technique de Gustave Courbet le permet et le montre. C’est vraiment un peintre matiériste et donc en fait il accumule des couches de peinture les unes sur les autres avec des instruments comme une brosse dure ou un couteau, pour justement nous donner cette impression de matière et d’épaisseur. Et en plus de ça, il avait préparé sa toile au goudron pour rajouter de la matière et une atmosphère très sombre au tableau. D’ailleurs, la palette est assez réduite. Les tons sont opaques, du vert, du gris, du brun, un peu de bleu et c’est tout. Là, ici, il veut nous parler de ce paysage qui est sombre, mystérieux et secret. Et il ne cherche pas à mettre de la lumière ou du soleil là où il n’y en a pas habituellement. Mais ce qui est très moderne dans ce paysage, et ce qui est important de préciser, c’est que c’est le premier paysage qu’on vous montre, où il n’y a pas d’humains, pas d’animaux, pas de personnages, rien du tout, aucune anecdote. Il y a juste le paysage pour le paysage. La nature prend enfin toute la place. Mais ça, c’est très moderne encore.
[Illustration : Evariste-Vital Luminais, “L’abreuvoir”, 1865, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bien sûr. Et justement, vous notez que le tableau que nous regardons à présent est exactement de la même année 1865. Mais là où Courbet était moderne pour se permettre de se passer de personnages, on revient ici à quelque chose de plus classique avec des animaux et un homme. Alors, dans ce tableau qui se nomme « l’abreuvoir », nous avons en fait cette heure tranquille où ce jeune paysan ramène à l’écurie ou à l’étable ses chevaux. Un cheval s’attarde encore au niveau de la ligne d’horizon. C’est pourquoi, le jeune garçon le regarde. Ce jeune garçon qui est monté à cru, c’est à dire directement sur l’animal, sans poser une selle sur le cheval. Ce qui nous donne une idée encore plus évidente du contact immédiat entre l’homme et l’animal.
Alors ce qui est intéressant, c’est de constater les belles robes de ces chevaux. Il y a le cheval blanc au centre, dont le reflet, magnifiquement est présent dans cette flaque, dans ce petit étang central. Et puis vous avez des chevaux de couleur bai, c’est à dire marron glacé, et puis des chevaux dont on dit qu’ils sont alezan brûlé, c’est à dire presque noirs, comme celui de gauche. Vous voyez ? Donc beauté de la lune aussi, qui crée le reflet dans l’eau. Et c’est vrai que le ciel est un petit peu menaçant ici. Il y a comme un pressentiment que le temps pourrait changer, qu’il faut peut être se dépêcher. Vous voyez en fait ces longs nuages qu’on appelle des cirrus qui s’effilochent.
Donc si vous voulez ici Luminais le peintre d’histoire, et bien il nous surprend dans la mesure où ici il y a tout à fait autre chose de ce qu’il produit. Que produit-il d’habitude ? Et bien, il produit des tableaux où il parle du Moyen Âge, des Gaulois dans les livres d’histoire de la 3e République. Et c’est vrai que ici, on n’a absolument pas l’histoire de France. On a juste le charme de cette heure particulièrement tranquille entre chien et loup, avec une ambiance extrêmement douce qui nous séduit. Donc c’est presque le symbolisme qui est là, c’est cette couleur mauve. C’est la beauté de cette palette entre le gris, le vert et le mauve, quelque chose de très onirique. Où sommes nous en fait ? Est ce que nous sommes vraiment dans un contexte de mer ? Est ce que la mer est à l’arrière ? La question est posée. En tout cas, ce qui est évident, c’est cette ambiance étrange, étrangement épurée.
[Illustration : Blanche Hoschede Monet, “Jardin de Monet à Giverny”, 1920, peinture]
[Marthe Pierot] : Et on reste dans les tons de mauve, mais là on arrive dans un paysage qui est beaucoup plus clair et précis. On sait exactement où nous sommes. Nous nous trouvons dans le jardin à Giverny de Claude Monet. Ce grand peintre impressionniste qui avait réalisé ce jardin lui-même pour justement pouvoir le peindre. Donc il travaillait avec une organisation chromatique très précise. Il plantait des fleurs de manière à justement pouvoir avoir cette atmosphère là de jardin à l’anglaise, de jardin sauvage. Tout était très libre dans ce lieu qui l’a beaucoup inspiré. Mais là je vous parle de Monet, mais ce n’est pas du tout un tableau de Claude Monet. Pourtant dans son nom, dans le nom de l’artiste, vous me direz, il y a Monet. Il s’agit d’un tableau réalisé par Blanche Hoschede Monet. Et bien en fait c’est la belle fille de Claude Monet. Et elle a très longtemps fréquenté ce jardin-là parce qu’elle va vivre chez son beau-père à Giverny. Mais en plus de ça, elle prendra soin toute sa vie de ce jardin à la mort du peintre. Elle va le conserver. Elle va le présenter aux visiteurs pendant une vingtaine d’années, vous imaginez. Et elle va même le protéger au moment de l’occupation allemande. Donc il y a un lien très fort avec ce jardin. Et elle réalise ce tableau au moment à presque à la mort du peintre pendant ses dernières années. Au moment où justement Claude Monet réalise les nymphéas. Voilà, mais il a probablement vu ce tableau avant de mourir. En tout cas, il y avait un lien très fort entre les 2. On confond assez souvent leur travail. Parfois voilà, on peut être un petit peu confus quand on voit les œuvres de ces 2 artistes. En tout cas-là nous sommes avec Blanche Hoschede Monet et on peut parler d’un tableau impressionniste parce que tout y est. On a cette idée d’imprécision, de contour flou, de couleur fondue. La touche est vive, rapide, presque esquissée. Tout semble un petit peu confus et mélangé. Regardez ces ombres colorées au niveau de l’allée qui est complètement envahie par ces fleurs. On ne sait pas vraiment où commence l’ombre et où s’arrête le parterre des fleurs. Tout est un petit peu mélangé. Au fond, on voit la façade arrière de la maison de Giverny. C’est un des seuls tableaux qui nous présente ce point de vue là finalement. C’est assez original. Par contre, ce qui n’est pas tout à fait original, c’est le style impressionniste. Parce que nous sommes en 1920, l’impressionnisme c’est les années 1860 et à partir du 20e siècle et bien le la peinture avant-garde, c’est plutôt le fauvisme, le symbolisme. Mais Blanche Hoschede Monet n’est pas tout à fait sensible à cette nouvelle tendance avant-gardiste et préfère prolonger l’impressionnisme avec ce très très beau tableau.
[Illustration : François Gauzi, “Bergère au milieu de son troupeau”, début XXe, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c’est que dans le tableau suivant, et bien on retrouve cette nature. Et le peintre Gauzi lui aussi de part son sujet, il n’est pas tellement moderne. Au début du 20e siècle, Marthe vous l’a dit, il y a donc différents courants artistiques. Et on a ici et bien quelque chose qui est ma foi, une bergère avec ses moutons dans ses champs. Ça semble un sujet extrêmement classique, ancien je dirais même parce que c’est vrai qu’à cette époque là, et bien on a des expressionnistes tourmentés, on a des cubistes qui décomposent le tableau. Ici, ce n’est pas le cas, mais néanmoins, on a des choses très mauves ici, très jaunes aussi, et on sent que les fauves sont quand même passés par là, puisqu’ils ont déplacé un petit peu les couleurs là où on les attendaient. Alors le peintre Gauzi ici nous propose une nature bienfaisante, magnifiée, dans laquelle on se sent comme protégé. Ça, c’est une constante. Mais cependant, et bien, il résiste avec ces sujets traditionnels, comme on vous le disait, et on voulait vous parler également du fait que son nom, Gauzi est un nom important puisqu’il était très ami avec Toulouse Lautrec. D’accord, et c’est vrai que Gauzi aime particulièrement ces coteaux mollement ondulés qui sont ceux des alentours de Toulouse. Nous sommes à Fronton et c’était important de situer donc ce peintre particulièrement local. L’ambiance est calme, bucolique. La bergère peut être un peu âgée, peut être un peu penchée, les épaules couvertes de son châle. Vous voyez, penche la tête et elle a cette tête donc ceinte de son paillol. Ça c’est le chapeau toulousain avec le ruban noir qui permet de le resserrer au niveau du menton. Et ce qui est intéressant ici, c’est qu’elle est de dos. En fait, elle ne veut pas voler la vedette au paysage. Si bien qu’on la regarde peu et que finalement on regarde vraiment cette composition où il y a tiers d’herbe en partie inférieure, 1/3 de champ et de route en partie centrale et 1/3 de ciel en partie supérieure. Mais l’originalité, ça n’est pas tant la ligne oblique des arbres qui viennent certainement border le canal du midi. L’originalité, c’est ce que vous avez sur la droite sur ce coteau. Cette ligne en forme de « S », très lisse, très simplificatrice, qui nous semble très moderne, un petit peu comme dans les tableaux de Hockney, dans les tableaux aussi de Mink, qui osent ces lignes extrêmement simplifiées. Donc voyez en fait ce thème traditionnel, mais modernité quand même.
[Illustration : André-Pierre Lupiac, “Le cumulus”, 1930, peinture]
[Marthe Pierot] : Et bien, on reste dans cette même lignée avec notre dernier tableau où finalement on retrouve dans l’espace inférieur quelque chose d’assez classique, une scène de pâturage, un personnage avec son chapeau et ses vaches. Mais ce qui est très moderne, c’est la manière de nous parler de ce sujet. Les couleurs qui sont utilisées et surtout la place qui est accordée à ce nuage qui devient le personnage principal du tableau. Finalement, 80% du tableau, c’est le nuage. Pas n’importe quel nuage. Il s’agit d’un cumulus. Donc c’est le nom qu’on donne à ces nuages qui ont une forme très reconnaissable et caractéristique. On a un peu l’impression d’avoir un chou fleur ou une crème chantilly. Finalement, on pourrait se dire tout ça. En tout cas, c’est un nuage qui grossit, qui grossit et qui très souvent précède des précipitations orageuses. Et le personnage qui est en bas le sait bien. Parce que, regardez, il avance d’un pas un petit peu pressé finalement. Il a son chapeau vissé sur la tête, la tête baissée, et il se dépêche parce que le nuage derrière le course et pourrait bientôt le rattraper. Et c’est ça qui est fort avec ce tableau, c’est cette impression d’images qui peut évoluer finalement, qui peut grandir. On imagine ce nuage qui ne va cesser de grandir, de se dilater jusqu’à occuper tout l’espace, tout le tableau, et qui comme une avalanche va complètement entièrement tout recouvrir. Et puis on voit le gris en dessous. Donc on imagine tout à fait que le mauvais temps est en train d’arriver. Donc tout va basculer d’un moment à l’autre dans ce tableau. Mais en tout cas pour le moment, avec ces couleurs-là, il y a quelque chose de très rafraîchissant et de très apaisant. Vous avez du bleu, du blanc, du vert, un peu de gris mais c’est tout. Et la modernité, elle réside dans la manière de placer ces couleurs de manière très franche. Il n’y a pas de dégradé, pas de nuances. On a vraiment des aplats de couleurs et on pourrait penser un peu au fauvisme justement, où on avait ces couleurs très pures et très franches qui étaient placées dans des tableaux. Même si ce ne sont pas du tout les couleurs des fauves, parce que là on est sur des couleurs beaucoup plus froides, on pourrait penser peut être plus à un peintre surréaliste belge, René Magritte, qui utilisait ces couleurs là et qui simplifiait les formes un petit peu de cette manière-là. Ou alors on pourrait même partir un petit peu plus loin et avoir l’impression d’avoir une affiche publicitaire des années 50-60 devant nous pour parler des produits laitiers ou des crèmes fouettées. Voilà, y a ce côté un peu vintage, rétro qui est assez intéressant avec justement la simplification de ses formes et la pureté et la fraîcheur de ses couleurs.
Voilà alors le peintre Lupiac pour dire 2 mots sur lui. C’est un peintre toulousain mais qui fait ses études à Paris, qui fréquente des grands ateliers de peinture mais qui redescend dans le midi toulousain au moment de la guerre et qui finit sa vie vers Castanet. Alors il peint beaucoup de tableaux d’histoire, beaucoup de paysages du Lauragais. Mais surtout si vous voulez le connaître un peu plus, vous pouvez aller dans la salle du conseil municipal au Capitole où il y a des tableaux de lui, notamment un qui s’intitule « le vent d’autan ». Où souffle déjà les éléments à cet endroit là. Donc on a peut être une scène assez attendue au premier plan et finalement la manière de le réaliser et la manière d’utiliser ces couleurs montrent toute la modernité et l’audace de ce peintre
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Exactement.
[Marthe Pierot] : Voilà, on revient vers vous pour conclure.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors au fil des tableaux qu’on a vu ensemble, on a connu des ambiances, des atmosphères tout à fait différentes et c’est vrai que on a voyagé de la Franche Comté à l’Asie en passant par le Lauragais, les Flandres, Venise. À vous de choisir le tableau dans lequel vous vous sentez le mieux. On s’est aperçu aussi que, en nous parlant des lieux, les peintres nous parlaient d’eux-mêmes. Parce que c’était les paysages intérieurs, ceux qu’ils portent en eux dont ils nous parlaient. Et c’est vrai que c’était leurs états d’âme dont ils faisaient état.
[Marthe Pierot] : Oui, et ça, c’est intéressant de le souligner. Donc on voulait vraiment vous montrer que le paysage a peiné à trouver sa place en histoire de l’art. Mais qu’il gagne en reconnaissance à mesure que le temps avance au fil des époques. Et aujourd’hui, ils n’ont plus de preuves à faire. Ils nous ont parfaitement conquis et on peut même aller plus loin et ouvrir et sortir de la peinture pour se dire aujourd’hui, qui sont les paysagistes du 21e siècle ? Et bien oui, on peut dire les photographes, les cinéastes. Voilà, on continue à nous faire voyager et à nous faire rêver. Et d’ailleurs comme on a fait pas mal d’ouvertures dans la conférence, on peut citer un photographe que vous connaissez probablement, Yann Arthus-Bertrand qui propose un très bel état des lieux de notre planète avec beaucoup de photos aériennes dans « La terre vue du ciel ».
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui par exemple.
[Marthe Pierot] : Oui, ça c’est beau pour ouvrir.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Voilà, merci vraiment de nous avoir suivis lors de cette conférence et à très vite
[Marthe Pierot] : Merci.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Au revoir.
Réalisme et impressionisme
Réalisme et impressionnisme
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Réalisme et impressionnisme”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2021]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Messieurs dames, Bonjour.
[Marthe Pierot] : Bonjour.
[Illustration : Valentin de Boulogne, “Judith”, vers 1625, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Nous sommes très heureuses de vous retrouver Marthe, Isabelle, pour vous parler donc aujourd’hui d’un nouveau sujet pour une conférence en ligne justement du musée des Augustins. Alors le sujet du jour, Marthe ?
[Marthe Pierot] : Réalisme et impressionnisme. Voilà donc on va vous parler de ces 2 mouvements, de ces 2 courants qui sont très très importants dans la 2nde moitié du 19e siècle. Et tous les 2 s’expriment bien dans le salon rouge du musée des Augustins. Alors ce qui est intéressant, c’est que ces 2 courants se libèrent vraiment de la dictature académique et du beau antique et classique qui étaient les normes pendant très très longtemps pour justement peindre des sujets totalement nouveaux avec une technique plutôt moderne en ce qui concerne en tout cas l’impressionnisme.
Alors c’est aussi important de dire que ces courants vont naître et voir le jour au cœur d’une société qui sera en pleine mutation au 19e siècle. Et on va vous en parler d’ailleurs.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, on va vous parler en fait d’une peinture qui est un petit peu en rupture avec les sujets romantiques, sentimentaux. Qui est également en rupture avec les tableaux de bataille, avec ce caractère épique qu’on ne retrouvera pas. Et c’est vrai qu’on a un mouvement artistique qui naît au départ par la littérature. Des gens comme Zola, des gens comme Hugo vont proposer ces nouveaux sujets. Alors ces nouveaux sujets, c’est la rudesse des conditions de vie des gens du peuple. Cet art engagé qu’est le réalisme représente vraiment les gens du peuple dans leur vie quotidienne. Et c’est vrai que nous sommes à une époque où les idéaux socialistes voient le jour et ceci va inspirer les peintres réalistes et les sujets réalistes. Et ça c’est une modernité.
[Marthe Pierot] : Exactement. Et on va commencer donc avec comme d’habitude notre petit partage d’écran pour vous présenter les œuvres du musée.
[Illustration : Alexandre Antigna, “La halte forcée”, 1855, peinture]
[Marthe Pierot] : Voilà. Donc vous avez un premier tableau sous les yeux réalisé par Alexandre Antigna en 1855. Ici c’est un tableau qui exprime quelque chose de très difficile, on le comprend et on le voit tout de suite. La palette est froide et monochrome. On voit que la saison est hostile, le cheval est couché, la carriole est baissée. Bon c’est mauvais signe. La famille est très nombreuse. On compte jusqu’à – Isabelle tu m’arrêtes si je me trompe – mais 6 enfants. Voilà y a 6 enfants et donc cette famille est bloquée dans la neige.
Et tous sont actifs. Regardez notamment les enfants qui s’activent énormément avec cette petite fille qui ramasse les fagots de bois, les enfants qui font le feu, un autre enfant qui va couvrir ou abriter le grand-père dans la carriole alors que justement les 2 hommes, eux, semblent totalement désœuvrés. Regardez le père qui pose lourdement sa tête sur ses mains, qui semble totalement désemparé par ce qu’il est en train de se passer. Et puis on a cette femme, cette femme au centre du tableau. Droite, tel un pilier au regard déterminé. Elle symbolise la force. C’est sur elle que tout repose. Mais alors, qu’est ce qui se passe ici ? Et bien, Antigna, nous parle de l’exode rural qui commence dès 1840. Et c’est une période où on va quitter la campagne pour aller en ville, pour travailler dans les usines, parce qu’on a l’espoir d’une vie meilleure, et donc c’est un contexte d’industrialisation. Et les peintres réalistes vont en parler à de très nombreuses reprises parce que c’est un sujet qui va les attirer. L’industrialisation et la misère qu’elle entraîne. Et Antigna est très sensible à ce contexte-là. Il veut parler des classes laborieuses, des problèmes des chômeurs, des bouleversements sociaux. C’est un peintre engagé et on le voit ici. Et regardez, il fait de cette femme une allégorie de la force. Elle représente le peuple infatigable dont Antigna veut nous parler.
[Illustration : Joseph Granié, “Le portrait”, avant 1896, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors nous allons quitter cette scène en extérieur pour une scène en intérieur. Cependant nous gardons l’idée d’une famille. Et cette fois-ci de son cadre de vie puisque nous avons devant nous une maison et c’est en fait une pièce unique. C’est une cuisine-chambre. Voyez sur la gauche, vous avez des carreaux bleus et blancs qui vous parlent du lit. Et puis à droite, vous avez une cheminée qui est très sombre. Donc vous avez une maison qui est extrêmement rustique. Vous avez un plafond lourd, ce qui fait que la pièce est sombre. Vous avez des gens dont les vêtements sont tachés. Regardez le tablier de la petite fille en bleu à gauche. Voyez les pieds nus, voyez où les sabots de bois que porte la grand-mère. Donc plusieurs générations semblent s’entasser, dans la même maison, parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement.
Alors la table est un petit peu le pivot de ce tableau, puisque vous avez le lit à gauche, la cheminée à droite – je l’ai déjà dit – mais vous avez quand même quelque chose qui s’organise autour de cette table. Et d’ailleurs, le titre du tableau, c’est « le portrait ». Alors le portrait, comment est ce que nous y venons ? Et bien justement, à gauche, vous avez la grand-mère qui présente une petite fille à qui ? A un jeune peintre qui se trouve sur la droite. Et ce qui est intéressant, c’est qu’on reconnaît les éléments, les attributs du peintre. Vous avez donc sa palette posée sur un tabouret, vous avez le châssis d’un tableau. Voilà donc comment identifier ce jeune garçon à droite. Et puis vous avez tout un jeu de regard puisque regardez, la vieille dame regarde le peintre tandis que la femme, avec sa chemise blanche au centre, est en train de regarder vers la petite fille, tandis que sur la droite, cet homme qui est debout derrière le peintre regarde le travail du peintre.
Donc vous avez tout ce jeu de regards qui est très intéressant. Et ce qui est intéressant ici, c’est qu’on pourrait vraiment aussi dire que c’est fort inhabituel que d’avoir la présence d’un artiste dans une telle masure. Mais voilà, pour ce sujet hautement réaliste, on peut terminer en parlant des couleurs qui piquent le tableau. Voyez le fichu jaune de la petite fille, son tablier bleu ciel, et puis également, le châle de la grand-mère qui est rouge et blanc et qui vient un petit peu égayer cet ensemble sombre.
[Marthe Pierot] : Oui, qui me rappelle un petit peu le le vêtement qu’a porté Isabelle aujourd’hui, j’y pense.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est pas calculé en plus ça.
[Illustration : François Bonvin, “Les forgerons”, 1857, peinture]
[Marthe Pierot] : Alors on continue pour vous présenter les tableaux qui là deviennent de plus en plus sombres. Alors on a un clair-obscur ici qui est tout à fait intéressant et qui permet vraiment d’accentuer sur l’ambiance qu’on a dans ces forges. On a 3 personnages dans le tableau et on a donc 3 générations. Ils travaillent tous. Ils ont des chemises ouvertes et retournées. Tout ça pour nous dire la pénibilité du travail et la chaleur qui doit être présente dans ces forges. Alors regardez, à gauche, on a un petit garçon qui va refroidir le métal. On voit qu’il verse de l’eau dans le baquet, et puis à droite on a un adolescent qui est en train d’activer un soufflé qu’on distingue à peine car il se noie dans la pénombre. Et enfin on a un adulte qui est très probablement le maître de la forge, et bien qui est en train de forger le métal. Donc finalement, on a une hiérarchie des tâches en fonction de l’âge et on va du travail de plus en plus pénible en fait en fonction de l’âge. Mais ce qui est intéressant, c’est de parler de cet enfant qui travaille alors qu’il est tout à fait jeune. Donc l’idée c’est vraiment de nous parler de la difficulté des conditions de vie de ces générations qui travaillent toutes ensemble.
Mais qui justement vont travailler comme une entreprise familiale dans un contexte où justement, on l’a dit, c’est l’industrialisation, c’est la standardisation. On a des usines et bien-là on a cette petite entreprise familiale qui lutte et qui résiste pour justement continuer à défendre leur activité malgré le contexte difficile du 19e siècle. Voilà donc dans cette toile charbonneuse on nous parle un petit peu de ce contexte-là, de cette difficulté-là.
[Illustration : Alexandre Falguière, “A la porte de l’école”, 1887, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. On va continuer avec cette fois-ci une sculpture. Une sculpture qui vous propose une scène attendrissante étant donné que on a une grande sœur qui est en train d’embrasser un bébé alors que la maman lui présente. Ici ce qui frappe, c’est la pauvreté de ces gens. Regardez sur l’épaule de la mère, le vêtement déchiré. Regardez les pieds nus de la mère. Vous avez également une absence totale bien sûr de bijoux et la mère est coiffée au plus simple. Donc c’est la nouveauté de ce réalisme représenté des gens pauvres. Ces gens pauvres deviennent le sujet du tableau et les faire exister afin de leur donner une dignité. Alors ce qui est intéressant également, c’est de revenir sur le titre puisque si c’est « à la porte de l’école », on comprend que la petite fille qui nous tourne le dos est une écolière.
Elle a sous son bras droit des livres et elle porte un tablier. C’est intéressant également de donner des éléments de contexte puisqu’on sait que 7 ans avant cette œuvre, est passée la loi Jules Ferry, en 1880 exactement, sur l’école obligatoire, gratuite et laïque. Et ça, et bien c’est tout à fait intéressant puisque l’école, le savoir permet une ascension sociale à ces classes défavorisées. Et c’est quelque part pour elle une revanche. Donc c’est vrai que on a là un propos très important étant donné le contexte.
[Marthe Pierot] : Oui, et on comprend le contexte avec le titre, mais aussi avec le livre que porte la petite fille et le tablier qui a aussi une signification importante.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, parce que finalement le tablier va uniformiser et va gommer les différences sociales. Et ça c’est tout un symbole.
[Illustration : Alexandre Falguière, “Diane”, 1882, sculpture]
[Illustration : Pierre Prouha, “Psyché”, 1867, sculpture]
[Marthe Pierot] : Oui, tout à fait. Alors on va continuer avec les sculptures. Cette fois-ci on avait envie de jouer de comparaison. On vous en montre 2. Et moi je vais commencer par la sculpture qui se trouve à gauche, qui est un plâtre qui nous présente une femme cette fois-ci sans vêtements. Donc on n’a aucun indice. On ne peut pas connaître ou comprendre son origine sociale comme on l’a vu tout à l’heure avec les vêtements déchirés de la famille. Là ici on ne sait pas grand-chose. Mais ce que l’on peut voir c’est le corps de cette femme qui n’est pas du tout idéalisé. On a un corps réaliste vraiment. C’est à dire qu’il est un peu lourd, un peu trapu. Il n’est pas élancé dans sa silhouette. La poitrine aussi est lourde, la manière dont elle se tient un peu avachie. Donc finalement, on a un corps qui nous parle d’une femme tout à fait actuelle, ordinaire. Alors que finalement cette femme normalement ne devrait pas l’être puisqu’il s’agit d’une personne de la mythologie. Il s’agit de Diane.
Et on le sait parce qu’on a un tout petit indice. Même si on n’a pas de vêtements, on a au sommet de sa tête un petit croissant de lune qui nous montre, qui nous parle du symbole de Diane. Et puis à l’époque elle tenait un arc parce qu’elle allait tirer. Mais là l’arc est brisé, donc on a juste ce petit croissant de lune qui nous parle de cette personne, de ce personnage de la mythologie. Donc finalement c’est juste un prétexte. L’artiste Alexandre Falguière a juste cherché à parler d’une déesse de la mythologie pour représenter un nu. En fait, pour s’autoriser à parler d’une femme ordinaire et de parler de ce corps nu tout à fait réaliste. Parce qu’elle n’a absolument pas le look d’une déesse. On ne pourrait pas le deviner.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors on va maintenant regarder sur la droite de l’écran afin de parler de cette œuvre qui a été réalisée une quinzaine d’années avant Diane dont vient de vous parler Marthe. Regardez comme les codes classiques qui idéalisent sont ici encore présents, bien qu’il y a un bras levé et l’autre tendu comme sur l’œuvre de gauche. Et bien vous avez un traitement, notamment des jambes qui sont bien plus fuselées. Vous avez une taille qui est plus marquée, vous avez une poitrine plus haute et qui se tient mieux et qui est plus menue. Vous avez un visage dont les traits sont extrêmement fins. Et regarder jusqu’aux doigts comment ils sont effilés. Donc bien sûr, ici vous avez quelque chose qui est un idéal. Et c’est ça que le réalisme va combattre. On peut dire également quelle est l’attitude de cette femme à droite ? Et bien, c’est celle de Psyché. Psyché, c’est également ce personnage mythologique qui cherche son amour perdu donc Eros dans la nuit, aidé par sa petite lampe qu’elle tient de la main gauche.
[Marthe Pierot] : Oui. Donc c’était intéressant de comparer ces 2 pour bien comprendre comment un corps réaliste est traité par rapport aux canons classiques.
[Illustration : Gustave Courbet, “Le ruisseau du puits noir”, 1865, peinture]
[Marthe Pierot] : Alors on retourne à la peinture sombre, mais cette fois-ci nous sommes en extérieur et on vous présente ce paysage réalisé par Gustave Courbet, qui est un paysage très sombre et sauvage et pas du tout idéalisé. Regardez déjà, il est très très dense. Et puis l’horizon est bouché. C’est assez moderne que d’accorder aussi peu de place au ciel. Ce qui est important, c’est cette falaise imposante et écrasante.
Et qui est d’autant plus impressionnante. Et juste grâce à la technique du peintre Courbet, on peut parler d’un peintre matiériste. Il travaille vraiment les couches de peinture à l’aide de couteaux, de truelles et de brosses dures pour justement traduire toute la géologie de ce paysage et nous donner vraiment cette impression de minéralité et de densité. Donc voilà, on a ce paysage très sombre, très lourd, cette masse minérale, cette technique. La palette est réduite, les tons sont opaques. Courbet, travaillait aussi ou préparait ses toiles avec du goudron. Ce qui donne un aspect vraiment très très sombre. Et puis ce qui est intéressant aussi dans ce paysage, c’est de s’apercevoir qu’il n’y a absolument pas de personnage. Il n’y a pas un petit chien, un animal, un humain qui passerait par là, rien. Voilà, on a juste la nature pour la nature. Et ça c’est assez moderne que d’avoir une nature ou un paysage comme sujet principal et unique. Finalement, il n’y a pas d’anecdotique ici. Et ça c’est tout à fait intéressant, c’est aussi moderne que la technique l’est. Voilà donc ça c’est un beau paysage que Courbet nous présente.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, et c’est un paysage qu’il restitue parce qu’il le connaît bien, dans la mesure où sa terre natale, c’est Ornant les gorges de la Brême dans la Franche Comté. Donc c’est vraiment un lieu qui lui est familier.
[Marthe Pierot] : Exactement. C’est une géographie qu’il apprécie et qu’il aime, oui.
[Illustration : Auguste Rodin, “Buste de Jean-Paul Laurens”, 1882, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Voilà alors on va passer donc au visuel suivant avec ce buste réalisé par Auguste Rodin. Ce buste de son ami Jean-Paul Laurens qui est un peintre toulousain. Alors en fait Rodin est le père de la sculpture réaliste. Et la réalité de la vieillesse de cet homme, il va la traduire au mieux en nous disant combien justement cet homme est âgé. Regardez son crâne dégarni, ses paupières devenues très fines, ses pommettes saillantes, ses joues qui sont creusées. Il y a également les plis tendus du cou. Vous avez des clavicules qui sont très apparentes parce qu’il est un peu décharné. Vous avez cette épaule qui s’avance en avant, l’épaule de droite.
C’est un beau vieillard vibrant. Très vivant. Regardez, la manière dont les narines sont dilatées, la bouche ouverte. Vous avez ici donc quelque chose qui nous parle de sa vigueur en dépit de son âge. Et c’est vrai que cette œuvre est aidée par la lumière, puisque elle joue sur le bronze et au fil de la journée, la lumière va être renvoyée de manière différente. Donc cette vie qui palpite encore vraiment, ce côté tremblé, ça c’est une idée impressionniste.
[Marthe Pierot] : Oui, ce qui nous permet donc de faire la transition et de vous parler de l’impressionnisme qui parle de ce tremblement, de cette vibration de la vie et de cette lumière. Donc l’impressionnisme c’est un petit peu l’aboutissement en fait du réalisme. C’est ce qui vient à la suite mais c’est un art d’extérieur et qui lui va rechercher le vrai. Donc non pas dans les sujets qu’on a vu tout à l’heure, mais plutôt le vrai dans la lumière, c’est ça qui est important. C’est ce sujet-là, c’est la lumière. Donc exit le sombre finalement. On a, on va avoir en tout cas et on va le voir ensemble, des palettes beaucoup plus claires, des ombres colorées et donc là ça change. Ce qui est important aussi, c’est la technique. On va le voir, cette technique moderne où la touche est parfaitement visible. Les formats sont très souvent plus petits et les angles de vue vont être un petit peu nouveaux et originaux. En tout cas, c’est un mouvement qui dure qu’une dizaine d’années à peine, entre 1874 et 1886. Mais ce qui est important de dire, c’est qu’il y a 2 événements qui vont en tout cas accélérer la naissance de ce mouvement. Déjà, c’est l’invention de la peinture en tube qui permet au peintre de se déplacer, de peindre à l’extérieur et donc de capter la lumière et toutes ces variations dans sa vérité. Et puis l’apparition de la photo en 1839. La photographie qui permet justement de capter le réel mieux que jamais. Donc aucun peintre ne pourra concurrencer l’objectivité de la photographie. Donc les peintres impressionnistes vont plutôt chercher à traduire un ressenti, des sensations. Ce qui est important, ce n’est pas ce qu’on peint, mais plutôt la manière dont ils vont réussir à le peindre.
[Illustration : Francesco Guardi, “Port du Rialto”, 1760, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Exactement. Alors on va vous proposer ce visuel. Il est évident que c’est un tableau du 18e siècle de Guardi. Mais ce petit retour dans le temps est intéressant parce que Guardi, quelque part, est un précurseur du paysage qui tremble et qui vibre. Un précurseur de l’impressionnisme. Vous avez par exemple au premier plan de ce tableau, une eau qui tremble et des reflets sur l’eau. Et puis des petites notations blanches qui disent l’écume de l’eau. Les touches sont rapides, elles sont légères et nous sommes 100 ans avant l’impressionnisme.
Donc on peut dire que la touche de Guardi est avant-guardisme si tu me permets.
[Marthe Pierot] : Moi je te permets.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : L’ambiance de ce tableau est une ambiance qui vibre. Nous l’avons dit, sur l’eau, mais qui grouille également dans les bateaux des gondeliers et également au sein de ces échoppes de marchands, au sein de ces embarcations. Vous avez une ville, certes qui repose sur l’eau, mais la fixité des façades fait d’autant plus ressortir justement ce qui vibre à la surface, notamment de l’eau.
Cette composition donne au ciel une très très grande place. Certainement pour nous faire respirer. Parce que justement l’animation est elle en partie inférieure. Vous avez une lumière tout à fait fugitive, puisque en fait le ciel est peut être menaçant, peut être un orage couvre, mais en tout cas nos yeux sont menés vers ce petit pan de murs rose orangé qui se trouve en dessous de l’arcade du pont du Rialto, que je n’ai pas nommé hein, mais vous l’avez vu c’est le nom de ce tableau. Donc nos yeux sont guidés vers cette lumière qui tient encore et qui se reflète dans l’eau et qui va peut être d’une manière extrêmement rapide et bien céder la place à l’obscurité. Mais Guardi aura saisi ce moment-là en impressionniste avant l’heure.
[Marthe Pierot] : Voilà, c’était cette petite parenthèse-là pour effectivement vous parler de ce qui se faisait avant l’impressionnisme.
[Illustration : Camille Corot, “L’étoile du berger”, 1864, peinture]
Mais là on retourne au 19e siècle. On est dans cette période impressionniste et on va vous parler de Corot qui est une figure très très importante pour ce mouvement parce que c’est l’un des premiers à justement aller à l’extérieur peindre sur motif.
Donc voilà, il lance un petit peu le mouvement. Et ici on retrouve cette fabuleuse étude de la lumière. Regardez ce soleil, cette pointe orange au fond du tableau. Donc c’est la fin du jour ou le début du jour. Alors ça, c’est l’éternel débat au musée des Augustins. On ne sait pas si le soleil se couche ou s’il se lève, mais c’est là toute la poésie du tableau. C’est un mouvement qui va basculer, un moment, pardon, qui va basculer. Voilà, on est dans cette furtivité aussi. On retrouve également l’idée de vibration. Regardez en bas, au premier plan, toutes ces feuilles et ces tiges et ces herbes fines qui semblent trembler et vibrer. Mais on retrouve également aussi le tremblement dans le ciel, au niveau des nuages. On a l’impression vraiment qu’ils sont comme dans une course. Voilà une course dans le ciel. Ça, c’est tout à fait intéressant. Et puis on a également l’idée de la poésie qui se retrouve ici. On a ce berger qui rentre ou qui sort ses moutons. Mais on a cette femme drapée à l’Antique, au centre qui est tout à fait finalement presque idéalisée, un petit peu classique. Et puis on a quand même, une modernité dans ce tableau, malgré l’Antiquité du vêtement de la femme, c’est cet arbre au centre qui vient couper le tableau en 2 vraiment. Cet arbre qui pourrait être placé sur le côté pour dégager justement le paysage. Et bien non, Corot le place au centre. Mais ce qui n’est pas tout à fait impressionniste ici, c’est les couleurs, ce sont les couleurs qui sont plutôt sombres. Voilà, on n’est pas encore dans ces palettes colorées que l’on va voir par la suite, mais on a quand même cette idée d’extérieur, cette idée de vent, voilà cette idée de sensation et de légèreté qui vraiment annonce le mouvement impressionniste.
[Illustration : Edouard Manet, “Marguerite de Conflans”, vers 1875, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors on va continuer avec un tableau d’Édouard Manet. Alors il y a une question qu’on se pose.
[Marthe Pierot] : Oui, est ce qu’il est impressionniste ?
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors, il appartient à la même génération que les impressionnistes, que ce soit Monet, Renoir..etc. Il est ami de ces impressionnistes, mais il n’est pas véritablement un paysagiste, même s’il a fait de très belles plages. Si on cite quelques-unes de ses œuvres. Il n’est pas vraiment un paysagiste et il refuse de participer aux expositions des peintres impressionnistes. Donc il est plus un portraitiste qu’un paysagiste. Mais quand on parle de sa peinture, on est obligé d’évoquer les notions impressionnistes. Parce que vous voyez ici, et bien, il y a une vraie imprécision. Regardez les mains de cette Marguerite de Conflans, qui sont très peu définies. Il y a son profil dans le miroir qui se dérobe. Vous voyez comme si ça n’était pas fini. Et c’est vrai qu’il y a aussi une très grande clarté, puisque en fait, la lumière frappe ce vêtement qui est un vêtement de transparence qui fait la part belle au blanc bleu. Et le miroir renvoie également la lumière. Si bien que la lumière inonde cet intérieur. Cette jeune femme est très brune, ce qui tranche justement avec ces tonalités plus adoucies qu’on a tout autour. C’est également assez inattendu de trouver cet ovale. Mais cet ovale, dans le format du tableau, cherche peut être à donc comprendre encore plus de lumière pour justement faire de la lumière un des personnages principaux.
[Illustration : Berthe Morisot, “Jeune fille dans un parc”, 1893, peinture]
[Marthe Pierot] : Alors on reste dans cette fraîcheur-là, mais on quitte le bleu pour le vert. Et pour vous parler de ce tableau réalisé par Berthe Morisot. On passe du format ovale au format carré, de l’intérieur à l’extérieur. Et donc Berthe Morisot, cette fois-ci c’est évident, on le sait, c’est une des figures clés de l’impressionnisme. Elle est même, elle fait partie des membres fondateurs de ce mouvement et donc elle en fait clairement partie.
Et ici elle nous propose, ce portrait, cette jeune fille dans un parc, assise sur un banc, qui fait corps avec la végétation. Il y a quelque chose de très libre, de très sauvage ici et de très naturel. Déjà ses cheveux sont lâchés. Ils sont lâchés au vent, donc il y a quelque chose de libre. Mais la liberté de ses cheveux nous rappelle un petit peu la liberté des plantes qui sont derrière elles. Parce que regardez, c’est peut être ces roses, ou en tout cas ces fleurs qui sont derrière. Et quelques-unes tentent un petit peu de sortir du cadre et de passer à travers les barreaux du banc. Donc, il y a cette idée un petit peu sauvage qui est aussi présentée dans la végétation. C’est une femme dont on ne parle pas. Le titre ne mentionne pas son identité. L’idée c’est vraiment de parler de la végétation qui l’entoure, de cette ambiance très très fraîche.
Et puis qu’est ce qui est impressionniste ici ? Et bien ce sont ces couleurs, cette palette très douce et délicate. Mais aussi les touches que l’on peut bien voir au niveau notamment du corsage, ces touches qui ondulent, qui sont très souples et qui se fondent avec sa chevelure. Voilà. Et puis on a vraiment un format aussi assez inhabituel. Je l’ai dit tout à l’heure, un format carré, c’est pour vraiment laisser autant de place à ce portrait qu’à la végétation qui l’entoure. L’idée, c’est vraiment de traduire une ambiance et un climat, et ça, c’est tout à fait impressionniste. Ce qu’il est aussi, j’y pense, c’est l’inachèvement. On en a parlé avec Manet un petit peu. Regardez ses mains ne sont pas tout à fait abouties, son visage est assez, n’est pas très détaillé, assez simple, alors que la végétation va être beaucoup plus étudiée. Mais on est dans cette idée d’inachèvement aussi impressionniste.
[Illustration : Eugène Durenne, “Nature morte”, avant 1905, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors on va garder cette notion de clarté avec cette petite nature morte de Eugène Durenne. Alors vous voyez qu’on est au tout début du 20e siècle et on est dans ce courant post-impressionniste. Mais qui maintient, qui conserve la clarté de l’impressionnisme, ce caractère fondu, presque duveteux en tout cas, cette palette très pastel. C’est une scène d’intérieur qui est aussi claire que si nous étions en extérieur. Et voyez la nappe qui est comme un jardin fleuri. Les tasses et la théière dont la blancheur est celle de la neige. C’est la blancheur de la porcelaine. Et sur la théière, vous notez les motifs chinois, des personnages. Et puis vous avez ce papier peint derrière qui nous emporte ailleurs. Pourquoi ? Parce que les femmes qui se promènent dans ce papier peint sont en kimono. Donc c’est le nouveau courant artistique à la mode. Ce japonisme qui est porté par la vogue des estampes. Estampes qui circulent beaucoup. Et vous avez également cette perspective écrasée justement, que l’Occident va intégrer et qui nous vient d’Asie. Alors la composition fait la part belle à la clarté. Je l’ai déjà dit. Mais vous voyez le vase sombre. Il vient trancher pour renforcer encore cette clarté et il fait la jonction, je dirais, entre l’heure du thé et puis le voyage en Orient. Puisque on va du bas vers le haut.
[Illustration : Henri Martin, “Beauté”, 1900, peinture]
[Marthe Pierot] : C’est poétique et exotique. En tout cas ça nous donne envie de voyager un petit peu. Alors on va terminer avec un dernier peintre dont on va vous présenter 2 œuvres. La première ici s’intitule « Beauté ». Il s’agit d’Henri Martin. C’est un peintre local et toulousain. On retrouve beaucoup d’œuvres d’Henri Martin au premier étage du Capitole, de la salle du Capitole. Alors c’est un peintre post-impressionniste. Regardez, nous sommes en 1900 on arrive dans le 20e siècle, donc c’est après l’impressionnisme.
Mais c’est un peintre qui va énormément s’intéresser au symbolisme et à l’onirisme. On le comprend très bien ici quand on voit l’ambiance vaporeuse de ce tableau : l’atmosphère de rêve, la couleur violette. Mais nous, ce qui nous intéresse, c’est la touche. La touche qui elle est impressionniste voir pointilliste. On va en parler. Regardez cette touche fine et fractionnée. Cette touche longue enfin très très longue et légère au niveau de la jupe mais qui se transforme en touche, enfin en pointillisme à mesure que l’on remonte au niveau de sa poitrine. Et le pointillisme c’est vraiment ce qui découle de l’impressionnisme dans les années 1880 et on a vraiment cette alternance de touches de couleurs.
C’est un réel jeu optique puisque ce sont ces touches de couleurs l’une après l’autre qui vont créer une couleur grâce à notre œil. C’est ça qui est intéressant. Là ce n’est pas fondu, ce n’est pas mélangé. Et ce qu’on aime bien avec Isabelle, c’est de voir aussi le mouvement de ces touches et de ces petits pointillés. Surtout au niveau du nombril, quand on voit vraiment le cercle que les touches forment. Mais en tout cas on a vraiment une alternance de touches qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon la position ou là où notre notre regard se pose.
[Illustration : Henri Martin, “Etude pour les bords de la Garonne”, 1906, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Et on va vous proposer ici un dernier visuel également d’Henri Martin qui est une étude pour « les bords de la Garonne ». Un tableau qui se trouve, comme le disait Marthe, au Capitole, au premier étage, dans la salle Henri Martin, juste avant la salle des illustres. Vous avez en fait ici et bien un promeneur et notez combien la touche évolue encore. Puisque la touche est plus épaisse. Elle est plus marquée. Elle semble plus efficace, plus moderne. C’est une touche matiériste. On pouvait déjà en parler avec Gustave Courbet parce qu’elle est épaisse. Et si vous voulez, elle est assez proche de celle de Vincent Van Gogh. C’est vrai que ici petit à petit, on avance dans le temps.
[Marthe Pierot] : C’est une belle manière de terminer en ouvrant sur Van Gogh. Et puis on va donc revenir vers vous pour pouvoir conclure ensemble et clôturer cette présentation.
Vraiment, on a tenté avec tous ces tableaux qui appartiennent au musée des Augustins. On a vraiment tenté de vous parler de ces 2 courants qui justement par les sujets qu’ils évoquent, c’est à dire par exemple les gens du peuple pour le réalisme ou la technique qu’ils utilisent, la touche pour l’impressionnisme notamment. Et bien ils vont innover. Comment ces 2 courants innovent. Comment ils marquent le 19e siècle, voir parfois comment ils le choquent.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui parce que ces 2 courants sont très critiqués et la critique justement va se déchaîner. Mais sur ces 2 courants et bien la peinture du 20e siècle va rebondir pour donner le fauvisme, l’expressionnisme mais ça c’est une autre histoire.
[Marthe Pierot] : Tout à fait. On va s’arrêter-là. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivies. Et puis à très vite pour un nouveau sujet. Une nouvelle conférence.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : A bientôt.
[Marthe Pierot] : Au revoir.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Au revoir.
L‘orientalisme
L‘orientalisme
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “L’orientalisme, un ailleurs fantasmé”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2021]
[Marthe Pierot] : Bonjour à tous et à toutes.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bonjour
[Marthe Pierot] : Et merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence en ligne. Donc Isabelle et Marthe, les conférencières du musée des Augustins, et aujourd’hui nous allons vous parler d’orientalisme
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, aujourd’hui nous allons vous parler d’un mouvement, d’un courant artistique qui a été très en vogue au 19e siècle. Mais il évoque davantage un climat plutôt qu’une géographie précise. Et c’est important de dire que l’orientalisme et bien, ça n’est pas tout à fait l’Orient de la carte des géographies. Cet Orient commençait au 19e siècle, quand on en parlait dans les œuvres, il commençait dès le Maghreb. Il incluait l’Égypte, il incluait la Turquie, la Perse, il allait même jusqu’en Inde. Mais c’était important de refaire ce petit point de géographie.
[Marthe Pierot] : Oui, et c’est important aussi de parler de ces relations qui existent entre l’Orient et l’Occident, qui existent depuis très, très longtemps. On connaît les croisades, les nombreux pèlerinages, mais c’est vraiment au 19e siècle que de nombreux bouleversements et événements vont un petit peu changer ces relations. Par exemple l’expédition égyptienne de Napoléon en 1798 ou encore la guerre d’indépendance grecque en 1820 et les colonies qui ne cessent de grandir. Et surtout les français qui pénètrent sur le territoire algérien dès 1831.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Donc à partir de ces données d’ordre politique, c’est vrai que les portes de l’Orient s’ouvrent. Mais déjà dans la littérature et dès le 18e siècle, des gens comme Montesquieu, des gens comme Voltaire avaient déjà parlé de l’Orient. Et puis d’autres écrivains comme Victor Hugo, comme Chateaubriand, vont au 19e siècle évoquer l’Orient et ils vont diffuser des mœurs, des coutumes, des esthétiques tout à fait différentes qui vont véritablement fasciner.
[Marthe Pierot] : Mais parfois ils vont diffuser des coutumes, mais un petit peu exagérer. Justement, on s’approche du cliché, on on va le voir ensemble. Parfois on va s’approprier un petit peu cet exotisme, idéaliser cet ailleurs, le fantasmer. Et donc on a des représentations qui vont vraiment nous dire finalement comment les occidentaux voient l’Orient en fait, avec quel regard ils regardent cet ailleurs finalement et qui est plus ou moins juste et qui est finalement très souvent sous le prisme du regard blanc et colonial
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bien sûr. Alors nous allons commencer avec donc une dizaine d’œuvres du musée
[Marthe Pierot] : Et on fait un petit partage d’écran.
[Illustration : Antoine de Favray, “ Dames Levantines ”, 1764, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Et je vous propose de commencer avec ce tableau intitulé « Dames Levantines ». C’est un tableau qui s’intitule également « Dames en coiffure d’intérieur » ou encore « Femmes turques ». Voyez cet élément, cet adjectif turc, ça me fait penser, on en parlait avec Marthe. Voyez Mozart au 18e siècle qui va écrire la marche turque. Et d’ailleurs, dès qu’on avait des éléments, des arguments orientaux dans les tableaux, on parlait de turqueries. Alors le peintre, pour en revenir à lui, Favray, est un homme qui a vécu à Malte et qui a pu justement avoir cette expérience de l’Orient. Dans le titre du tableau « Dames Levantines », il est question de ce levant. Le levant fascine. Le Levant, ce sont les contrées situées là où le soleil se lève. Et vous avez également un cadrage très intéressant ici puisque les personnages sont à mi-corps, ce qui permet une proximité avec ces femmes. L’ambiance qu’elles nous proposent est donc un monde clos, un monde coupé du monde extérieur. Ces femmes sont entre elles, elles sont dans une intimité, dans une atmosphère de langueur et d’amitié, je dirais. Donc c’est une scène de genre. Et voyez les parures, regardez les boucles d’oreilles, les pierreries dans les turbans, les colliers, les ceintures serties de diamants. Vous voyez cette femme en blanc qui peut être une mariée apprêtée pour le jour de ses noces. Ces femmes sont très apprêtées, cependant elles ne sortent pas. Et ce monde étrange, ce monde différent, ce monde qui a des codes tout autres bien sûr, intriguent beaucoup l’Occident.
[Illustration : Ernest Bordes, “ La robe turque ”, vers 1911, peinture]
[Marthe Pierot] : Oui. Et on reste un petit peu dans cette même lignée, même si là on arrive au début du 20e siècle, parce que le tableau d’avant était bien sûr antérieur. On a quand même cette idée d’intérieur, cette femme qui est présente, face à nous et qui porte un vêtement tout à fait oriental. Donc c’est un tableau qui est réalisé par Bordes, qui est un peintre né à Pau. Et ici tout est dans le costume, même le titre. On appelle ce tableau « La robe turque ». Donc vraiment on nous parle de ce vêtement là, de ce turban, de ces babouches aux pieds ou de ce pantalon qui ressemble à un sarouel, de ces couleurs, de ces étoffes qui sont vraiment à l’orientale, mais qui sont portées par une femme blanche, occidentale, européenne. Donc finalement elle n’est pas orientale, mais elle s’habille à l’orientale, parce que c’est la mode, et on aime porter ses vêtements comme un costume finalement. Et c’est de ça dont le peintre veut nous parler. Comme on a dit, le titre parle de la robe, pas de cette fille. On ne connaît pas son nom, son identité, on ne sait pas qui elle est, ce qu’elle fait. Ce c’est un petit peu comme une figure de fantaisie au 17e siècle finalement. Tout ce mystère qui plane autour de cette jeune fille qui nous regarde et dont rien autour ne vient perturber ce face à face et ce regard. Il y a juste un fauteuil et des coussins sur lesquels elle est assise. Donc on comprend qu’elle est à l’intérieur. Mais rien d’autre ne vient perturber notre regard, son regard magnétique. Elle occupe tout l’espace et ses vêtements et ses couleurs nous parlent de l’Orient, même si elle ne l’est pas.
[Illustration : Fernand Cormon, “La mort de Ravana”, vers 1875, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors on va passer à tout à fait autre chose avec le tableau suivant, puisque c’est un tableau, donc de grands formats et à multiples personnages. Il s’agit de « La mort de Ravana ». Le peintre Cormon est un peintre qui a été l’élève de Cabanel. Cabanel qui est un peintre de Montpellier et Cormon est un peintre à Paris qui va dans son atelier accueillir des gens comme Van Gogh ou Lautrec. Ce qui n’est pas rien. Donc Cormon lui va voyager en Tunisie et va cependant ici nous parler d’un Orient qui est extrêmement lointain puisque on est ici en pleine mythologie indienne. Il est question de ce Ravana qui est cet homme mort au sol. Qui est cet homme arrogant qui est devenu le roi du Sri Lanka. Mais son poste de roi est tout à fait remis en cause et il va être destitué. Et si vous voulez ici, c’est son agonie et on le voit ici entouré de toutes ces femmes et c’est l’occasion d’une débauche de corps allanguis. Vous avez un caractère érotique et morbide à la fois. Cet homme qui finalement nous propose une image de polygamie orientale avec toute cette diversité de femmes qui sont ses favoris, qui sont ses esclaves, mais qui sont des objets sexuels. C’est véritablement le prétexte à montrer des femmes blanches ou des femmes noires en tout cas des femmes dévêtues dont les seins et les hanches sont tout à fait montrés. Et là aussi, cet argument orientaliste, c’est l’utilisation des bijoux. Vous avez en fait ici des étoffes, mais de lourds bijoux qui viennent habiller ces corps. Donc le roi est vaincu, c’est une défaite, c’est une veillée funèbre également et c’est un tableau qui existe parce que un précédent existe. Et ce précédent, c’est Marthe qui vous en parle à présent.
[Illustration : Eugène Delacroix, “La mort de Sardanapale”, vers 1827, peinture]
[Marthe Pierot] : Oui. Ce tableau n’aurait pas pu exister si celui-ci n’avait pas vu le jour non plus. C’est un tableau réalisé par Eugène Delacroix qui a clairement inspiré Cormon. Alors on vous le précise, c’est un tableau que nous n’avons pas au musée des Augustins, il est au Louvre. Mais c’était important pour nous de faire juste un petit aparté et de vous en parler rapidement parce qu’on comprend tout à fait l’influence. Parce que si vous avez encore l’autre tableau en tête, et bien on voit la ressemblance quant aux couleurs, à la dramatisation, la théâtralisation de la scène, à ces corps vraiment dénudés. Cet orientalisme, cette composition vraiment assez similaire. Et le sujet aussi. Là on parle de la mort de Sardanapale. Nous ne sommes plus en Inde, mais plutôt dans ce qu’on dirait aujourd’hui l’Irak, à Mossoul, à cet endroit là. Et donc on parle de la fin tragique de ce roi qui voit son pouvoir lui échapper et qui préfère se donner la mort plutôt que de subir l’humiliation de sa défaite. Donc il organise un bûcher collectif où il va brûler son palais, son or, ses chevaux, ses esclaves, ses femmes. Tout doit brûler avec lui pour que rien ne tombe dans les mains de son ennemi. Alors lui paraît tout à fait serein, mais on voit la panique qui se déploie autour de lui. Et puis on a encore l’argument oriental, avec tous ses bijoux, ses dorures, ses parures, ces femmes nues, mais qui ont bien sûr des bracelets aux mains, aux pieds. Et puis un détail qu’on adore avec Isabelle, regardez ce lit, les têtes d’éléphant au pied du lit qui sont probablement un or massif. Là on est en plein dans l’exotisme.
[Illustration : Eugène Delacroix, “Moulay Abd-er-Rahman, Sultan du Maroc”, vers 1845, peinture]
[Marthe Pierot] : Et donc on n’a pas ce tableau Eugène Delacroix, mais nous avons quand même un tableau d’Eugène Delacroix au musée qui est celui-ci qui va nous permettre un petit peu de parler en fait de la vie de Delacroix, parce que c’est un peintre qui a fait le voyage. Il est allé en Afrique du Nord et on a quelque chose d’assez réaliste finalement dans les toiles qu’il a représentées par la suite. Pendant 7 mois, il va accompagner la grande mission diplomatique du roi Louis Philippe auprès du Sultan du Maroc. L’idée en fait, c’est d’apporter un message de paix au Sultan. Et donc lui, il va accompagner cette délégation avec son petit carnet de croquis et tel un photoreporter finalement et bien, il va essayer de rendre compte un petit peu de tout ce qui se passe, des paysages, des situations. Il va peindre énormément d’aquarelles qui vont lui inspirer beaucoup de toiles orientalistes quand il rentrera en France dont celle-ci. Et donc il va voyager, il voit ce pays, il réalise ses aquarelles et c’est pour ça qu’on a quelque chose de très réaliste au niveau des couleurs et au niveau de l’ambiance. Regardez cette unité chromatique, ces tons ocres très harmonieux et à la fois ce jeu de couleurs complémentaires. On a le bleu qui fait ressortir justement l’architecture du palais de Meknès. Mais on a aussi le rouge qui est complémentaire du vert. Voilà, on a le cheval qui est bleu aussi. Donc on a vraiment quelque chose de très riche et de très recherché au niveau des couleurs, mais de très juste et de très réaliste aussi parce qu’il y est allé. Donc ce tableau politique est important, mais c’est aussi important pour nous de vous préciser que Delacroix a fait ce voyage. C’est un des premiers à le faire et il va inspirer aussi d’autres peintres, notamment Benjamin Constant.
[Illustration : Benjamin Constant, “Entrée du Sultan Mehmet II à Constantinople”, 1876, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bien sûr, parce que le tableau qui suit, vous voyez la filiation, c’est à nouveau un palais. C’est ce bel arc qui vient nimber les personnages et c’est un peu le même argument que précédemment. Benjamin Constant, c’est un peintre d’origine toulousaine qui va cependant faire carrière à Paris. Mais c’est quelqu’un qui va ici nous proposer un tableau d’histoire, un tableau qui est lourd de sens puisque il s’agit de cette ville de Constantinople qui va cesser d’être un bastion chrétien puisque vont y triompher les turcs ottomans. Donc au sol, vous distinguez ces évêques et ces prêtres morts couchés alors que debout ou à cheval, en tout cas triomphant, vous avez ces turcs ottomans qui prennent la ville de Constantinople.
Regardez comme ils sont nimbés par l’arc de la porte. Et vous avez ici vraiment un orientalisme qui est guerrier, qui est viril, qui est presque épique, qui est porté aussi par un format extraordinaire. Sachez que ce tableau fait plus de 7 mètres de hauteur. Alors la séduction de ce tableau, c’est la force effectivement, des couleurs comme tout à l’heure chez Delacroix. Vous avez cette force du ciel bleu très intense et les dorures des vêtements. Vous avez des couleurs tout à fait éclatantes. Regardez ce drapeau orange sur lequel s’inscrit ce drapeau émeraude terminé par le croissant qui nous dit le monde musulman. Si vous voulez, il y a certainement des déformations parce que ces guerriers sont habillés comme des soldats d’opérettes. Des guerriers devraient être sales ou poussiéreux. Ici ils sont impeccables donc il y a quelque chose qui est un petit peu de l’ordre des effets spéciaux qu’on pourrait retrouver dans des films en Technicolor avant l’heure. Mais c’est vrai que ce tableau saturé, très encombré, frappe fort. Benjamin Constant a envie de nous parler vraiment de la fin d’un monde ou de la fin d’une hégémonie qui va faire la place à une autre.
[Marthe Pierot] : Oui, et c’est important de faire un petit point géographique aussi. Constantinople, c’est la ville d’Istanbul aujourd’hui. Voilà, c’est faire un petit rappel. Et ce qui est vraiment intéressant, c’est quand on a encore le tableau de Delacroix en tête, c’est de voir la différence entre quelqu’un qui a fait le voyage, qui a vu et peint des aquarelles et Benjamin Constant qui évidemment n’était pas là au moment de cette prise de Constantinople, et donc qui fantasme un peu et exagère, comme vous l’a très bien expliqué Isabelle.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Voilà, parce que c’est vrai que cette prise de Constantinople a eu lieu en 1453. Nous sommes à la fin du 15e siècle. Et c’est une date bien sûr charnière pour l’histoire du monde.
[Illustration : Benjamin Constant, “Cour de l’Alhambra”, 1880, peinture]
[Marthe Pierot] : Oui, oui, alors on sort un petit peu de ce contexte historique pour parler de quelque chose, d’un petit peu plus doux et léger, ça fait du bien. Voilà et beaucoup plus petit aussi. Tableau réalisé par Benjamin Constant également, mais cette fois-ci on est sur un petit format, on est sur quelque chose d’intime. Il fait à peu près 50 sur 40 centimètres. Mais parce qu’il nous parle aussi d’une architecture, d’une ambiance, le sujet est tout à fait différent. Là, nous sommes en Andalousie, plus exactement à Grenade, et encore plus exactement dans le palais de l’Alhambra. Ce grand palais des rois de Grenade qui est tout à fait spectaculaire et qui représente très bien l’architecture mozarabe qu’on trouve vraiment au sud de l’Espagne. Ça, c’est pour vous rappeler aussi la présence musulmane qu’il y a eu pendant très longtemps en Espagne entre le 8e et le 15e siècle, et dont on reconnaît cette coupole vernissée, ou alors ces arcades avec ces stucs détaillés ou ces couleurs chaudes qui représentent enfin qui nous rappellent en tout cas une architecture arabe. Alors on est dans cette cour du palais de l’Alhambra. On a l’impression d’avoir un tableau esquissé finalement.Furtivement peint. Et pourtant les couleurs sont très très recherchées. Regardez, il y a des nuances de rose orangée tout à fait charmantes qui sont parsemées de touches vert émeraude avec le bassin ou l’oranger sur la droite. Donc il y a un jeu et un camaïeu de couleurs qui est extrêmement fin et étudié, et puis une atmosphère vaporeuse, une atmosphère de rêve vraiment tout à fait agréable. Et puis ce patio, cette cour est vide. Donc on imagine peut être parce qu’on le sait en Espagne il fait chaud. On imagine peut être qu’il fait très très chaud dans cette cour. Donc les personnes sont parties s’abriter à l’ombre. Mais on imagine aussi qu’il y avait quelqu’un il y a peu de temps. Parce que regardez, sur le premier plan, vous avez ce tapis ou cette étoffe qui est posée là au bord du bassin. Peut être qu’une femme était assise là il y a quelques secondes et puis elle a été appelée et elle est partie hors du cadre et donc il n’y a plus personne. Mais ce tapis nous parle d’une absence, d’une présence qui a disparu. Voilà.
[Illustration : Jan-Baptist Huysmans, “Café arabe”, après 1851, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors on va continuer avec cette atmosphère de tranquillité puisque nous voilà ici avec le café arabe face à une toile de Huysmans qui est un peintre orientaliste belge. Ce peintre a beaucoup voyagé, au Maghreb, en Grèce, en Égypte et même en Asie. Et c’est vrai qu’il sait de quoi il parle. Ici, il nous propose un monde d’hommes, un monde où femmes et hommes ne se mélangent pas, un monde qui exclut les femmes. Et les activités sont paisibles, strictement masculines. Quelles sont-elles ? Regardez, vous avez ce personnage à droite qui est en train de fumer cette longue pipe qu’on appelle sebsi. Et puis il est en train regardez à la main, de boire un café qu’on imagine très fort. Il est vêtu tout à fait à l’orientale puisqu’il porte ce sarouel, et ce pantalon large et cette cape-manteau, ce burnous. Il a un pied chaussé, l’autre pas, ce qui peut nous rappeler cette habitude de se déchausser quand on rentre à l’intérieur. Et puis il y a ce mobilier également exotique avec ce petit banc qui est à la fois bleu et rouge, donc de couleur très vive. Et enfin il y a cette nonchalance que l’on perçoit très bien. Il y a ce jeu de cartes au fond qui occupe ces hommes dont le regard est baissé. Ces hommes concentrés et à l’intérieur de cette pièce sombre, on aperçoit des coupelettes qui sont en fait très à l’orientale, puisqu’on imagine qu’elles sont remplies d’une huile où flotte une mèche. Donc si vous voulez ici on est dans un décor très ciblé. On est dans une scène de genre qui nous fait véritablement voyager.
[Illustration : Jean André Rixens, “La mort de Cléopâtre”, 1874, peinture]
[Marthe Pierot] : Oui. Et alors on change tout à fait de registre quand on vous présente ce tableau-là, évidemment beaucoup moins calme, un peu plus dramatique réalisé par Rixens qui est un peintre de Saint-Gaudens. Alors son père était cordonnier, mais lui devient grand peintre, un peintre d’histoire et il gagne notamment le premier prix d’anatomie. Et quand on voit ce tableau, on le comprend tout à fait. Alors là, il nous parle de l’histoire égyptienne. On est au 19e siècle, et à cette époque là l’Égypte fascine, on parle même d’égyptomanie. On comprend bien et on imagine bien que l’histoire de Cléopâtre fascine également l’imaginaire collectif. Voilà, on aime entendre parler de cette reine d’Egypte qui meurt tragiquement 30 ans avant notre ère. Et c’est cette scène là que Rixens nous présente, « La mort de Cléopâtre ». Donc on est en Égypte, on le comprend même un peu trop parce que les décors ou le décor est exagéré. Les couleurs sont saturées, on a l’impression d’avoir un décor cinématographique un petit peu. Isabelle parlait de Technicolor avec Benjamin Constant. On retrouve un petit peu cette surcharge colorée et décorative ici. Et bien, il faut savoir que Jean André Rixens, le peintre n’a absolument pas voyagé. Lui, il puise son inspiration à travers la littérature d’autres peintres et surtout à travers les collections du Louvre où il y avait des bronzes ou des collections égyptiennes qui l’ont inspiré. Regardez tout au fond, on a en fait une statue d’Isis en bronze, donc il a peut être vu un modèle au Louvre. Et alors qu’est ce qui fait égyptien aussi ? Et bien, les hiéroglyphes sur le mur du fond, mais aussi, ce faucon ailé émaillé de bleu, symbole de l’Égypte. La colonne à droite avec la fleur de lotus, la peau de bête au sol, et puis bon, la position d’une des servantes qui a une position un petit peu très pharaonique. Les épaules de face, la tête de profil, voilà, on a tous ces codes un petit peu égyptiens qui sont peut être un petit peu trop dans l’exagération tendue. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c’est de parler donc de de cette histoire et de cette Reine. Alors Regardez son bras guide de notre regard vers le panier de figues. Donc pour nous rappeler l’histoire, c’est ici que le serpent s’était glissé pour mordre la Reine Cléopâtre. Et elle est complètement nue. Donc il a gagné le premier prix de l’anatomie. Il sait peindre un corps nu, certes, mais il souhaite nous parler de cette femme nue qui reste finalement désirable dans la mort. Donc là aussi, il y a une sorte d’érotisme un peu morbide qui pourrait être dérangeant. Parce que voilà, on a vraiment cette exposition du corps nu de de cette reine sous nos yeux et qui en plus répond parfaitement aux canons des femmes du 19e siècle blanches. Et on ne sait pas si Cléopâtre était comme ça, mais en tout cas au 19e siècle, on aimait voir les femmes comme ça. Donc voilà finalement l’histoire de Cléopâtre, la grande histoire, est souvent un prétexte pour réaliser des nus féminins très érotiques ou pour étudier le nu.
[Illustration : Edouard Debat-Ponsan, “Le massage”, 1883, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Je suis tout à fait d’accord. Et cette peau laiteuse on la retrouve dans le visuel qui suit. En fait, on retrouve ce nu allongé cette fois sur le ventre et non plus sur le dos. Et on s’aperçoit aussi que l’ambiance est différente puisque, Marthe vous proposait des couleurs chatoyantes et chaudes, ici on est dans un ensemble de couleurs beaucoup plus froides. Vous voyez ce bleu, ce blanc et ce gris. Donc ici, il est question d’un tableau intitulé « le massage ». Le peintre Debat-Ponsan est un peintre qui s’est essayé une seule fois dans sa vie à l’orientalisme, parce que c’était beaucoup plus un peintre finalement de tableau en extérieur dans l’esprit du début de l’impressionnisme. Mais ici c’est un coup de maître, même si c’est un coup isolé. Intéressant de dire que de Debat-Ponsan, c’est quelqu’un qui est le grand-père de Michel Debré, qui était un ministre du Général De Gaulle, également le grand-père d’Olivier Debré qui est un peintre abstrait très important au 20e siècle, et il est également l’arrière grand-père de Jean-Louis Debré, un autre homme politique qu’on connaît un petit peu mieux, qui est plus proche de nous. Quelle filiation. Mais revenons à notre tableau et à cette atmosphère, cette ambiance de hammam. Le décor est planté. Le dépaysement, je pense est immédiat. On est dans ce monde, voyez de céramique bleue, de fontaine de marbre blanc. Et vous avez également ces détails, cette serviette d’éponge à l’extrême gauche à côté de cette coupelle de cuivre qui luit. Donc on est dans un monde secret, un monde qui est interdit aux hommes. Et la nudité, tout à fait évidente donc du modèle féminin, fait de nous des voyeurs, parce qu’on n’a pas le droit d’être là, mais on y est quand même. Ce qui alimente évidemment le fantasme des occidentaux dans tous ces rituels autour du bain et du massage. Alors maintenant, la composition est tout à fait intéressante parce qu’on note des axes très marqués. Vous voyez le côté horizontal de ce corps blanc et la verticalité du corps noir. Et également l’abandon de cette femme blanche. Et le côté très actif de cette femme noire qui travaille, qui est puissamment musclée. Regardez ses épaules et ses bras. C’est un tableau qui fonctionne sur l’opposition. Ces 2 femmes évoluent dans 2 mondes qui sont différents. Mais là il y a la rencontre et le point de rencontre se fait par la peau de ces 2 femmes. Et ce rapprochement, bien sûr nous trouble.
[Illustration : Jean Rivière, “Théodora”, vers 1891, sculpture]
[Marthe Pierot] : Oui, c’est très joliment dit. Et nous quittons la peinture pour arriver à une sculpture qui sera notre dernière œuvre, réalisée par Jean Rivière. Donc un artiste qui vient du Tarn et qui est un artiste multiple. Il est peintre, sculpteur, céramiste, ébéniste et il nous propose ici un plâtre doré. Alors regardez, il n’y a pas de socle ni de base. En fait, c’est un plâtre qui est destiné à être suspendu à un mur. Et ce plâtre nous parle d’une femme, une femme qui se nommait Théodora qui était une impératrice byzantine au 5e et 6e siècle. Alors elle est beaucoup moins connue que Cléopâtre. Mais pourtant c’était une femme de caractère, avec vraiment un tempérament très affirmé et qui a fait beaucoup de choses. Alors sa jeunesse est incertaine. On raconte qu’elle serait la fille d’un dresseur d’ours et d’une danseuse. C’est un petit peu flou, mais ce qu’on sait, c’est qu’elle va épouser Justinien, qui lui, sera le dernier grand empereur de Rome. Et en fait, elle épouse ce Justinien qui lui n’a pas beaucoup d’ambition en tout cas, qui n’a pas une force de caractère très très très reconnue. En revanche elle oui et donc finalement elle va être vraiment être associée à cet empereur là et elle va même être la première impératrice femme qui est officiellement associée aux décisions. Vraiment, donc ça c’est très très important à cette époque là, pour une femme. C’était la principale conseillère de Justinien et elle était reconnue officiellement comme telle. Donc c’est dire aussi l’influence qu’elle pouvait avoir et le caractère qu’elle avait. Alors au 19e siècle, elle fascine quand même, et elle est très très populaire, Théodora. On la retrouve dans la littérature, au cinéma et au théâtre, notamment parce que Sarah Bernhardt va jouer une Théodora dans la pièce de Victorien Sardou de 1884. Donc voilà, on a vraiment cette femme qui devient connue. On ne connaît pas son visage, mais justement Jean Rivière, lui, va s’inspirer des traits de Sarah Bernhardt pour réaliser cette Théodora. Et puis on a une coupe de cheveux ou une coiffure qui est tout à fait 1900. Voilà, c’est intéressant alors qu’on n’est pas du tout au 5e siècle finalement. Mais on retrouve quand même cet orientalisme parce que le plâtre est entièrement doré, et puis la couronne en casque sertie de pierres précieuses, on a tous ses bijoux. Et regardez ses boucles d’oreilles, elles sont incroyables ces boucles d’oreilles qui tombent jusqu’à ses épaules et qui se terminent en petit disque. Donc ça c’est tout à fait fascinant. Et on a évidemment cette auréole derrière, tel un soleil qui montre que cette femme rayonnait mais aussi parce qu’elle était une sainte. Donc on a, voilà vraiment tous ces accessoires autour d’elle qui nous disent son importance. On a quand même son mari qui est tout en bas, en petit, mais c’est elle qui domine sur cette sculpture évidemment.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors messieurs dames, on va donc à présent revenir vers vous. On va couper ces visuels puisque on va donc vous proposer une petite conclusion. Et en nous retrouvant, vous pouvez donc constater que Marthe est votre Théodora au musée, étant donné que ces boucles d’oreilles n’ont rien à envier à Théodora, le buste dont on vient de parler.
[Marthe Pierot] : C’était un peu calculé. Je vous le dis honnêtement. Alors on avait vraiment envie, en tout cas à travers ces 10 visuels du musée des Augustins, plus un du Louvre, de vous parler de ces différentes représentations qui nous parlent d’un Orient ou réaliste ou imaginaire, parfois documenté, parfois fantasmé, cela dépend vraiment des artistes qui peignent ces œuvres, ou qui sculptent ces œuvres en fonction de la vision qu’ils ont de l’Orient. Mais on le rappelle qui est souvent une vision occidentale, coloniale aussi à cette époque là et donc ça influe vraiment le rapport qu’ils ont avec l’Orient.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, mais à force d’Orient, d’Orientalisme, d’approximation et de déformation, finalement le sujet se tarit un petit peu et il va y avoir une nouvelle évasion, un engouement tout à fait nouveau, un nouveau coup de cœur, je dirais encore plus étrange pour une contrée encore plus lointaine, j’ai nommé le Japon. Et le courant qu’on appelle le japonisme va donc fasciner. Les estampes qui circulent abondamment vont le faire découvrir et ce sera la nouvelle tendance.
[Marthe Pierot] : Et remarquez japonisme, orientalisme, on a tous ces mouvements qui se terminent en isme en histoire de l’art. Mais ce qui est intéressant c’est de se dire comment un mouvement en chasse un autre. Quand on est lassé finalement quand il y a l’épuisement d’un sujet et qu’il est passé de mode, et bien un autre surgit.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Un autre prend la place.
[Marthe Pierot] : Voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivi.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Merci à vous.
[Marthe Pierot] : Voilà et on se retrouve très bientôt pour une…
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Une nouvelle conférence
[Marthe Pierot] : Voilà sur un nouveau sujet.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : A bientôt
[Marthe Pierot] : Au revoir.
Art roman et art contemporain
Art roman et art contemporain
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Trésors romans et audace contemporaine”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2021]
[Marthe Pierot] : Messieurs dames, bonjour.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bonjour
[Marthe Pierot] : Et merci de nous retrouver pour cette conférence en ligne. Isabelle et Marthe, les conférencières du musée des Augustins et aujourd’hui, nous allons vous parler d’un très beau sujet, « Trésors Romans et audace contemporaine ». On vous en parle tout de suite.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Depuis mai 2014, vous pouvez voir donc au musée des Augustins, dans la salle romane, cette installation Jorge Pardo. Et attention les yeux, c’est véritablement une audace colorée. Un pari un petit peu fou, celui de donner une nouvelle vie à ce bel espace qu’est la salle romane. C’est une petite révolution, mais l’idée de créer un dialogue entre l’art ancien et l’art contemporain, ça, c’était une très belle idée.
[Marthe Pierot] : Exactement. Et cet art ancien dont vous parle Isabelle et bien il s’agit de la collection romane du musée des Augustins. Alors l’époque romane au Moyen Âge se situe entre le 11e et le 12e siècle, à partir de l’an 1000 on va dire, et c’est une époque extrêmement importante pour la ville de Toulouse. Pourquoi ? Et bien parce qu’à ce moment-là Toulouse est un centre de pèlerinage phare avec Saint Sernin et c’est une étape des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et en plus, et surtout parce que Toulouse n’est pas en France à l’époque romane. Toulouse, c’est la capitale d’un comté indépendant. Alors les comtes de Toulouse vont justement chercher à faire de cette ville une véritable vitrine du monde. Donc le contexte à cette époque est très favorable au développement et à l’éclosion d’un art original qu’est l’art roman et l’art des chapiteaux.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors la collection qu’on va vous montrer, c’est une collection qui est unique au monde et qui provient de 3 cloîtres romans. En fait, Toulouse est un des foyers les plus importants du monde roman. Et on va avoir une ville qui est le théâtre de 3 chantiers importants. Il y a celui du monastère de la Daurade, il y a celui de Saint Sernin et il y a celui de la cathédrale Saint-Étienne. Et c’est dans cet ordre là que nous allons vous en parler. Les cloîtres aujourd’hui sont détruits suite à la Révolution française. Et quelques chapiteaux subsistent, ils ont été sauvés in extremis.
[Marthe Pierot] : Et on en est ravis. Alors pour vous donner une définition rapide du chapiteau, parce qu’on va beaucoup en parler, et bien c’est vraiment cette partie supérieure de la colonne, un petit peu comme une tête, on les voit un petit peu derrière nous, mais on va les voir bien sûr en photo et en fait cette partie permet de soutenir l’architecture dans le cloître, de faire le lien entre la colonne et la toiture, mais elle permet aussi, cette partie en pierre d’avoir et de supporter un décor sculpté. Alors on va faire notre petit partage d’écran.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Nous allons passer à nos visuels et nous vous rappelons que ça va se passer en 2 temps. Premièrement, on parle des œuvres romanes. Deuxièmement, on parlera de Jorge Pardo.
[Illustration photographique, salle romane et vue générale sur les chapiteaux et l’installation Jorge Pardo]
[Marthe Pierot] : Donc là vous avez la salle avec les chapiteaux au-dessus des colonnes.
[Illustration vue du monastère Notre Dame de la Daurade au XIIe siècle]
[Marthe Pierot] : Et nous commençons avec le monastère Notre-Dame de la Daurade. Où ici vous avez donc un dessin qui propose une reconstitution du monastère pour comprendre comment il était au 12e siècle. Donc là nous sommes à l’actuelle place de la Daurade, vous savez juste en face de la Garonne. Aujourd’hui, sur cette place qui est beaucoup plus vide, vous pouvez voir une église, mais qui elle date de la fin du 18e siècle. Mais au 12e siècle, on avait ce monastère qui abritait les moines bénédictins, et on voit le cloître qui se trouve justement avec la souris. On peut voir cette cour carrée ici avec toutes les colonnes autour, au-dessus, il y a les chapiteaux. Et bien ce cloître, il a été décoré par plusieurs ateliers tout au long du Moyen Âge. Au fil des années plusieurs tailleurs de pierre se sont succédés et ont décoré les chapiteaux dont le premier atelier est clairement influencé par Moissac d’ailleurs.
[Illustration : “Daniel dans la fosse aux lions”, entre 1100 et 1110, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Exactement. Donc nous allons parler de ce premier atelier ici avec « Daniel dans la fosse aux Lions ». Vous avez un caractère plutôt statique des personnages. Vous voyez le personnage de Daniel au centre qui est très droit, qui semble dire haut les mains. Vous voyez, en tout cas, vous avez un chapiteau qui est historié, c’est à dire qu’il vous raconte une histoire. Et le sujet est édifiant. Il raconte le miracle de Daniel qui n’a pas été dévoré par les bêtes féroces qui l’entourent. En fait, il a été condamné pour une faute qu’il n’a pas commise. Il est jeté dans une fosse et il n’est pas dévoré. Donc il est l’exemple même de l’homme juste, de l’homme pieux. Il est ce modèle pour les fidèles. Donc les chapiteaux racontent des histoires, souvent bibliques, un petit peu comme une bande dessinée en pierre, et les chapiteaux sont des supports qui sont à hauteur des yeux pour édifier le fidèle. Il y a la volonté de lui enseigner la Bible. C’est un véritable catéchisme et c’est vrai que les fidèles pouvaient régulièrement rentrer dans les cloîtres pour les regarder. Il n’y avait pas que les moines qui pouvaient les consulter, les fidèles, certains jours de l’année, certains jours de l’année liturgique pouvaient le faire.
[Illustration : “La course au saint sépulcre de Saint Pierre et Saint Jean”, entre 1126 et 1150, sculpture]
[Marthe Pierot] : Oui alors on continue, on est toujours dans le même cloître monastère Notre-Dame de la Daurade pour vous présenter un autre chapiteau qui lui a été sculpté plus tard. Il appartient à ce qu’on pourrait appeler le 2e cycle. Donc d’autres sculpteurs qui sont intervenus pour décorer le cloître et on le comprend alors c’est à peu près une quinzaine d’années plus tard. Mais on le voit tout à fait parce qu’il y a une réelle différence par rapport au chapiteau dont vient de vous parler Isabelle. Ici, il y a beaucoup plus de détails, de mouvement, de dynamisme, de profondeur et on a une histoire qui fait tout le tour et qui prend toute la place sur la corbeille. La corbeille, c’est cette partie qu’on va sculpter et qu’on a justement sous les yeux dans le chapiteau. Alors ici, c’est l’histoire de Jean qui est racontée. Parce que, après avoir été averti par Marie Madeleine, il court pour voir et découvrir le tombeau du Christ vide. On le comprend. Le tombeau est parfaitement creusé, donc on voit qu’il est vide. Et puis on comprend justement la sidération de Jean, parce qu’ici c’est le corps qui nous parle. Il n’y a pas vraiment d’expression sur le visage, mais c’est toute la gestuelle qui est signifiante. Il lève la main grande ouverte. Main qui est surdimensionnée tout comme ses yeux en amande pour qu’on comprenne bien son geste et son étonnement. Et cette scène fait vraiment écho au témoignage capital, dans la foi catholique qui dit concernant Jean, il vit, il crut comprend tout à fait ici. On a également un petit fond en gaufrage juste au-dessus du tombeau qui peut être nous rappelle finalement les mosaïques dorées qui se trouvaient au monastère de la Daurade, d’où son nom d’ailleurs. Et puis il permet aussi de modeler la lumière, ce fond en gaufrage, pour justement créer du dynamisme dans le décor.
[Illustration (autre face du chapiteau) : “La course au saint sépulcre de Saint Pierre et Saint Jean”, entre 1126 et 1150, sculpture]
[Marthe Pierot] : Donc si on tourne un petit peu dans le chapiteau, donc on voit vraiment à quel point l’histoire prend de la place. On a vraiment Jean qui se trouve derrière une colonne, c’est très habile. Et puis on a ce buste de face, cette tête de 3/4, les jambes de profil, le genou fléchit et bien on comprend tout à fait son mouvement, surtout quand on observe son vêtement qui vraiment semble s’envoler par le vent derrière. Ici pour justement montrer la course de Jean, donc c’est très adroit, c’est très dynamique. Voilà, on est vraiment au cœur l’art roman ici.
[Illustration : “Sirène se coiffant entre un centaure et un chasseur”, fin XIIe siècle, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors on va regarder un autre chapiteau qui est différent puisque ici, il s’agit d’un autre atelier. Quelques années ont passé, nous sommes toujours au 12e siècle, mais on se rend compte que les artistes artisans étaient des équipes qui changeaient. Et le style en est tout différent. Donc ici il est question de sirène. D’une sirène qui se coiffe au centre entourée par un chasseur à gauche et à droite par un centaure. Donc il est à noter que ce chapiteau est positionné sur des colonnes jumelles. Et que vous avez des personnages isolés. Il n’y a plus de narration, il n’y a pas véritablement de lien, même si on peut en trouver un entre les personnages. Il y a la volonté de vous dire que chacun exprime quelque chose d’important. En fait, les 2 personnages de droite, la sirène et le centaure, sont véritablement ce qui nous intéressent puisque en fait, ce sont des personnages qui ont un sens qui représentent 2 exemples à ne pas suivre. La sirène au centre représente la luxure, tandis que sur la droite, le chasseur, pardon, le centaure représente en fait l’absence de maîtrise de soi. Le centaure fait n’importe quoi, il est ivre en permanence. Donc si vous voulez, revenons à notre sirène, puisque j’ai dit qu’elle était le symbole de la luxure et de la séduction. Il est important de dire que ces personnages ont une grosse charge morale. En fait, ils sont ceux qu’il ne faut pas être, et c’est pour ça qu’on va les montrer avec insistance.
[Marthe Pierot] : Alors ce sont des personnages de l’Antiquité, mais cette sirène qui est une femme poisson n’est pas tout à fait une sirène de l’Antiquité.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Je suis bien d’accord avec toi Marthe, dans la mesure où à l’époque antique, la sirène est une femme ailée. Une femme oiseau, mi-femme mi-oiseau. Alors qu’on va rentrer vers le 8-9e siècle et son personnage va se modifier, se métamorphoser pour devenir une femme poisson.
[Illustration vue de l’abbatiale Saint Sernin au XIIe siècle]
[Marthe Pierot] : Voilà ça c’est la petite anecdote exactement, on change de lieu, nous arrivons à Saint Sernin là on a aussi sous les yeux un dessin qui représente l’abbatiale de Saint Sernin au 12e siècle. Alors on parlait d’abbatiale au Moyen Âge pour justement mettre en valeur l’abbé qui s’y trouvait. Aujourd’hui on connaissait Saint Sernin sous le nom de basilique. Les basiliques, ce sont ces églises remarquables qui ont une valeur commémorative. Et bien c’est le cas pour Saint Sernin puisqu’elle abrite le tombeau de Saint Saturnin, premier évêque de Toulouse. Alors Saint Sernin, c’est important de le savoir. C’est la plus grande église romane en France encore debout donc elle est extrêmement célèbre. Bien sûr, elle a été construite à partir de 1070.
[Illustration : “Rameaux”, entre 1120 et 1140, sculpture]
[Marthe Pierot] : Alors pour les chapiteaux, et bien là on va voir la différence. Là à Saint Sernin on n’a que des chapiteaux feuillagés ou animaliers. Il n’y a pas d’histoire biblique, ni de leçon de morale, pas de personnage. C’est juste un décor qui fait la part belle à la nature. L’idée, c’est de témoigner de la virtuosité des sculpteurs qui parviennent
[Illustration : “Lions mordant des lianes”, vers 1120, sculpture]
[Marthe Pierot] : Regardez ce chapiteau, à évider complètement la corbeille. On creuse en 3D. On voit ces lions qui sortent presque de la matière finalement.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Et on pourrait penser qu’au risque de fragiliser l’œuvre parce qu’à force d’enlever la matière
[Marthe Pierot] : De fragiliser l’œuvre, de fragiliser le chapiteau et de fragiliser l’architecture effectivement, puisqu’on vous le rappelle, le chapiteau, c’est un élément d’architecture qui soutient une toiture. Donc c’est pour ça que les sculpteurs alternaient, comme on l’a vu justement, entre chapiteau rempli ou chapiteau évidé. Voilà pour justement ne pas créer de problèmes de construction.
[Illustration vue de la cathédrale Saint Etienne au XIIe siècle]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bien sûr. Alors on va ici donc parler de la cathédrale Saint Étienne. Donc vous avez ici sous les yeux le plan de la cathédrale au 12e siècle. C’est le siège d’un évêché. La cathédrale pour cette raison est la plus importante à Toulouse, même si on connaît davantage la Basilique Saint Sernin. Le cloître de la cathédrale Saint Étienne était le plus vaste de toute la France méridionale. 96 Chapiteaux au total, dont seulement 7 ont été sauvés. C’est à déplorer parce que vous allez voir en fait le caractère hautement esthétique de ces chapiteaux.
[Illustration : “La mort de Saint Jean-Baptiste”, entre 1120 et 1140, sculpture]
[Marthe Pierot] : Oui, Regardez, on va vous montrer un des fleurons de cette collection romane, un des chapiteaux de Saint Étienne. Donc on revient au chapiteau historié et Isabelle et moi on va vous raconter d’ailleurs l’histoire de ce chapiteau qui est décliné en plusieurs faces, qui raconte la mort de Saint Jean-Baptiste. Alors ici, on est sur une première partie, un côté où l’on voit un roi, on reconnaît que c’est un roi parce que, regardez, il a une couronne au-dessus, des habits sertis de pierre et de broderie, assis sur un siège qui attrape le menton d’une jeune femme. Donc le roi, c’est le roi Hérode et en fait il regarde la jeune femme, Salomé, qui vient juste de danser pour lui, pour son anniversaire.
Et le roi est tellement charmé par cette danse qu’il propose en remerciement de lui offrir ce qu’elle souhaite. Mais Salomé est bien trop jeune pour savoir ce qu’elle veut, donc elle demande conseil à sa mère et sa mère va lui demander la tête de Saint Jean-Baptiste.
[Illustration (autre face du chapiteau) : “La mort de Saint Jean-Baptiste”, entre 1120 et 1140, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors justement, de l’autre côté de ce chapiteau, on aperçoit Saint Jean-Baptiste dans une mauvaise posture, puisqu’on est en train de lui trancher la tête. Vous le voyez en fait un peu recroquevillé sur lui même en train de tomber. Et cette épée qui lui passe, par le cou sur la gauche du chapiteau. Mais ce qui nous interpelle, et c’est une chose un petit peu récurrente au musée des Augustins. Quand on parle du Moyen Âge, on voit souvent la chose suivante, c’est à dire qu’on voit un tout petit enfant et là vous voyez semblant émerger du dos de Jean-Baptiste, il y a un petit enfant qui est accueilli par les bras accueillant justement de Dieu le père dans le ciel. Et cela signifie qu’en fait Jean est mort. Mais sa vie continue puisque il continue de vivre au ciel. Et c’était tellement consolateur pour les fidèles au Moyen Âge, de se dire que après la mort, la vie continuait.
[Marthe Pierot] : Oui, c’est son âme, c’est ça.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est son âme. Exactement. Cet enfant n’est en rien un enfant, mais l’âme de Jean-Baptiste.
[Illustration (autre face du chapiteau) : “La mort de Saint Jean-Baptiste”, entre 1120 et 1140, sculpture]
[Marthe Pierot] : Et on termine cette histoire sur la face la plus importante du chapiteau où le sculpteur a choisi de conclure. Où là en fait, on aperçoit Salomé qui va enfin donner la tête de Jean-Baptiste. Alors ce qui est intéressant, c’est de comprendre et de voir comment le sculpteur nous parle du mouvement, nous donne l’illusion du mouvement, quelque chose de très dynamique comme un dessin animé. Regardez sur la droite, ici vous avez la petite flèche. Il y a le bourreau qui était en train de décapiter Saint Jean-Baptiste, la partie dont Isabelle vient de vous parler. Il est de nouveau représenté à côté comme un petit copier/coller et il donne la tête à Salomé. Salomé attrape la tête et elle est représentée encore une fois à côté et elle donne la tête à sa mère. On a vraiment ce jeu de copier/coller, on a ce dédoublement, ce fondu enchaîné qui permet justement de créer du mouvement, et ça c’est très habile de la part du sculpteur. Et puis on voit toute la préciosité aussi des drapés, des vêtements, des cheveux, qui est tout à fait exceptionnel. Par contre les visages, eux ne sont pas du tout individualisés. Encore une fois, tout est dans le corps et dans la gestuelle.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Je souriais alors que Marthe vous parlait parce que à regarder le plateau sur lequel se trouve la tête de Salomé, on avait l’impression déjà d’une partie de rugby. C’était déjà peut être un peu ça. Excusez-moi, je ferme la parenthèse.
[Illustration : “Saint Paul et Saint Pierre”, entre 1120 et 1140, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors à présent, on va parler toujours d’œuvres qui se trouvent, qui se trouvaient à la cathédrale Saint Étienne et nous allons parler donc de Pierre et de Paul. En fait, ici, il s’agit d’œuvres qui se trouvaient dans la salle capitulaire qui jouxtaient le cloître de Saint Étienne. Et ce sont des statues piliers dans la mesure où, et bien comme pour les chapiteaux qui coiffent une colonne, ce sont des soutiens d’architecture. Alors vous avez le personnage de Pierre qui se trouve à droite et on va zoomer un petit peu afin que vous puissiez le voir et reconnaître son attribut, qui est ce trousseau de clés qu’il porte dans sa main au niveau de son ventre. Voilà les clés que Marthe vous fait voir. Et puis il y a sur la gauche le personnage de Paul que l’on identifie à sa calvitie. Vous voyez cet immense front. Dans ces 2 personnages, pour ces 2 personnages, on peut parler d’une influence byzantine. Suite aux croisades en terre sainte, les comtes de Toulouse rapportent de nouveaux codes esthétiques dans leurs bagages et notamment, il y a comme un nouveau dress code. Et vous allez avoir et bien des vêtements bien sûr, mais aussi des anatomies puisque ces 2 personnages ont des corps extrêmement élancés, très fins, leurs torses sont très étroits et ils n’ont quasiment pas d’épaules comme des corps de jeunes filles. Leur barbe ciselée et très ondulée, et il y a également des galons de pierreries qui bordent leurs vêtements, et tout cela est véritablement le raffinement de Byzance. Les plis regardez comme ils jouent, et ils jouent d’autant mieux que le sculpteur donc a placé les jambes croisées, les jambes sont croisées en X, ce qui fait danser et bien les plis. Vous Notez également au niveau des visages que derrière les têtes il y a ces rayonnements comme un soleil qui permet de former l’auréole derrière Pierre et Paul. Donc il y a là vraiment une grande élégance.
[Illustration photographique, salle romane et vue générale sur les chapiteaux et l’installation Jorge Pardo]
[Marthe Pierot] : Oui et justement, pour sublimer toute cette collection dont on vient de vous présenter, en tout cas les grandes lignes, et bien, on va parler de l’installation de Jorde Pardo. Alors c’est un espace de 600 m² qu’il a entièrement revisité de manière inattendue et gaie. Son ADN à Pardo, c’est la couleur, vous l’avez bien compris. Alors qui est-il ? Et bien il est latino-américain.
[Illustration photographique, portrait de Jorge Pardo dans la salle romane]
[Marthe Pierot] : Il vit entre le Mexique et les États-Unis. Il est né à Cuba de parents Catalans. Donc voilà c’est un un peu un nomade. Mais ce qu’on sait c’est que dans les années 80, il étudie à l’école de Pasadena à Los Angeles. Et pour parler de lui et de son art, c’est important de vraiment mettre en valeur l’idée comme quoi c’est un artisan de tout ce qui l’entoure. Il va utiliser et détourner les objets du quotidien pour justement lui servir d’idées et d’art. Comme les lampes on va le voir. Et en plus de ça, il va questionner les genres. Il remet vraiment en question les hiérarchies et les valeurs esthétiques. Pourquoi ? Parce qu’il est à la fois designer, sculpteur, architecte, graphiste, scénographe. Bref, il met tout au même niveau pour lui. Et en faisant ça, il bouleverse le territoire des arts plastiques, il éclate les frontières traditionnelles. Et c’est un artiste de renommée internationale.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui. Alors comment est-ce que Pardo nous est arrivé à Toulouse ? Et bien c’est à l’occasion d’un festival d’art contemporain qu’on appelle « le printemps de septembre ». Nous étions en 2014 et il va donc à ce moment-là intervenir en France. C’est important de le dire parce que, et pour la première fois au musée de Augustin, parce que jusqu’à présent, il avait réalisé des choses dans les autres pays d’Europe, mais rien en France encore. Donc avant son intervention, comment se présentait la salle ? Et bien je pense que vous pouvez en avoir une idée. Parce que derrière notre artiste, vous voyez et bien cette moquette beige, ces colonnes d’un rouge Bordeaux un peu éteint, des bornes rosées qui rythmaient l’espace. Et vous aviez un espace dans lequel les visiteurs ne s’attardaient absolument pas.
[Illustration photographique noir et blanc, vue de l’ancienne installation de la salle romane]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bon, mais avant nous avions pire, entre guillemets. On avait dans cette salle et bien une mezzanine qui coupait complètement son volume et les chapiteaux étaient positionnés sur des trépieds métalliques. Voyez un peu acérés.
[Illustration photographique, salle romane et vue générale sur les chapiteaux et l’installation Jorge Pardo]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout ça n’est plus aujourd’hui puisque Pardo a réveillé la belle au bois dormant en quelque sorte. Et vraiment, la couleur n’est pas un contre-sens dans la mesure où Marthe a pu vous dire que c’était son ADN. J’aime bien cette expression. Mais c’est vrai qu’il a usé de couleurs. Et cela vraiment à juste titre, puisque à l’époque romane, tous ces chapiteaux que vous voyez si blancs étaient peints de couleurs extrêmement vives. Donc faire revenir la couleur, c’est un c’est un juste retour je dirais. Alors il vous propose et bien une démarche d’art total puisque du sol au plafond. Du plus lourd, vous voyez la lourdeur de ses colonnes jusqu’à ses lustres très très légers et bien il revisite l’espace.
[Marthe Pierot] : Exactement. Et justement, on va le décrire dans le même ordre du sol au plafond pour voir un petit peu ce qu’il a fait. Et donc à commencer par le carrelage qui est volontairement pâle et qui présente des motifs répétitifs et symétriques et qui permettent ainsi de creuser la perspective. Mais il a imaginé aussi les couleurs de ses 96 colonnes justement, qui sont entourées de bracelets ou de bagues colorées à différents endroits et qui répondent aux lignes sur les mobiliers le long des murs. Ces mobiliers qui ondulent, qui donnent une impression vraiment de mouvement et qui nous donnent l’impression aussi que tout vient enserrer cette salle. Et donc toutes ces lignes guident un petit peu notre regard. Et ce qui est très intéressant, c’est que rien n’a été placé au hasard. Parce que selon la position ou l’angle de vue que l’on adopte, on a l’impression que ces lignes vont converger, elles s’alignent pour créer une ligne de perspective comme on le voit très bien sur la photo. Et il y a plusieurs points comme ça dans la salle. Donc en faisant ça, Pardo rend réellement le visiteur acteur, il le sollicite et donc son œuvre est vivante. On peut parler d’art inclusif et participatif.
[Illustration photographique, détail des luminaires de l’installation Jorge Pardo]
[Marthe Pierot] : Quand on monte encore un petit peu, on a ces lampes. Justement, on fait un petit zoom ici, ces lampes feuilletées qui sont réalisées à l’aide de plexiglass où les pétales sont vraiment d’une découpe différente à chaque fois, et il y a autant de lampes qu’il y a de chapiteauxD donc ça c’est tout à fait intéressant.
[Illustration photographique, salle romane et vue générale sur les chapiteaux et l’installation Jorge Pardo]
[Marthe Pierot] : Et enfin, tout en haut, on a vraiment ces cordes, telles une jungle, qui viennent habiter la hauteur sous plafond. Donc c’est pour ça vraiment qu’on parle d’art total, c’est que tout a été vraiment repensé. On a cette idée de hauteur, la volonté de remplir entièrement l’espace.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait, donc on perçoit ces accents baroques de part les couleurs tout à fait flamboyantes, et c’est une vraie rupture avec la stabilité des colonnes. Il y a cette souplesse un peu partout. Il vient rompre vraiment avec la blancheur des chapiteaux, et c’est vrai qu’il a envie de remettre en lumière cet espace, de redonner à cet endroit et bien toute sa superbe. Parce que c’est vrai que avant lui, et bien la scénographie ne permettait pas de voir et bien la grandeur de cet ensemble, ni de le comprendre. Et pour le comprendre justement, il a su rythmer la salle au moyen de couleurs. Les couleurs des lustres nous permettent de comprendre les différentes zones d’intérêt. Le lustre que vous distinguez orange, celui qui est tout à fait au centre en haut de l’image, nous permet de comprendre que sous les lustres oranges se trouvent les chapiteaux de Saint Étienne. Tandis que sous les lustres verts se trouvent les chapiteaux de Saint Sernin. Alors que plus loin donc sous les lustres qui sont rouges et bleus se trouvent les chapiteaux de la Daurade. Et ainsi c’est clair,
[Marthe Pierot] : Voilà, il renforce la lisibilité de cette salle avec ce code couleur.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait.
[Marthe Pierot] : Tout à fait, mais c’est intéressant parce que c’est grâce à ça qu’on peut distinguer les espaces. Mais il n’a pas du tout touché aux chapiteaux. Ils étaient déjà positionnés ainsi. Donc c’est vraiment une scénographie, c’est à dire qu’il a mis en valeur et bien les œuvres. Comment elles étaient positionnées, elles étaient positionnées selon le choix des conservateurs. Mais lui, sans toucher ces chapiteaux parce qu’il en avait pas le droit, il a réussi à créer ces espaces là visuels. Et en fait c’est ça qui est intéressant dans son art, c’est qu’il avait carte blanche. Mais bien sûr le budget était limité et il ne pouvait pas toucher ces chapiteaux, donc il fallait redoubler d’inventivité.
[Illustration photographique, l’installation Jorge Pardo durant les travaux de mise en place]
[Marthe Pierot] : Donc ça a quand même demandé, cette installation, 6 mois de fermeture, pour pouvoir vraiment tout protéger, tout créer. Là on a une petite photo des travaux où on voit comment ils ont protégé les chapiteaux sans les déplacer avec ses petits casques de bois. On voit les lignes qui sont en train d’être peintes sur les colonnes, les câbles qui pendent. Donc on a ces 6 mois de fermeture. Mais on a aussi un mécénat de compétences. Jorge Pardo a fait appel à des entreprises locales pour l’aider à travailler sur ce projet afin justement d’utiliser différents matériaux et différents savoir-faire qui sont très spécifiques. Il est très attaché à l’artisanat traditionnel donc il n’a pas tout fait tout seul. Il a su s’entourer des entreprises et de leur savoir-faire. Donc c’est un réel partage au service de l’art.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors quand on réfléchit un petit peu, on se dit qu’il existe un réel dialogue entre le passé et le présent. Et c’est une chose dont on a déjà parlé. Mais c’est une chose récurrente puisque il a déjà pratiqué cela. Au musée des Augustins, c’est bien sûr des chapiteaux qui ont quasiment 1000 ans, repositionnés dans un contexte actuel. Mais on sait très bien qu’il est déjà coutumier du fait, puisque dès les années 2000-2008 il procédait ainsi.
[Illustration photographique, l’installation LACMA de Jorge Pardo à Los Angeles – 2008]
[Marthe Pierot] : Oui, parce qu’ici, vous avez donc 2 images qui vous présentent donc le LACMA, un musée à Los Angeles, où on voit Pardo, qui a réalisé des installations, des scénographies pour valoriser ses collections d’art précolombien. Et donc on retrouve sa signature. On a ces couleurs, on a ces lampes organiques, on a ces lignes obliques, ces accents un peu baroques. Et donc on comprend vraiment cette signature et cette volonté de voir des œuvres anciennes dans une perspective actuelle. En fait, Pardo casse vraiment le discours d’une œuvre figée dans son époque. Systématiquement.
[Illustration photographique, l’installation Hôtel L’Arlatan de Jorge Pardo à Arles – 2018]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Voilà. Avec Marthe, on avait très envie de vous montrer une réalisation récente puisqu’elle date de 2018. Et nous sommes en Arles. Depuis Toulouse il a eu envie en fait de continuer avec des réalisations qu’il nous propose en France. Et vous avez un lieu qui est un hôtel qui s’appelle l’Arlatan. C’est au départ un hôtel particulier de la Renaissance, et Pardo va complètement le repenser. Il va nous proposer quelque chose d’un peu kaleidoscopique puisque des salles de bains au placard, en passant par les escaliers, les bars, etc.. dans cet hôtel, il y a cette ambition là encore d’œuvre d’art totale. Donc vous voyez comme il a plaisir à repenser des lieux publics que sont les musées, les restaurants, les hôtels et souvent bien sûr en s’appuyant sur des bâtiments très anciens.
[Marthe Pierot] : Voilà donc on avec cette belle image, nous arrêtons notre partage d’écran et nous allons pouvoir du coup se retrouver pour conclure. Voilà sur sur cette petite présentation qui parlait à la fois de la belle et riche collection romane du musée et de l’installation de Pardo. Ce qu’on peut dire, c’est vraiment que le pari est gagné. Il y a une réelle satisfaction de la part des visiteurs. Quand ils entrent dans cette salle, il y a vraiment cette volonté de déambuler, de circuler et de rester. Isabelle vous l’a dit, l’ancienne scénographie n’invitez pas vraiment à cette déambulation. Là on a envie de regarder les chapiteaux et donc de prendre plaisir à y rester. Et ce qui est intéressant aussi, c’est qu’on a de l’art contemporain au musée des Augustins. Et finalement, c’est aussi le rôle du musée que de valoriser des artistes contemporains.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui mais alors la question qu’on peut se poser, c’est est-ce qu’il y a un télescopage d’époque ? Est-ce qu’il y a des œuvres anciennes parasitées ou dévalorisées ? Est-ce qu’il y a une provocation de la part de Jorge Pardo ? Est-ce qu’il y a dissonance, ou est-ce qu’il y a harmonie ? Tout est là, c’est le débat. En tout cas, on peut se dire qu’il brouille vraiment les pistes.
[Marthe Pierot] : Oui, et c’est un mariage subtil d’art, de design, d’histoire et d’architecture. Alors l’installation devait durer 3 ans, on vous le rappelle avec Isabelle, ça fait 7 ans et elle n’est pas prête de partir. La barre est placée très très haute de toute façon et dans le domaine de l’excentricité, de la couleur, c’est difficile de faire plus. Donc si l’installation qui reste quand même et bien temporaire est amenée à changer, on peut se demander ce qu’il y aura à la place. Peut être qu’on peut prendre le contre-pied et revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : De beaucoup plus simple mais ce serait triste. Je pense que ce serait triste.
[Marthe Pierot] : On perdrez un peu de gaieté. En tout cas, on a été ravi d’être avec vous pour cette conférence. On espère avoir eu un discours assez coloré à l’image de Pardo. Et puis on vous dit à très bientôt merci beaucoup.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : À bientôt pour une nouvelle conférence.
Le portrait
Le portrait
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Le portrait, que nous raconte-t-il vraiment ?”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2021]
[Marthe Pierot] : Bonjour à tous et à toutes.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Bonjour.
[Marthe Pierot] : Et merci de nous rejoindre pour cette conférence en ligne du musée des Augustins.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Marthe, Isabelle, nous sommes les conférencières du musée.
[Marthe Pierot] : Voilà et nous allons être avec vous pendant 30 minutes pour vous parler du portrait.
Exactement. Aujourd’hui nous allons parler de ce genre. Vous savez, il y a en peinture différents genres, il y a les natures mortes, les paysages et aujourd’hui, on a décidé de vous parler de ce genre. Alors je prends la définition pour être tout à fait certaine de vous dire les choses convenablement. Le portrait, c’est la représentation peinte auscultée de la figure humaine d’après un modèle réel pour traduire les traits les plus caractéristiques d’une personne.
[Marthe Pierot] : Alors on a aussi envie de se demander mais pourquoi est ce qu’on fait un portrait dans le temps ? Et bien déjà c’est pour garder le souvenir d’une personne qui a compté, laisser la trace de quelqu’un qui a été important. Donc il a une fonction de mémoire, le portrait, mais il peut aussi avoir une fonction plus politique quand il est là pour assurer la postérité ou la glorification de quelqu’un de très important. Et là on va plutôt parler d’un portrait dans une sphère publique.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, mais on peut se demander aussi quand cela commence-t-il ? Il y a une vraie chronologie dans l’histoire du portrait et c’est vrai que c’est une pratique très ancienne. On se questionne sur l’identité depuis les grecs, mais même depuis les égyptiens depuis la plus haute antiquité. Ce sont des personnages réels ou mythologiques que l’on va représenter. Mais comme vous le disait Marthe, on va les glorifier, on va les idéaliser, on va même les déifier, ça peut arriver. Et puis au Moyen Âge, qu’est ce qui se passe ? Et bien on a une relation un petit peu ambiguë avec l’image à cause du christianisme, nous le verrons ensemble. Mais on se rend compte qu’à partir du 16e siècle, c’est à dire de la Renaissance, et bien il va y avoir là et bien un retour en force du portrait. Parce que à cette époque-là, l’homme est au centre de l’univers.
[Marthe Pierot] : Exactement. Et après le 17e siècle, le 18e, le 19e, et bien ce sont vraiment des siècles où le portrait va se développer. Il va même se diversifier avec différentes catégories et styles. On va le voir ensemble et on va justement voir comment les peintres vont nous parler d’une personne. Qu’est ce qu’ils cherchent à nous dire ou à nous dévoiler de leur modèle ou parfois même d’eux-même ? Et c’est ça en fait ce sujet-là, que le portrait nous raconte vraiment. On va le voir ensemble dans les 10 visuels que nous avons sélectionnés.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Exactement.
[Marthe Pierot] : Alors on va faire un petit partage d’écran pour donc pouvoir vous présenter ces visuels là.
[Illustration : Anonyme italien du sud, “ Le christ en croix avec l’orant du Cardinal Guilhem Peire Godin ”, vers 1320, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : On va commencer tout de suite par cette crucifixion, c’est une œuvre du 14e siècle. Alors on vous a dit qu’au Moyen Âge, il y avait cette petite éclipse du portrait, cette relation un peu ambiguë, à l’image. On se méfie, on se dit que l’homme est un pêcheur, qu’il est plein d’orgueil ou de vanité, et que l’image par excellence, qui vaut la peine d’être représentée, c’est celle de Dieu. L’image de l’homme est imparfaite, on ne le représente pas. Mais bien sûr qu’on représente les plus puissants, les papes, les évêques et les rois. Mais ce ne sont pas véritablement des portraits de ces gens-là, ce sont des archétypes et on va identifier ces personnes à leurs fonctions. Alors si on regarde de plus près notre crucifixion, et bien on se dit qu’il y a en bas de la crucifixion un portrait. Que fait cet homme à cet endroit là ? Pourquoi est ce qu’il est là ? En fait, il est là en donateur. Il a fait quelque chose pour l’église des Jacobins de Toulouse. Il a financé le chevet des Jacobins de Toulouse. Donc c’est en donateur. Il offre à Dieu quelque chose. C’est un don sacré pour l’église. Il est le cardinal Godin. C’est un personnage important, mais voyez comment il est représenté. Il n’est pas tout seul, il est tout petit, agenouillé, d’une manière très humble, il est vêtu en dominicain, c’est à dire en noir et blanc, c’est sa fonction. Mais ce qui est intéressant, c’est de se rendre compte qu’à ces éléments impersonnels s’ajoute quelque chose de plus particulier. On sait, les textes le disent, qu’il était difforme. Et bien ici l’artiste du 14e siècle, un anonyme que l’on pense italien, nous le présente bossu. Et il y a là cette volonté de se rapprocher d’une ressemblance. C’est le début d’une fidélité au réel.
[Illustration : Philippe de Champaigne, “ Réception d’Henri d’Orléans dans l’Ordre du Saint Esprit par Louis XIII ”, 1634, peinture]
[Marthe Pierot] : Exactement. Alors on va continuer, on arrive au 17e siècle. On fait un petit saut dans le temps pour vous montrer ce portrait collectif ou portrait de groupe réalisé par Philippe de Champaigne. Nous avons 6 personnages qui sont très haut placés. On le voit à leurs vêtements et on y reviendra plus tard. Et on en voit un qui est à genoux qui est presque de dos. En fait il est en train de vivre un rituel, une cérémonie, il entre dans une communauté dans l’ordre du Saint Esprit qui est l’ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie. Et il s’agit de Henri d’Orléans. On a un petit peu l’impression qu’il entre dans une secte. Finalement, cet ordre là qui est extrêmement fermé et aussi très codifié très ritualisé, on le voit ici. On a beaucoup de personnages qu’on peut clairement identifier, mais celui dont j’ai envie de vous parler, c’est celui qui se trouve au centre, debout. On voit qu’il est sur quelques marches, il est plus haut que les autres, il a un chapeau avec une plume. Il s’agit du roi Louis XIII. Et regardez juste au-dessus, vous avez une colombe. C’est l’oiseau qui symbolise le Saint Esprit pour nous montrer que ce roi, il est roi de droit divin. Parce qu’on le rappelle, au 17e siècle, l’Église et l’État sont encore très très liés. Donc on a le roi, on a ses proches collaborateurs autour et regardez, ils sont tous traités avec la même précision, sans distinction. On peut reconnaître tous les personnages et ils sont tous très bien étudiés. Un petit peu comme une photo de classe. Tout le monde est au même niveau à par le roi qui est surélevé. Mais en tout cas, on peut vraiment parler d’un portrait collectif pour cette raison. On remarque aussi la richesse des étoffes, la préciosité et le rendu des matières, du velours, des soies, des broderies. Et puis on a une pièce qui est entièrement recouverte de tissu. Du sol au plafond, au mur en passant par les escaliers, tout est tissu. Et donc si on revient aux vêtements et aux broderies, regardez sur les vêtements que portent les personnages. Et bien il y a des petites flammes qui partent, qui semblent partir un petit peu de tous les côtés, qui sont brodées sur les vêtements. C’est l’ordre, c’est le symbole de l’ordre du Saint Esprit. Et on a également le symbole de la monarchie qu’on connaît très bien, qui se trouve à l’arrière ou même sur le sol, qu’est la fleur de Lys. Et puis, si on continue un petit peu dans la description de ces costumes, on remarque qu’on est parfaitement dans l’époque. Dans le 17e siècle, avec ses costumes très caractéristiques. Ces collerettes qu’on appelle les fraises, les collants, les chaussures. Et alors, il y a un détail qu’on adore avec Isabelle, c’est regardez le personnage qui est à genoux, Henri d’Orléans. Il a des petits chaussons par-dessus ses chaussures pour bien protéger le tapis justement, le tissu qui est en bas pour ne pas l’abîmer. Donc on aime bien voir ces petites pantoufles de chaussures. En tout cas, vous avez ici vraiment tout ce qui représente l’orgueil, la vanité de l’apparence. Ici, on ne cherche pas à être modeste. Comme tout à l’heure, on peut clairement dire aussi que l’habit fait l’homme. On comprend qu’ils sont importants. On a vraiment un très grand tableau d’histoire. Grand parce qu’il est déjà de très grande dimension, il fait presque 3 mètres sur 4, mais aussi parce qu’il est important, il parle d’un moment très important et il nous parle aussi de la monarchie et de l’alliance du trône avec l’hôtel et l’Église. Regardez, on voit l’hôtel à droite.
[Illustration : Hyacinthe Rigaud, “ Portrait de Michel Robert le Peletier des Forts ”, 1727, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Exactement. Alors je vous propose à présent de continuer dans cette veine de l’apparat avec le portrait de cet homme. Alors vous notez qu’ici cet homme est tout seul et qu’il occupe justement tout l’espace de la toile. Ici, un peu comme tout à l’heure, bien sûr, l’habit fait l’homme et tout nous parle de sa fonction. C’est un homme d’État doublé d’un juriste. Il sera contrôleur des finances et ministre d’État. Nous sommes sous Louis XV. Nous sommes donc au début du 18e siècle. Le peintre qui a réalisé cette œuvre s’appelle Hyacinthe Rigaud et on aime avec Marthe insister sur le fait qu’il est de Perpignan. Il est important de parler des peintres locaux et Hyacinthe Rigaud est le portraitiste très officiel de Louis XIV et des enfants du roi. Alors comment est ce que ce ministre est mis en valeur ici ? Regardez son vêtement, il est noir, mais c’est un noir qui est lumière puisque c’est un velours ou un satin qui renvoie la lumière. Voyez sa perruque. Cette perruque qui est ample et surtout qui est fraîchement poudrée. On aime ce détail. Regardez sur son épaule, il y a un dépôt de poudre blanche, ça veut dire qu’on vient de l’apprêter. Donc surtout il faut lui laisser cette poussière de poudre. Ensuite, regardez les dentelles au niveau des poignées, au niveau de son col. Ce sont des dentelles qui sont photographiques tant elles sont précises. Et puis tout ce décor. Il est assis sur un fauteuil de bois doré. Derrière lui, il y a une colonne cannelée de marbre. Au-dessus de lui il y a cette épais rideau de velours. C’est d’une théâtralité. On se sent dans un théâtre. C’est le cas de le dire ou dans un palais. Et puis il y a aussi des détails qui sont nombreux et qui disent encore son importance. La plume : au début du 18e siècle avoir une plume à la main, ça veut dire qu’on sait écrire. Mais qui sait écrire dans cette époque ? Et quand il écrit regardez son mot de lettres tout à fait à droite de la toile. Il tend un billet sur lequel il est noté « au roi ». Excusez du peu. Quand il écrit, il écrit au roi de France. Un autre détail avec Marthe nous revient. Derrière encore, vous voyez à droite du fauteuil au côté de la plume blanche qui est piquée dans l’encrier, il y a une cloche. Ça veut dire que sa lettre est écrite et qu’il ne va pas s’égosiller pour appeler quelqu’un afin que sa lettre soit livrée. Non, entre 2 doigts il va faire teinter la clochette et on va accourir pour livrer la lettre. Donc voilà, tout nous parle d’exception de cette personne d’exception.
[Illustration : Antoine Rivalz, “ Autoportrait devant l’esquisse de la chute des anges rebelled ”, 1726, peinture]
[Marthe Pierot] : Voilà tout à fait. Alors maintenant que vous l’avez bien en tête, ce beau portrait d’apparat, on vous propose de vous en montrer un autre qui est différent et on peut le jouer vraiment de comparaison quand on voit cet homme qui est à l’opposé de notre Peletier des Forts où là vraiment, on a un portrait qui est tout à fait dans la modestie, dans la simplicité. Regardez, les couleurs sont sombres, les vêtements de ce personnage sont terreux, très simples. Regardez la perruque. Il porte une perruque, mais alors elle est courte, plat et grise, beaucoup moins blanche et volumineuse que la précédente. Là, il n’y a aucun effet de théâtralité. On n’a pas de colonne de marbre, de rideau, de velours. Le décor est très sombre, le regard est baissé. Il y a peu d’éléments lumineux autour de ce personnage. Mais il y a quelques petits éléments quand même qui peuvent nous donner des indices pour comprendre de qui il s’agit. Regardez en bas à gauche, vous avez une palette avec des couleurs et des pinceaux. Derrière le personnage, vous avez une toile qui est probablement posée sur un châssis et on voit qu’il tient un crayon à la main. Il est en train de dessiner. Et bien il s’agit donc, vous l’avez compris, d’un peintre, mais il s’agit du peintre lui même, Antoine Rivalz, qui sait représenter. Donc il s’agit là d’un autoportrait. Alors Antoine Rivalz, c’est un peintre toulousain, un très grand portraitiste. Et il fait même partie d’une grande dynastie de peintres et d’architectes. Son père. Voilà on connaît beaucoup de Rivals ici. Là il est en train de représenter un dessin qui sera en fait le tableau pour la cathédrale de Narbonne « la chute des Anges rebelles ». Alors ce qui est intéressant dans un autoportrait, c’est que on voit vraiment ce que le peintre souhaite nous dire de lui. Comment il se voit lui même et comment il veut que les autres le voient. Et ici, avec simplicité, humilité et modestie, on le comprend tout à fait. Il est vraiment un petit peu presque en retrait. Et puis il faut se dire aussi que quand on n’a pas de commande ou qu’on n’a pas de modèle sous la main ou à disposition et bien on s’exerce sur soi-même. C’est un travail important. Et puis ça peut aussi être un travail et un exercice d’introspection très stimulant. Et c’est ce que faisait beaucoup Rembrandt d’ailleurs.
[Illustration : Francesco Solimena, “ Portrait de femme ”, après 1705, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, cette pratique là. Alors on continue et ici on cherche à vous montrer un autre type de portrait qui n’est pas tout à fait un portrait. Donc dans quelle mesure ? En fait, ici, on est au début du 18e siècle et c’est ce qu’on appelle une figure de fantaisie. Ça, c’est une nouveauté qui voit le jour, je dirais dès le 17e siècle. Et le peintre ici n’est plus contraint à la ressemblance. Il ne se dit pas qu’il est obligé de réaliser un portrait qui ressemble à une personne réelle. Donc ici, finalement, cette personne que vous avez sous les yeux n’a pas d’identité. Et c’est très rarement une commande. En fait, ici, le peintre est dans un espace de liberté et d’imagination. Il est donc tout à son inspiration. Il est porté par son inspiration. Il est dans le pur plaisir de peindre. On sent qu’il est fasciné par cette femme qui est peut être une femme réelle mais qui l’a tout à fait sublimée. Quelle est-elle ? Ça reste une énigme. En tout cas, le peintre, on le connaît, c’est Solimena. C’est un peintre de Naples. Un peintre qui s’illustre vraiment dans la catégorie du baroque italien avec vous le reconnaissez ses effets de matière autour de cette femme, autant les vêtements que le lourd rideau au-dessus d’elle. Mais quand on la regarde, ce qui est intéressant et ce qui participe aussi vraiment de la figure de fantaisie, c’est que il n’y a pas un dress code particulier. Quelle est l’époque ? On a un peu de mal à le dire parce que finalement, et bien ce sont des vêtements autour d’elle qui ne sont pas du tout ajustés. Donc on a un petit peu de mal à définir l’époque, et d’ailleurs il y a quelque chose d’un petit peu affriolant. Parce que un peu de vent ferait que rien ne tient. Elle serait peut être nue dans quelques minutes. Passons à autre chose. Ce que je voudrais vous dire c’est que regardez ce turban comme il magnifie son visage, l’ovale de son visage. Et regardez justement ses yeux qui se perdent au loin. Qu’est ce qu’ils regardent ? Nous n’en saurons jamais rien et c’est tout ce qui nous attire vers elle. Et puis sur la droite, vous avez cette église, cette fin du jour, cette lumière pauvre. On a quelque chose d’un petit peu dramatique qui couve, on ne sait pas, mais en tout cas la lumière nous interpelle. Donc ici, vraiment, cette femme au naturel, puisqu’il n’y a aucun bijou, voyez, il y a néanmoins à côté d’elle, une tasse, une perle. Est ce qu’elle est l’allégorie de quelque chose ? On ne sait pas, on ne sait pas, mais elle reste finalement la belle inconnue du musée des Augustins.
[Marthe Pierot] : Et c’est pour ça qu’on l’aime.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui, c’est vrai.
[Illustration : Pieter Verelst, “ Tête de vieillard ”, 1648, peinture]
[Marthe Pierot] : Alors on reste dans le mystère justement pour vous montrer ce visage, ce portrait. Mais cette fois-ci, Isabelle, on va changer de pays.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : On va grimper plus au Nord.
[Marthe Pierot] : Exactement. Là où nous étions, en Italie et bien on va arriver en Hollande pour vous présenter cette tête d’expression, cette tête de vieillard réalisée par Peter Verelst. Compliqué à dire. Mais on y est. Vous l’avez écrit, si jamais. Et en fait on a vraiment ici ce qu’on appelle une tronie. Ce qui va donner le terme de trogne en français. Ce sont vraiment ces visages de caractère très très fort. Et ce qui est intense ici dans ce visage, c’est de voir toute la couleur et la lumière, la manière dont elle est travaillée. Cette douce lumière blonde qui nous rappelle un petit peu les portraits de Rembrandt. Finalement, on pourrait dire que ce portrait est un petit peu rembranesque, on va utiliser ce terme là. Mais ce n’est pas pour rien, parce que le peintre, justement, est un peintre hollandais du 17e siècle qui étaient l’élève de Rembrandt. Donc on comprend tout à fait d’où il a puisé son inspiration. Alors on parlait de ce regard qui est très intense. Il est d’autant plus intense qu’il est très très noir, que le visage de l’homme est très clair et que le fond est très dilué. Il n’y a aucun élément autour qui va venir perturber notre regard. Tout est fait pour que le spectateur ne voit que cet homme ou ses yeux. Le reste est très très flou et donc ça c’était intéressant. Et puis Isabelle m’a fait remarquer tout à l’heure, ça c’est c’est bien on aime bien découvrir des choses, qu’il a – regardez – la ride du lion. Ce qu’on appelle cette ride du lion, ce petit sillon entre les 2 yeux. Cette ride au niveau des 2 yeux qui va encore plus venir souligner non seulement son regard, mais aussi le temps qui passe pour nous parler de la vieillesse, car c’est une tête d’un vieillard, donc on a envie de parler de ça. Ce qui nous dit de la vieillesse aussi c’est sa barbe. Cette barbe très très importante, grisonnante, mais qui est extrêmement bien travaillée. Regardez les poils, comment ils se sont vraiment séparés les uns des autres parce que le peintre a travaillé dans la matière, il a utilisé non pas les poils de son pinceau mais le bois du pinceau pour pouvoir gratter justement et créer ces différents poils de couleur blanche, blonde, voilà noire, on est dans plusieurs camaïeux et donc c’est tout à fait intéressant. Il est vraiment dans cette finesse de glacis. C’est vraiment ces couches de peinture diluées dans l’huile, et on a un réel effet de transparence. Il travaille la matière. Mais sinon on a très très peu d’éléments sur cet homme. On ne sait pas comment il est habillé, on ne sait pas qui il est. Il n’y a aucun attribut, il n’y a aucun élément de décor ni de contexte. Le mystère est là. Finalement, le peintre a juste envie de nous parler de ce visage qui l’a marqué, de ce regard qui l’interpelle. Ce n’est pas forcément une commande. Il souhaite juste nous parler de cette trogne finalement.
[Illustration : Philippe-Laurent Roland, “ Jean-Antoine Chaptal ”, 1802, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Exactement. Alors à présent on va parler sculpture. C’est vrai que les portraits existent bien sûr aussi en sculpture. On va parler 3D, 3 dimensions ou encore puisque c’est le terme donc consacré, on va parler ronde bosse. Alors c’est un exercice difficile de faire un portrait en sculpture puisque on va pas être aidé derrière le buste sculpté par le décor d’une ville, les bibelots d’une pièce qui pourraient nous parler du personnage. En fait, tout doit être sur lui. Alors ici, on a un ministre. Alors on dirait c’est très différent de ce qu’on a vu tout à l’heure avec le Peletier des Forts, vous vous souvenez, ce ministre vêtu de noir et portant perruque. Ici, on en est très très loin. En fait, on a un type de portrait qu’on qualifie de portrait au naturel. Et qui répond au code de ce qu’on appelle le portrait d’artiste. Ça veut dire que voilà un coup de vent a un petit peu ébouriffé ses cheveux, la chemise est ouverte sur sa poitrine, un peu débraillée. Il esquisse un sourire. Et d’ailleurs, Roland, le sculpteur, est celui qui va vous proposer de vraies études psychologiques et qui arrive à faire affleurer toute l’humanité de son modèle ici même, d’une manière, je dirais bienveillante et un peu poétique. Alors maintenant revenons au code vestimentaire du temps qui ont changé. On est en 1802. La révolution, je vous le disais, est passée par là. Et c’est vrai que les aristocrates à la lanterne, c’est à dire qu’ils sont pendus et le pouvoir au peuple, voilà un vent de démocratie à souffler. Et donc et bien exit ce qui est guindé, ce qui est posé, ce qui est coquet. On est dans le naturel. Quelques mots maintenant, de ce Chaptal que vous avez devant vous. En fait, il était médecin, il était surtout chimiste. Bref, c’était un scientifique. Il a été l’homme politique de Napoléon. Il a été ministre de l’Intérieur sous Napoléon. Et il a laissé son nom puisqu’on parle de chaptalisation. Cela consiste à ajouter du sucre dans l’alcool pour faire monter le degré d’alcool du vin. Alors pour nous au musée des Augustins, cet homme est très important. Pas que pour le vin, mais cet homme a fait voter un décret sur la naissance des grands musées de France. Et il est à l’origine de la création des 15 grands musées de France au tout début du 19e siècle, dont le musée des Augustins. Donc nous lui devons beaucoup.
[Marthe Pierot] : Voilà, c’est ça le musée de province. Tout à fait, et on est ravis de l’avoir.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors on va continuer avec un nouveau portrait.
[Illustration : Thomas Couture, “ Juliette ”, vers 1876, peinture]
[Marthe Pierot] : Exactement. On a ici ce visage réalisé par Thomas Couture. Donc on avance dans le 19e siècle et on garde un petit peu cette volonté d’avoir des portraits au naturel. On l’a vu en sculpture tout à l’heure avec Chaptal, mais là on le retrouve ici en peinture. On a ce côté spontané finalement, ce côté d’instantané qui fait vrai ici. Alors qu’est ce qui est naturel ? Et bien, en regardant cette coiffure, on a les mèches tout à fait rebelles, ce regard fuyant, ce visage pensif. On a même une petite cerne sur l’œil à gauche. Donc voilà ici on n’est pas dans cette idéalisation. On a un portrait qui est légèrement de 3/4. On voit qu’une partie du visage est dans l’ombre. Et ici, c’est un portrait qui représente l’élève de Thomas Couture. Elle s’appelait Juliette et c’était très important pour Thomas Couture de connaître ses modèles. Donc il représente beaucoup de portraits de personnes qu’il connaît ou qu’il côtoie, avec qui il a une relation particulière parce que c’est comme ça qu’il va chercher et trouver la vérité dans un visage. Et les portraits, c’est extrêmement important pour lui parce qu’il réalise beaucoup de portraits pour ensuite les placer dans des compositions à plusieurs personnages. C’est pour ça qu’on peut aussi parler d’une tête d’étude ici, parce qu’elle va lui servir par la suite dans des plus grands tableaux. Et pour Thomas Couture, c’est très important. Et je cite une citation qui est importante, qu’on aime bien vous dire avec Isabelle. Il dit : « Celui qui sait peindre une tête sait peindre un tableau », donc ça en dit long sur sa philosophie du portrait. Voilà donc on a cette petite Juliette qui est tout à fait attendrissante, qui est fraîche et délicate. Mais on a une peinture monochrome. On a vraiment quelque chose qui tourne autour des couleurs ocres. Le brun est très présent, mais ce n’est pas un dessin, on aurait tendance à le croire, mais c’est bien une peinture à huile et même s’il y a peu de couleur, il y a un jeu de lumière très intéressant. Une grande partie de son visage est lumineux et contraste avec la densité de ses cheveux très sombres. Pour finir sur Thomas Couture, donc vous l’avez compris, c’est un portraitiste très recherché. Il apprécie et travaille beaucoup le dessin. On lui reconnaît ce talent, mais c’est aussi un très grand professeur. Il a des qualités de pédagogue qui sont parfaitement reconnues et il a notamment enseigné à Manet. Et on vous en parle pas pour rien d’ailleurs.
[Illustration : Edouard Manet, “ Marguerite de Conflans ”, vers 1875, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Voyez l’excellence dans votre transition puisque à présent on va parler d’Édouard Manet avec ce portrait de Marguerite de Conflans. Alors ce qui est intéressant ici c’est les nuances. Alors bien sûr que Manet appartient à ce mouvement, à ce temps qu’on appelle l’impressionnisme, et il va faire rentrer tellement de lumière dans ses œuvres. Il fait la part belle au blanc, au blanc-bleu, et il capte la lumière par le biais du miroir, puisque la lumière est renvoyée par le miroir qui se trouve à gauche, mais également par les voiles du tissu. Donc cette clarté qui vient de l’extérieur vient inonder la pièce où se trouve cette femme. Et c’est vrai que il y a ici une préoccupation tout à fait impressionniste. Alors cette femme justement, Marguerite de Conflans, voyez, elle a un petit peu un visage à la Frida Kahlo dans la mesure où elle est très brune. Ici, son visage est un bel ovale, mais voyez, ses sourcils sont également très bruns, très marqués comme surlignées. Et cela contraste avec finalement des mains qui sont à peine esquissées, un profil qui se perd dans le miroir et un décor qui est assez fondu. Donc vous avez en fait cette opposition entre ce qui est très défini et ce qui est vaporeux et presque impalpable. Il y a ce petit côté, donc inachevé, qu’on appelle en italien le non finito que les impressionnistes aimaient beaucoup, ne pas fignoler à l’excès comme au début du 19e siècle. Donc regardez la ici accoudée peut être bien à sa coiffeuse dans une attitude de décontraction un livre à la main. Son vêtement est un vêtement d’intérieur, peut être un peignoir et si vous voulez c’est comme si on la saisissait dans son intimité puisque derrière c’est peut être bien son lit avec un oreiller posé dessus. Et nous on arrive. Elle est certainement tout à fait ravie de nous voir, vous voyez, elle a un sourire un peu un peu mutin très légèrement mutin. Mais en tout cas, c’est vrai quel est le moment du jour ? Est ce que c’est le matin ? Est ce que elle va se mettre à choisir une robe ? Quel sera son agenda dans la journée qui vient ? Finalement, on ne sait pas, on est là un petit peu dans un moment qui est suspendu. Mais ce qui nous intéresse c’est de dire qu’au 19e, quand on fait des portraits, on a beaucoup utilisé le cadrage ovale pour inscrire un portrait dans une verticalité. Ici Manet va détourner un peu le cadrage, le mettant à l’horizontal pour finalement faire entrer beaucoup plus que la personne puisque finalement tout le contexte autour d’elle nous parle d’elle. Et ça c’est audacieux, voilà, et ça c’est moderne.
[Illustration : Achille Laugé, “ Portrait de femme ”, vers 1894, peinture]
[Marthe Pierot] : Tout à fait et on termine avec notre dernier portrait. On continue dans cette modernité, donc on dépasse l’impressionnisme, on est dans le post-impressionnisme, on a presque ce qu’on appelle du pointillisme. On va y revenir pour l’expliquer, on a ce profil pointillisme et c’est très très moderne comme technique, mais à la fois l’utilisation du profil est tout à fait ancestrale et n’est pas forcément moderne puisque c’est quelque chose qu’on utilise à l’antiquité notamment pour inscrire les profils des empereurs dans les pièces de monnaie. Donc on a ce profil qui accentue d’ailleurs la sévérité de cette femme, regardez son regard extrêmement dur, ses cheveux sont tirés en chignon. Ca ajoute beaucoup à sa sévérité. Les sourcils sont épais, le nez est droit, les lèvres sont fines et pincées, on en a quelque chose de très sévère, de très rude. Et puis on a vraiment cette technique pointilliste qui vient aussi cribler vraiment son visage de touches de couleur. Alors le pointillisme qu’est ce que c’est ? C’est vraiment cette idée de juxtaposer des couleurs, des petits points de couleurs les unes à côté des autres, enfin les uns à côté des autres, et c’est notre œil qui va faire le mélange de couleurs. Mais on distingue vraiment les touches et regardez, les touches ne sont pas les mêmes à mesure que l’on va descendre. Regardez tout en haut, au niveau du front et du haut du chignon, les couleurs sont sombres, c’est du bleu foncé, du Bordeaux, presque du noir et les points sont très rapprochés. Et puis on va descendre. Les couleurs vont s’éclaircir et les touches vont s’aérer, devenir plus fines et légères, plus longues. Regardez son vêtement, sa collerette. On est dans le orange, le bleu ciel. On a beaucoup plus de blanc, beaucoup plus d’espace. Et quand on regarde au fond, on a encore un travail différent, une autre touche qui est représentée avec d’autres couleurs. En tout cas Laugé qui est un peintre né à Carcassonne – on aime bien aussi le dire quand les peintres sont proches de chez nous – il est très connu pour ces paysages justement tremblés qui ont ce pointillisme. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c’est aussi de voir dans ce qui est moderne, au-delà de la technique, c’est de voir comment Laugé nous parle d’une femme qui n’est pas du tout idéalisée. On n’est pas dans la douceur, on n’est pas dans les traits très fins, dans l’archétype ou dans l’idée qu’on pourra avoir d’une femme au 19e siècle dans les canons de beauté. Ici elle est très sévère, elle a les traits épais. Elle n’est pas dans l’idéalisation, et ça c’est moderne. Elle est très naturel aussi finalement.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Elle n’est pas dans la grâce.
[Marthe Pierot] : Voilà, mais c’est aussi, c’est ça ? Alors on va revenir à vous pour conclure.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui absolument, vous allez nous retrouver à présen. On a ensemble considéré 10 portraits du musée des Augustins et finalement on peut se reposer la question de l’introduction.
[Marthe Pierot] : Exactement la question que le portrait nous raconte t il vraiment ? Et bien, on a pu voir ensemble que justement un portrait nous disait beaucoup, nous parlait beaucoup du modèle qui était représenté, de sa vie, de sa fonction, de son histoire. En fonction des vêtements qu’il porte, en fonction du décor où il est placé, en fonction du contexte autour de lui. Donc on comprend des choses sur le modèle. Mais un portrait peut aussi nous parler du peintre lui-même. En fonction de la technique qu’il va utiliser, en fonction justement de la modernité qu’il va dévoiler ou déployer. Il nous permet de nous parler d’un contexte aussi. On a vu avant la révolution, après la révolution. Donc en fait, un portrait nous donne beaucoup d’indices sur le peintre, le contexte, l’époque et aussi le modèle.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Oui et en fait on s’est rendu compte qu’il y a vraiment une évolution technique, c’est à dire que les 10 visuels que nous avons proposés et bien diffèrent. Vous me direz, c’est normal, il y a plusieurs siècles qui les séparent. Mais on a commencé avec des portraits qui étaient sombres, qui étaient épais, qui étaient huileux, et on arrive à des portraits qui sont plus allusifs, plus clairs, plus légers. Alors en fait qu’est ce qui s’est passé ? Il se passe quelque chose de très précis. Il y a forcément une évolution au court du temps. Mais il y a aussi une date très importante qui est celle de 1839 et qui correspond à l’arrivée de la photographie. La photographie est son objectivité. Donc le peintre portraitiste se dit qu’il peut faire tout à fait autre chose parce qu’il ne fera jamais mieux que le photographe quant au rendu de la réalité d’une personne. Alors le peintre de portrait va employer d’autres chemins, on l’a vu avec Laugé dont Marthe vous a parlé. On va avoir cette notion de ressemblance à la réalité qui n’est plus si importante finalement. Et le peintre de portrait de toute façon, aura beaucoup moins de commandes.
[Marthe Pierot] : Oui donc ça change beaucoup. Et puis on a vraiment envie de d’ouvrir et de parler d’aujourd’hui aussi parce qu’on parle, Isabelle vous parle de la photo, et bien on a envie de se dire aujourd’hui en fait, qu’est ce que c’est vraiment un portrait ? Si on reste dans l’idée de la photographie, et bien la photographie aussi a beaucoup changé puisque aujourd’hui tout le monde peut faire des photographies. On a tous un appareil numérique ou un appareil photo sur notre téléphone et donc c’est très très facile et très rapide de réaliser des portraits. Et surtout on va pas demander, on va beaucoup moins demander aux gens de nous faire un portrait. Pourquoi ? Et bien parce qu’il y a ce qu’on appelle le selfie. C’est tout à fait générationnel, mais le selfie qui va justement permettre aux personnes de réaliser leur propre portrait. Donc finalement c’est très facile de faire son portrait et en plus ça nous permet de contrôler notre image, d’avoir la main vraiment sur l’image de que l’on a de soi. Donc on peut nous même le réaliser. On a les moyens, on a les capacités, on a les possibilités matérielles de faire son propre autoportrait finalement, donc ça change beaucoup. Et puis on est vraiment dans une époque où l’image est très très présente. On voit des portraits partout. Finalement on n’a plus les mêmes symboles autour du portrait.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Mais ça nous laisse un petit peu démunis parce qu’on nous a montré des portraits des siècles passés pour lesquels il fallait x séances de pause, des heures et des heures pour arriver à un portrait. Aujourd’hui en un clic, on a un portrait. Donc c’est vrai que c’est quelque chose qui nous déstabilise un petit peu parce qu’on se dit que finalement c’est très facile de faire un portrait aujourd’hui, à la différence dans les siècles passés. Mais ça ne banalise pas pour autant, c’est vrai, l’importance de l’identité que l’on veut garder, que l’on veut laisser. Donc voilà un vrai sujet.
[Marthe Pierot] : Tout à fait. En tout cas, nous avons terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour de prochaines conférences.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : On se retrouve bientôt.
[Marthe Pierot] : Au revoir
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Au revoir.
Le voyage en Italie
Le voyage en Italie
[Conférence en ligne du musée des Augustins sur le thème “Le voyage des artistes en Italie”, menée par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot, conférencières, 2021]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Messieurs dames, bonjour.
[Marthe Pierot] : Bonjour
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Nous sommes ravis de vous retrouver, Marthe et moi-même, Isabelle, les conférencières du musée des Augustins, pour une nouvelle conférence.
[Marthe Pierot] : Oui, et aujourd’hui nous allons parler d’Italie, plus exactement des artistes qui ont voyagé en Italie. On va voir ensemble justement comment les artistes qui sont présents au musée des Augustins ont été influencés par ce pays qui est une destination privilégiée. Pourquoi ils y sont allés et dans quel contexte ils ont fait ce voyage.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors je pense qu’on peut parler de cette irrésistible attraction dès le Moyen Âge. On sait qu’il y a des échanges entre l’Italie et la France. Et ces échanges, ce sont les professeurs ou les étudiants qui circulent. On sait que Bologne, dès le 11e siècle, est la plus importante et la première université d’Europe. Et puis Toulouse, ça sera le 13e siècle. Mais il y a ces échanges universitaires intenses.
[Marthe Pierot] : Exactement, et puis ça continue au niveau de la Renaissance pour d’autres raisons. La Renaissance, c’est le siècle de l’humanisme. On voyage au nom de la connaissance, on part à la recherche des vestiges de l’Antiquité, et donc là le voyage devient une véritable aventure initiatique, un voyage de formation qui s’impose pour les artistes. Un passage obligé où ils vont copier les antiques et par la suite copier les artistes de la Renaissance qui deviendront une référence.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors après au 17e siècle qu’est ce qui se passe ? Il y a une date très importante qui est celle de 1663. En fait c’est la création du prix de Rome qui récompense les meilleurs artistes de l’année. Ces artistes auront une bourse et la possibilité de se former en Italie pendant 2 ans, pendant 4 ans, quelques fois davantage. Et c’est vrai qu’ils auront leur lieu, l’académie de France à Rome, qui deviendra au 18e siècle la fameuse Villa Médicis. Cette date de 1663 est très importante.
[Marthe Pierot] : Oui, elle facilite vraiment le séjour des artistes français en Italie. Et puis il y a aussi le grand tour qui est vraiment à l’origine du tourisme d’ailleurs et qui va créer ou développer des itinéraires en Europe et surtout en Italie, pour permettre surtout aux jeunes gens de l’aristocratie, enfin issue de l’aristocratie cultivée, qui vont leur permettre de voyager pour parfaire leur éducation et donc de rencontrer des intellectuels, des financiers, des diplomates. Et donc dans ce grand tour, ce qui est intéressant, c’est que c’est un voyage qui ne va pas concerner uniquement les peintres justement. Et il trouve vraiment son apogée au 18e siècle.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors maintenant, pourquoi est ce qu’il y aurait plus d’art en Italie qu’ailleurs ? En fait, il faut remonter à l’empire Romain puisqu’on sait que cet empire était extrêmement puissant et très très vaste. Et Rome rayonnait. Puis il y a le fait que Rome est la capitale de la chrétienté, le siège du Vatican. Ça fait qu’en Italie, précisément à la capitale, à Rome, il y a tellement de gens puissants, de gens riches qui sont des commanditaires qui ont beaucoup d’argent. Donc les artistes affluent.
[Marthe Pierot] : Alors nous allons commencer notre partage d’écran pour vous présenter 10 œuvres du musée qui vont justement illustrer ces petits points qu’on a développé en introduction. Et c’est Isabelle qui va commencer.
[Illustration : Nicolas Tournier, “ Un soldat ”, vers 1630, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Alors messieurs dames, je vous propose de regarder cette œuvre de Nicolas Tournier qui s’intitule « Un soldat ». Nous sommes au début du 17e siècle. Nicolas Tournier est un homme de la Franche Comté. Il va quitter sa région natale et puis il va partir à Rome pendant 7 ans. C’est une importante période de sa vie, importante période de formation. Puis il va ensuite se fixer à Toulouse. Mais pendant sa période romaine bien sûr, il va se frotter aux nouveautés, notamment aux clairs obscurs du Caravage. Ses contrastes de lumière, qu’on appelle également le ténébrisme, vont beaucoup l’influencer, lui qui est un peintre de la retenue, un peintre du silence va donc introduire dans ses œuvres ses contrastes puissants. Ici, c’est le portrait d’un soldat, mais c’est plus un archétype. On ne connaît pas l’identité de la personne et on sait que Nicolas Tournier réaliser ses visages afin de constituer un ensemble dans lequel il puisait pour ensuite réaliser des tableaux à multiples personnages. Donc ici, vous voyez, ce personnage cherche à rentrer en communication avec nous. Regardez toutes les rides qui viennent sillonner son front qu’on retrouve dans pas mal de modèles du Caravage d’ailleurs, ces fameuses rides très réalistes. Alors le cadrage est serré et c’est vrai que ce personnage va pivoter sur lui-même, va dégainer son épée. Regardez sa bouche s’ouvre. On dirait qu’il est prêt à crier et c’est vrai qu’on a cette sensation d’immédiateté qui est servie par des très très intéressantes couleurs puisque vous avez les couleurs froides que sont le blanc et le gris métal de sa plume ou de son armure. Et puis ses couleurs bien plus chaudes que sont le roux orangé je dirais de sa barbe et de son vêtement. Donc une très belle harmonie de tonalité.
[Illustration : Valentin de Boulogne, “ Judith ”, vers 1625, peinture]
[Marthe Pierot] : Alors on continue un petit peu dans la même veine pour vous parler de Valentin de Boulogne qui comme Nicolas Tournier arrive à Rome à peu près à la même période en 1609. Et sauf que lui il va y faire toute sa carrière et meurt à Rome. Donc il ne reviendra pas en France. Et d’ailleurs il était le maître de Nicolas Tournier dont vient de vous parler Isabelle. Alors Jean Valentin de Boulogne est l’un des plus grands peintre caravagesque français. Et qu’est ce qui est caravagesque ici dans ce tableau que vous avez sous les yeux ? Et bien déjà le cadrage très très resserré. On l’a vu aussi un petit peu avec le soldat tout à l’heure. Et puis la lumière qui est dramatique. Et enfin le sujet qui est aussi, on va le voir très propre à Caravage parce qu’il s’agit de Judith et Holopherne. Nous sommes en Palestine au 6e siècle avant Jésus Christ et le général Holopherne opprimait le peuple de Judith. Et donc elle va arriver à ses fins, elle va réussir à se débarrasser du général et le décapiter. Et Caravage représente très souvent la scène où Judith est en train de décapiter le général avec sa servante avec beaucoup de sang. Il y a quelque chose de très violent. Et bien ici l’originalité réside du fait que la décapitation a déjà eu lieu. Et Judith ici a planté l’épée dans le crâne du général Holoferne. Mais il n’y a pas de sang. Mais la violence est quand même là évidemment, par rapport à cette scène. On sait ce qui s’est passé et l’expression très poignante de Judith nous marque et nous interpelle évidemment, elle est à la fois calme et mélancolique. Il y a quelque chose de très froid et de très grave dans ce regard. On remarque aussi toute la féminité assumée de cette jeune femme, avec tous les bijoux qu’elle porte, les boucles d’oreilles, les perles dans les cheveux, les broches qui attachent son vêtement. C’est pour nous parler aussi de sa stratégie finalement, parce que elle a séduit le général. C’est comme ça qu’elle est arrivée à ses fins, et donc c’est important aussi d’en parler sur ce tableau. Et puis sa robe aussi, elle prend énormément de place. Elle occupe pratiquement la moitié du tableau. On a tous ces plis qui sont bouillonnants, on peut parler de baroque des étoffes vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup d’étoffes, beaucoup de plis, et c’est très théâtral aussi d’être dans cette exagération là. Et c’est aussi très italien de réaliser ses drapés.
[Illustration : Charles de la Fosse, “ Présentation au temple ”, 1682, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors à présent, on va passer à un tableau tout à fait différent puisque ici c’est un tableau à plusieurs personnages. C’est un tableau qui est très très grand puisqu’il fait 3 mètres sur 4. Et on est ici devant une œuvre d’un artiste parisien, Charles de la Fosse qui est un des plus importants peintre de son temps. On est à la fin du 17e siècle. Il vous propose donc ce thème de la présentation de la Vierge. La présentation de Marie au temple. Alors c’est intéressant de dire que ce tableau était destiné à l’église du couvent des Carmes aujourd’hui à Toulouse. Si vous êtes toulousain vous connaissez peut être le parking cylindrique. C’est à peu près tout ce qui reste de ce beau couvent médiéval, donc ce tableau s’y trouvait. Mais revenons à Charles de la Fosse, il est parti en Italie grâce à une pension que le roi lui a accordée à la fin du 17e siècle le roi de France, et il va étudier là-bas Raphaël et les antiques. Il va donc séjourner à Rome, mais il va surtout séjourner à Venise. Et à Venise il va se frotter à l’art du Titien et au secret chromatique du grand peintre italien. D’ailleurs, Titien avait réalisé un tableau sur l’argument de l’escalier, vous voyez cette composition qui est importante de part l’escalier. Et bien il existe un tableau du Titien qui s’appelle la Vierge à l’escalier et on sait quand on le connaît qu’elle est la source de ce tableau pour Charles de la Fosse. Alors il y a ici 2 groupes très intéressants puisque vous avez sur la gauche Joachim et Anne, qui sont les parents de la petite Marie qui poussent et qui peut ainsi gravir les marches pour aller à la rencontre du groupe de droite où se trouve le grand prêtre et d’autres personnes qui l’entourent. Alors ce qui est intéressant, c’est de voir que sur la droite, les personnages sont très droits, un petit peu aidés par la verticalité des colonnes, notamment derrière le grand prêtre. Et sur la gauche comme le jeu de nuages, un petit peu mouvant, un peu ondoyant, vous avez les personnages que sont les parents de Marie qui sont courbés. Cependant, on aime dans ce tableau en fait, ce face à face impérieux entre la petite fille très digne, très droite, très responsable déjà d’une tâche qu’elle ignore encore, et qui va rencontrer le prêtre qui lui ouvre la main afin qu’elle gravisse les marches. Donc ce face à face est très fort dans je dirais un un tableau qui fait la part belle aux nuages, à la respiration par le ciel bleu.
[Illustration : Louis Joseph Le Lorrain, “ L’apothéose d’Hercule ”, 1760, peinture]
[Marthe Pierot] : Oui, c’est très solennelle. Alors on quitte ce tableau à l’architecture très classique et rigoureuse pour vous parler d’une architecture qui part dans tous les sens, qui est complètement baroque. Ici, vous avez sous les yeux une peinture illusionniste, un trompe l’oeil étourdissant réalisé par Louis Joseph Le Lorrain. Alors Le Lorrain, il gagne le prix de Rome en 1739 et c’est grâce à cette bourse et à ce prix qu’il va pouvoir aller en Italie. Il va rester 9 ans à Rome, on va même l’appeler le romain. Donc, c’est dire l’importance qu’il a accordé à cette ville et à ce pays. Et il est très, très influencé par le baroque italien, on le comprend ici. Donc là vous avez sous les yeux ce qu’on appelle un modelo, c’est à dire une version préparatoire, parce que cette peinture était destinée à être placée sur le plafond d’un palais. Et l’idée c’est de nous donner l’illusion d’une ouverture vers l’infini. Et c’est très complexe, très confus, parce qu’on ne sait pas où s’arrête l’architecture et où commence la peinture. Et bien ce n’est que peinture, tout est faux ici. Tout ce tableau est fait de fausses voûtes, de faux marbres et d’un faux ciel qui s’éclaircit à mesure que l’on se rapproche dans le centre. On a l’impression d’être aspiré ou happé vers ce ciel qui devient de plus en plus vaporeux et léger au milieu. Alors il y a une histoire aussi bien sûr. Il y a beaucoup de personnages qui sont représentés vus d’en dessous, donc déjà c’est très complexe, et puis qui ont vraiment des vêtements gonflés par le vent, donc il y a quelque chose de très léger. Mais l’histoire c’est l’apothéose d’Hercule. Hercule qui se situe sur le coin gauche inférieur et bien monte sur son char pour se rendre, après avoir réussi ces 12 très célèbres travaux, monte sur son char pour rejoindre le Mont Olympe et devenir un Dieu. Voilà l’histoire qui nous est racontée ici. Sur ce très beau trompe l’œil.
[Illustration : Jean Auguste Dominique Ingres, “ Tu Marcellus eris ”, 1811, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Nous continuons ici avec un autre très grand Prix de Rome, à savoir Ingres ce peintre de Montauban, cet enfant du pays qui va en 1801 obtenir le fameux prix de Rome. Et suite à cela il va séjourner en Italie pendant 18 années. Ce qui n’est pas rien. Il est pensionnaire pendant 18 années, mais c’est intéressant de dire qu’il va y retourner pendant 7 autres années pour être cette fois le directeur de la Villa Médicis. Donc au total, il aura séjourné 25 ans, un quart de siècle, là-bas. Ce tableau que nous avons sous les yeux nous parle d’un récit, c’est celui que fait le personnage de Virgile. Sur la gauche, vous avez ce personnage qui est en train de lire le récit de la mort de Marcellus. Marcellus, c’est le fils d’Octavie. Octavie c’est cette femme qui s’évanouit à la lecture de la mort de son enfant. Elle s’évanouit dans les bras de son frère Octave, qui deviendra Auguste, le premier empereur de Rome. Et puis dans l’ombre, cette femme qui a ce voile blanc sur la tête au centre, c’est Livie certainement la commanditrice du meurtre de Marcellus.
[Marthe Pierot] : Parce que quand on voit son regard on se dit que quelque chose n’est pas net.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Elle est inquiète, elle sait qu’elle y est pour quelque chose. Alors dans ce tableau, ce qui nous intéresse vraiment c’est sa romanité. Tout est à l’antique. On est au début du 19e siècle et ce courant qu’on appelle le néoclassicisme est tout à fait important. Le néoclassicisme, c’est une nouvelle fois le classicisme, donc de l’Antiquité. Alors quels sont les éléments qui nous permettent de dire que tout est à l’antique ici ? Et bien par exemple regardez le mobilier, les éléments qui permettent de donner la lumière, les petits meubles bas. Vous avez également les vêtements qui sont des drapés retenus certainement par des fibules ou des broches. Regardez les profils des personnages. Le nez est dans le prolongement du front. C’est très très à l’antique. Regardez les éléments de décor, la frise qu’on appelle une grecque avec ce motif rouge tout en bas du tableau au premier plan. Et puis vous avez cette présentation en frise justement aussi des personnages. C’est à dire qu’ils sont devant au premier plan, les uns à côté des autres. Donc ça c’est ce classicisme ici qui s’exprime parfaitement. Donc si vous voulez, ce Ingres est vraiment un homme qui s’est nourrit de l’Italie et qui nous propose ici un sujet extrêmement abouti.
[Illustration : Gaspar Van Vittel, “ La place Saint-Pierre à Rome ”, vers 1700, peinture]
[Marthe Pierot] : Oui, et alors je vous propose de sortir un petit peu de ce huis clos où la tension était palpable pour respirer et vous proposer un paysage urbain. On n’est à l’extérieur mais nous sommes toujours à Rome. Ici, c’est Gaspard Van Vittel, le peintre de ce tableau, qui réalise la place Saint-Pierre à Rome. C’est un peintre néerlandais qui lui va faire le Grand Tour. C’est dans ce contexte-là qu’il va voyager en Italie. Il va à Florence, à Venise, à Bologne, à Milan, à Naples et évidemment à Rome où il s’installe définitivement. Il va même aller jusqu’à italianiser son nom, il se fera appeler Gaspard Van Vittelli. Donc, au moment de ce Grand Tour, ce voyage précurseur du tourisme, et bien il va pouvoir se nourrir des villes italiennes et il va réaliser beaucoup d’œuvres qui ont un style, un genre particulier qu’on appelle le vedutisme. En fait, veduta en italien, ça veut dire vue et donc c’est un style en peinture qui permet de reproduire, enfin, qui offre la possibilité en tout cas de reproduire des vues de ville d’italiennes avec beaucoup de justesse et de précision et beaucoup d’objectivité. On le retrouve à Venise mais aussi à Rome. Et pour ça, les peintres vont s’aider d’un objet essentiel qu’on appelle la camera oscura, qui, à l’aide d’un petit miroir, permet au peintre justement de reproduire la ville avec une exactitude topographique. C’est un peu l’ancêtre de la photographie finalement, on peut se dire. Et c’est important de parler de ce tableau et de cet artiste parce qu’il témoigne vraiment du lien qui existe pendant très longtemps entre les pays du Nord et l’Italie où justement les peintres du Nord vont amener et utiliser leur savoir-faire et leur maîtrise des paysages et des détails pour peindre ces vues italiennes. Et donc c’est un genre qui plaît beaucoup parce que justement les anglais qui pratiquent énormément le Grand Tour, vont vouloir ramener un petit souvenir des villes où ils sont allés. Et l’avantage de ces vedutas, c’est que les formats sont très petits. Donc cette pratique a emporté et finalement et bien les anglais pouvaient ramener ces petits tableaux chez eux. C’est un petit peu comme une carte postale. Et Gaspard Van Vittel maîtrisait parfaitement le sujet. Il travaillait beaucoup pour les guides de voyage qu’il l’illustrait. Il fréquentait les imprimeries donc il avait vraiment tout à fait une maîtrise au niveau de ses représentations de paysages urbains. Et puis on reconnaît parfaitement à la fois cette ville et cette vie qui grouille au premier plan avec beaucoup de détails et de finesse. Et puis les 2 grands bras courbes de la place qui viennent enserrer les fidèles. On est vraiment dans la justesse ici.
[Illustration : Pierre Henri de Valenciennes, “ Campagne romaine ”, vers 1800, peinture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors on va rester dans le paysage. Mais cette fois, on quitte la ville et son côté un peu encombré parfois, pour se décontracter, puisque vous avez cette vue très ouverte avec ce ciel immense. L’auteur de ce tableau donc s’appelle Pierre Henri de Valenciennes et il est parfaitement toulousain comme son nom ne le mentionne pas. Donc il nous propose une campagne romaine qu’il a réalisée lors de ses longs séjours qu’il passe en Italie puisqu’il quitte Toulouse 2 longues fois pour l’Italie. Et ses voyages en Italie lui permettent d’être tout à fait imprégné de la lumière et de tout ce qui peut s’y passer, parce qu’on sait très bien qu’il se trouvait par exemple en Sicile en 1779 et qu’il a vu l’Etna cracher du feu. Et ça lui a donné l’idée d’un tableau qui se trouve au musée des Augustins. Un tableau c’est donc furieux. Mais ici, on est face à un tableau tellement calme. Un tableau qui est de tout petit format puisque il fait à peu près 50 cm sur 35 cm. C’est important de le dire parce qu’à le regarder, vous avez un sentiment d’espace extraordinaire. Et ce qui donne la notion d’espace, ce n’est pas la taille du tableau, c’est justement la composition et l’échelle. Voyez les toutes petites arcades de ce pont sur la gauche en bas, et les arbres effilés très fins, justement qui n’encombrent en rien le ciel et qui dégagent l’espace. Intéressant de dire aussi que Pierre Henri de Valenciennes avait cette vocation de pédagogue et il avait écrit un ouvrage qui s’intitule « Éléments de perspective à l’usage des peintres » pour bien inciter les élèves peintres à aller sur le motif, à sentir l’extérieur, à comprendre ce qu’on appelle la perspective atmosphérique. C’est à dire que plus on éclaircit le tableau à l’arrière, plus les distances et bien deviennent profondes. Voyez, au tout premier plan du tableau on a des tonalités sombres et à l’arrière plan, vous avez ce jaune qui aide bien sûr à nous faire sentir la profondeur de ce paysage. Ce qui est moderne aussi dans ce paysage, c’est qu’il n’y a pas du tout de personnage. On sait que Pierre Henri de Valenciennes aimait à créer des paysages historiques pour raconter des faits d’histoire. Mais ici il se permet de n’y mettre personne. Et c’est presque une abstraction. Donc c’est une modernité également de sa part.
[Illustration : Louise Joséphine Sarazin de Belmont, “ Naples vue de Pausilippe ”, vers 1850, peinture]
[Marthe Pierot] : Oui, et je vous propose de poursuivre dans ces paysages qui font du bien, très lumineux. Mais cette fois-ci, on change un petit peu de gamme chromatique. On est plus dans l’étang de bleu ici pour vous présenter ce paysage réalisé par Louise Joséphine Sarazin de Belmont qui était l’élève de Pierre Henri de Valenciennes et qui nous propose ici la baie de Naples plongée dans une douce lumière. Alors la lumière, c’est un sujet qu’elle travaille beaucoup lors de ses voyages. Elle cherche l’exactitude, la vérité de la lumière. On le comprend bien ici, mais c’est important de parler aussi de son caractère et de ses voyages, parce que quand on est une femme, ce n’est pas évident de voyager et l’Italie n’est pas ouverte ou accessible de la même manière qu’aux hommes. Déjà, pour vous donner un exemple très concret, le prix de Rome n’est pas ouvert aux femmes. Il faut attendre 1903. Donc quand on est une femme et qu’on veut faire le voyage en Italie et bien il faut prendre son baluchon et partir un peu comme une aventurière, c’est ce qu’elle fait et elle se rend à Florence, à Rome et à Naples. On le comprend bien, ici, elle nous propose une vue très très juste de ce qu’était Naples au 19e siècle. Donc on a cette baie, mais on a aussi le Vésuve que l’on voit au fond justement, avec cette petite fumée. Et on retrouve la perspective atmosphérique dont parlait Isabelle, le premier plan très sombre, et puis l’arrière plan qui semble se diluer, se dissiper et s’éclaircir. Donc ça, c’est tout à fait intéressant. Donc, Louise Joséphine Sarazin de Belmont nous parle ici d’une vie avec beaucoup de justesse, mais nous parle aussi d’une femme. Cette femme qui est en rouge, tout devant rouge et noir, qui était une de ses amies, qui était également la femme d’un grand peintre. Et à sa mort, et bien, Sarazin de Belmont décide de réaliser plusieurs tableaux pour lui rendre hommage. Et elle en fait ici une allégorie de la charité. Regardez, elle est en train de donner de l’argent à une famille de mendiants. Voilà donc là, ici, il y a de l’anecdotique contrairement au paysage avant où tout était silencieux.
[Illustration : Félicie de Fauveau, “ Buste funéraire de François Bautte ”, 1849, sculpture]
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Alors à présent, nous allons parler sculpture. Nous quittons ces 2 beaux paysages et nous allons parler de Félicie de Fauveau. Ici et bien elle vous présente cette très belle œuvre en marbre blanc qu’elle a réalisé avec beaucoup de douceur. Cependant, c’était une véritable amazone. Une femme qui s’habillait en homme qui avait une coupe de cheveux très courte, on l’appelait l’Amazone. C’est un personnage tout à fait engagé et notamment elle prendra part à l’insurrection vendéenne après la Révolution Française, en tant que monarchiste, ce qui lui vaudra 8 mois de prison. Et puis elle choisira l’exil justement. Elle part en Italie et elle va passer sa vie en Toscane. Et quelle est la matière noble de la Toscane ? Quelle est cette matière qui a été choisie par Michel-Ange pour ses plus belles œuvres ? Et bien c’est le marbre de Carrare. Et vous avez ici un matériau exceptionnel puisque en fait, il est blanc comme le sucre. Il est doux, extrêmement doux et pourtant il est d’une très grande dureté. Et ça n’est pas évident pour une femme de s’attaquer justement à ce matériau-là. Alors Qui représente-t-elle ici ? Et bien un petit garçon qui s’appelait François. Et lisez le mot qu’il y a au niveau du col de son vêtement. Vous lisez « Franciscus », et c’est ici en fait une œuvre commémorative. C’est certainement un enfant mort en bas-âge dont elle veut nous parler. Regardez la couronne mortuaire qui se trouve au bas de cette œuvre. Ce visage aux yeux absents s’inscrit sur cette coquille rainurée tout à fait comme durant la période de l’Antiquité on inscrivait dans les bustes des empereurs sur fond de coquillages. Donc ce qui est intéressant ici, c’est finalement la contradiction presque entre une femme qui était extrêmement intrépide et engagée et l’extrême douceur de cette œuvre que nous avons au musée des Augustins.
[Marthe Pierot] : Oui, qui ne reflète pas son tempérament de feu finalement.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait.
[Illustration : Auguste Rodin, “ Buste de Jean-Paul Laurens ”, 1882, sculpture]
[Marthe Pierot] : Et on continue avec la sculpture et on termine même pour vous présenter donc ce buste réalisé par Auguste Rodin. Rodin, grand sculpteur très important au 19e siècle. Là, nous avons du bronze. On quitte le marbre pour le bronze. Et ce qui est intéressant, c’est que Rodin a un rêve, faire le Grand Tour. Il va réaliser ce rêve en 1875. Il part en Italie réaliser ce Grand Tour, il a 35 ans. Déjà c’est intéressant, au 19e siècle, le Grand Tour fonctionne encore, c’est encore à la mode, et en plus c’est à partir de là que la carrière de Rodin va véritablement être lancée finalement. Il a 35 ans, donc il a une certaine maturité, mais à partir de là, on peut se dire que voilà, il a finalement réussi à trouver quelque chose pour ses œuvres. Il a réussi à trouver son inspiration. C’est un voyage qui l’a probablement secoué et donc il va enfin pouvoir exceller dans la sculpture à partir de là. Et notamment parce qu’il a pu découvrir les trésors de l’Antiquité et les œuvres des artistes qu’il admire tant qui sont Donatello et Michel-Ange. Et ici, on la comprend et on la voit, la référence à Michel-Ange, quand on voit toute la vibration de ce buste, le tremblement et la vivacité de cet homme. Alors cet homme, il est âgé, on le comprend. Regardez ses clavicules, sa peau fine, les pommettes saillantes, les paupières très fines. On a une petite calvitie, on a vraiment l’impression que cet homme est âgé. Il s’agit de Jean-Paul Laurens. D’ailleurs son nom est écrit au niveau du socle. C’était un ami de Rodin, également un peintre. Et au musée, on a des œuvres d’ailleurs de cet artiste. Et donc il nous parle de cet homme d’âge très avancé, mais qui a encore beaucoup de vigueur et de vie. Regardez le mouvement en fait de ce buste, avec cette épaule qui est avancée, la bouche entrouverte, les narines dilatées, la barbe encore en mouvement. Donc il est quelque chose de très fort. Et puis il y a aussi un aspect un peu d’inachevé, qui donne beaucoup de vie à l’œuvre. Regardez au niveau du socle, on a l’impression que le buste semble s’extraire en fait de son support. Finalement, il n’est pas tout à fait fini. On a encore les coups et les traces de doigts en bas, donc c’est ce qu’on appelle l’esthétique un peu du non finito et que Michel-Ange aussi avait pu réaliser. En tout cas, on a, si vous avez en tête les esclaves mourants de Michel-Ange qui se trouvent au Louvre, et bien ce sont des personnes qui sont encore emprisonnées dans le marbre et qui donnent l’impression qu’ils vont s’extraire de la matière, un petit peu comme ce buste que vous avez sous les yeux. Donc c’est dans ça qu’on a cette douce référence à Michel-Ange.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Tout à fait. Alors nous avons parlé de 10 œuvres du musée et à présent, nous allons vous proposer une petite conclusion.
[Marthe Pierot] : Voilà donc nous revenons. Voilà pour vraiment conclure sur ce qu’on vient de voir ensemble. On a bien compris qu’au fil des siècles l’Italie est un réel pôle d’inspiration artistique et un repère géographique pour tous les artistes afin de comprendre l’art et de se former. Et finalement, pour être légitime en son pays, et bien il faut passer par l’Italie.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai. Mais l’Italie aujourd’hui, où en est elle ? C’est vrai qu’elle n’est plus ce pôle d’attraction. Elle n’est plus cette référence. Cependant, on peut quand même insister sur le fait qu’il existe en Italie une véritable création, mais dans un domaine un petit peu différent. Et il est vrai que dans le design, le design industriel pour l’aménagement des bureaux, des hôtels, vous avez des artistes qui excellent dans le mobilier et la décoration. On a des noms comme Alessi qui propose des bibelots pour les cuisines. On a par exemple à Toulouse la boutique qui s’appelle Trentotto qui vous propose à la fois de beaux objets qui sont en même temps usuels. Donc il y a suffisamment de biennales à Venise et à Milan qui mettent véritablement en avant les créations italiennes actuelles.
[Marthe Pierot] : Voilà, mais c’est intéressant aussi de parler de la mondialisation pour vraiment comprendre que aujourd’hui, et même dès le 20e siècle, les pôles d’attraction artistique se développent un petit peu partout dans le monde. L’Italie n’a plus le monopole de l’art ou des rencontres artistiques. On connaît Paris, New-York et Berlin qui sont des lieux très très importants au 20e siècle. Le marché de l’art anglo-saxon avec Londres notamment est très réputé. Et puis on peut aller encore plus loin en Asie avec Tokyo, Singapour, en Amérique centrale, au Brésil. Voilà finalement chaque continent et chaque pays peut avoir aussi sa capitale artistique, en tout cas sa reconnaissance. Et puis il y a autre chose qui est intéressant, qui traduit vraiment cette volonté de diversifier les centres et les pôles culturels, c’est l’élection en Europe des capitales européennes de la culture. Chaque année 2 villes en Europe deviennent capitales de la culture européenne et deviennent un lieu de rencontres, un point de référence pour tous les artistes où l’art se diversifie également.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : C’est vrai, se diversifie parce qu’on ajoutera la photographie, la vidéo, le Street Art. C’est vrai qu’il n’y a plus que simplement la peinture et la sculpture comme ça a été le cas pendant des sièges. Il y a bien d’autres disciplines.
[Marthe Pierot] : Exactement. Voilà nous avons terminé, merci beaucoup de nous avoir suivies.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Merci à vous.
[Marthe Pierot] : On est ravies et puis on vous dit à bientôt.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : A très bientôt.
[Marthe Pierot] : Au revoir.
[Isabelle Bâlon-Barberis] : Au revoir.